|
|
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
Les dix derniers Numéros :
51 , 52 ,
53 , 54 ,
55 , 56 ,
57 , 58 ,
59 , 60 ,
61 , ,
| |
|
L'Hymne des Français d'Algérie
offert par Jean-Paul Gavino
EDITO
6ème ANNIVERSAIRE DU SITE
En six ans, j'ai vu défiler des centaines de millier de massages dont malheureusement je n'ai pas pu apporter à chacun des réponses, faute de temps et d'activités diverses.
J'ai mis en lignes des milliers de fichiers.
J'ai sorti 62 numéros de la Seybouse.
J'ai travaillé parfois des nuits entières.
Je ne me plains nullement de tout cela car j'en ai tiré une très grande satisfaction, un immense bonheur, le même que celui procuré aux lecteurs qui me l'écrivent souvent avec émotion. C'est même une fierté face aux ennemis de notre passé et de notre communauté. C'est aussi un hommage à nos ancêtres pionniers qui ont œuvré pour construire un pays.
L'ouverture du site de Bône était nécessaire car il y avait de graves carences que malheureusement ne comblaient pas les associations attachées bien plus à la fête et à leurs querelles pour savoir qui aurait les honneurs.
Ces carences étaient les récoltes, les conservations numériques et surtout la plus grande diffusion possible et gratuite de notre mémoire avec un outil comme Internet.
C'est certain, qu'un homme seul, ne peut pas tout faire. C'est grâce à tous les lecteurs qui me font parvenir des documents (dont je n'ai pas encore pu tout exploiter) ; des collaborateurs qui m'écrivent des rubriques ; des écrivains qui me permettent de diffuser leurs écrits ; grâce à tout cela le site s'est étoffé et qu'ensuite la gazette " La Seybouse" est née.
Tout cela demande énormément de travail, des heures passées au service de la communauté et implication dans des actions.
Il faut avoir une volonté de fer, un moral à toute épreuve, une patience asiatique. Et même si le dépit, causé par une minorité de malfaisants, me dicte souvent d'arrêter de me battre contre les moulins à vents qui n'ont pas le courage d'aller au charbon, la force de caractère reprend toujours le dessus grâce au soutien de milliers de lecteurs mensuels. Cela est la meilleure réponse aux détracteurs qui n'ont pas d'armes autres que la méchanceté, la diffamation ou les menaces.
Il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour faire connaître notre passé, notre pays qui est et reste à jamais l'Algérie dans nos cœurs, quoique en disent les pisses-vinaigre.
Grâce à la diffusion de notre passé, je reste convaincu que tous les sites contribuent à une œuvre de paix. Nos jeunes descendants qui ne veulent pas entendre parler d'associations regardent, scrutent les sites et s'intéressent ainsi plus à notre histoire qu'au sein même de leur famille. Il en est de même pour les Algériens qui découvrent une autre histoire que celle enseignée dans leurs écoles.
Là aussi, la lecture des nombreux messages, reçus d'Algérie, me réchauffe le cœur et cela se traduit par des manifestations extraordinaires d'accueil et d'amitiés lorsque les Pieds-Noirs retrouvent leur pays au cours de voyages de plus en plus nombreux.
Retrouver le pays, c'est rendre hommage à nos ancêtres sur leurs tombes, sur leurs réalisations, leurs lieux de vie ; c'est ne pas oublier ce que notre communauté a enduré ; c'est montrer au monde entier que le Pieds-Noirs n'est pas l'affreux colon honni par les faux historiens et donneurs de leçon qui ne connaissent rien du tout de l'Algérie, de ses mœurs et de ses mentalités ; ce n'est nullement faire acte de repentance, d'un coté comme de l'autre ; c'est se parler, se retrouver, évoquer les passés heureux et douloureux ; c'est retrouver nos racines et découvrir notre pays que l'exode nous a privé.
OUI, tout cela c'est en très grande partie, grâce à Internet qui rapprochent les hommes et tout le mérite en revient aux Webmasters qui ont osé en être les pionniers.
L'accomplissement de ce travail, ne pourrait se réaliser sans le soutien, la compréhension et la patience de nos épouses, bien souvent "patos" de naissance mais bien plus Pieds-Noirs de cœur que certains Pieds-Noirs.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui par leurs témoignages ; leur apport de documents ; leur permission de diffuser leurs livres ; nous permettent de faire ce "retour" dans le passé et qui marquera les consciences et les esprits, même les plus chagrins.
Et comme me l'a écrit un copain pour m'encourager à continuer ce travail:
Bats-toi, serre les poings et bats-toi,
Bats-toi, serre les dents et bats-toi,
Relèves-toi, il faut se battre pour la vérité,
Bats-toi pour la mémoire et la paix,
Bats-toi contre le dénigrement et l'infamie,
Bats-toi, car derrière toi sont tes amis,
Bats-toi contre ceux qui disent que tu perdras,
Bats-toi encore et encore, un jour tu gagneras.
OUI, battons-nous ensemble, c'est la paix qui en sortira vainqueur.
OUI la paix des cœurs, des âmes et tout simplement celle des hommes.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
|
|
RAPPEL La Saint-Couffin !
A UZES le 3 JUIN 2007
Communiqué de l'A.B.C.T
RETENEZ BIEN CETTE DATE 3 JUIN 2007
ET RESERVEZ-LA
Grand Rassemblement national des Bônois, Constantinois et anciens de Tunisie
Cher(e) Compatriote et Ami(e) de l'Est Algérien
J'ai le grand plaisir de vous annoncer, que pour la 41ème année, l'Amicale des Bônois, Constantinois et
Anciens de Tunisie du Gard, organise le grand rendez-vous national d'UZES. C'est donc le:
dimanche 3 juin qu'aura lieu la traditionnelle journée champêtre
Comme les années précédentes, c'est dans le cadre verdoyant
du camping municipal d'UZES, mis à notre disposition
par la Municipalité de cette ville, que nous vous accueillerons.
Le programme est le suivant :
8 heures 30 : Entrée libre et gratuite - accueil des participants.
10 heures 30 : Grand-messe en plein air avec la statue de Saint Augustin : Evêque d'Hippone. (si possible dans le recueillement et le silence)
11 heures 30 : Accueil des personnalités Gardoises et des représentants des amicales de rapatriés de toute la région.
12 heures : Repas tiré du sac.
15 heures 19 heures : Animations diverses avec comme d'habitude Jean Pierre PACE et son Saxo.
17 heures : Tirage de la tombola. 10 lots de grande valeur (prix du billet 1 Euro 50) Vous trouverez sur place : Boissons, merguez, Fougasse, pâtisseries orientales et café.
La recette des différents stands, nous permet de couvrir les frais de cette organisation (assurances - animation - sécurité - agencements etc.) Nous comptons sur vous pour les faire " tourner ".
Bônois, Constantinois, anciens de Tunisie, Pieds Noirs de tous horizons, amis et sympathisants, venez nombreux participer à cette journée, afin de retrouver des visages connus, d'échanger des souvenirs impérissables et d'assurer dans la joie et la bonne humeur le succès complet de cette manifestation.
Qu'on se le dise ! ! ! de bouche à oreilles ou par Tam-Tam....
Merci d'avance de votre participation
Le Président, J.P. ROZIER Cette journée nationale, Campagnarde et conviviale, se déroule au Camping Municipal d'UZES (dans le Gard).
Chacun apporte son "Couffin" ou sa "Cabassette",
sa petite table et ses chaises pliantes.
N'oubliez pas les verres pour notre éternel "Sirop de Cristal"
(se délecter avec modération entre copains)
|
|
| ECHOS et POTINS
N° 7 de novembre 1950
de M. D. GIOVACCHINI
Envoyé par sa fille
|
ON attend le premier de l'an et le vote d'une réforme électorale pour ouvrir la foire... aux slogans et aux promesses.
MM. MUNCK et FADA sont renouvelables en Avril.
M. MUNCK sera élu, car il a pour lui le sourire, les campagnes et l'armement complet de toutes les Coops.
Mais FADA ! Ah ! Le pauvre petit ! Il recommande son âme à Sainte-Anne et ne quitte déjà plus le Bureau de Bienfaisance.
* * *
CHARLES BUSSUTIL et mon ami Baptiste POMA, en exil provisoire au Sainte-Hélène font du travail en " profondeur "
Charlot veut la Colonne au Conseil Général et Baptiste se laisserait faire pour la Place d'Armes.
Et pourquoi pas.
On en a vu bien d'autres !...
On a même vu CADI Abdelkader délégué à l'O.N.U....
Il y a de belles journées à vivre pour des spectateurs amusés...
* * *
ON cherche des loupes, dernier modèle, pour l'Usine MOREY,
* * *
ROBERT l'Agile a enfin rougi de la boutonnière. Lui aussi ! Tout joyeux et ainsi fleuri il est parti pour son tour du Monde. Après avoir vu le Pape et Staline, il se rendra auprès du Pandit Nehru, pour régler le différend survenu entre le Tibet et la Chine.
Il n'a nullement besoin d'avion. Il voyage en chaland, c'est à dire sur ses propres pieds.
Robert, qui est Livournais, connaît le vieux proverbe " Chi va piano va sano ".
La Chambre de Commerce, l'Hôtel d'Orient et le vignoble de Lannoy ne souffrent aucunement de son absence.
Ce qui prouve qu'il n'est ni indispensable, ni même utile...
S'il ne revient pas vite, on enverra son ami! MUNCK, qui a de longues jambes, escalader le Tibet et l'Himalaya pour le retrouver.
* * *
SUR le bel annuaire des " sportsman " de la mer, on peut admirer la figure martiale du " Cocu Magnifique ", sur papier de luxe, S. V. P.
Veston noir et pantalon blanc, probablement. Officier de Marine ou inspecteur d'autobus ? Non, la casquette blanche est plutôt celle du légendaire Chef de gare.
Etre cocu, n'est qu'un accident banal dont peuvent être victime bien des époux modèles.
Mais, être cocu et content, c'est bien plus grave.
Il aurait mieux fait de se présenter à ses concitoyens en maillot jaune.
Vous verrez que, malgré tout, Saint-Joseph le fera admettre au Paradis par priorité.
La belle " Offensée " l'attend avec un éclatant vocabulaire et de fines lanières en peau de zébu.
* * *
JACQUES AUGARDE... prend garde. René MAYER et PANTALONI voudraient bien débarquer le député de Bougie.
Mais ce dernier, spécialiste des figues et des dattes, réserve, le cas échéant, une désagréable surprise à ses colistiers.
* * *
CHICARELLOU nous écrit de La Calle pour nous dire que sa petite ville se meurt de l'amour que les Callois ont pour FRANCIS.
Ni eau, ni écoles !
ET, Joseph a perdu sa garnison. Nous publierons cette lettre dans notre prochain numéro.
* * *
A l'heure où PANTALONI promet la " Place d'Armes " à NATAF, ON (vous devinez qui !) fait pressentir MM. ISTRIA et JOURDAN pour le même fauteuil.
C'est beau !
* * *
SI vous voulez visiter les châteaux de la Loire, demandez d'abord au cicérone si aucun indiscret n'a passé le pont-levis !
|
|
LE PLUSSE DES KAOULADES BÔNOISES (48)
|
|
J'EN AI VU TRENTE SIX…
J'en ai vu trente six, diocamadone, pas des étoiles, non ! des bônois et des bônoises bien sûr qu'y z'ont débarqué ce 15 avril d'une avion qu'elle venait direct de Marseille, tu sais, cette ville de Patosie qu'elle est juste en face Bône, de l'aut' côté d'la mer.
Trente six qu'y z'étaient, j'te dis, trente six qu'y sont venus avec leur accent comme au premier jour, un accent qu'y z'ont pas réussi à le perde malgré des z'années passées à en apprende un aut' et qu'y z'ont jamais réussi. Y avait Jean-Pierre, Jeanine, Christian, Noelle et les z'aut', tous les z'aut que, bônois y sont et bônois y restent pasqu'y z'ont juré de le rester à preuve, y sont revenus vérifier si que leurs racines elles sont toujours en dedans cette terre qui les z'a tous vu naître, cette terre que leur cœur y s'la jamais quittée laissant leur corps aller se promener partout à travers toute la Patosie pour apporter à ce pays, le pauv' et à son peupe, le pauv' aussi, un peu de not' civilisation nourrie à la mona et au couscous qu'il a venu à force, main'nan, le plat préféré des patos.
Trente six qu'y z'étaient, trente six venus de partout, même de la Réunion, tu sais cette île qu'elle est tellement loin là-bas, de l'aut' côté des mers qu'à de bon, chais même pas aousqu'elle se trouve à cause, que ma géographie à moi elle a jamais très bien marché, elle a toujours été en panne sèche comme la pointe de mon stylo qu'à ce sujet, elle a jamais voulu tracer un seul mot dessur ma feuille de composition.
Trente six qu'y z'étaient, trente six que bône elle s'les z'a reconnus tous et tout de suite et qu'elle les z'a accueillis à bras z'ouverts avec le sourire en plusse, un sourire accroché à la fugure du soleil qu'il a venu s'afficher dessur la ville, là-haut dedans le ciel et ce soleil-là, diocamisère, y valait bien l'or de sa couleur, une couleur jaune comme celle du maillot qu'y s'le porte le premier du tour de Patosie.
Trente six qu'y z'étaient, j'me répète, mais c'est toujours les mêmes, trente six qu'y te formaient un seul bloc mais un bloc avec trente six corps, trente six cerveaux différents, trente six personnalités mais une seule et même amour dedans le cœur et si que tu devines pas laquelle, c'est que bababouk t'y es et babalouk tu restes à cause, que cette amour qu'elle est pas aveugue, c'est leur ville natale, la seule dedans ce triste monde qu'on s'l'appelle la coquette, la bien nommée Bône que, si tu ois son cimitière, l'envie de mourir y te donne.
Rachid HABBACHI
|
|
|
| LES JOURNAUX
BÔNE son Histoire, ses Histoires
Par Louis ARNAUD
|
BÔNE est après Alger, la ville où parut le plus ancien journal d'Algérie.
C'est, en effet, en 1843, que fut publié par l'imprimeur Dagand, " La Seybouse " qui portait en sous-titre " Journal de l'Est algérien " et s'offrait aux " annonces administratives ", judiciaires et commerciales des Provinces de Bône, Philippeville et Constantine.
II paraissait trois fois par mois, les 4, 14, et 24, sur quatre pages, réduites à un demi format de journal ordinaire actuel, chacune divisée en trois colonnes.
L'abonnement coûtait quatorze francs par an et le prix du numéro était de cinquante centimes.
L'imprimerie de Dagand fut longtemps Place du Commerce, alias place de la Marine, ou du Général, juste en face de la Subdivision.
Elle vint ensuite au numéro II de la rue Perrégaux dans un immeuble, aujourd'hui occupé par l'Hôtel de Nice, dont le propriétaire était alors M. Térigi, Capitaine du port de Bône, arrière-grand-père de la célèbre vedette de cinéma, Danielle Darrieux, qui a donc une ascendance nettement bônoise, et pour finir, Place Alexis Lambert, à l'angle des rues Marcel Lucet et des Santons, aujourd'hui rue Pasteur Meyer. Cette imprimerie est aujourd'hui communément appelée " Imprimerie Thomas ", du nom du successeur de Dagand, Emile Thomas, qui était son propre neveu.
Peut-être pourrait-on retrouver dans le vieux matériel de cette imprimerie, plus que centenaire, des formes, des casses et des caractères ayant servi à composer, dix ans après la venue des Français en ce Pays, ce vieux journal qui a tant contribué à rendre supportable le séjour de notre cité naissante et qui n'a jamais cessé de proclamer sa foi profonde dans sa prospérité future.
L'action bienfaisante de la " Seybouse " sur le moral de la population, aux premiers temps de l'occupation est indéniable.
C'est par la lecture de ce vieux journal que l'on peut aujourd'hui revivre la vie des premiers habitants de Bône, suivre les fluctuations de leurs espérances et connaître leurs passagères déceptions.
***
C'est en 1877 que, pour soutenir la candidature de Gaston Thomson, fut créée la "Démocratie Algérienne ", premier journal quotidien bônois.
La " Démocratie Algérienne " eut divers rédacteurs en chef dont certains firent ensuite carrière dans l'Administration coloniale.
Car, on le sait, le journalisme mène à tout, à la condition d'en sortir, ainsi que l'a dit Emile de Girardin.
Avec Gaston Thomson, la porte de sortie du journalisme était toujours ouverte sur le chemin des Colonies.
Il est vrai que c'était l'époque de la grande entreprise coloniale de Jules Ferry qui a donné à la France, après le désastre de 1870, un si grand rayonnement à travers le monde.
La troisième République portait aux quatre coins de l'Univers, chez les peuplades les plus sauvages, et les plus frustes, les bienfaits de la Liberté et le Flambeau de la Civilisation.
François, l'un des premiers rédacteurs en chef, sinon le premier de ce journal, se trouve Consul de France en Chine, en 1900, lors de la guerre des Boxers.
L'ancien rédacteur en chef de la " Démocratie Algérienne " eut, en cette occasion, une belle conduite qui lui valut d'être nommé Gouverneur général de la Guyane Française, et de rentrer ainsi dans le cadre colonial, si cher à Gaston Thomson, dont il avait, jadis, à Bône, soutenu la candidature.
Puis, ce fut Louis Vernin qui abandonna, bien tard, son fauteuil directorial et sa plume pour entrer, comme Sous-Préfet, dans l'Administration.
Après Louis Vernin, le poste de rédacteur en chef de la " Démocratie Algérienne " fut confié à l'un des plus brillants journalistes algériens, François Beuscher, polémiste ardent et distingué, qui maniait aussi bien la plume que l'épée, et qui ne manquait ni d'esprit, ni de courage, ni de talent surtout.
François Beuscher, lui n'est pas sorti du journalisme. Il a dirigé, depuis, de grands journaux dans la capitale algérienne.
Après François Beuscher, André Servier, rédacteur en chef du grand quotidien du chef-lieu, la " Dépêche de Constantine " fondée par Louis Morel, entreprit avec Mathieu Mariani, imprimeur de la " Démocratie ", de transformer la vieille feuille de combat bônoise, en grand journal d'information.
C'est ainsi qu'est née la " Dépêche de l'Est " qui eut André Servier, écrivain de talent et arabisant distingué, pour premier rédacteur en chef.
La " Dépêche de l'Est " a conservé, en sous-titre la vieille manchette de la " Démocratie Algérienne ", ce qui lui permet d'en être à sa quatre-vingt-unième année d'existence.
La " Démocratie Algérienne " qui menait une campagne politique opportuniste, groupe auquel appartenait la représentation parlementaire du Département de Constantine, avait à Bône des adversaires qui, pour n'être pas négligeables n'avaient cependant pas son importance.
Le " Courrier de Bône " chronologiquement se place au premier rang de ceux-ci.
Ce journal combattait l'opportunisme en général, et, en particulier, Jérôme Bertagna et ses amis.
Le " Courrier de Bône " qui était la propriété de l'aimable et souriant Philippe Puccini, maître imprimeur, eut longtemps, comme rédacteur en chef, Charles Taupiac, publiciste excellent, qui avait la peinture comme violon d'ingres.
Ce goût de la peinture et cette habileté dans les nuances se retrouvaient dans les polémiques du rédacteur en chef. La lutte du " Courrier de Bône " contre le Bertagnisme était, en effet, à l'eau de rose, bien plus qu'au picrate.
C'est du " Courrier de Bône " qu'est partie, inventée par son rédacteur en chef Charles Taupiac la fable du serpent monstrueux du Lac Fetzara qui fit à Bône, et dans la région, une carrière semblable à celle du fameux monstre du Lac Ecossais Loch Ness.
Si le " Courrier de Bône " menait contre le Bertagnisme une lutte des plus nuancées, " La Liberté ", de Théodore Celerin, prouvait que le picrate était insuffisant pour Jérôme Bertagna et sa " clique ".
C'était un petit journal que dirigeait un ancien principal clerc de notaire, autrefois condamné, par la Cour d'Assises de Bône, pour un attentat à la pudeur qu'il affirmait n'avoir jamais commis.
II accusait des gens de l'entourage, et même de la famille, de Jérôme Bertagna, dans laquelle il avait été reçu, d'avoir fomenté de toutes pièces cette monstrueuse accusation.
Revenu du bagne, il n'avait eu qu'une seule préoccupation, poursuivre sa réhabilitation complète.
Il avait, ne pouvant plus être notaire, fondé " La Liberté " dont les bureaux et l'imprimerie, au bas de la rue Vieille Saint-Augustin, voisinaient avec ceux du " Courrier de Bône ".
" La Liberté " était naturellement dirigée, contre Jérôme Bertagna.
Théodore Celerin, quoique ancien bagnard, jouissait dans la ville d'une réelle estime de la part de gens honorables et bien pensants.
Etait ce parce que ces gens honorables et bien pensants croyaient en son innocence et à l'abominable machination dont il prétendait avoir été la victime ?
Ou bien, était-ce, tout simplement, en vertu de ce principe, qu'une même inimitié rassemble, souvent bien mieux que l'amitié, que tous ces gens, dont la presque unanimité était opposée à Jérôme Bertagna, s'étaient groupés autour de Théodore Celerin ?
Celerin, au surplus, savait parfaitement écrire, mais il savait mieux encore attaquer les Bertagna (ils étaient trois frères Jérôme, Dominique et Gustave) ayant été, jusqu'à sa condamnation, admis dans l'intimité de leur famille.
C'était un adversaire redoutable pour le Maire de Bône.
" La Liberté " finit avec Celerin qui mourut sans avoir pu obtenir la révision de son procès.
Il eut pour ses amis, et, pour d'autres aussi, l'auréole du martyre.
***
Dans le même temps, le " Petit Bônois " qui s'imprimait chez Pompéani et Sollacaro, dans la rue de l'Arsenal, combattait aussi, avec une virulence extrême, et non déguisée, la politique du Maire de Bône.
Ce journal, venu ensuite installer son imprimerie et sa direction dans le passage Bronde, avait modifié son titre pour devenir le " Bônois " tout court.
Il avait acquis une certaine vogue dans le public, lorsque sa carrière fut gravement ébranlée par un fâcheux événement. Son rédacteur en chef, Pierre Omessa, par un après-midi de printemps, 1890, commit, en effet, un double homicide sur la personne de sa femme et celle du Lieutenant Darrier-Chatelain du 3ème Tirailleurs, dont il était l'ami.
Ces deux crimes n'avaient pas été commis, comme on pourrait le penser, simultanément et spontanément.
Non. Pierre Omessa avait déjà déchargé son revolver sur sa femme qui prenait son bain, dans le cabinet de toilette de leur appartement, situé au deuxième au-dessus de l'entrée du passage sur le Cours, lorsqu'il arriva, d'un pas relativement tranquille, à l'Hôtel Négro dans la rue Beaucaire où logeait son ami, le Lieutenant Darrier-Chatelain.
Là ; après un colloque échangé sur un ton amical, Pierre Omessa avait sorti brusquement le revolver encore chaud qu'il avait dans la poche de son veston.
Le malheureux officier put à peine esquisser un geste de défense en se servant d'une chaise. Il fut abattu par Pierre Omessa qui alla ensuite, se constituer prisonnier.
On imagine l'émotion provoquée en Ville par ce double drame.
Les Tirailleurs qui adoraient leur chef furent aussitôt en effervescence, et c'est à grand peine qu'on put éviter de plus graves désordres.
Pierre Omessa comparut devant la Cour d'Assises de Bône, défendu par Maître Forcioli, ancien sénateur du Département, et, alors, Député de Bône.
Ayant bénéficié d'un acquittement, Pierre Omessa quitta Bône, et la direction du "Bônois ", pour aller se fixer à Tunis, où il devait mourir très âgé.
Après le départ de Pierre Omessa, le " Bônois " poursuivit péniblement sa route, avec un prestige bien diminué.
Il eut, comme rédacteur en chef, un certain Grégoire qui avait du talent, mais qui avait le tort de succéder à Pierre Omessa.
Depuis l'affaire Darrier-Châtelain, les militaires de la ville ne prisaient plus, et c'était compréhensible, le journal " Le Bônois " et sa rédaction, qui évoquaient en eux, en toute occasion, le douloureux drame, qui avait endeuillé la garnison.
Ce fut le Capitaine de Cassagnac du 3ème Chasseurs d'Afrique qui se fit le Champion du souvenir.
Cet officier, qui était, disait-on, le frère du célèbre polémiste et duelliste, le député bonapartiste Paul de Cassagnac, provoqua Grégoire en duel.
Au retour de l'Orphelinat, où Grégoire avait été blessé, les amis du Capitaine affirmaient que le journaliste portait, sous sa chemise molle, une cotte de maille légère.
Le Capitaine de Cassagnac, comme son frère, avait la réputation d'être un escrimeur redoutable et dangereux.
Après cet incident, Grégoire disparut de la Direction du " Bônois ", qui passa à Georges Gobillon, sympathique et excellent journaliste.
Hélas, le mal était fait, et il était irrémédiable, dans le moment, du moins.
L'affaire Omessa : le drame d'abord, les tractations avec les Bertagnistes, ensuite, et le comportement du rédacteur en chef, Grégoire, avaient ruiné le crédit et l'autorité du journal qui finit, dans l'indifférence, et même la réprobation, une carrière qui avait été courageuse et presque brillante parfois.
Le " Bônois ", ne pouvant plus être un journal d'opposition à Jérôme Bertagna, n'avait plus sa raison d'être à Bône, car la " Démocratie Algérienne " suffisait largement à chanter les louanges du Maire de Bône et de ses amis.
Le " Réveil Bônois ", venu se mêler aux choses de la politique locale depuis trois ans à peine, allait devenir le leader de la critique et du mécontentement de ceux qui en voulaient aux maîtres locaux de l'heure, quels qu'ils fussent, parce qu'ils occupaient une place qu'ils estimaient n'être due qu'à eux-mêmes, peut-être.
Et ces gens là, qui se prétendaient injustement méconnus, étaient aussi nombreux que divers. Ils accouraient à la direction da journal, faisaient les empressés auprès du rédacteur en chef à qui chacun disait " Tiens, prends ma canne et tape dessus ! "
C'est, sans doute, ainsi que Maxime Rasteil, venu de son Auvergne natale, sans idée préconçue et sans la moindre connaissance du pays où il allait se fixer définitivement a pu devenir, avec le beau talent d'écrivain qu'il possédait, et sa lucide intelligence, seuls bagages qu'il avait apportés avec lui, l'ardent polémiste et l'admirable pamphlétaire que l'on a appelé : le " Rochefort Algérien ".
Avant de parler plus longuement du " Réveil Bônois " qui dans l'ordre chronologique devrait avoir sa place ici, il parait convenir de rappeler toutes les publications, plus ou moins journalistiques, qui s'éditèrent, dans notre cité, sous des prétextes divers et dans des buts pas toujours clairement définis, ni nettement moraux.
Des feuilles naissaient et mouraient, avant et après les élections. C'étaient, ce que les idoines appelaient des " brûlots ", dont l'utilité, en ces périodes d'agitation, se bornait à dire aux candidats adverses leurs " quatre vérités ", afin que les électeurs soient parfaitement renseignés sur ceux qui venaient briguer leurs suffrages et que ceux-ci soient déconsidérés et se repentent bien vite d'être montés dans une pareille galère.
La chose était courante, et elle ne se pratiquait qu'à Bône.
Georges Clemenceau avait dit, parait-il, que lorsqu'on voulait grimper au mât de Cocagne, il fallait avoir le caleçon propre.
Comme les caleçons n'étaient pas toujours très propres chez certains ambitieux, la crainte des brûlots était pour beaucoup le commencement de la sagesse.
Les autres, même s'ils se croyaient purs et sans tâche, étaient livrés à la triste besogne d'une " Matraque " ou d'un " Fouet " qui auraient pu, tout aussi bien, s'appeler " le Venin " ou " la Poubelle ".
Ce n'est point de ces feuilles éphémères, anonymes et toujours indignes, qu'il pourrait être question dans ce rappel d'une époque qui, pour ne pas avoir toujours été marquée par la Facilité et la Prospérité, n'en a pas moins laissé dans le coeur de ceux qui l'ont vécue des résonances d'une douceur mélancolique.
Chaque imprimeur avait son journal, comme chaque moulin son canal pour apporter l'eau qui lui était nécessaire.
L'imprimeur Alexandre Carle, avait " L'Impartial " qui ne paraissait que d'une manière sporadique, et seulement lorsqu'une annonce légale, pour laquelle une trop large diffusion n'était pas absolument nécessaire, lui avait été confiée.
L'aimable Léon Lampronti, imprimait, au N" 30 de la rue Bugeaud, la vieille " Gazette Algérienne " qui sortait périodiquement pour montrer qu'elle était toujours là pour la défense des intérêts bônois.
" L'Avenir de l'Est ", dirigé et rédigé, avec courage et compétence, par William Gaillard, journaliste de race, poursuivit hebdomadairement et inlassablement, pendant de longues années, le bon combat pour l'Idée Républicaine, d'abord, la défense de l'Avenir économique du pays et de ses amis, ensuite, et la satisfaction de ses rancoeurs et de ses inimitiés personnelles, enfin.
Il y eut un " Echo de Bône ", insipide et incolore, et un " Echo d'Hippone ", plein de science et d'onction, qui faisait revivre le passé de l'antique Cité Chrétienne de Saint Augustin et défendait les intérêts du Diocèse, sous l'érudite direction de l'Abbé Leroy, aumônier d'Hippone, et savant archéologue.
" La Petite Revue Agricole " éditée par Jules Royer, vieil organe où les agriculteurs trouvaient tous les renseignements qui pouvaient les intéresser, ce oui était dans la tradition de Théophraste Renaudot qui, en mai 1631, avait créé " La Gazette ", ne publiant que des avis, des conseils et des règlements sans la moindre allusion aux événements politiques.
" Le Chêne-Liège ", enfin, qui parait encore, mais ailleurs qu'à Bône, où il avait été fondé par Edmond Coudeyre, pour la défense de nos forêts, de leurs produits, du commerce et de l'Industrie du liège.
Il y eut même un joli petit journal littéraire imprimé sur papier rose, " Les Clochettes Bônoises " qui paraissait vers la fin du siècle passé, tous les samedis soirs.
Les tintements timides des clochettes s'accordaient avec les premiers balbutiements rimés de jeunes poètes bônois, presque tous collégiens en exercice, qui y collaboraient.
Mais ce journal rose groupait aussi de vrais poètes qui savaient mettre leurs lyres à l'unisson sous la baguette de leur Rédacteur en chef, Maxime Rasteil, qui était poète, aussi, et qui avait eu, avant sa venue à Bône, une comédie en vers reçue au Théâtre Français.
***
Par le tintinnabulement léger et gracieux des " Clochettes Bônoises " toutes roses, nous voici revenus, presque naturellement, à Maxime Rasteil qui, dès 1890, allait sonner sans répit, ni faiblesse, dans le " Réveil Bônois ", le Tocsin du Bertagnisme.
La rédaction et l'imprimerie de ce journal qui étaient au N° 14 de la rue Bugeaud, ne tardèrent pas à être saccagées par les partisans du Maire de Bône, exaspérés par la virulence des attaques dirigées contre leur chef.
Ce fut, à dater de ce jour, une lutte sans merci entre la rédaction du " Réveil Bônois" et ceux qu'elle attaquait journellement.
Maxime Rasteil était continuellement, ouvertement et anonymement, menacé de mort. Aussi, ne circulait-il en ville qu'en landau et armé de son fusil Lefaucheux qu'il tenait ostensiblement appuyé contre sa poitrine, tout prêt à s'en servir.
L'opinion publique était sans cesse en état d'alerte et chaque soir le journal de Rasteil était arraché par des centaines de lecteurs impatients.
Jamais, avant lui, les campagnes de presse n'avaient atteint un si haut degré d'acuité, ni suscité une pareille tension d'esprit dans la population.
C'est que Maxime Rasteil connaissait parfaitement l'art de la polémique et il avait su accorder son tempérament au tempérament bônois.
Il savait traduire les pensées et les désirs des adversaires de Jérôme Bertagna. Il leur prêtait sa plume, sa verve, son esprit et son art.
Quatre lignes de lui, une ligne, un blanc même, et tout était dit, le numéro avait toute sa valeur et l'opinion était remuée.
Il y avait, en lui, du Rochefort surtout, mais aussi de l'Armand Carrel, du Clemenceau et du Drumont du temps de l'antisémitisme.
C'était un journaliste complet, polémiste et pamphlétaire. Mais c'était aussi un écrivain et un poète.
Il avait écrit, ou plus exactement retracé, grâce à des documents particuliers, le lamentable exode des colons de 1848, dans la région bônoise.
La lecture de cet admirable petit livre qu'est le " Calvaire des Colons de 1848 ", doit être recommandé à tous ceux qui s'intéressent à l'évolution de notre belle Algérie et tout particulièrement à l'histoire de la colonisation dans la plaine de Bône.
Après Jean Bouchet, qui succéda à Maxime Rasteil, le " Réveil Bônois " devint la propriété des frères More] de la " Dépêche de Constantine " puis la guerre de 1939 vint, et le " Réveil Bônois " (qui l'eut cru...) devint l'organe du Parti socialiste de Bône.
Mais cette nouvelle mission qui cadrait mal avec les idées et les principes qui avaient présidé à sa fondation, fut de bien courte durée, et le journal finit par cesser de paraître.
Reprendra-t-il un jour sa place dans la " Presse Bônoise ? Nul ne saurait le prédire avec certitude.
Mais s'il reparaissait, le " Réveil Bônois " sans Rasteil et sans le Bertagnisme ne serait plus le " Réveil " d'autrefois, des temps héroïques.
***
Maxime Rasteil qui, par son mariage, s'était allié à une ancienne et très honorable famille bônoise, est mort à Bône, à l'âge de 71 ans, le 16 avril 1933, quelques heures avant que sa fille, Madame Suzanne Delon, qui l'avait soigné avec le plus grand dévouement filial et dont rien ne faisait prévoir la fin prochaine, ne succombât elle-même, terrassée par la douleur.
Et, le lendemain, par un après-midi froid, triste et pluvieux, celui que Mallebay, le doyen respecté des journalistes algériens, avait appelé " Un véritable paladin de la Presse " allait, en compagnie de sa fille chérie, dormir son dernier sommeil, dans cette terre bônoise pour laquelle il avait renoncé à l'Auvergne de Vercingétorix et de Pascal.
| |
| LE VIEILLISSEMENT...
Envoyé par Jean Louis
| |
Deux gars dans la soixantaine parlent du vieillissement et l'un dit à l'autre :
- Le pire, c'est pour nos femmes ; elles refusent d'admettre qu'elles vieillissent et essaient toujours de cacher leurs petits bobos"
- Tu as bien raison lui dit l'autre mais j'ai trouvé un bon truc pour les prendre au jeu : ainsi, si tu veux savoir si ta femme commence à être sourde, places-toi à 5 metres d'elle et pose-lui une question, puis, quand tu verras qu'elle ne répond pas, avances-toi à 4 metres, puis à 3, puis à 2 et là, elle va devoir se rendre à l'évidence qu'elle est sourde.
Le bonhomme trouve l'idée bonne et en entrant chez lui, il est à 5 metres de sa femme et lui demande d'une voix forte :
- " Qu'est-ce qu'on mange pour souper ? " Pas de réponse !
Il s'approche alors à 4 metres et lui demande encore :
- " Qu'est-ce qu'on mange pour souper ? " Pas de réponse !
Il s'approche encore, à 3 metres, et lui redemande :
- Qu'est-ce qu'on mange pour souper ? " Pas de réponse !
Le gars n'en revient pas ; il s'approche alors à 2 metres et hurle :
- " Qu'est-ce qu'on mange pour souper ? "
Sa femme se retourne et lui dit :
Pour la quatrième fois, bon sang !! .................. du poulet !
|
|
Le temps des souvenirs d'autrefois. |
Histoires courtes d'un autre temps.
La Macaronade d'un dimanche de Pâques.
C'était à Bône en Algérie autour des années 1930.
La famille habitait dans cette coquette ville, où, depuis de nombreuses années déjà, Vincenzo Pêpe alias l'Africain mon grand-père, exerçait le beau métier de marin-pêcheur à bord de son bateau baptisé Sainte Candide, en hommage à la patronne de Ventotène son île natale... Avec leurs 4 enfants, ils étaient installés depuis toujours dans un modeste appartement de la maison Sans, laquelle était située à quelques pas du grand port de commerce de la ville.
Devenus adultes, les enfants étaient depuis longtemps déjà, presque tous rentrés dans le monde du travail : Antoine l'aîné, chauffeur aux transports Xiberas - Louise ma mère, la deuxième de la fratrie et sa sœur cadette Philomène, toutes deux employées à la Tabacoop au tri des feuilles de tabac et restait Gaby le petit dernier qui était encore sur les bancs de l'école.
Maintenant que voici plantés décors et acteurs, écoutons à présent cette courte et succulente histoire, venue en droite ligne d'un passé qui ne m'a jamais paru aussi proche :
" En ce dimanche jour du Seigneur, Pétronille, ma grand-mère sicilienne, avait invité à déjeuner une famille de leurs amis, pour fêter dignement Pâques dans la plus pure des traditions. Au menu et comme de coutume, si l'habituelle et incontournable Macaronade du dimanche était de circonstance, en cette belle et sainte journée Pascale Pétronille se devait en plus, l'honorer d'un éclat et d'une opulence toute particulière. Aussi la Mama qui ce jour-là s'était levée de grand matin, devait activement s'affairer auprès de ses fourneaux la matinée entière, au sein de la sombre petite cuisine toute encombrée de divers victuailles et autres ustensiles hétéroclites… Car en ce jour de Pâques et pour faire honneur à ses invités, il lui était absolument indispensable et surtout obligatoire, de réaliser une divine sauce tomate bien grasse et de haut goût, qui, à coup sûr, devrait faire la joie et satisfaire tous les convives rassemblés autour de la table. Il faut dire qu'en matière de Macaronade, il n'était pas du tout souhaité ni décent de servir n'importe quoi et affecté de n'importe quel goût ! En Algérie il faut savoir que les gens de cette époque, étaient incontestablement en raison de leurs origines latines, de fins connaisseurs dans la cuisson des pâtes alimentaires et de tomates préparées à toutes les sauces. Autant dire que si le bricolage culinaire n'était jamais toléré voire manifestement sacrilège, il se trouvait encore moins admis dans la communauté Latine et à fortiori un dimanche de Pâques. Ainsi à longueur d'année et comme le Seigneur notre Dieu, dont elle marquait régulièrement le jour du dimanche, la macaronade était sanctifiée avec tout le respect qui lui était dû et même dite au maigre elle se devait d'être, un chef-d'œuvre culinaire au sein de tous les foyers. C'est pourquoi Pétronille ce jour-là ne ménagea pas sa peine : dans l'âtre du vieux potager de sa petite cuisine obscure, elle avait allumé un bon feu de charbon de bois, dont les braises ardentes allaient tendrement faire mijoter la matinée durant, une merveille de sauce tomate pieusement couvée par l'antique cocotte de fonte noire - la préférée de Pétronille.
Midi devait vite être là… mais bien épaulée par ses deux filles, Pétronille fût largement à l'heure pour recevoir ses amis. Elle avait installé une belle table recouverte d'une nappe brodée, laquelle portait fièrement la vaisselle des grands jours, alors que flottait outrageusement dans les lieux un subtil et divin parfum de fête. Il ne restait plus alors qu'à accueillir les invités, qui, du reste, ne se firent pas attendre très longtemps… Après les congratulations d'usage et la blanche et traditionnelle Anisette, il était grand temps de passer aux choses sérieuses, en clair, la Macaronade que Pétronille ramenait résolument sur la table, accompagnée fièrement par son cortège habituel - de Parmesan - de polpettes - de couennes farcies et d'opulentes saucisses. C'est ce beau et alléchant spectacle que devait plus tard m'évoquer Pétronille avec force détails.
Puisqu'une Macaronade ne supporte aucune attente, alors, le ballet des fourchettes commença sans perdre une seule minute. Antoine mon oncle qui avait pris place prés de Pétronille faisait plaisir à voir, à chaque coup de fourchette qu'il enfournait à la régalade avec une gourmandise non dissimulée. Cependant après avoir commencé à savourer béatement avec son habituel et très solide appétit, une assiette énorme débordant de spaghetti, soudain ! il arrêta tout net son repas, en posant discrètement et définitivement sa glorieuse fourchette sur la table, en prétextant à qui voulait l'entendre que pour l'heure il n'avait plus très faim ! ? Comme on peut s'en douter la mama un moment surprise n'insista pas outre mesure, car, elle devait remarquer un peu de pâleur sur le visage de son fils et que son front paraissait brillant de sueur. Tout le monde pensa sur l'instant que le jeune homme avait sans doute de la fièvre et sur ces sages et rassurantes paroles la Macaronade et son accompagnement carné furent vite engloutis - sauf, celle qui reposait dans l'assiette d'Antoine,, que Pétronille devait ramener en cuisine.
Après les traditionnels Pastières et Gazadiels qui marquaient le dessert, Antoine, quelque peu frustré semble-t-il, s'était lentement levé de table pour s'en aller en catimini rejoindre sa mère qui furetait dans la cuisine. Pétronille qui à l'évidence restait toujours intriguée par le comportement curieux et inhabituel de son fils, lui demanda alors et une nouvelle fois, pourquoi, en ce dimanche de Pâques, il n'avait pas fait honneur à sa superbe et délicieuse Macaronade ?… C'est très discrètement et à l'abri de tous les regards, que le jeune homme se saisit doucement de son assiette encore pleine et là délicatement du bout de la fourchette, il entreprit d'explorer consciencieusement le plat de spaghetti, sous le nez de la mama quelque peu interloquée. C'est alors que dans le secret des entrailles du tas de spaghetti entremêlés, qu'une forme noire et diffuse maculée de sauce tomate commença insensiblement à se profiler. Pétronille les yeux écarquillés fixait intensément le fond de l'assiette, en se disant que c'était là une feuille de laurier barbouillée de sauce tomate. Mais Antoine qui avec quelques hauts le cœur, poursuivait de plus belle ses investigations, devait ramener tout à coup sur le bord de l'assiette, un magnifique et sombre cafard de bonne et belle taille, qui, manifestement, était accidentellement tombé dans la Macaronade au moment du service.
L'affaire devenait alors claire comme de l'eau de roche : pendant le repas, le jeune homme devait hériter par hasard de l'infortuné insecte, qu'il s'empressa de camoufler sous les pâtes pour éviter de l'exposer à la vue des convives et leur faire savoir que le chef-d'œuvre culinaire de la maîtresse de maison, était surtout parfumé au cancrelat ! … Le cafard étant comme on le sait une créature viscéralement exécrée en Algérie, quelle aurait été alors la réaction de tous les convives ? Pardonnez-moi du peu ! Mais par charité chrétienne, j'aime mieux ne pas y penser. Cependant on peut tout de même dire, que si Antoine a eu l'intelligence de maîtriser une situation des plus délicate, l'explication donnée en cuisine à sa mère aurait bien mérité d'attendre le départ des invités ! Car prise soudain de violentes nausées à la vue du cafard, Pétronille devait s'empresser de bondir vers les WC qui se trouvaient à l'extérieur, pour régurgiter bruyamment et de bon cœur la totalité de son repas Pascal… Mon grand-père ignorant la situation réelle, a dû lui dire en toute innocence et sur un ton doctoral : " qu'elle avait une fois encore avalé trop vite sa macaronade ! " Je crois que le secret du cancrelat Pascal fût bien gardé et que cet incident culinaire servi d'exemple dans notre famille, où à la façon de mon oncle Antoine on prit l'habitude de se taire en pareille circonstance.
Voilà une petite histoire familiale bien ancienne, que j'ai eu très envie de nous raconter en ce temps de Pâques, pour faire revivre dans les mémoires tous ces spectres du passé afin de ne jamais les oublier. Joyeuses Pâques à tous et à toutes, en vous recommandant surtout de ne pas oublier les traditionnels Pastières et Gazadiels ( que je vous interdis formellement, mais respectueusement - d'appeler Mounas ! )
Jean-Claude PUGLISI -
de La Calle bastion de France.
N.B : Anecdote authentique racontée autrefois, par ma grand-mère Pétronille Pêpe née Celano.
Pour ceux qui l'ignorent ou qui l'aurait oublié, ce sont des gâteaux d'origine napolitaine. :
" le Gazadiel est une couronne de pâte au levain, sucrée et décorée de petits anis multicolores.
" La Pastière est un gâteau de vermicelles et raisins secs, nappé de caramel liquide ( voir les recettes dans mon ouvrage :" la Cuisine du Bastion " éditée par l'Amicale des Callois et amis de La Calle.)
|
|
|
| A l'Aube de l'Algérie Française
Le Calvaire des Colons de 48
Par MAXIME RASTEIL (1930) N° 7
|
|
EUGÈNE FRANÇOIS
Mon ancêtre
Quoi de plus louable que de partir à la recherche de ses ancêtres !
Découvrir où et comment ils ont vécu !
La Bruyère disait : " C'est un métier que de faire un livre. "
|
|
J'ai voulu tenter l'expérience de mettre sur le papier après la lecture d'un livre sur "les Colons de 1848" et le fouillis de souvenirs glanés dans la famille, de raconter la vie de ce grand homme, tant par sa taille que par sa valeur morale, de ce Parisien que fut Eugène FRANÇOIS né à Meudon en 1839, mort à Bône en 1916.
Tout a commencé lors de l'établissement d'un arbre généalogique concernant le côté maternel de notre famille : arrivé à notre ancêtre : qu'avait-il fait pour qu'une "Rue" de ma jolie ville de "Bône la Coquette", porte son nom dans le quartier de la Colonne Randon ?
Tout ce que j'ai appris, j'ai voulu le faire découvrir tout simplement comme d'autres ont écrit sur nos personnalités et grandes figures Bônoises !
Pour qu'aujourd'hui, on n'oublie pas ce qui a été fait hier !...
Marie Claire Missud-Maïsto
|
PREMIÈRE PARTIE
UN VISITEUR SINISTRE...
LE CHOLÉRA !
Sans la moindre transition, le printemps de 1849 débuta par des chaleurs torrides. Après avoir pataugé et grelotté tout au long d'un hiver calamiteux, c'était maintenant un soleil de plomb qui nous assommait dehors et nous rôtissait même dedans, car nos minces " châteaux" en bois étaient de véritables fours sous l'action d'un tel calorique.
Les fièvres paludéennes ne tardèrent pas à s'abattre sur la plupart des familles qui composaient la Colonie agricole. Hommes, femmes et enfants montraient leurs figures terreuses, ravagées par l'anémie. Les plus vaillants sentaient leur courage faiblir et leurs forces s'en aller. Dans chaque baraquement, il y avait des malades.
Un matin, ce fut pire et l'alarme fut grande, car d'après les, médecins militaires appelés en consultation, le nouveau fléau qui venait de s'installer à Mondovi n'était autre que le choléra.
Et ce fut alors la panique, la peur, la désolation en permanence. Les Colons tombaient comme des mouches. Le premier qui succomba fut le fils Pigeon, âgé de seize ans, qui s'était alité en revenant de Bône, ce qui fit croire qu'il en avait rapporté le terrible mal.
Devant la gravité de l'épidémie, le capitaine Blanchet avait dû faire aménager une ambulance pour isoler les sujets les plus fortement atteints ; mais il se trouva que notre docteur, M. Sistac, habitant une ferme qu'il faisait valoir dans les environs, on avait beaucoup de peine à obtenir de lui des visites régulières.
Bref, faute de personnel médical, de mesures rigoureuses, de soins urgents et assidus, c'étaient chaque jour de nouvelles fosses qu'il fallait creuser. Des familles de six, sept et huit personnes disparaissaient dans l'espace de quelques heures.
Souvenir déchirant ; le 7 juin 1849, six mois après notre arrivée en Algérie, nous eûmes la douleur de conduire au cimetière ma soeur Augustine.
Quatre autres cercueils s'ajoutèrent, ce jour-là, à son convoi funèbre.
Chère et douce Augustine, elle qui m'aimait tant et qui avait brodé de si jolies choses, à Paris, pour le roi Louis-Philippe ! Frêle et délicate comme les fleurs que ses aiguilles dessinaient si bien sur les étoffes précieuses, elle s'était étiolée au contact de la terre lointaine où le sort nous avait jetés !
Pauvre soeurette !... En recueillant son dernier souffle, ma mère dont elle était l'orgueil fut secouée d'une sombre crise de désespoir, et, gagnée par le mal affreux, elle ne tarda que de quelques jours à la rejoindre dans la mort.
Le 19 juin, il nous fallut tout en larmes reprendre le chemin du champ des trépassés pour y déposer sa dépouille. Ce matin, trois autres cercueils l'y avaient précédée.
Le 25 du même mois, ce fut pour nous une catastrophe non moins attristante. Mon beau-frère Langevin, marié depuis peu avec ma soeur Rosine, fut fauché à son tour. On l'enterra en même temps que cinq nouvelles victimes de l'épidémie qui continuait ses ravages.
Ceux-ci se manifestaient au surplus avec une violence telle, qu'à bout de science et de remèdes, certains médecins-majors, envoyés sur les lieux, ne trouvèrent rien de mieux que d'ordonner aux habitants de danser.
- Pour éviter la contagion du choléra, leur dirent-ils, il faut que votre sang soit en mouvement !.. Dansez et vous serez épargnés !...
Dans des circonstances aussi tragiques, les colons déjà si éprouvés n'y regardèrent pas à deux fois. Ils firent appel à un violoneux de Mondovi-le-Haut qu'on appelait le père Crakousky, et, à raison de cent sous par séance, ils dansèrent chaque nuit polkas, valses, quadrilles à en perdre haleine.
Le musicien ne coûtait pas cher.
Tout de même, ça faisait quelque chose de voir se trémousser sur des airs de bastringue tous ces malheureux en deuil pour la plupart de quelques-uns des leurs, et qui, entre deux enterrements, n'en criaient pas moins : " En avant deux ! " ou: " En place pour la pastourelle ! " en balançant leurs cavalières.
On dansait de huit heures du soir à quatre heures du matin dans une petite taverne servant aussi d'hôtel et tenue par un nommé Droublet. Tristes bals que ces réunions chorégraphiques où l'on ne venait que dans l'espoir d'éviter le fléau, ce qui n'empêcha pas plusieurs danseurs et danseuses d'être emportés de façon foudroyante par le choléra en rentrant chez eux.
Ce fut notamment le cas de Mme Meynier.
De l'ambulance, qui était archi-pleine, ne sortirent que deux personnes: Cyrille Fauvet et Caroline Boissonnet. De 1849 aux premiers mois de l'année suivante, il y eut, à Mondovi, environ 250 cas mortels. Beaucoup d'autres cholériques succombèrent dans les hôpitaux de la région où on les avait transportés.
Les inhumations se faisaient précipitamment tout en haut du cimetière, dans un banc de tuf. C'est là que, pour notre compte, nous avions dû nous acheminer à trois reprises depuis le début de ces jours maudits.
A SUIVRE
Merci à Thérèse Sultana, et Marie-Claire Missud/Maïsto, de nous avoir transmis ce livre de Maxime Rasteil qui a mis en forme les mémoires de son arrière grand-père Eugène François.
Elle a aussi écrit un livre sur lui.
J.P. B.
| |
| LE MONT PAPPUA
Par Paul BAYLET N°5
Envoyé par Mme Gauchi
|
|
Préface de Erwan MAREC
Extrait du bulletin N°38 (1938-1961)
De l'Académie d'Hippone
Bône Imprimerie Centrale
IV.- INVENTAIRE ET DISCUSSION
DES THÈSES CONNUES
Les précisions et l'argumentation qui précèdent permettent d'éliminer les hypothèses situant le Mont PAPPUA aux BABORS (1), entre les BABORS et l'EDOUGH (2), près de MILA (3), aux environs de DJIDJELLI (4) et erronées simplement parce que leurs auteurs sont allés chercher trop loin les limites de la NUMIDIE.
Plus grave encore, est l'erreur de ceux qui ont placé cette montagne en AURES... Cette idée a d'ailleurs été réfutée sans appel par PAPIER (5) et de POUYDRAGUIN (6). Faute de références suffisantes, je n'ai pu savoir qui l'avait avancée, mais des recherches sur ce point m'ont paru inutiles, la cause étant indéfendable. On ne peut, en effet, imaginer que GÉLIMER ait tenté de s'enfuir vers le Sud, hors de ses frontières, chez des voisins dont la plupart avaient, dès la victoire d'AD DECIMUM, " envoyé des émissaires à BELISAIRE " (7) pour lui porter leurs hommages " afin de se concilier sa faveur " (8). GÉLIMER les connaissait trop bien pour, vaincu une deuxième fois, aller ainsi se mettre à leur merci !
En outre - et l'on ne peut en cela qu'être entièrement d'accord avec Chr. COURTOIS - " il faut, de toute évidence, sous peine de rendre inintelligible le récit de PROCOPE, situer le Mont PAPPUA à faible distance d'HIPPONE " (9). N'oublions pas que le roi déchu, alourdi dans sa course par sa suite et ses bagages, ne pouvait songer à fuir bien loin sans augmenter le risque d'être rejoint par les 400 Hérules rapides lancés à sa poursuite.
Cette seule raison autoriserait à faire le procès des thèses de BERNELLE (10) qui place le PAPPUA à la Guelâa SERDOUK, au Sud de GUELMA, et de PAPIER (11) selon qui le PAPPUA se confondrait avec le Djebel NADOR, entre GUELMA et SOUK-AHRAS. J'ajouterai que GELIMER, dont on connaît par PROCOPE lui-même le dessein de fuir en emportant ses trésors vers l'Espagne, seul pays où il pensait compter encore une amitié sûre, devait nécessairement se tenir à faible distance de la mer, unique voie de salut pour lui et pour les siens. Enfin, cette dernière thèse - basée principalement sur une inscription où l'auteur avait cru pouvoir lire P A P (P U ) A, approuvé en cela par TISSOT (12) - a été anéantie par SCHMIDT (13) et par GSELL (14) qui ont montré que le texte doit se lire, en fait, P A P (I C) A.
On ne prendra pas au sérieux la proposition de PERROUD (15), qui voudrait confondre notre montagne avec le Mont BALBUS ou BELLUS, mentionné par TITE LIVE (16), " entre la presqu'île " du Cap BON, le Golfe d'HAMMAMET et les Plaines de KAIROUAN "...
Je serais tenté d'être presqu'aussi sévère pour Monseigneur TOURNIER (17), évêque de Thagaste, qui fait un trop facile rapprochement entre MILA dans les monuments ecclésiastiques, selon les manuscrits grecs et le nom de la ville recherchée sur le flanc du mont PAPPUA, car il estime qu'un lambda a bien pu se transformer en delta (j'ajouterai que, par la même occasion, un oméga se serait changé en omicrone !). De pareilles spéculations, purement subjectives, n'apportent aucun élément valable dans un raisonnement ou dans une recherche.
***
D'autres savants, sans indiquer la région sur laquelle se porteraient leurs préférence (c'est plus commode), ont simplement déclaré - parfois avec force et pas toujours avec une grande objectivité - qu'il ne pouvait être question de rechercher le PAPPUA dans l'EDOUGH. Leur erreur provient toujours de ce qu'ils l'ont vu à la limite Ouest de cette NUMIDIE Occidentale qui, n'existant plus, ne pouvait plus avoir de limites (tirons-en la leçon que l'Histoire et la Géographie sont deux disciplines absolument indispensables l'une à l'autre). C'est le cas, notamment, de Ch. TISSOT (18), de PELISSIER (19), de POUYDRAGUIN (20), de GSELL (21).
Par contre, d'autres archéologues - les plus nombreux - ont estimé que le Mont PAPPUA ne pouvait se trouver que dans le massif de l'EDOUGH. Malheureusement, la plupart n'indiquent pas en quel point précis. C'est le cas du voyageur SHAW (22), de d'ANVILLE (23), de DUREAU DE LA MALLE (24), de MANNERT (25), de PELISSIER (26).
Restent ceux qui ont précisé l'endroit dans le massif où se trouvaient, selon eux, le Mont PAPPUA et la ville de MEDENOS. Il convient d'examiner et de discuter chacune de leurs théories.
1° Une Commission de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres (27) place le Mont recherché au " Mont EDOUGH " qui, d'après le contexte, semble devoir être le BOU-ZIZI. La Ville de " MEDENOS ou MIDENE " aurait été située au pied occidental de ce mont.
Cette Commission a pu être inspirée par l'aspect abrupt de la falaise du KEF-SEBAA vue depuis BÔNE. Mais cette dernière n'entoure pas - tant s'en faut - le sommet " de toutes parts " ! Les Membres de la respectable Commission auraient pu le constater s'ils étaient montés sur ce sommet. Ils ne l'ont certainement point fait et nul ne songera à leur en faire grief car leur rapport date de 1835, alors que la première piste d'accès a été ouverte (par le Général RANDON) en 1842 seulement. Le premier explorateur du Massif de l'EDOUGH, l'Ingénieur en Chef des Mines FOURNEL, n'y a pénétré qu'en 1843.
Quant aux restes de la ville, on n'en a jamais retrouvé aucune trace, ni sur le versant occidental, ni nulle part à proximité.
2° Louis MARCUS (28) (dont je n'ai pu me procurer le texte, mais qui est cité par FOURNEL, BERBRUGGER, PAPIER et POUYDRAGUIN) aurait situé le mont et la ville " au Sud-Ouest du massif ". S'il entend par là le Massif de l'EDOUGH proprement dit - c'est-à-dire celui du BOU-ZIZI -, l'hypothèse est celle que reprend FOURNEL (Cf § n° 3° ci-après). S'il voyait en l'EDOUGH le massif tout entier, l'endroit se trouverait vers la Plage de LA MARSA et c'est l'hypothèse de COURTOIS (Cf § n° 5° ci-après). Ces deux possibilités sont discutées plus loin.
3° Henri FOURNEL (29), bien que n'émettant " aucun doute sur l'identité du PAPPUA avec l'EDOUGH, se représente difficilement comment GELIMER put y être bloqué par une petite armée ". Pour ce qui est de la Ville de MIDENE, il pense qu'on pourrait " la voir dans les ruines d'EL K'SOUR " (visibles encore à quatre kilomètres au Nord-Ouest d'AIN MOKRA).
Il est bien évident que PHARAS n'a pu assiéger tout le Massif de l'EDOUGH (même limité à sa seule partie orientale) avec un effectif réduit, après l'assaut infructueux, à quelque 300 soldats. Quant aux ruines d'EL K'SOUR, elles ne représentent que celles d'un oppidum moyen, car elles ne couvrent même pas un demi hectare. Mais surtout, elles sont situées dans une plaine, loin de tout sommet susceptible de répondre à la description précise que donne PROCOPE. Cette hypothèse est tout à fait étonnante de la part d'un auteur aussi sérieux que H. FOURNEL (30).
4° DOLLY (31) (ancien Chef du " Bureau Arabe Départemental de BÔNE "), a été mis en éveil par un rocher situé à 7 kilomètres au Nord-Ouest de BÔNE, dominant l'Oued El Kantara et l'aqueduc romain, nommé par les habitants " MELAG GELIMINI ". Si MELAG signifie " confluent ", " point de rencontre ", GELIMINI n'a aucun sens en arabe ni en berbère et pourrait être la déformation du nom de GELIMER. Et l'auteur en déduit que le rocher en question aurait pu être l'endroit de la rencontre de ce dernier avec CYPRIEN, envoyé par BELISAIRE pour recevoir sa reddition.
La thèse n'est pas aussi absurde qu'on l'a laissé entendre (32), mais ne peut résister à un examen critique. Selon le récit de PROCOPE, GELIMER se serait rendu à CYPRIEN sur les lieux mêmes où il venait d'être assiégé. Le " pont de rencontre " était donc le Mont PAPPUA et il faut avouer que le rocher en question, le MELAG GELIMINI, est bien trop minuscule pour représenter ce dernier. Et ces ruines de MEDENOS, où seraient-elles ?
Au surplus, on ne comprendrait pas pourquoi GELIMER, en fuite, aurait traversé la Ville d'HIPPONE - qui faisait toujours partie de son royaume (33) et qui avait eu le rare privilège de conserver ses remparts - pour aller se réfugier aussi près d'elle. S'il l'estimait assez sûre pour se livrer à ses habitants (ce dont il est permis de douter), il aurait eu plutôt l'idée de s'y enfermer ou d'y embarquer sur sa flotte qui n'attendait plus que lui pour prendre la mer.
5° Christian COURTOIS (34), réfutant l'opinion de la plupart des auteurs - de GSELL (35) en particulier -, ne voit pas dans les ruines existant à SIDI BOU MEROUANE (ou plage de La MARSA) celles du CULUCITANIS de l'Itinéraire, mais celles de MEDENOS dont le nom, déformé au cours des siècles, pourrait être rappelé par celui de la Mechta EL MENADI que l'on trouve à un kilomètre plus au Nord.
La recherche de la vérité a des exigences qui surpassent - sans les amoindrir - les égards que l'on doit à l'érudition inépuisable, écrasante, à l'argumentation dépouillée de toute passion, à la logique lumineuse d'un Christian COURTOIS. C'est avec beaucoup de gêne et en m'inclinant respectueusement devant sa mémoire, que je vais prendre la hardiesse de ne pas partager son avis.
Je ne pousserai pas l'audace jusqu'à discuter les raisons qui l'incitent à le faire passer entre la NUMIDIE et la PROCONSULAIRE " alors que (à mon sens) la première faisait partie de la seconde. Je note qu'il situe cette limite aux environs de la borne de BOUKTIFA et, qu'il s'agisse de la frontière EST de la défunte NUMIDIE Occidentale ou de la frontière OUEST de la NUMIDIE Vandale, cette ligne de démarcation est exactement placée au même endroit. De sorte que mon raisonnement ne heurterait pas la conclusion de COURTOIS si je me trompais sur la définition de la NUMIDIE selon PROCOPE.
Mais il serait fort étonnant que GELIMER, qui ne pouvait ignorer la "tendresse" de ses voisins pour les vaincus, ait songé à aller se réfugier chez eux, hors des limites de son royaume, alors qu'il ne pouvait leur apporter ni présents, ni promesses (croyables) de récompenses futures, ni menaces de représailles éventuelles.
Et puis, pourquoi fuir si loin (environ 80 kilomètres d'HIPPONE), par des routes de plaine (36), quand il sentait presque dans son dos le souffle de ses poursuivants ? Pour atteindre un port ? Mais, ce faisant, il en aurait ainsi laissé plusieurs sur sa droite, beaucoup plus proches, sis sur son territoire, occupés par ses compatriotes, accessibles seulement par des chemins de montagne jalonnés de nombreux fortins que tenaient des garnisons pouvant encore être considérées comme fidèles, clone susceptibles de freiner la poursuite des HERULES !
Se dirigeant vers un port, manifestement pour essayer de fuir en Espagne auprès du roi THEUDIS, son ami, il n'eût à coup sûr, pas choisi celui de SIDI BOU MEROUANE ! C'est en effet, - sur tout le pourtour du massif de l'EDOUGH - le seul qui soit ouvert en grand aux tempêtes de l'Ouest et du Nord-Ouest, disposition qui le rend à peu près inabordable pendant les saisons au cours desquelles les vents de ces directions dominent en quasi-permanence, c'est-à-dire en automne et en hiver. Or, l'histoire se passe en fin décembre et nous savons, par plusieurs passages de PROCOPE, que le temps est mauvais et la mer démontée depuis quelques jours. GELIMER le sait aussi et ne peut l'oublier, quel que soit son affolement.
Enfin, je connais assez bien cette partie du Douar RAS-EL-HADID pour y avoir souvent rayonné, joignant (trop rarement à mon gré) à l'obligation professionnelle le plaisir de répondre aux invitations réitérées de mon ami, le Bachagha DJEMAOUN Brahim BOUMERAH. J'ai un peu parcouru ses pistes et beaucoup longé ses côtes : je n'y vois absolument pas de pic ressemblant, par la forme et l'altitude, au Mont PAPPUA tel que le décrit PROCOPE, même en tenant compte de probables exagérations de cet historien qui, n'ayant ni le goût (un Grec est rarement habitué au froid) ni aucune raison de se rendre sur les lieux, ne les a certainement pas vus et a dû se contenter de transcrire ce que lui a rapporté PHARAS,... lequel avait besoin de justifier et l'échec de son assaut initial et la longue durée de son siège !
Et puis, PROCOPE ne parle-t-il pas de neige annuelle à propos des habitants de MEDENOS ? Ceux de SIDI BOU MEROUANE en voient, au maximum, trois fois dans toute leur vie.
Pour toutes ces raisons, bien qu'elle se rapproche je crois de la vérité, je pense que l'hypothèse de Christian COURTOIS, la dernière en date, la plus séduisante et, semble-il, la plus sérieuse, ne peut être admise. J'en retiendrai cependant la position - qui lui paraît certaine - du Mont PAPPUA dans le Massif de l'EDOUGH, à proximité d'une frontière passant par la borne de BOUKTIFA. A l'Ouest ou à l'Est de cette ligne ? Là, est tout notre litige.
***
Voilà toutes les opinions - autorisées ou fantaisistes - que j'aie pu retrouver sur l'emplacement possible du PAPPUA et de MEDENOS. Je pense avoir montré qu'aucune ne pouvait être définitivement et intégralement adoptée, en précisant, toutefois, que c'est dans l'érudition même des auteurs étudiés que j'ai puisé les arguments qui m'ont amené à réfuter successivement leurs propres thèses.
Pour ne pas arrêter là ce travail -- qui serait alors purement destructif - je vais essayer, poussant jusqu'au bout mon audacieuse entreprise, de suivre à mon tour GELIMER dans sa fuite éperdue, espérant n'y perdre ni mon souffle, ni l'attention du lecteur, s'il veut bien m'accompagner.
***
(1) RAGOT, Sté Archéologique de Constantine, T, XVII, p. 295, renvoi n° 1.
(2) BERBRUGGER, Revue Africaine, 1862, T. VI, n° 36, pp. 477 à 480.
(3) Mgr TOULOTTE, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1891, p. 427.
(4) BERBRUGGER, Revue Africaine, 1862, T. VI, n° 34, N.D.L.R. p. 274.
(5) " Du Mont PAPPUA ", Société Archéologique de Constantine, vol. XX, 1879-80, pp. 93 et 94.
(6) " L'EDOUGH ", Société Archéologique de Constantine, vol. XXXII, 1898, p. 156.
(7) Charles DIEHL, " L'Afrique Byzantine ", p. 33.
(8) Chr. COURTOIS, " Les Vandales et l'Afrique ", p, 347.
(9) Chr. COURTOIS, " Les Vandales et l'Afrique ", p. 184.
(10) Société Archéologique de Constantine, 1892, pp. 57 à 60.
(11) " du Mont PAPPUA et de sa synonymie avec le Djebel NADOR ", ibidem, 1879, pp. 83 à 111.
(12) " Géographie comparée de la Province d'Afrique ", 1884, p. 39. renvoi 1.
(13) " DEUTSCHE LITERATURZEITUNG ", 1885, p. 1.082.
(14) " Inscriptions latines de l'Algérie ", t. I, n° 941.
(15) " DE SYRTICIS EMPORIIS ", pp. 172-173.
(16) Cité par TISSOT, " Géographie comparée ", T. I, p. 28.
(17) C.R. Académie d'Hippone - 1892 - pp. XXVIII, XXIX.
(18) " Géographie comparée ", T. I, pp. 36-37.
(19) " Exploration scientifique de l'Algérie ", (Sciences, Histoire et Géographie), T. 6, p. 368.
(20) " L'EDOUGH ", Société Archéologique de Constantine, 1898, p. 158.
(21) " ATLAS ", F. 9, n° 12.
(22) " Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant ", 1743.s
(23) " Géographie ancienne abrégée ", 1834, p. 665.
(24) " Recueil de renseignements sur la Province de Constantine ", 1837, p. 232.
(25) " Géographie ancienne des Etats Barbaresques ", 1842, L. II, Ch. XV, pp. 437 à 439.
(26) " Mémoire historique et géographique sur l'Algérie ", 1844, p. 361.
(27) " Recherches sur la partie de l'Afrique Septentrionale connue sous le nom de Province d'Alger ", 1835, t. I, pp. 105 à 109
(28) " Histoire des Vandales ", 1836, L. III, Ch. XIII, p. 389.
(29) " Richesse minérale de l'Algérie ", 1849, pp. 31 et 32.
(30) Au moment d'imprimer la présente monographie, quatre ans après sa communication à l'Académie d'HIPPONE, je dois présenter des excuses à H. FOURNEL, dont j'ignorais qu'il avait fait, dans la suite, amende honorable. Un pur hasard m'a fait découvrir, en effet, une nouvelle opinion de sa part, postérieure de 24 ans à la première, qu'elle infirme, et manifestement ignorée des différents auteurs cités, lesquels en auraient été grandement éclairés. Malgré son imprécision sur le lieu recherché, elle consolide tellement ma thèse, que je ne puis m'empêcher de la reproduire intégralement en annexe.
(31) Lettre à M. FERAUD, Interprète de l'Armée (Revue Africaine N° 36 de 1862, t. VI, p. 475) au sujet d'une N.D.L.R. ajoutée à un article de ce dernier par BERBRUGGER (n° 34, p. 274).
(32) BERBRUGGER répond à la lettre mentionnée au nota précédent, pourtant sensée et fort courtoise, d'une façon péremptoire, désagréable, presque hargneuse ; peu objective au demeurant, ce qui ne laisse pas de surprendre de la part d'un savant authentique. D'autant plus que sa propre interprétation du texte de PROCOPE est pour le moins... fantaisiste!
(33) PROCOPE, " Bellum Vandallicuni ", t. I, p. 437.
(34) " Les Vandales et l'Afrique ", pp. 120, 184 et 348.
(35) " ATLAS ", F. 2, n° 2.
(36) Car les routes de plaine sont rarement jalonnées de fortins. De toute façon, dans ce cas, ces points de résistance sont facilement " tournés " par une cavalerie légère qu'ils ne retardent guère dans sa course. A part les ruines d'EL K'SOUR dont il est question plus haut, on n'en a pas trouvé trace dans la plaine de l'Oued EL ANEB que GELIMER aurait dû suivre pour aller à LA MARSA.
| |
LES FRERES PIEDS-NOIRS
Par Christian Roehrig
N° 13
|
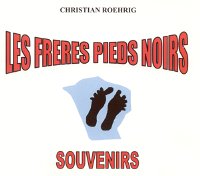 |
PREFACE
A travers un survol virtuel de mes souvenirs, moi, petit et humble piednoir de Bab-El-Oued (Place Lelièvre) je retrace certains faits historiques qui m'ont profondément marqué.
Mi goguenard, mi-cynique, quelquefois acerbe, je décris en pataouète, mes états d'âme et mes ressentiments à l'égard de certains hommes politiques qui ont failli à leur parole d'honneur.
Depuis ces désillusions, j'observe les charognards se disputer le pouvoir.
Devenu grand-père, je doute, si rien ne bouge, de la nationalité future de mes arrière- petits enfants que je ne connaîtrai pas et à qui je veux, par le présent, laisser le témoignage d'une vérité.
C. ROEHRIG
|
<====OOO====>
NAUTE FIERTE, NAUTE REUSSITE
Joseph : Ouais, tout ça on le sait Main'nant, mais à c'moment là on savait pas, nous on croyait, on pouvait pas penser qu'un Président d 'la République y disait des mensonges. Tiens r'garde cette photo, j'l 'ai prise juste avant d 'partir, c'était après la tuerie de la grande poste. Tu reconnais ?
Christian : Ouais c'est les Facultés. Et pourquoi tias pris Ces Facultés toutes seules ! C'est en souvenir de Lagaillarde ?
Joseph : Exactement, pace que j' me suis rappelé es barricades et j'ai pensé que p't'éte qu'un jour j'oublierai cette page de naute histoire alors j'ai voulu prendre cet endroit en photo.
Tu t'rappelles des barricades ! Lagaillarde et son équipe y sont restés une semaine dedans, y voulait pas s'rendre, et quand y sont sortis y z'ont défilé la tête haute. Mais j'crois que si y sont sortis comme ça c'est pace qu'y ne voulaient pas tirer sur des Français Eux. Enfin c'est dommage d'avoir dépenser tant d'énergies et de vies humaines pour en arriver là. Quand j'pense au décor naturel de naute beau Pays ! Si au moins ils le mettaient en valeur, ça m' ferait moins mal, mais non ils détruisent 130 années de labeur. D'après c'que j'ai entendu, les Arabes y z'ont déserté en partie la campagne pour habiter en ville, c'qui fait qu'y a une surpopulation et la campagne elle est en train de redevenir sauvage comme quand nos arrières grands parents y sont venus s'installer. Si y continuent comme ça dans trente ans on reviendra à la case départ mais c'te fois y faudra plus compter sur nos p'tits enfants pour refaire le trajet.
Christian : Mloi j'sais plus, j' me perds dans tout cet imbroglio, alors pour l'avenir hein ! J'pense au putch des Généraux. Tu crois pas qu'y z' auraient dû faire appel à nous ? Pace que j' sais qu'y z'ont pas réussi leur action pace que y a des militaires qui n'ont pas voulu s 'mouiller, j'les comprends mais si par exempe y nous z'avaient dit : Français d'Algérie, des militaires sont en train de faire échouer naute action. Pour pouvoir continuer naute lutte nous vous demandons encore un p'tit effort, les unités Territoriaes doivent conserver leurs armes et que tous les gens qui sont pour l 'Algérie Française se présentent dans les casernes près de chez eux pour se mobiliser contre les fellouzes et contre ceux qui veulent brader notre terre.
Il ne s'agit pas d'une guerre contre les arabes, au contraire nous voulons protéger les gens de bonne volonté. Nous réfutons toutes les dispositions qui seront prises sans naute consent'ment. Nous instaurons une démocratie nouvelle. Oilà ! moi j'crois qu'ça aurait marché. En plus de ça, on n'aurait pas entendu, comme j'l 'ai entendu une fois à la télévision, y `avait un truc sur l'Algérie et les tortures, tu vas pas m'croire mais y a un type qui avait fait son service en Algérie du côté de la kabyfie y a raconté qu'il entendait des cris des gens qui z'étaient torturés qu'il en avait mal au coeur et après il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il était venu faire en Algérie vu qu'c'était un pays qu'la France elle aurait dû donner. Et, mais là tiens toi bien ! C'était un Alsaco, comme moi qui s'demandait c'qui foutait en Algérie. Il m'est rentré une rabia qu j'avais envie de téléphoner pour lui dire c'que j' pensais d'lui mais j'étais tellement en colère que j pouvais plus parler pace que si j 'suis un pied noir, comme y disent, c'est Pace que mon arrière-grand-père il a quitté l 'Alsace en 1872 ou 1873 pour pas ête Allemand alors hein !!! Heureus'ment y en a un qu'y était invité aussi, qui lui a dit qu'il était coco alors là j'ai tout d 'suite compris.
Bon pour en revenir à naute histoire, une fois nous aute en scène on renvoyait les militaires qui n'auraient pas voulu se joindre à nous dans leur foyer, ils auraient pu crier vive la quille et on aurait continué naute chemin ensembe. Oilà, moi j'crois qu'ça a été une grossière erreur. .Mais maintenant c'est fait et quarante ans après assis devant une anisette avec un rayon d 'soeil qui nous réchauffe les vieilles articulations, on peut tout dire. R''marque que j'en veux pas aux Généraux ni aux autres qui se sont battus pour une Algérie française, à c'moment là j'crois qui pensaient bien faire mais ça n'a pas marché et l 'grand il en a tiré parti pour brader au plus vite naute Pays et, chose que j'ai jamais compris, alors qu'on avait gagné la guerre subversive comme y disait, c'est nous qui avons déposé les armes et libéré es fellouzes. Tu parles que dès qui z'ont été libérés, y se sont empressés de rejoindre leurs amis et de tuer les pauves arabes et les français qui s'trouvaient sur leur chemin en étant sûr de l'impunité puisque les armes, nos soldats ils les avaient déposées. Tu vois en pensant bien, on aurait pu accuser la France pace que c'est même écrit clans le code pénal, " non assistance à personne en danger". Tu t'rends compte toi ? J'te dis pas l 'carnage qu'les fellouzes y z'ont fait. Et main'nant y en a comme le journaliste Alleg ( qui était communiste) qui crie à la torture et tous les français qui z'écoutent ça y s'disent qu'l 'armée elle a torturé pour rien. Mais d'après le çénéral Massu, j' crois me souvenir qu'il a écrit dans un livre que le Alleg il avait reçu une baffe et qu'il s'était mis à table sans ête invité alors main'nant y veut crier à la torture pour paraître un héros, mais c'type-là pour moi c'est un zéro ouais. On va pas refaire l 'histoire. Tu comprends qu'j'ai d-'l 'amertume dans ma bouche mais y faut s'arrêter un peu, s'dire qu'on peut plus revenir en arrière et...
Joseph : Ouais, moi j'veux bien tout effacer et laisser uniquement le souvenir dans ma tête mais quand j'entends qu'on veut faire parler uniquement ceux qui ont été torturés par les français et qu'on oublie c'que les fellouzes y z'ont fait ça m'fait sauter l'cœur et commence à m énerver.
Christian : Ti'as raison mon frère mais y faut prendre ça avec la philosophie. R'gardes, quand j'pense qu'en 1874 mon arrière-grand-père il est venu de son village au fond du Bas Rhin. Il est né à Salmbach et après avoir fait 11 ans de militaire il a habité Roeschwoog (j'suis allé pour voir ce village et j'ai revu une partie d 'la maison où il a habité et où mon grand père il est né) donc il est venu avec sa femme ses deux enfants et sa mère et ils ont vécu sous la tente dans un village qui s'appelait avant ZifZef et qui s'est appelé après Mercier Lacombe près de Mascara dans le département d'Oran. Lui il a construit de ses mains deux maisons et il a mis en valeur plus de 40 hectares de terre qu'avant lui la terre elle était en friche, qu'il a participé à la mise en valeur de ce pays et qu'il a lui aussi tout abandonné par la faute d 'l 'administration, qu'il est allé après s'installer dans fa région de Marengo.
Enfin j'vais pas m'appesantir sur le passé d'mon arrière grand-père, mais qu'en j'pense à toute cette énergie qu'y z'ont dû mette nos anciens pour donner une vie meilleure à c'pays et qu'y nous z'ont foutus à la porte en disant qu'on était tous des cotons j'peux pas supporter.
Joseph : T'énerves pas Christian, ça sert à rien, toute façon on peut plus rien alors laisse toi vivre.
Si tu veux, après tu m 'parleras de l'histoire de ton grand-père. Tiens r'garde cette photo, dis moi si elle te rappelle queque chose.
Christian : J'crois qu'cette photo elle représente la place de Fort de l'Eau. C'est ça hein ?
Joseph : J'vois qu'ti as pas oublié. Ouais c'est la place de Fort-de-l'Eau tu t'rappelles les merguez et la soubressade mahonaise qui nous servaient quand on allait le dimanche ! On s'régalait. Et puis quand c'était la fête c'est sur cette place qu'on dansait. J'revois la plage avec ses dunes de sabes et toutes ces petites villas qui étaient bâties sur le sabe à 50 mètres du bord de mer. La majorité avait été construite par leur propriétaire. C'était l 'bon temps. On travaillait dur mais on n'était jamais fatigué, d'ailleurs il a fallu que j'rentre en France pour entendre dire quelqu'un qu'il était fatigué de travailler, punaise qu'est-ce qu'on aurait dû dire nous autes ! Et nos anciens eux, les pionniers d 'la première heure ? Plus j'pense et plus j'crois qu'la politique d'information qu'les patos y z'ont eu à naute sujet c'était que nous on avait une vie de cocagne et on faisait travaillait les arabes. On avait une fatma d'un côté avec un chasse mouche et une aute fatma d'l'aute côté qui nous faisait la danse du ventre pendant que nous ont tirait sur le narguilé en attendant les cailles roties qui nous tombent du ciel Purée va ! ... Les temps ont changé, main'nant ceux d'ici y sont fait de chewin gum.
En parlant chewin-gum tu t'rappeles quand on jouait avec la terre glaise ! On faisait des tartes qu'on jetait par terre en les renversants, l'air qui s'engouffrait les faisait éclater en touchant le sol et celui qui avait fait la plus grosse goffa (trou) il avait gagné l'droit d 'recommencer.
Tiens r'garde cette photo, j'suis sur que tu la connais pas
Christian : J'vois qu'c'est un kiosque à musique et des gens qui dansent , c'est p'tête une fête de village non ?
Joseph : Ouais c'est la fête de Castiglione.
Christian : L'atchidente, c'est là que mon oncle Louis il habitait, punaise, il était directeur de l'agence du Crédit Agricole, tout le monde y le connaisait. Mon oncle il avait trois enfants, mon cousin Roger et mes cousines Eliane et Jocelyne, j'yense bien que j'connais Casti, petit village au bord de mer, il était réputé pour sa fête de village, c'est sur cette place qu'ma cousine Eliane quand elle s'est mariée avec Roland Delcroix elle a fait la fête. j'me suis bien amusé. J'allais assez souvent chez mon oncle, c'était l 'bon temps. Main'nant mon cousin Roger il est l 'Président de l'association des Castiglionais et tous les ans je participe à leur réunion. On retrouve un peu l'air de chez nous.
Mais tu sais pas que main'nant quand les Castiglionais y demandent une carte d'identité eh bien comme tout est informatisé on dit qu'y sont nés en Italie pace que Castiglione c'est en Italie alors va comprendre toi. J'sais ça pace que c'est arrivé à mon cousin tu t'rends compte que main'ant tous les Castiglionais qui sont nés eux en Algérie eh ben y sont devenus des mangeurs de spaghettis.
Joseph : J'savais pas que ti avais un cousin président, c'est dommage qui soit pas l 'Président d'la France ! Enfin ! .. .
Ouais, les fêtes des villages c'était l 'bon temps, on pouvait aller partout sans avoir peur de pas revenir à la maison. J'me souviens des villages de Marengo, Téfeschoun, Berhard, Chifallo, tous ces lieux étaient pour nous des endroits de réjouissance, pour nous autes c'était comme la côte d'Azur mais en mieux encore, tout au moins pour nous Pace qu'à c't'époque on connaissait pas la France alors quand on parlait de la Côte d'Azur nous ça nous disait rien puisqu'on avait la naute alors hein ! Pourquoi aller si loin quand on avait tout à la portée de la main, c'est pas vrai christian !
Christian : Bien sûr c'est vrai mais y faut reconnaître que la Côte d'Azur c'est beau aussi, seul 'ment y manque un peu plus de chaleur, on dirait que le soeil y chauffe pas autant que là-bas, p't'ête que lui aussi il nous punit d'avoir été des colonisateurs et y nous réchauffe pas autant ou alors c'est pour qu'on voit la différence. (Tu sais qu'à Marengo j'avais aussi d 'la famille ? Mon cousin Freddy il a été longtemps le goal de l'équipe de foot et j'ai mon cousin René qui est main'nant à Marseille qui a été à l'école d'ingénieurs Les Castors à Maison Carrée. Tiens, tu sais toi pourquoi on a appelé Maison Carrée ?
Joseph : Non, comment tu veux que j'le sache ? P'tête qu'à l'époque y avait une maison carrée où alors c'est pour rappeler qu'les Mosquées elles ont un minaret ? Mais le Minaret il est rond, alors j'comprends pas. Allez on va pas s'éterniser là-dessus hein ! D'toute façon on va pas y retourner main'nant alors ... Et p'tête que main'nant Maison Carrée elle s'appelle autrement va sa'oir... Ti as vu es nouveaux évènements qui nous mettent en présence main'nant ! Et toute cette histoire qui font avec ces policiers de Paris qui z'ont, y paraît, matraqué des arabes en 1961, tu comprends queque chose toi ? J'crois qui veulent en faire des martyrs. Qu'est-ce ti en penses toi !
Christian : J'en pense... Que ce que le Maire de Paris y vient de faire me laisse rêveur. Y s'rend pas compte de la connerie qu'y vient de faire et y a personne qui lui dit qui vient de commettre un délit pace que, écoute bien c'que j'vais te dire hein.
Tu t'souviens qu'après la guerre de 1940 les français de France y faisaient la chasse aux collaborateurs qui z' avaient traficotés avec les boches hein ! Bon, c'est vrai qu'y en a qui z'ont été un peu trop près des schleus, alors ils les z'ont attrapés et ils les z'ont mis devant les tribunaux pour collaboration avec l'ennemi. Tu m'suis
Joseph : Ouais j 'm'en rappelle mais où tu veux arriver avec çà ?
Christian : Eh ben oilà. La guerre d'Algérie c'était bien la guerre puisqu'on dit qu'c'était une guerre (suivez-moi) donc si c'était une guerre qui c'est qui z'étaient les ennemis hein ? Les fellouzes, autrement dit le F.L.N. donc ceux qui défilaient à Paris le 17 octobre 1961 y z'étaient bien des collabos ? Y fallaient donc les arrêter et les présenter devant un tribunal puisqu'y z'étaient des collabos de l'ennemi ? Et même y z'étaient les ennemis puisqu'y collectaient des fonds pour eux. Alors !... Et oilà que main'nant monsieur l'Maire y vient découvrir une plaque de commémoration pace qu'y a les policiers qui z'ont fait la chasse à ces collabos, moi j'comprends plus. En plus y dit qu'y commémore les Algériens ! Mais quels Algériens ? Il est fou ce Maire, puisqu'y z'étaient tous français et qu'y z'avaient la carte d'identité où y avait marqué français musulman, donc y z'étaient bien des français ; et l'Algérie c'était bien des départements français alors hein ! Moi j'crois que c'type là ( excusez mais j'vais êtes grossier ) c'mec là il est con et en plus y connaît pas l'histoire de sa France, ou alors y veut s 'mettre copain avec les Algériens et y sait pas comment faire alors y met des plaques. J'pense que l 'gouvernement y devrait poursuivre le Maire de Paris pour collaboration avec l'ennemi, puisque le FL, c'était l'ennemi. Tu comprends queque chose toi !
Et l'aute à la radio, çui qui fait l'émission "viens voir là-bas si j'y suis" tous les ans à la même époque y recommence la même émission sur les massacres de Charonne mais, y doit pas connaître les évènements d'l'Algérie pace qu'y fait motus sur le massacre de la rue d'Isly où c'étaient des français qui criaient vive la France qui z'ont été mitraillés par des soldats Français (remarque que main'nant je doute pace que c'était des tirailleurs algériens alors... et d'après c'que j'sais mais y faut pas l'dire c'étaient des fellouzes intégrés dans l'armée pour faire comme on dit la fusion, mais motus hein faut pas qu'ça se sache) et sur la tuerie d'Oran, le 5 juillet 1962, le général Katz y croyait qu'les accords y z' allaient ête respectés et il a dit aux troupes françaises de rentrer dans les casernes et de mette les armes aux rateliers, ouais mais quand les fellouzes y sont rentrés dans la ville y a eu la chasse aux français et d'après c'que j'sais y a eu non pas 40 morts comme à Paris mais plus de 2000 Français tués sous le couvert des accords qui n'étaient plus des accords vu qu'y avait qu'un seul camp qui les respectait. Ouais ! Je sais que c'est difficile à suivre mais y faut réfléchir encore un peu. Alors moi j'comprends plus rien, à croire qu'on est les pestiférés d 'la terre et que d'après ces gens là y z'auraient dû nous tuer tous comme ça eux y vivraient tranquilles comme Baptiste. Tu vois, moi, toutes ces choses me révoltent. Y veulent dire la vérité, alors qui disent toute la vérité et pas seulement pour nous assassiner une aute fois. Mais en France y'en a que pour les fellouzes, nous on était les colons alors haro sur les colons ?
Tu t'rappelles d 'la propagande qui se disait en France " L'Algérie nous coute très cher, c'est pour ça que les impôts y z'augment " Ouais c'était p't'ête vrai, mais y a longtemps qu'la guerre d'Algérie elle est terminée et les impôts y z'augment toujours, alors ?...Pour en revenir aux colons qu'on était, j 'pense qu'en France ils disent qu'y a pas de colons n'empêche que quand en 62 on est arrivé, du côté de Perpignan quand y z'ont fait les vendanges, les propriétaires agricoles, ouais chez eux c'est pas des cotons, y payaient 20 francs par jours les ouvriers qui ramassaient le raisin. Et ça, c'est pas être colons non ? Eh ben non, ici c'est des agriculteurs ou des viticulteurs comme tu veux, tu vois qu'y a une différence. Enfin comme on disait chez nous, pour nous tout ça c'est igual. Y diront c'qui voudront et y feront c'qu'y voudront, mais dans l'histoire d 'la France y pourront jamais nous effacer, y pourront pas ignorer les 130 années qu'on a passé là-bas, et p'tête qu'un jour l'histoire, la vraie, pas celle d'aujourd'hui, elle racontera pour de bon notre vie et le bien que nos anciens y z ont fait et ça, tu vois joseph, j'suis sûr qu'ça les emmerde.
Joseph : Ti'as raison, y z'ont du mal à avaler la pillule mais c'qui les emmerde le plus c'est que tous les pieds noirs que je connais on a tous réussi naute petite vie. R'garde moi, j'suis venu avec ma caisse à outils, j'ai relevé les manches et j'ai réussi à créer ma propre entreprise, bien sûr j'ai mangé d 'la vache enragée au début pace qu'y croyaient qu' j'étais un bon à rien et puis quand y z'ont commencé à me connaître j'ai pris la plupart des marchés qui s'ouvraient et comme j'étais toujours dans les délais de livraison, eh ben j'ai été réputé pour naute sérieux et main'nant j'suis à la retraite. Tu t'rends compte Christian que mon entreprise a fait toutes les boiseries de 15.000 logements et en plus j'faisais l'agencement de certains commerces alors hein !.... Ca mon frère c'est naute fierté, j'ai montré qu'on était pas des fainéants et qu'on savait travailler et ça aussi ça les emmerde.
Tu vois, le temps passe vite, on va bientôt s'quitter mais avant j'voudrais que tu m'parles un peu comment, ton arrière grand-père il a pu venir de son Alsace natale pour s'installer à Mercier Lacombe. 'Tu t'rends compte du chemin et à c't'époque ! Purée…
La Suite au prochain Numéro
| |
| Les Vers...
Envoyé par Bernard
| |
Une petite expérience valant mieux qu'un long discours, le pasteur décide qu'une démonstration donnerait plus de poids à son sermon du dimanche.
Il met 4 vers de terre dans 4 flacons : le premier ver dans un flacon d'alcool, le second dans un flacon plein de fumée de cigarette, le troisième dans un flacon de sperme, enfin le dernier, dans un flacon d'huile bien propre.
A la fin de son sermon, le pasteur donna les résultats de l'expérience :
- Le ver dans le flacon d'alcool est mort.
- Le second, dans le flacon plein de fumée de cigarette, est mort.
- Le troisième, dans le flacon de sperme, est mort.
- Le dernier, dans le flacon d'huile bien propre, a survécu.
Le pasteur demande à l'assemblée :
- Quels enseignements pouvons-nous retirer de cette démonstration ?
Et on entend la voix d'une petite vieille du fond de l'église :
- Tant qu'on boit, qu'on fume et qu'on fait la bagatelle, on n'aura pas de vers !
|
|
Le rêve de Carmelo Farrugia
|
Carmelo Farrugia n'était pas plus bête qu'un autre. Il avait même hérité de son père de cette forme d'intelligence pratique, bien plus adaptée aux problèmes de l'existence que tout ce que l'on peut apprendre à l'école.
Carmelo Farrugia savait à peine lire et écrire. Mais quelle importance. Personne n'a jamais demandé à un cocher maltais de Bab el-Khadra de réciter les fables de La Fontaine. Par contre, et c'était là l'essentiel, il connaissait Tunis comme la poche de son bleu de travail, la Médina autant les quartiers européens, et pouvait sans hésiter vous conduire dans n'importe quelle ruelle des souks des Tanneurs ou de celui des Parfums.
La veille, Carmelo Farrugia avait mis longtemps à s'endormir. Il réfléchissait encore en assistant à la première messe du matin, appelée ici " Messe des cochers "
En sortant de l'église du Sacré Cœur, sans doute inspiré par le bon Saint Paul, sa décision était prise.
Le soir même il rendit visite à son cousin Coco Zammit ; un Zammit de la rue Malta Srira, dont le frère " faisait boucherie chevaline " au marché central, à ne pas confondre avec son autre cousin, un Coco Zammit lui aussi, celui qui s'était marié avec la plus jeune des filles Caruana de la rue de Monastir, et qui lui, tenait un éventaire de salaisons au marché de Bab el-Khadra.
Les deux cousins s'étaient assis devant un verre d'anisette accompagné de sa kémia.
- Je suis venu te voir, dit Carmelo Farrugia, parce que tu connais les automobiles aussi bien que moi je connais les chevaux.
- C'est vrai, je n'ai plus rien à apprendre en mécanique. Mais je suis surtout un spécialiste pour les Renault, mais aussi pour les Citroën, et je me débrouille pas mal dans les autres marques, répondit Coco Zammit d'un ton modeste.
Il but une goutte d'anisette avant de demander :
- Pourquoi ta question ? Tu veux t'acheter une automobile à présent ?
- Iva ! Mais pas pour me promener jusqu'à La Goulette le dimanche, pour faire le taxi-bébé.
Coco n'en revenait pas.
- Toi, taxi ?
- Oui, pourquoi ? C'est un miracle à t'entendre ?
- C'est pas un miracle ; mais cocher, c'était quand même le métier de ton père, répondit Coco Zammit.
L'argument porta. Carmelo Farrugia se rendait bien compte que sa décision représentait un sacrilège. Une réticence qu'il s'était employé à vaincre depuis que cette idée lui avait traversé l'esprit.
- C'est quand même pas de la faute de mon pauvre père si de nos jours les taxis nous mangent la laine sur le dos. Bientôt, à Tunis, il n'y aura plus que les vieux, ceux qui ont peur des automobiles, qui prendront nos karrozzins, dit-il, un ton plus haut.
- Ne t'énerve pas. Je te disais ça sans malice. Alors tu es décidé à faire le taxi, et tu veux que je t'aide si j'ai bien compris ?
Carmelo Farrugia approuva d'un geste de la main.
- Tu sais que je n'ai rien à te refuser. Bon, comment tu vois ton affaire ? demanda Coco Zammit.
- Tu es mécanicien. Tu peux peut-être m'apprendre à conduire, et m'expliquer un peu de mécanique en même temps. Pour la licence, je m'en occupe par une connaissance qui est bien placée à la Résidence. Après, tu me trouveras une quatre chevaux, une bonne occasion, et surtout pas trop chère.
- C'est comme si c'était fait, lui dit son cousin en lui servant un autre verre. Et tu verras, tu apprendras vite. Nous, les Maltais, nous avons la voiture dans le sang.
- Une quatre chevaux, c'est après tout qu'un gros attelage, en conclut Carmelo.
Ils se donnèrent rendez-vous pour le dimanche suivant avant de trinquer à nouveau. La nouvelle méritait bien une troisième tournée.
Carmelo Farrugia avait franchi un premier obstacle. Ne lui restait plus qu'à décider son épouse, fille de cocher, née elle aussi au-dessus de l'une de ces écuries maltaises bordant l'avenue Garros. Pour y parvenir, il eut l'habilité de lui parler de sous, de gros sous. Gracieuse ferma alors les yeux. Elle se vit habillée comme une métropolitaine, couverte de bijoux comme Mme Bismuth, allant le dimanche en famille déguster un poisson complet à La Goulette. Elle accepta sans trop de réticences.
Ainsi, Carmelo Farrugia vendit sa calèche et son cheval et devint propriétaire d'un taxi-bébé.
Jamais, avant cette fameuse nuit, il ne regretta sa décision. L'abondance régnait chez les Farrugia de Bâb el-Khadra. Les cochers du quartier avaient de plus en plus de mal à nourrir leur famille et leurs chevaux. Gracieuse Farrugia se pavanait à la messe du dimanche dans des robes qu'elle achetait désormais dans les magasins de la rue de France.
Puis il y eut ce rêve. Et Carmelo, à l'image de bien des habitants du quartier, croyait aux messages contenus dans les rêves.
Son père lui apparut dans son sommeil. Celui-ci, dans sa tenue de cocher, son fouet à la main, portait sur son visage toute la misère du monde.
- Mon fils, qu'as-tu fait ? Lui dit-il d'une voix où se lisait sa détresse. Tu as vendu la karrozzin qui appartenait à mon père, qui déjà la tenait du sien. Ton geste aura des conséquences graves, mon fils. Des conséquences dont tu porteras seul la responsabilité.
Ceci étant dit, le père s'éloigna en courbant l'échine. Gracieuse, éveillée en sursaut, découvrit son époux à genoux sur le tapis, bras ouverts, suppliant la Madone, les saints du paradis et tous ses morts de lui pardonner son crime.
Ce rêve bouleversa l'existence de Carmelo Farrugia qui, de ce jour, ne vivait plus que dans l'attente de la punition annoncée par son père.
Puis l'événement politique s'emballa. Ce fut ainsi, qu'un beau matin, Carmelo Farrugia et bien d'autres Maltais, accompagnés de Siciliens et de Juifs de Tunis, certains pleurant dans leur mouchoir, d'autres serrant les poings, virent disparaître au loin le port de La Goulette. Ils quittaient le pays où étaient nés leurs ancêtres, laissant derrière eux leur église, leur synagogue et leur cimetière.
En vous promenant à Marseille, quartier de Sainte Marguerite, peut-être pourrez-vous rencontrer Carmelo Farrugia. Si vous lui demandez de vous raconter la fin de son histoire, voici ce qu'il vous dira :
Le nationalisme tunisien, Bourguiba, l'arrivée au pouvoir de Pierre Mendés France, l'indépendance de la Tunisie et le départ des Européens, ne représentèrent que les péripéties de la punition que son père lui avait infligée.
***
|
|
"Tunisie de notre enfance."
|
|
POUR TOUTE COMMANDE INTERNET
MERCI D'INDIQUER VOS COORDONNEES COMPLETES
A imprimer, à découper et à envoyer
Nom - Prénom : ........................................................
Adresse : ..............................................................
Code Postal : .........................................................
Ville : ....................................................................
Tel… : ...................................................................
Email : ...................................................................
PRIX UNITAIRE TTC : 15 €
Frais de port 2,11 f (pour un livre)
2,90f pour 2 ou 3 livres)
Dès réception de votre règlement :
à EDITIONS L'INFINI
29 Rue EDOUARD SCOFFIER - 06300 NICE
Tel & fax : 04 89 92 36 31
Email :CLaude RIZZO
Nous vous ferons parvenir votre commande dans les meilleurs délais. Merci.
|
|
|
| COLONISATION de L'ALGERIE
1843 Par ENFANTIN N° 22
| |
IIème PARTIE
COLONISATION EUROPÉENNE
PERSONNEL ET MATÉRIEL DES COLONIES CIVILES ET MILITAIRES.
XVIII. J'ai parlé de retraite et de durée de service, c'est le moment d'expliquer ces mots.
Tous les soldats colons seraient pris parmi les jeunes soldats entrés sous les drapeaux depuis une année ou deux au plus ; ils auraient donc encore environ six années à faire : c'est là ce que j'appelle la durée de leur engagement colonial.
L'abandon ou le renvoi de la colonie, et toute condamnation infamante, feraient perdre le droit à ce que j'ai nommé la retraite. Celle-ci serait le produit capitalisé du revenu attribué chaque année au soldat, pour sa part dans le produit net du travail, augmentée de la répartition de toutes les parts abandonnées ou perdues par les manquants. Elle serait personnelle et ne serait acquise qu'au terme fixé; elle serait, en outre, distincte de la masse proprement dite, et ne serait pas susceptible de retenues ou d'imputations. Les recrues annuelles des colonies auraient leur compte ouvert sur ce fonds de retraite, depuis l'année de leur arrivée.
Après l'expiration, de la durée de cet engagement colonial, les soldats qui consentiraient à un second engagement auraient une part plus forte que la part individuelle générale, et ils toucheraient d'ailleurs la retraite acquise par le premier engagement, avec faculté de la laisser capitaliser dans les caisses de l'État, jusqu'à la fin du second engagement.
L'abandon de la colonie, qui ferait perdre le droit à la retraite, ne serait possible qu'après deux années au moins de service colonial et le soldat colon rentrerait dans l'armée active, où il achèverait son temps ; il serait privé de cette faculté, dans le cas dont il va être question.
Tout soldat colon pourrait être autorisé à faire venir dans la colonie son père et sa mère, ou l'un de ses parents marié. Il pourrait même être autorisé à s'y marier lui -même. Les familles ainsi autorisées feraient partie du corps, comme auxiliaires et seraient particulièrement chargées des travaux intérieurs et des jardins ; elles formeraient une division ou compagnie spéciale, sous les ordres et la haute surveillance du major, qui remplirait d'ailleurs, pour toute la colonie, les fonctions d'officier civil.
Les autorisations d'admission de colons civils, parents des soldats colons, ainsi que les permis de mariage, seraient délivrés par le Gouverneur général, sur la demande directe de chaque chef de colonie.
En cas de mariage du soldat colon, l'abandon de la colonie ; et la rentrée dans l'armée, avant l'expiration du temps de service, ne sont plus possibles.
XIX. - Je ne me permettrai pas d'entrer plus avant dans les détails d'organisation de ces colonies, quant à leur discipline, leur hiérarchie, leur justice ; tout cela existe déjà dans l'armée, et les modifications qui pourront être nécessaires ne sont pas importantes, et viendront peu à peu, avec l'expérience des besoins de cette nouvelle position militaire. "
Cependant, j'ai à coeur de traiter un sujet qui, dans l'armée active, a été jusqu'ici le motif de continuels débats, d'accusations et récriminations affligeantes. Je veux parler de l'administration, et spécialement de l'intendance.
Dans l'armée, dont la mission est de faire la guerre, et qui doit être pourvue par l'État des moyens de la faire, de sorte qu'elle puisse s'y consacrer entièrement, il a toujours été très difficile d'unir convenablement l'armée qui combat aux personnes chargées de la pourvoir. On a essayé bien des moyens, j'examinerai tout à l'heure si le moyen actuellement employé est le meilleur; mais ce dont je suis convaincu, c'est que s'il est bon, appliqué à une armée qui combat, il est tout à fait mauvais pour une armée qui cultive, et qui doit être animée elle-même, au plus haut degré, de l'esprit de pourvoyance, sous peine de faiblesse et de mort.
Dans des colonies militaires, la division entre les fonctions ne doit plus être, à beaucoup près, aussi tranchée ; c'est une simple division de travail, pour un but commun : car des militaires colons doivent nécessairement être, en même temps, soldats et pourvoyeurs, tantôt l'un tantôt l'autre, aptes aux deux fonctions.
Il n'en est pas ainsi pour l'armée active; on veut que celle-ci tienne toujours l'épée en main, elle ne peut tenir la plume que de la main gauche. Le colon militaire doit aller un jour au combat, l'autre jour à la charrue, quelquefois aux deux le même jour ; il doit être ambidextre. Sans doute il en résultera un peu de médiocrité militaire et un peu de médiocrité agricole, mais c'est inévitable ; un soldat colon n'est pas un soldat, n'est pas un laboureur, c'est un soldat-laboureur : seulement, il faut que nous ayons de vrais soldats-laboureurs, et non des personnages de comédie politique ou de vaudeville ; et ceux de l'Algérie doivent être plus réellement politiques et dramatiques que ceux du Champ-d'Asyle.
Je disais donc qu'il avait été difficile d'unir convenablement les combattants et les pourvoyeurs, je me sers exprès de ce mot, parce que moi qui estime beaucoup la fonction, je sais qu'elle est d'autant moins appréciée par les combattants, qu'on cherche à lui donner un, lustre qui n'est pas le sien et qui appartient de droit et exclusivement au combattant.
Prenons encore l'exemple du corps du génie, qui, sauf dans une guerre de siège, est le corps le moins combattant de l'armée, et dont pourtant l'union complète avec I'armée n'excite pas la susceptibilité militaire. Pourquoi l'assimilation ou l'identité même, ici, est-elle possible, et pourquoi semble-t-elle impossible pour l'intendance? Le génie pourvoit l'armée de son casernement, de .ses moyens de défense ; il a un maniement de fonds assez considérable, des marchés à faire, des magasins et ateliers nombreux; enfin, en Algérie surtout, il paye à tous les soldats qu'il emploie en dehors de sa propre troupe, une solde pour leur travail. Est-ce donc seulement parce qu'il fait des sièges? -- Non ; c'est, avant tout, parce qu'il forme corps, et que l'organisation de ce corps est faite de manière à donner aux hommes qui le composent la capacité et la moralité que leur fonction réclame.
L'intendance embrasse tous les comptables des vivres, des fourrages, du campement, du casernement, le corps médical, le corps du train dès, équipages, celui des ouvriers d'administration; enfin c'est une véritable armée à côté de l'armée, je ne dis pas dans l'armée, elle n'y est pas, quoi qu'elle en pense, et quoique la loi, les ordonnances et arrêtés le disent. Et elle souffre, et l'armée souffre de cette contradiction du fait avec le droit ; de là, des prétentions d'une part et un orgueil de l'autre, qui ne sont pas les conditions de l'harmonie désirable ; de là aussi des vices réels et des plaintes exagérées.
L'intendance ne forme pas corps, ai-je dit en effet, quelle relation y a-t-il entre les diverses spécialités qui dépendent d'elle ? Quel rapport existe-t-il entre la fonction de chacune de ces spécialités, et les études ou l'apprentissage des personnes qui dirigent, sous le nom d'intendant, toutes ces spécialités ?
La relation qui existe entre les spécialités de l'intendance, est, par rapport à l'armée, négative ou positive :
1° Elles se ressemblent, parce que les individus qui les composent ne sont pas combattants; ceci prouve bien qu'ils doivent être en dehors des combattants, et ne pas être traités comme eux; mais cela n'indique pas où ils doivent être, et comment ils doivent être traités.
2° Elles se ressemblent encore, parce qu'elles sont toutes utiles à l'armée qui combat ; ceci indique seulement qu'elles doivent être avec elle et former avec elle- une armée complète de combattants et de pourvoyeurs; mais ce n'est pas là encore ce qui peut déterminer le lien d'organisation qui doit faire de toutes ces spécialités un corps, l'administration de la guerre.
Il y a, dans toutes les écoles militaires, d'infanterie, de cavalerie, du génie; de l'artillerie et de l'état-major, des cours d'administration militaire; tout le monde sait que ceux des élèves qui s'en occupent avec le plus de zèle, n/y cherchent naturellement que ce qu'ils savent pouvoir leur être spécialement utile un jour, c'est-à-dire l'administration de la troupe qu'ils commanderont. Mais y a-t-il une école spéciale pour l'intendance? -- Non. Ce corps manque donc déjà par la base; et certes, si des hommes sont chargés de pourvoir à tous les. besoins d'une armée, afin que, pouvant se reposer sur eux de ces soins , elle soit constamment préparée pour le combat, il semble qu'il faudrait au moins exiger de ces hommes des études spéciales aussi fortes que celles auxquelles on oblige un officier du génie.
Mais s'il n'y a pas d'études préalables obligatoires, et des concours qui soient une garantie de capacité, y a-t-il au moins un apprentissage, analogue à celui qu'on impose à l'état-major, un' apprentissage dans les spécialités importantes qui composent la portion de l'armée que les intendants administrent et dirigent ? -- Non, encore. - Les officiers d'état-major ne font pas de stage dans les hôpitaux et dans le train des équipages, et ils n'en font pas non plus dans le génie et dans l'artillerie; mais ils en font dans l'infanterie et la cavalerie, parce que ce sont les deux corps essentiellement combattants. De même, je ne parle pas de faire faire aux intendants un apprentissage dans les corps combattants (et c'est malheureusement en quelque sorte ce qui se fait, puisque l'intendance se recrute presque uniquement là) je ne demande pas même que les futurs intendants fassent un stage dans chacun des branches de l'administration, mais il me paraît indispensable qu'ils en fassent un au moins dans le service des vivres et dans celui des hôpitaux.
Quel rapport, par exemple, peut-il y avoir aujourd'hui entre les intendants et les médecins, qui sont pourtant sous leur dépendance, qui attendent d'eux leur avancement, leur emploi spécial, leur déplacement et même l'éloge ou le blâme, bien plus ! Une autorisation ou une défense pour tel ou tel procédé ou remède médical? A quel titre les intendants peuvent-ils se permettre d'intervenir dans les conseils de l'armée, quoiqu'ils aient le corps médical sous leurs ordres, chaque fois qu'il est question de mesures hygiéniques à prendre, soit pour l'armée en campagne, soit pour fonder une ville, établir un camp bâtir une caserne, un hôpital en Algérie? Où ont-ils appris l'hygiène? - Aussi, combien d'erreurs déplorables ont été commises !
Mais quel rapport surtout (c'est le point délicat) entre les intendants et les comptables? - Celui de surveillant et de soupçonné; ce n'est pas là de la hiérarchie de corps, c'est de la police, dans laquelle le surveillant et le surveillé doivent presque inévitablement perdre leur moralité. Je parle en termes généraux qui permettent assez largement l'exception.
C'est bien autre chose encore pour le train des équipages, les ouvriers d'administration et les infirmiers, c'est à dire les trois parties de l'administration qui ont une troupe et une troupe assez nombreuse, fort utile, composée d'hommes vigoureux (le train), adroits (les ouvriers) ; j'avoue que je ne sais pas bien l'épithète que méritent les infirmiers, mais aussi ces derniers sont les parias, à peine s'ils ont des sous-officiers. Ils, ne peuvent être qualifiés. Dans quelle route ces trois corps de l'intendance conduisent-ils les hommes qui s'y distinguent; les conduisent-ils à l'intendance? - Pas le moins du monde. De là, le peu d'estime dont jouissent ces corps, même dans l'administration militaire, malgré les services qu'ils rendent ; de là aussi, les vices qui peuvent être reprochés à ces corps; car l'absence de considération que méritent l'importance de la fonction et les qualités qu'elle exige, empêche beaucoup d'hommes qui possèdent ces qualités, de s'engager dans ces tristes impasses.
J'ai vu et beaucoup vu en Algérie tous les corps de l'administration ; ils n'y jouissent pas, à beaucoup près, de l'estime que, selon moi, leur fonction mérite, et même de celle qui leur est due pour la manière dont, avec leur imparfaite organisation, ils la remplissent ; d'un autre côté, je suis convaincu que, parmi les plaintes soulevées par l'administration, il y en a beaucoup qui sont fondées ; mais, je le répète, ces plaintes fondées, qui tiennent très souvent à la qualité des personnes, ont pour première cause la fausse organisation de ces corps, qui en éloigne plusieurs des bons éléments naturels , et pour seconde cause, le peu de ressort de cette organisation, pour faire résister ses membres à la tentation du mal.
Ce n'est pourtant pas cette raison qui me fait repousser, pour les colonies militaires, l'idée d'une division tranchée entre la direction et l'administration; j'ai dit le véritable motif, et ce motif suffirait, quand bien même l'intendance de l'armée serait mieux organisée. D'ailleurs, il s'en faut de beaucoup que cette exclusion de l'intendance, quant à l'administration intérieure des colonies militaires, porte sur les corps qui dépendent de l'intendance elle-même; je crois, au contraire, et je l'ai déjà dit, que le train, les ouvriers, le corps médical et les infirmiers, doivent contribuer, pour une très large part, à la composition du personnel des colonies militaires ; et de même, ces corps peuvent rendre d'immenses services pour l'organisation des colonies civiles.
Je ne l'ai pas dit lorsque je m'occupais de ces colonies, afin de réunir en un seul point tout ce qui se rapporte à ce sujet ; mais c'est précisément parce que l'administration de la guerre n'est pas un corps combattant, qu'elle serait très utile pour les colonies civiles, si elle pouvait se dépouiller un peu de ses prétentions à l'épée et à l'épaulette, et devenir davantage ce qu'elle devrait être : un corps industrieux, intermédiaire entre l'armée qui consomme et la société qui produit , véritable .économe , oui, économe (1) ! Alors, ce corps, pourvoyeur des économes de l'armée, serait pour elle et pour les colonies une providence. Si un bon général est le père de ses soldats, un bon intendant serait leur mère.
Les noms ne sont pas inutiles aux choses; lé nom d'intendant est mauvais, c'est un nom d'autrefois, ce n'est pas celui de, nos jours. Les militaires qui l'ont donné à l'administration de la guerre ont agi sous l'influence des vieux souvenirs de la noblesse d'épée ; considérant le corps qui touche le vil métal, l'ignoble matériel de la vie, et qui tient la plume et noircit du papier, comme le premier de leurs serviteurs, ils l'ont nommé leur intendant : à qui donc la première faute pour tout ce dont ils se plaignent? Tout le monde ne sait-il pas ce que signifie ce mot?
Malgré ce triple vice, absence d'organisation, prétentions mal fondées, et même mépris des titres véritables que l'on devrait avoir, je le répète, les différents corps de l'intendance rendent des services qui ne sont pas payés de la reconnaissance qu'ils méritent. C'est l'administration elle-même qui souffre le plus de la fausse position où elle se trouve, et j'admire profondément ceux de ses membres, bien plus nombreux qu'on ne pense, qui portent si injustement la responsabilité des vices du corps, et dont la conduite honorable et dévouée mériterait une récompense exempte de cette affligeante solidarité.
Lorsque, dans les grandes expéditions, je voyais ces lourds bagages, ces longs convois, marchant sous l'escorte des régiments et conduits par les vigoureux , les infatigables soldats muletiers du train des équipages et de l'administration; lorsqu'arrivé au lieu de campement, je voyais ces hommes décharger les bagages et repartir encore chercher des fourrages, vider des silos, tandis que les régiments gardaient le camp, nettoyaient leurs armes, s'organisaient pour la nuit; alors, je songeais aux colonies, et je me demandais si ce n'était pas là le principal contingent que l'armée pourrait donner à la colonisation de l'Algérie. Voilà des hommes qui, malgré leur titre de soldat, travaillent; ces mêmes hommes, flans les villes, transportent les fourrages, mesurent et emmagasinent les grains ; ils sont bouchers, boulangers, meuniers, charpentiers, menuisiers, maçons; ils sont charretiers, muletiers, charrons, bourreliers; ils portent, à la vérité, l'uniforme militaire et savent l'honorer ; ils portent des fusils et savent s'en servir; mais personne ne s'y trompe, excepté quelquefois eux-mêmes, par réaction d'un amour propre aveugle; personne ne s'y trompe, dis-je, ce sont des artisans actifs et braves, ce ne sont pas là des soldats.
Plusieurs des questions qui intéressent l'organisation des colonies civiles et celle des colonies militaires n'ont pas trouvé place dans cette SECONDE PARTIE ; quelques unes ont été seulement indiquées, d'autres n'ont pas même été soulevées, et particulièrement celles qui exprimeraient les relations qui doivent exister entre les colonies civiles et les colonies militaires, et plus généralement entre ces colonies de deux espèces et l'autorité de nature différente de la leur; enfin, je n'ai pas dit leurs rapports avec les tribus indigènes.
En général, je renvoie à la Conclusion ce qui est. Gouvernemental dans cette grande entreprise, et je vais compléter, dans la TROISIÈME PARTIE, ce qui touche à l'organisation intérieure des colonies civiles et militaires, en m'occupant de 1'ORGANISATION DES INDIGÈNES.
(1) Il est remarquable de voir combien l'intendance est étrangère aux principes élémentaires de l'économie politique; ou plutôt : cela est naturel où, pourquoi et par qui les apprendrait-elle?
A SUIVRE
|
| |
Vais je souffler les 45 bougies de cet anniversaire aujourd'hui ?
Voilà exactement 45 ans que je quittais Alger.
A 17 ans, c'était comme si on partait en vacances.
Des vacances en France !!! Comme toutes les annés précédentes.
Pour ne pas trainer son ennui durant les trois mois d'été.
Certains parmi vous connaissent déjà le texte que je vous joins.
Je pourrais presque vous le réciter.
45 ans après, tout est encore frais dans ma mémoire.
Bien à vous
JPF
-Mon général, tous ces gens vont souffrir !
-Et bien, qu'ils souffrent ! Avait répondu De Gaulle
Je venais d'avoir dix-sept ans à Alger, le dix huit Avril 1962.
Le 26 Mars est passé avec son cortège de représailles de l'OAS aux attentats du FLN et les réponses aux Barbouzes, missionnés par Paris, dont les portraits ornaient toujours les murs d'Alger.
Le mot d'ordre du FLN est : " La valise ou le cercueil ! " L'OAS, notre Résistance répondait : " ni valise, ni cercueil, cette terre est française et nous nous battons pour qu'elle le reste malgré les volte-face incessantes du pouvoir parisien. "
La liste des assassinés de la fusillade de la rue d'Isly du 26 Mars était collée partout. On lisait les noms pour n'avoir pas la malchance d'y trouver celui d'un ami ou un parent.
L'atmosphère était bizarre, lourde, chargée d'électricité.
Malgré les actions militaires, nous entendions cependant que des pourparlers auraient lieu entre FLN et OAS, pour mettre fin à tous ces massacres et pouvoir continuer à vivre ensemble.
Rien cependant ne pouvait arrêter, tous les soirs, nos concerts de casseroles qui scandaient : " Algérie Française, Algérie Française ! ", ni nous faire ôter les drapeaux tricolores que nous avions tous mis à nos fenêtres ou balcons, même si la statue de Jeanne d'Arc, près de la Grande Poste avait été recouverte d'une poubelle une nuit.
Le général Salan avait été arrêté. Sa photo avait paru à la Une de l'Echo d'Alger, de la Dépêche Quotidienne et du Journal d'Alger. Il avait les cheveux teints en brun et une moustache épaisse de la même couleur. Il était à peine reconnaissable.
Certains généraux qui avaient quitté l'armée régulière pour rejoindre l'OAS, préconisaient la tactique de la terre brûlée. Si nous devions partir, il fallait détruire le maximum de sites nécessaires à la vie de tous les jours, si les négociations avec le FLN échouaient. D'autres préféraient des actions violentes contre les positions des CRS, Gardes Mobiles et autres représentations de l'Etat qui nous avait abandonnés.
Nous découvrions des mouvements de civils vers le Port ou l'Aéroport de Maison Blanche. Personne n'osait avouer partir: " Nous avons pris un aller-retour pour mettre les enfants à l'abri dans de la famille en France et nous reviendrons; C'est sur! Que voulez-vous que nous fassions là-bas ? Nous n'avons rien. Toute notre vie est ici ainsi que notre travail." Cependant, des cadres de déménagement avalaient, ici ou là, les meubles qui partiraient. Certains, par peur de représailles déménageaient le soir, à la limite du couvre-feu. Ils partaient sans dire au revoir. Sans dire " Adieu ". Des femmes seules avec des enfants, parfois accompagnés de leurs vieux parents. Des familles entières, les hommes la tête baissée. Ils avaient honte car ils avaient peur. Ils avaient peur d'avoir pris cette décision. Partir. Protéger mes enfants, ma femme…Mais ils savaient tous au fond d'eux-mêmes qu'ils ne reviendraient jamais. Ils partaient à l'aventure. Comme leurs arrières grands parents venus ici en pionniers, mais en sens inverse. Les uns regardaient devant le pays neuf qui s'ouvrait à eux. Les autres baissaient la tête pour ne pas voir le pays qu'ils abandonnaient. Ne plus le voir. Ne plus le sentir.
D'autres les suivront dans quelques jours, quelques semaines. Mais personne ne voulait l'avouer, se l'avouer. Partir dans la famille, en France. Mais quelle famille, nous les Martinez, Gonzales, Ferrer, Soler, Trani, Camilleri, de Ubéda, Jover, Bensoussan, Teboul, Catala, Pons ? Nulle part. Nous étions tous d'ici. Nous ne connaissions même plus les origines de nos ancêtres arrivés en Algérie très tôt. Trois de mes grands-parents sont nés à Alger au début des années 1860.
Désœuvré, puisqu'il n'y avait plus de classe depuis Février, je passais les après-midi à la Piscine toute bleue du RUA. Nous retrouvions des copains du Lycée Gautier ou du Hand. Avec le RUA, j'allais être champion d'Alger, cette année. Magnifique maillot bleu ciel et blanc. Allongé sur les énormes cubes de béton brise-lames de la digue qui fermait à la houle l'accès au port. Nous bronzions. Nous faisions des matchs de volley à trois contre trois. Et nous piquions une tête dans l'eau salée et fraîche de la piscine. De combien de flirts, de fiancées la Piscine avait-elle été témoin ? Nous étions tous beaux, bien bronzés. La mode à Alger, pour les garçons était, à cette époque, des petits shorts de coton blancs ou de couleurs, à carreaux, serrés, enfilés sur le slip de bain; Les filles portaient des bikinis à balconnets, certaines avaient un petit volant qui décorait slips et soutiens-gorge. Nous étions beaux. Notre race qui se créait était belle. Le sel et le soleil éclaircissaient nos cheveux et rendaient nos yeux plus brillants.
Il n'y avait déjà plus grande affluence autour du bassin ou sur les gradins. Il n'y avait plus de matchs de Water-polo et peu d'entraînement de natation. Rares étaient les courageux qui se lançaient du plongeoir recouvert de carrelages azur. Le grand amusement était de courir le long de la piscine et de se jeter au ras du bord en provoquant une belle vague qui inondait les quelques naïades qui bronzaient sur leurs serviettes. Ils volaient au soleil, sans le savoir, leurs derniers rayons algériens. En haut, allongés sur les blocs, nous regardions Alger descendre en cascades blanches vers la mer. Tout à droite, L'Amirauté surveillait les quelques bateaux de plaisance et barques ancrés qui tanguaient paresseusement, fatigués par ce soleil intense. Tout à gauche, vraiment à l'extrémité de la baie, le Cap Matifou dont nous pouvions découvrir, le soir, le manège lumineux de son phare.
Mon dieu, que c'était beau!
Plus près, nous apercevions le Kairouan, le Ville de Marseille, non, le Ville d'Alger, je te dis, et les petits Sidi Mabrouk ou Sidi Ferruch. Le Kairouan se distinguait plus facilement, tout blanc et plus majestueux. Le Kairouan, que j'avais pris plusieurs fois pour aller en colonie de vacances en Métropole, c'est ainsi qu'on nous avait appris à parler de notre mère la France, ne mettait à peine que dix huit heures pour aller d'Alger à Marseille. Alors qu'il en fallait aux autres entre vingt et vingt deux.
Ces paquebots longeaient, le soir, les Iles Baléares et, nous attendions ce moment pour découvrir dans le noir, au loin, les petits scintillements lumineux des maisons. Dans la journée, nous comptions les marsouins qui nous accompagnaient en sautant gracieusement, en cadence, de part et d'autre du bateau. Ils étaient infatigables. Leur peau semblaient huilée.
Quand nous revenions à Alger, après le mois passé en colonie de vacances, - pour changer l'air de nos poumons qu'ils disaient nos parents - dès six heures du matin les voyageurs se dirigeaient à l'avant du bateau.
Au loin, d'abord une simple ligne violette. Puis un trait plus épais irrégulier gris foncé embrumé décorait l'horizon.
Et puis, soudain, la merveille ! Alger se dessinait sous les premiers rayons roses du soleil.
" Tu crois qu'on voit notre maison? "
" Et le Fort l'Empereur! "
" Ty as pas pris ton appareil Kodak ? Mais ty es couillon, ou quoi ? Pourtant, c'est pas le soleil du nord qui t'a fondu la cervelle! Regarde à droite on commence à deviner la Mosquée de la place du Gouvernement! Ty as vu comme c'est blanc, purée, comme c'est beau! C'est pas comme Marseille, à part le château d'If, y a que les montagnes de derrière qu'elles sont blanches! C'est pas la neige, des fois, que c'est le nord là-bas? "
" Arrête, tu l'as dit que c'est le nord, j'ai compris. A Marseille, c'est des rochers qui sont calcaireux! Voilà pourquoi c'est blanc (sic) "
Oui, c'est peut-être une dernière fois que je vois Alger comme ça. Il est l'heure de rentrer. Une douche rapide dans les vestiaires humides. On se rhabille. Vite, il faut prendre le canot de Négro pour nous ramener sur le quai. On lui laisse vingt francs d'avant-avant, des centimes, quoi, le pôvre! Et on danse tous sur une jambe, puis sur l'autre pour faire bouger la barque. C'était toujours la même chose. Et Négro qui fait semblant d'être en colère. On ne voit que ses dents blanches sous son chapeau de paille effrangé.
Avec Mahfoud, on traversait le port. Toujours aux mêmes endroits le goudron est mou de la chaleur de la journée. On s'enfonçait un peu.
Nous flânions pendant le trajet du retour au quartier Mulhouse-Danton. Il faisait doux. Notre peau gorgée de sel et de soleil craquait un peu. On se disait " à demain ". Mahfoud ouvrait le portail métallique qui grinçait et descendait chez lui. Aujourd'hui, j'étais seul. Mahfoud et sa famille avait quitté le quartier pour se mettre aussi à l'abri. Tout le monde craignait tout le monde. Même les amis de toujours. On était ensemble depuis la Maternelle. Depuis toujours.
Je rentre dans la boulangerie de mes parents, étrangement silencieuse. Ma mère a l'air toute tristounette. Mon père ne chante pas, comme d'habitude, de sa voix de stentor.
Il s'adresse à moi : " Monte dans ta chambre, j'ai acheté des valises. Tu fais comme ta sœur, tu prends le plus de vêtements que tu peux sans oublier tes affaires de classe! "
Moi : " C'est quoi cette histoire ? Pourquoi des valises ? Où va-t-on ? "
Mon père: " Te fais pas de soucis! Demain vous prenez l'avion "
Moi: " L'AVION ? On s'en va pour de bon ? Où? "
Mon père: " D'abord à Marseille, après vous irez à la Gare prendre un billet pour Voiron (près de Grenoble). Vous rejoindrez vos cousins Michèle et Alain qui sont chez leur tante Gabrielle. Tu te souviens? On y est allé, il y a deux étés. Ta marraine Denise, elle est de là-bas, tu te rappelles que Gabrielle, c'est sa sœur? "
Merde! C'est vrai ? C'est la fin, alors ?
Je monte dans les chambres, silencieux, en appuyant mes pieds hargneux sur les marches d'escalier en bois. Marif est déjà en train de remplir sa valise. Elle pleure en silence. Je choisis ce que je vais emporter. Je n'oublie pas le dictionnaire Latin-Français Gaffiot et les Bordas de littérature. Comment vais-je caser tout çà? Il faut mettre quelques vêtements chauds quand même. On n'en a pas beaucoup, nous. J'allais oublier mon maillot du RUA…
Voilà, c'est fait! Mémée Cerdan, ma grand-mère maternelle, me regarde en grignotant des cacahuètes toutes chaudes que le moutchou du coin a fait griller dans le four de la boulangerie.
Je redescends au magasin. Abasourdi. Ecrasé. Ce n'est pas possible ! Partir! Tout laisser!
Je sors comme un somnambule; personne n'est assis sur les trois marches de la Boulangerie. Sur la façade à gauche, la signature en lettres anglaises :
J. Ferrer.
Le J pour Jacques, mon grand-père qui était le propriétaire du magasin. Et pour Joseph, mon père qui en était le gérant. Il réinvestissait toujours ses gains pour moderniser la petite boulangerie.
Je remonte la rue Danton, pour une dernière fois.
Que de matches de foot avec une balle de tennis ou de mousse y avions nous faîtes ! Combien de courses de vélo avait-elle vues ! Combien de tours de France avec des capsules de limonade avaient noirci nos genoux et nos mains !
Les Géro ont mis les volets de bois sur les portes vitrées de leur petite ébénisterie et ont rejoint leur appartement des Escaliers Cornuz.
Puis, je passe devant notre garage aux grandes portes de bois gris dont le bas, rongé par l'âge et les arrosages répétés de la rue, a laissé suffisamment d'espace au passage des rats. Les lettres OAS y avaient été écrites en gros à la craie.
En face, mon grand-père paternel. Je lui dirai au revoir tout à l'heure. Je continue. Je touche chaque mur, je caresse chaque porte d'immeuble. Je regarde les trottoirs où nous jouions aux noyaux ou aux roseaux, il y a quelques années. L'épicerie des Cassoba est déjà fermée.
La Traction Avant Noire de Sauveur, avec son aile avant gauche déchirée est stationnée devant chez lui. Un soir en jouant tout seul au foot je m'étais déchiré la cuisse avec ce bout de métal qui pendait sous le gros phare en acier inoxydable en forme d'obus. Le jean n'avait pas été déchiré mais la peau me piquait et je ne pouvais rien voir tant que je ne l'aurais pas enlevé avant de me coucher.
Les Cuénoud sont à table. Je vois la famille nombreuse au travers du rideau qui les isole légèrement de la rue. La Vespa-125 Vert métallisé d'André est garée près de la fenêtre. Il y a avec eux Rodrigue, un jeune appelé du Contingent, venu de Istres. Il est tombé amoureux de la plus jeune des filles Cuénoud. Il tournait pendant des heures dans le quartier pour la voir sans oser lui parler, parfois en bravant le couvre-feu. Il s'asseyait sur les couvercles des poubelles et attendait. Aujourd'hui, ils sont mariés et vivent dans la région de Marseille-Istres.
La porte d'entrée et les volets de la cuisine des Ruffenach sont fermés. Je ne pourrai pas dire au revoir à Bernard. Il coiffait ses cheveux blonds et bouclés en arrière pour faire une banane à la Elvis. Il avait du passer l'après-midi sur le quai de l'Amirauté aux Bains Sportifs avec tous les copains : Jean-Jacques, Smaïn, Christian, Farouk, Pierrot…
Le quartier est vide. C'est bientôt le couvre-feu qui débute à 20 heures.
Je continue mon pèlerinage, refoulant mes larmes.
J'arrive à La Placette: minuscule parking, aux derniers numéros de la rue Danton, qui nous servait de quartier général quand plus jeunes, nous étions des cow-boys ou des Indiens. Au coin une épicerie fermée aussi. Les escaliers qui partent de chaque coté de la Placette conduisent à la Croix Rouge et chez Baechler, grossiste en produits d'épicerie, rue de Mulhouse.
La rue Abbé de l'Epée avec la villa où la Territoriale "gardait" le Quartier !… Et, tout en haut, le club des cinq, dont Clarac, Amat, Company, toujours assis près de l'autre épicerie, près de l'école de filles du Village d'Isly.
Je reprends en sens inverse l'impasse Danton, pour dire adieu à mon école maternelle. J'arrive en haut des escaliers Danton. Habite ici, ma "fiancée" de l'époque, Renée-Paule C.. Son père est prothésiste dentaire. Son frère, Jean-Marc est aujourd'hui, dentiste à Nice. Elle est mariée et vit à Toulouse; je ne l'ai jamais revue. Je ne peux pas lui dire au revoir. L'immeuble est fermé. Et les filles ne sont pas dehors à cette heure ci.
Je commence à descendre les escaliers étroits en me tenant à la rampe métallique, usée, rendue brillante par les milliers de frottements de mains. Les Chailan, eux aussi ont fermé leur porte. Adieu, Andrée.
Je laisse mes talons glisser tout seuls d'une marche à l'autre. Je lance un dernier coup d'oeil au balcon de Michèle C., sur la gauche. J'ai adoré ses yeux verts d'eau. A-t-elle eu un peu d'affection pour moi, comme elle me le disait? Son père, Georges, lui interdisait d'aller avec moi, à la piscine du RUA. Il aurait dû, car il pêchait toujours par-là et pouvait nous surveiller. Je ne l'ai jamais revue, non plus. A droite l'entrelacs de cours et d'escaliers où vivaient Kader Bessalchi, et ses sœurs, madame Joseph, madame Daoui, mariée plus tard avec le boulanger du bas de la rue de Mulhouse, monsieur Arduin et dont le fils avait rejoint " notre clan ", les Fischer, madame Benoit qui vendait des petites pommes de terre déjà épluchées au Marché Clauzel…
En face, je regarde les volets du petit appartement de Pierre P., Pierrot, dont la sœur Marianne sortait aussi avec un jeune soldat du Contingent. Il soupait tous les soirs chez eux. Leur appartement était grand comme une maison de poupée. Ils étaient très pauvres. Le type de Pieds-Noirs qui n'existe pas dans l'esprit des Français de Métropole, puisque nous sommes tous des gros colons, ici. J'aimais bien Pierre; il était sérieux, très gentil. Et, il jouait bien au foot. Quand la fin de la période en Algérie de ce jeune métropolitain est arrivée, ils l'ont accompagné au port pour embarquer vers Marseille. Marianne pleurait sur le quai et sa mère tentait désespérément de la consoler.
- Ah! Le voilà, Tu le vois, là en haut, à droite ?
De grands signes, des baisers soufflés au bout des doigts. Tous les soldats ont embarqué. Tout le pont est en kaki. On lève l'ancre. Le Ville d'Oran corne. La cheminée fume. Il commence à s'éloigner du quai, tiré par un remorqueur. Des mouchoirs s'agitent en guise d'au revoir. On les aimait bien ces petits jeunes qui patrouillaient dans Alger, le doigt, toujours sur la gâchette de leur P.M. tant ils avaient peur.
- Au Revoir? Adieu, oui; sale race de Pieds Noirs.
Et il nous fait des bras d'honneur, ce petit con. Je ne le crois pas. Il avait l'air si bien. Il couchait chez eux, et tout; vous voyez ce que je veux dire…Il n'a jamais sorti un sou. Pauvre Marianne, si timide, si sincère.
Je suis au bas des escaliers. Je ne suis pas allé chez mon cousin Rosello au 12. Je n'ai pas aperçu non plus Jean-Jacques. Je ne verrai plus madame Monteil qui brodait des napperons de façon extraordinaire. Adieu, Monsieur Ravel avec votre ceinture de flanelle rouge qui entourait votre énorme ventre. Je ne me suis pas dirigé vers Bidon V, le bar où nous faisions des compétitions de Baby-foot, et la rue Berthezène. Qu'est devenu Jean-Paul Soler? Nous nous étions brouillés pour des bêtises de gamins depuis la cinquième. (Un coup de talon sur mes chaussures neuves, pour les baptiser...). Nous allions au lycée en remontant la rue Michelet, côte à côte, sans nous adresser la parole. Et cela a duré quelques années. Nous nous parlions à la troisième personne ou par l'intermédiaire d'un troisième copain. Mais, nous étions toujours près l'un de l'autre. Bernard nous laissait en haut de la rue Tirman pour rejoindre le Cours Complémentaire. Jean-Jacques continuait avec nous. Il y avait aussi parfois Jean-Michel Company qui était dans la même classe que Jean-Jacques.
Je partirai sans revoir la villa de mes grands-parents à Bouzaréah, ni mon école primaire de la rue Daguerre ni le lycée Gautier. Ni l'Eglise Sainte Marcienne où j'ai fait ma communion. Où nous l'avons tous faite. C'est dingue ! Le jour de ma communion, nous entrions dans l'église, les garçons à gauche, les filles à droite. C'était Chantal Michel, la sœur du clarinettiste Jean-Christian qui marchait à côté de moi.
Je n'irai pas nom plus me recueillir sur la tombe de ma grand'mère paternelle enterrée au cimetière du Boulevard Bru, ni celle de mon grand-père maternel à Saint-Eugène, sous Notre Dame d'Afrique. Ils resteront seuls face à la mer. Abandonnés, face au Nord où nous partons, pour toujours sans doute.
Nous avons soupé en silence, écoutant les dernières consignes de mes parents. Ma mère pleurait sûrement. Je ne m'en souviens pas. Et puis nous sommes montés nous coucher.
Au matin du 26 Mai 62, après le petit déjeuner, un minibus d'Air France transportant du personnel de l'Aéroport de Maison-Blanche s'arrête devant la boulangerie.
Le cœur serré, nous embrassons une dernière fois nos parents, Mémée Cerdan, et montons dans le véhicule. Nous serrons bien fort entre nos jambes nos valises et sacs de sport. Les hôtesses et le personnel en costume bleu marine et chemise blanche, tentent de nous réconforter. C'est un steward, client de la Boulangerie, qui sera notre guide. Reverrons-nous un jour nos parents ?
Je ne pensais pas qu'à une telle heure, il y aurait autant de monde sur la route. Les bus étaient pleins. Leurs passagers faisaient grise mine. On voyait des femmes, leurs enfants dans les bras, qui s'essuyaient d'un revers de manche les yeux. On était aux portes de l'été, et malgré cela, beaucoup avaient mis leurs vêtements d'hiver. Partaient-ils aussi? Comme nous ?
Le petit car prit la rue Richelieu et s'arrêta devant l'immeuble du Maurétania, pour prendre du personnel d'Air France.
Et nous repartîmes aussitôt. Les voitures, pare-chocs contre pare-chocs, semblaient prendre la même direction que nous. Beaucoup d'autres se dirigeaient vers le port. Ça bouchonnait sec.
Je ne compris pas aussitôt pourquoi, à quelques kilomètres de Maison-Blanche, les chauffeurs garaient leurs autos sur le bord de la route. Ils les laissaient là et repartaient à pied.
J'en vis de nombreuses ouvertes, comme abandonnées. Mais pourquoi? On n'a pas l'habitude de laisser sa voiture ouverte, tout de même!…
Nous accédâmes, enfin, à l'Aéroport. C'était pire. Il y avait des autos partout. Les parkings étaient pleins. Elles étaient stationnées des deux côtés des voies d'accès aux halls d'embarquement. Même, en double file. Des valises laissées sur leurs galeries ou dans les coffres béants.
Des centaines de personnes, peut-être des milliers se bousculaient devant les entrées vitrées, avec leur baluchon. Toutes les pelouses étaient transformées en terrains de camping.
Depuis combien de temps étaient-ils là ? Des vêtements et des draps, ou ce qu'il en restait, traînaient sur l'herbe. Les massifs de fleurs étaient piétinés. Une famille, ici, assise autour d'une nappe imaginaire, près d'une bouteille Thermos, probablement vide. D'autres grignotaient des morceaux de pain. Tout le monde était grave. Même les enfants avaient le regard vide et ne comprenaient pas pourquoi leurs parents pleuraient et ce qu'ils faisaient là.
Il paraît que des femmes ont accouché, ici, à même le sol. Que des familles ont attendu de nombreux jours avant de pouvoir partir. Peut-être VOULOIR partir.
Quatre vingt dix pour cent de tous ces Pieds Noirs ne savaient pas où ils allaient. Nous n'avions pas tous des points de chute en France.
Je n'ai même pas noté si c'était encore le drapeau de la France qui flottait encore sur les hampes. Notre beau drapeau.
Notre bus contourna les bâtiments, un garde-barrière nous laissa passer et nous nous dirigeâmes vers un Super Constellation que les plus chanceux de ce matin prenaient d'assaut. Celui là allait à Marseille. Est-ce que tout le monde désirait se rendre à Marseille?
On nous fit monter par la passerelle des Premières classes. Devant nous, une famille portait des vêtements arabes, gravissait aussi les marches. Le père avait une djellaba blanche enfilée sur une chemise. Leurs petits garçons avaient les cheveux tressés.
Ils ne parlaient ni le Français ni l'Arabe. On m'expliqua que c'était des Juifs qui avaient fui le Sud Algérien.
Il n'y avait plus de place à bord pour ma sœur et moi. Notre steward-mentor parlementa quelques minutes avec le commandant, qui accepta de nous prendre dans la cabine de pilotage.
Le voyage ne devait pas être très long avec un tel avion. Deux heures maximum.
Dans deux heures, nous ne serons plus en Algérie…
Dans le vrombissement de ses quatre moteurs, l'avion se lança sur la piste, prit de la vitesse et s'arracha de la terre d'Algérie.
Je n'en avais même pas pris une poignée…
Tout le trajet se passa debout, entre le pilote et le co-pilote. Il y avait des cadrans partout. Des boutons de tous les côtés! Ils furent très gentils avec nous. Nous ne les connaissions pas. Ils ne nous connaissaient pas. Ils devaient avoir déjà pris des "clandestins" comme nous. Nous étions des clandestins dans Notre propre pays. Nous quittions Notre pays pour nous rendre dans Notre pays !
Nous survolâmes la Méditerranée bleue foncée, devenue presque noire depuis notre altitude. Le pilote tendit son bras et me montra au loin les côtes métropolitaines qui commençaient à se dessiner.
Il fit un tour au-dessus de l'Etang de Berre et se mit dans l'alignement de la piste. Personne ne me demanda de m'asseoir. J'étais fasciné. Hypnotisé. L'avion descendait tranquillement vers la terre qui semblait l'attirer comme un aimant. Il se posa sans grande secousse, roula dans la voie qui lui était attribuée, ralentit dans un grand bruit de moteurs inversés.
Devant nous, un employé faisait de grands signes des deux bras.
-Qu'est ce qu'il veut ce pantin? On va l'écraser s'il reste là!
-Non, non, il nous guide.
-Ah, bon!
L'avion s'arrêta définitivement. Les portes s'ouvrirent, les escaliers étaient déjà collés aux issues et les premiers Pieds Noirs descendaient.
Il faisait presque aussi chaud qu'à Alger mais il y avait un vent, la tchidente ! Le Mistral qu'ils l'appellent.
Nous traversons l'aéroport. Nous avons l'air hébété. Ahuris, perdus.
"Et, maintenant ?…" Nous sentons que nous ne sommes plus chez nous. Il est bien trop tôt pour dire " pas encore, chez nous!…" Le dirons-nous un jour?
On nous regarde, avec nos peu de bagages, comme des étrangers, des espèces inconnues. Des extra-terrestres. Quelques-uns sont attendus par de la famille partie plus tôt et qui leur fait des grands signes et se jette dans leurs bras en pleurant. D'autres errent dans le vaste hall. Près d'une porte vitrée, un homme en gabardine d'hiver triture sa casquette. Son épouse, assise sur une valise à la limite de l'éclatement console une petite fille en pleurs qui traîne son ours en peluche sur les carrelages de l'Aéroport. Les parents ont les yeux gonflés par les larmes déjà versées. Que faisons nous ici, mon Dieu ? Où aller ? Semble dire leur regard angoissé.
Des militaires nous demandent de nous regrouper et nous diriger vers une porte de sortie, où des CRS sont alignés jusqu'aux bus navettes qui nous attendent pour nous conduire au centre de Marseille. Avec ma sœur, nous suivons le mouvement. Les CRS vérifient nos papiers d'identité, pour contrôler si nous ne sommes pas recherchés et fichés pour "Activités subversives".
Nous montâmes dans notre autocar. Le centre ville était assez loin de l'aéroport.
Nous débarquâmes je ne sais où. Mais comme un seul homme, nous nous dirigeâmes tous probablement vers un supposé centre d'accueil (!?!?!?). Je me souviens d'une rue en légère pente.
Nous devons quitter cette file qui patiente sur ce trottoir pour aller à Voiron. Je cherche derrière moi qui sont les assassins que les CRS recherchaient. Ce vieux monsieur avec sa canne noueuse ? Cette Mémée à la recherche d'un appui pour se reposer ? Oui, c'est certainement ce gamin qui tire un cartable ! Peut-être ce vieil arabe à la peau cuite par le soleil. Il a conservé sa chéchia usée sur la tête. Nous devons aller à Voiron, me répétais-je.
Nous apprîmes bien plus tard en quoi avait consisté pour certains cet accueil. Rien n'était prêt et personne ne s'attendait à l'ampleur que prenaient les départs d'Algérie. Peu de Pieds-Noirs restèrent là, à Marseille. Le maire Deferre ne voulait pas de nous chez lui !!! " Que les Pieds-Noirs aillent se réinstaller en Argentine " mentionnaient les banderoles des dockers de Marseille et pour nous inciter à le faire, les containers qui transportaient nos maigres affaires étaient trempés dans l'eau du port ou lâchés du haut d'une grue pour s'éclater sur les quais. Pas de cellules psychologiques, évidemment. Aucun appel, ni aide de l'Abbé Pierre, non plus, nettement plus prolixe d'habitude. Le silence et la haine, seuls, nous accueillaient. Les familles étaient réparties aléatoirement dans des trains et étaient envoyées aux quatre coins de la France. Pour nous éclater. Nous écarteler. Il n'y aurait plus de Pieds-Noirs, pensaient-ils. Nous n'avons que faire de leur vulgarité, de leur accent, de leur pseudo-misère, ajoutaient-ils.
De Gaulle, encore lui, nous intimait de retourner chez nous. Mais où était-ce ce chez nous ? Nous n'en avions plus. Chez nous, c'était la France. Là-bas, ce n'était plus la France. Nous n'étions donc pas chez nous, ici, en France de France ?
- La gare, s'il vous plaît, Monsieur? Demandai-je à un passant, après avoir quitté la file et entraîné ma sœur avec moi.
- Là-bas, en haut des escaliers, au bout de la rue qui monte, mon petit.
De larges marches accédaient à la Gare Saint Charles. Les guichets:
- Deux billets pour Voiron, SVP.
- Vous changez à Valence et vous vous arrêtez à Moirans. C'est juste avant.
Nous montons et choisissons un compartiment avec des places libres. Ce qui était difficile. Il y avait beaucoup de monde pour cette destination. Le but final du train était Paris. Le nord !
Je jetais un coup d'œil par-dessus l'épaule de mon voisin qui lisait l'Express. Que d'horreurs et mensonges sur nous étaient rapportés!
Je préférai me lever et je me dirigeai vers les Toilettes des Secondes. Déjà deux personnes attendaient devant la porte fermée. Je fis demi-tour et retraversai le demi-wagon jusqu'à la porte battante qui nous séparait des Premières.
J'eus l'audace de prendre ce couloir. Presque tous les sièges étaient vides. Les toilettes, au bout du wagon étaient disponibles. Les secousses et mouvements latéraux du train n'étaient pas propices à un bon équilibre, jambes écartées, sans poignée pour se tenir.
Je revins vers le compartiment où Marif attendait. Juste avant la porte battante, je m'arrêtai pour regarder le paysage. C'était quand même un peu plus vert que chez nous. Et soudain la porte s'ouvrit. C'était un contrôleur dans son costume officiel de la SNCF, avec son carnet d'une main, une poinçonneuse dans l'autre et une petite besace en bandoulière. Une casquette avec des étoiles!…C'est un Général, ou quoi?
-Billet, SVP.
-Voilà.
-Mais ce sont des billets de secondes
-Oui, je suis allé au WC, j'en reviens.
-Mais tu es en première, là. D'où viens-tu?
-D'Alger, M'sieur. Ma sœur est dans ce compartiment là-bas.
-Et bien, je te refais un billet Première Marseille-Moirans que tu paies en totalité, et en plus, je te colle une amende…Et tu retournes en seconde.
-Mais, je suis juste allé…
-Tu t'arrêtes, ou je te fais descendre à la prochaine gare. Tu n'étais pas bien dans ton pays, non ?
Le train entre en gare de Moirans. Personne, sur le quai, pour nous récupérer. Bizarre, non? Elle était avertie Gabrielle, je crois?
- Voiron, c'est où, Monsieur? S'il vous plaît.
- Tu vois le clocher, un peu à droite? C'est là.
- Il n'y a pas d'autobus?
- Pas à cette heure. Vous pouvez aller à pied. C'est à cinq kilomètres environ.
L'herbe était humide. Il avait du pleuvoir. Nous sommes partis vers le clocher avec nos valises marron clair et nos sacs de sport. Nous avons coupé à travers champs.
Nous sommes finalement arrivés à Voiron. Notre destination finale était l'école maternelle construite dans l'enceinte du CREPS dont les étudiants suivaient des cours et avaient leurs dortoirs dans le château de La Brunerie.
Quel nom! La classe! Ça fait bien, non, Ferrer de la Brunerie!!! On ne me demandera plus d'où je viens avec un tel nom.
C'était en haut de la côte. Elle était plutôt raide. Nous atteignons enfin l'entrée du parc. De grands arbres bordent le chemin de graviers blancs qui conduit à l'école.
Les logements de fonction sont, juste, en face des classes. Nous grimpons au premier étage. Oui, c'est ici. Un coup de sonnette. La porte s'ouvre.
- Vous voilà enfin ! Venez, je vous montre où vous allez dormir avec vos cousins.
Nous suivons. Des escaliers. Une porte ou une trappe.
- Voilà, c'est là … Installez-vous.
C'ETAIT UN GRENIER !
JP FERRER.
Saint-Laurent-du-Var.
26 Mai 2001
|
|
|
| La veuve éplorée
Envoyé par Marcel
| |
Il était une fois un homme très pingre qui avait travaillé toute sa vie et épargné son argent.
Il aimait l'argent plus que tout et juste avant de mourir il dit à sa femme : "Lorsque je mourrai, je veux que tu mettes tout mon argent dans le cercueil avec moi, ce sera pour ma vie après la mort"
Bien à contre-coeur, sa femme lui fit le serment de mettre tout son argent dans le cercueil avec lui.
Peu de temps après, il mourut...
Au cimetière, il était étendu dans son cercueil entouré de quelques amis, membres de sa famille et de son épouse toute de noire vêtue.
Comme la cérémonie se terminait et juste avant que le cercueil soit refermé et porté en terre, l'épouse dit: "Attendez une minute" Elle prit alors une boîte qu'elle déposa dans le cercueil avec son époux.
Les préposés firent alors descendre le cercueil dans la fosse.
Un ami lui dit alors: "Écoute bien, j'espère que tu as été assez intelligente pour ne pas mettre tout son argent dans le cercueil avec lui comme il t'avait demandé ?"
L'épouse dit alors: "Je suis une bonne chrétienne et je ne puis revenir sur la parole faite à un mourant de mettre son argent avec lui dans le cercueil".
Et elle ajouta : "Je lui ai fait un CHEQUE".
Ne jamais sous-estimer l'intelligence et le pragmatisme d'une femme.
|
|
MON PANTHÉON DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE
DE M. Roger BRASIER
Créateur du Musée de l'Algérie Française
Envoyé par Mme Caroline Clergeau
|
|
FREDERIC, ANTOINE ALTAIRAC
|
Né à Alès (Gard), le 5 mai 1821, mort à Alger, le 25 janvier 1887.
A Ales, depuis 1920.
Simple ouvrier tailleur, il arrive en Algérie en 1845, âgé de 24 ans.
Vivant de son métier d'ouvrier, il étudie le pays au point de vue "travail".
- En 1859, il commence à confectionner, pour la colonie, des effets militaires. En 1860, il ouvre ses premiers ateliers,
- En 1869, il obtient la concession de la fourniture des uniformes d'une partie de l'Armée d'Afrique (400 ouvriers).
- En 1877, de nouveaux ateliers emploient 800 ouvriers à l'intérieur et autant à l'extérieur.
- En 1882, à Maison-Carrée, il crée une Usine de Tannerie-Corroyage.
Puis une briqueterie (200 ouvriers et 10 millions de pièces manufacturées par an)
(Livre d'Or de l'Algérie- Challamel - 1890).
|
|
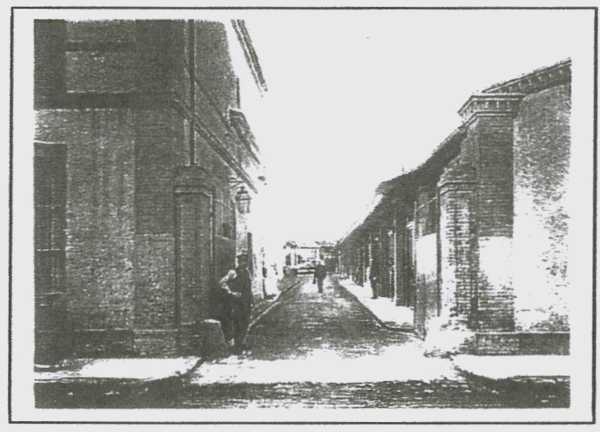
Entrèe de l'Usine de Mustapha, à Alger |

Ateliers de Confection d'habillement |
Né à Alais (Gard), le 5 mai 1821, mort à Alger, le 25 janvier 1887.
A Ales, depuis 1920.
Il a doté l'Algérie d'une industrie de premier ordre... Il a assuré pour l'avenir, chez lui ou chez ses concurrents, du travail pour toute une population. Jusqu'en 1962, ses héritiers poursuivirent son oeuvre en l'amplifiant.
A SUIVRE
|
|
Les Bônois et Constantinois
à l'Ossuaire de Douaumont
Envoyé par M. Jean Yves Sardella
|
Nous revenons d'un voyage pour la Mémoire à Verdun.
Après avoir visité les sites du champ de bataille où tant d'hommes se sont sacrifiés et ont souffert, nous sommes allés nous recueillir à l'Ossuaire de Douaumont où reposent les restes de 130 000 hommes.
Et l'on sait, ou on devrait savoir, que l'Algérie a donné son tribu de soldats, toutes religions confondues, qui sont tombés sur tous les Champs de Batailles. Ils étaient tous français.
D'autres heureusement sont revenus.
Et voilà ce que nous avons découvert sur la frise du mausolée, entre autres écus.
Émotion profonde !
Jean Yves Sardella, 21 mai 2007
|
|
|
TOURNÉE 2007 - Jean Paul GAVINO
DATES & VILLES
Jean Paul Gavino
... grâce à ses chansons le peuple prend la parole...
UN ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER!!!
Date/heure |
VILLES |
Salles de Concert |
Vendredi 20h30
6 Juillet 2007
|
LA GARDE [83]
Entrée : 20 € |
Salle Gérard Philippe
Rue, Charles SANDRO
83130 LA GARDE
|
Samedi 20h30
15 Septembre 2007
|
SAINT ORENS [31]
Entrée : 25 €
|
Salle Altigone Espace Culturel
Palace Jean Bellières
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
|
Dimanche 16h00
16 Septembre 2007
|
POLLESTRES [66]
Entrée : 25 €
|
Salle Polyvalente Jordi BARRE
Avenue Pablo Casals
66450 POLLESTRES
|
Vendredi 20h30
21 Septembre 2007
|
BÉZIERS [34]
Entrée : 25 €
|
Palais des Congrès
29, Avenue Saint Saëns
34500 BÉZIERS
|
Samedi 20h30
22 Septembre 2007
|
LA GRANDE MOTTE [34]
Entrée : 25 €
|
Palais des Congrès
Avenue Jean Bene
34280 LA GRANDE MOTTE
|
Vendredi 20h30
28 septembre 2007
|
MARIGNANE [13]
Entrée : 25 €
|
Salle Saint-Exupéry
Cours Mirabeau
13100 MARIGNANE
|
Dimanche 16h00
30 Septembre 2007
|
CANNES [06]
Entrée : 25 €
|
Théâtre LA LICORNE
25, Avenue Francis T0NNER
06150 CANNES LA BOCCA
|
Samedi 20h30
20 Octobre 2007
|
BRON [69]
Entrée : 25 €
|
Salle Albert Camus
1, rue Maryse Bastié
69500 BR0N
|
Samedi 20h30
21 Octobre 2007
|
NOGENT S/ MARNE [94]
Entrée : 25 €
|
Espace Watteau
Place du Théâtre
94736 NOGENT SUR MARNE
|
RESERVATION ET VENTE BILLETERIE
Par Courrier:
Gavino Music Ediciones
17, Rue Trousseau
75000 PARIS
|
Par Tel/Fax :
CONTACTEZ MICHELE
Téléphone: 00 (33) 01 58 30 91 91
00 (33) 01 58 30 91 11
Télécopie: 00 (33) 01 58 30 91 09
|
Sur Internet:
www.jeanpaulgavino.com
Par mail :
ediciones@jeanpaulgavino.com
|
|
|
Il était une fois un mendiant qui recevait chaque jour 25 Euro d'un passant. Et cela dura plusieurs années, jusqu'à ce qu'un beau jour, le passant ne lui donnât que 18 Euro. Etonné, le mendiant se consola en se disant que 18 Euro ce n'était pas si mal.
Un an plus tard, soudainement, le mendiant ne reçut plus que 15 Euro, et il se dit qu'il allait demander au passant pourquoi, recevant d'abord 25 Euro, il ne recevait ensuite plus que 18 et maintenant seulement 15 Euro.
L'homme lui répondit :
- Oui, je sais, mais la vie devient de plus en plus chère et l'an passé, mon aîné est entré à l'université et cela coûte, très cher. Donc, je ne vous ai plus donné que 18. Et maintenant, c'est ma fille qui entre à l'université et cela me coûte donc encore plus !
Le mendiant lui demande :
- Et combien d'enfants avez-vous ?
L'homme lui répond fièrement :
- Quatre adorables enfants !
Le mendiant s'inquiète :
- Et vous comptez les faire étudier tous sur mon compte ?
|
|
A.M. – TRAVEL, Sarl
Algerian Tour Operator
Licence d’Etat n° 836/07 - RC Alger n°06B0972121
Siège social et Agence Centrale d’Alger
21, Rue Mohamed Tahar Sémani, HYDRA 16405, ALGER
Tél. (213).61 59 48 12 - Fax. (213).21 48 24 58
ET
M. BARTOLINI Jean Pierre
Webmaster du site de Bône la coquette
Organisateur amical, et non commercial
CONTACT - Tel. 04 68 21 75 17 - jean-pierre.bartolini@wanadoo.fr
Avec la Participation
D’AIR ALGERIE
Ont organisé un voyage exceptionnel
Pour et entre les Amis du Site
Pour Voir et Revoir notre terre natale.
Du 15 au 26 Avril 2007
A BÔNE/ANNABA – SITES HISTORIQUES de
MADAURE, TEBESSA, TIMGAD, LAMBEZE,
DJEMILLA, TIDDIS,HAMMAM MESKOUTINE
|
|
| LES MOTS ECRASÉS
Par R. HABBACHI & J.P BARTOLINI N°4
|
| |
Les, qu’y sont couchés
1-Bons à rien surtout quan y sont vieux et encore plusse quan y sont vrais.
2-Nous z'aut' on l'a connue au ciléma et son p'tit nom c'était Nadine. - Un, ça va, mais beaucoup, c'est lourd à porter.
3-C'est bon à manger mais quan c'est vieux, ça vient casse bonbons et en plusse c'est endigeste. - Y brille en dessur les schkolls carrés par en bas et pointus par en haut.
4-Bougé. - Distribué par çui-là là qu'à taleur, y brillait.
5-Quan elles me viennent, diocamadone, j'ai la larme aux oeils.
6-Y z'ont des plumes qu'elles donnent chaud. - C'est Hubert Bonisseur 117.
7- C'est là qu'y se lève avant de briller. - Tu peux aussi dire en plusse.
8- Artique mâle. - A nous z'aut' y sont, ça c'est !
9- On peut se mouiller avec et aussi la boire. - On se mouille dedans mais elle est pas z'à boire. - Et dire que, y en a qu'y s'le parle à Montpellier.
10- Quan y sait, le passé simple. - Un Crack qu'y se bat toutes les dames. - Un argentin qu'il a porté le béret baxe avec un étoile dessur.
| I- Les instruments à Bagur.
II- Le 9 couché, c'est le même.
III- Un drôle de numéro qu'en plusse, des fois il est rapporteur. - Note qu'elle est vieille la pauv'.
IV-J.P y s'le travaillait à joanonville. - J'te jure, c'est à moi.
V- Un chien mort que jamais il aboie. - C'est aussi à moi.
VI- Le patos y s'les z'appelle comme ça mais ça sent qu'à même le choléra. - Y sont venus nous rejoindre.
VII- C'est le premier en Patosie. - Le bleu, il en sort des fois avec des sardines.
VIII- Quan l'anglais y les z'a, c'est qu'il a pris racines.
IX- Purée de leur race affoguée quan y mordent, y t'arrache le bras et tu cois à de bon que c'est du gros mais macache, il sont tout p'tits et comme on dit nous z'aut', y mangent et y payent pas. - Ça, c'est le patos qu'y le dit, nous z'aut on dit ah ouah ! ou alors zek ! ça dépend.
X- C'est juste après neuf mois que ça se passe, mais pas toujours.
Solution des Mots Ecrasés N° 3
| |
Les, qu’y sont couchés
1- Passez un été au soleil à la Caroube et comme ça, vous venez.
2- Escagassée. Y vaut mieur qu'une reine.
3- Il a pris des coups et il a demandé à son fils d'aller le venger en courant et en volant. Un service agrégé de la police.
4- Une grecque. Un acide.
5- Basse et vieille, la note. Cet Andréa-là, il a eu un gros problème un jour en pleine mer.
6- le formage à trous, c'est là que tu peux t'le trouver. Ça, c'est quan tu le sais pas.
7- Qu'est-ce qu'y souffe çui-là là. Des impôts que personne y s'les comprend.
8- C'est un musicien mais j'te jure, y vaut pas Bagur. Ça qu'y fait çui-là là qu'y travaille au soleil, l'été.
9- Une p'tite dessur le calendrier. Encore un agrégé d'la police mais espéciale celle-là là.
10- Pardon, je l'ai faite, je m'ai trompé.
| I- Des fois y font rire et des fois y font pitié, j'te jure.
II- On dit ça quan c'est qu'on coit pas beaucoup ça qu'on raconte (2 mots). On la prend tous un jour ou l'aut', en oiture, la plupart du temps.
III- Un verbe que j'ai appris à le conjuguer avec l'ordinateur.
IV- quan t'y as çui-là là et qu'il est sincère, tu peux compter dessur. Tu le lis comme tu veux c'est qu'à même un artique.
V- C'est des oiyelles de celles qu'on sonne pas.
VI- encore un artique. Quan t'y emmène la vache, c'est juste avant le taureau.
VII- Elles font tellement du bruit même la nuit, que des voleurs qu'y z'ont voulu rentrer dedans le Capitole (pas le ciléma, l'aut') y se sont ensauvés.
VIII- Conjonction qu'elle vaut cher. Un prénom.
IX- C'est ceux-là là qu'y z'ont donné la tannée au général Lee, pas Bruce, l'aut'.
X- Y paraît qu'avant, le sémaphore du cap de garde il en faisait pour les bateaux. C'est ça qu'on se dit, nous z'aut' bônois quan on se parle sans faire des necs.
|
| |
MESSAGES
S.V.P., lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
De Mme Sylvia Delaruelle
Bonjour
Une partie de ma famille est originaire de Bône. Ils faisaient partie des premiers colons arrivès de Malte et de diverses régions Françaises. Je cherche des renseignements sur Louis XERRI qui tenait le "café du théâtre" à Bône et qui aurait eu un rapport avec le journal le Réveil Bônois mais lequel ?
Auriez-vous des renseignements sur cette époque.
D'avance merci
Cordialement
Mon adresse : Sylvia Delaruelle
|
De M. Georges LUCAS
Je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils Bônois, mais je n'ai malheureusement aucun récit de ce qu'était la vie à Bône, mon père l'ayant quitté après la libération pour retrouver une jeune fille en métropole qui allait devenir sa femme.
Pour des raisons que vous comprendrez peut être mon père ne voulait pas discuter du passé et je n'ai su que par mes recheches généalogiques que je suis d'origine Italienne Pieds-Noirs.
Mon nom est LUCA si cela vous dit quelque chose, si vous êtes au courant de quelque renseignements sur cette famille ou la famille BOSCO, je serai heureux que vous me les communiquiez.
Je vous remercie d'avance. Georges LUCAS
Mon adresse : Georges LUCAS
|
De Mme Evelyne
Etant native de Bône j'aimerais créer un diaporama de notre Ville.
Pour cela j'ai besoin que l'on m'adresse des photos d'avant 1962.
J'habitais aux Frênes, mes parents tenaient un salon de coiffure sous les arcades du cours Bertagna. (Famille KAYOUN)
Je remercie d'avance toutes les personnes qui voudront bien m'envoyer ces photos, et si elles le désirent je leur enverrais le diaporama.
Bien entendu ces photos seront envoyées par mail (afin de les conserver)
Je souihaiterais savoir si dans Paris où la région parisienne il y a une association de Bônois?
Merci à Tous
Mon adresse : Evelyne
|
De Mme Anna Tuil
Bonjour,
J'ai mis un message sur le forum du site zlabia.com.
Je vous écris à vous aussi: ma grand mère va fêter son annniversaire bientot, donc on voudrait lui faire une petite fete.
Ce serait trop sympa qu'il y ait une ou deux personnes de Bone, qui l'ont connu, qui viennent lui faire la surprise ou bien qui l'appelllent ou bien qui lui signent la carte d'anniversaire.
C'est Rose Tuil, la femme de Roger, peut-être que vous la connaissez. Si oui vous êtes le bienvenu, et sinon pouvez vous voir dans votre entourage si quelqu'un la connait?
Ce serait très très aimable de votre part.
Je vous remercie, Anna
Mon adresse : Anna Tuil
|
De M. Medag
Je suis un ancien éléve du lycée St-Augustin Annaba, je sollicite votre aide.
Je viens de decouvrir avec une nostalgie immense ce site qui me fait revenir vers le passé. J'ai retrouvé dans une photo Mr Cararesi qui était mon prof de français au lycée St-Augustin à Annaba, Bône.
Je suis entré dans ce lycée en septembre 1958 en classe de 6ème A1 ou A6 je ne m'en souviens pas précisement.
J'ai fait 8 ans d'internat puisque j'ai redoublé la 6ème de septembre 1958 à juin 1966.
Parmi celles qui sont exposées dans le site je ne retrouve pas mes classes.
Je tiens à vous temoigner ma reconnaissance pour m'aider à retrouver quelques traces de mon passé.
Je serais très heureux de pouvoir revoir les photos de classe de cette époque en vous remerciant très chaleureusement.
Encore une fois mille merci pour votre aide.
Mon adresse : M. Medag
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
| |
| Le saut de l'Ange François
Envoyé par Geneviève
| |
Le socialiste François Hollande est dans un avion.
Soudain, le moteur explose.
Une seule solution pour sauver sa peau, sauter en parachute !
Malheureusement dans sa précipitation (nan, personne ne l'a poussé), François oublie le parachute, et le voilà tombant comme un caillou vers le sol à 250 km/h .
Soudain, le defunt Charles de Gaulle lui apparaît et lui dit : « François, crie Vive l'UMP et tu seras sauvé. »
François refuse : « Ca va pas non ?? »
De Gaulle revient encore et dit : « François, regarde le sol comme il se rapproche vite... crie "Vive l'UMP" et tu seras sauvé .»
François refuse toujours mais à 100 mètres du point d'impact fatal, il hurle de toutes ses forces « VIVE L'UMP !! VIVE L'UMP !! VIVE L'UMP !!!!!! »
De Gaulle le prend alors par dessous les aisselles et le dépose délicatement sur le sol.
L'émotion est telle que François tombe dans les pommes.
Quand il se réveille enfin, de Gaulle a disparu, mais Ségolène Royal est là, qui le regarde méchamment et qui lui dit :
« Non seulement tu dors pendant les réunions, mais en plus tu gueules des conneries. »
|
| Aprés cette visite,
(---nous vous invitons à Cliquer )
|
|