|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Avertissement :
Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-Pierre Bartolini.
Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m'adresser une demande écrite par lettre ou par mel.
Merci.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
253, 254,
255, 256, 257,
258, 259, 260,
261, 262, 263,
| |
L’AUTOMNE
Chers Amies, Chers Amis,
L’automne s’est installé et les températures ont chuté de façon significative dans certaines régions.
Le 1er octobre 1946, c’était le Verdict du tribunal de Nuremberg, le verdict contre la folie du Nazisme. La leçon des années 30 jusqu’à 1945, n’a pas été retenue.
En effet, en reconnaissant un pays qui n’existe pas juridiquement, qui détient des otages innocents, Jupiter a suscité, après le travers des manifestations, une floraison de drapeaux sur les frontons de mairies, universités, rues, etc...
Né du panarabisme, ce drapeau (noir, blanc, vert et rouge) parait anodin mais il ne l’est pas. Il est devenu l’objet d’une bataille politique et idéologique sans neutralité pour certains responsables qui se rendent complices d’un récit conflictuel qui, consciemment ou non, encourage l’islamisme radical, (le nouveau nazisme), que ce soit par militantisme, par clientélisme électoral, par calcul politique, par contrainte ou par peur...
Ces responsables ne rendent pas service aux populations qui souffrent chez eux.
A quand un nouveau Nuremberg ? Combien de morts en paieront la note ?
La Toussaint approche et en hommage à nos morts restés là-bas, je me permets de rappeler que l’opération 2025 « Jardin des Etoiles », fleurissement des cimetières de Bône et alentours est lancée. Vous en trouverez le bon de commande sur ce N° de la Seybouse.
" Bône " lecture et bon mois d’octobre
A tchao, Diobône,
Jean Pierre Bartolini
| |
| Les CHATS du BASTION de FRANCE.
|
|
NOUVELLE deJean-Claude PUGLISI
- de La CALLE bastion de France.
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
- Ils prennent en songeant,
les nobles attitudes
Des grands Sphinx
allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s'endormir
dans un rêve sans fin.
Charles Baudelaire - les Chats
Sommaire.
- Les Chats bleus de LA CALLE.
( Poème de Marc PATALANO – alias - Marquis de la Pépinière + )
- Préambule : Conte - Rêve Nostalgique - Énigme à découvrir.
- Citations : Nostalgie - Rêves - Souvenirs.
- Le temps de Noël - autrefois, à La CALLE de France.
- C'était à l’ancienne Douane - rue des Corailleurs.
- La maison de ma Mère - un soir, dans ma tendre enfance.
- Une Veillée dans la tempête - avec Vincenzo et Pétronille mes grands-parents.
- Le bon Génie du Kanoun.
- C’était mon Chat !
- A la Lumière d'une lampe à pétrole.
- Le mystérieux récit - de Vincenzo le Marin.
- Le Coin des Cimetières.
- Les Chats du Bastion de France.
- Samuel et Carmen - les Cousins BALZANO.
- Vincenzo, raconte sa Mésaventure.
- Le Roi des Chats est mort - Vive le Roi !
- Quand fleurissent les contes.
- Épilogue.
Citations : nostalgie, rêves, souvenirs.
Ce rayon si clair au pied de mon lit, serait-ce déjà le gel ?
Me soulevant, j'ai regardé ; c'était le clair de lune.
En retombant, j'ai pensé soudain à ma maison.
Li –Tai - Po - Dans la nuit calme.
Oh ! mes frères noirs, que mon cœur se lasse,
Loin des vieux de chez nous !
S.C. Foster - Les vieux de chez nous.
Devant mon lit est le clair de lune,
Le sol paraît plein de gelée blanche,
Je lève la tête et contemple la lune,
Puis, je la baisse et songe à mon pays natal.
Li - Pai - Poèmes.
Plus je vieillis, plus je vois que ce qui ne s'évanouit pas, ce sont les rêves.
Jean Cocteau.
Une chanson, là-bas... C'est un mendiant.
Puisqu'il chante, ce vieillard qui n'a jamais rien possédé,
Pourquoi gémis-tu, toi qui as de si beaux souvenirs ?
Tou-Fou - Poèmes.
Et là, dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile,
L'âme en un repli sombre où tout semble finir,
Sent quelque chose encor palpiter sous un voile...
C'est toi qui dors dans l'ombre, ô sacré souvenir !
Victor Hugo – Tristesse 'Olympio.
Un homme sans patrie est un oiseau sans chant.
Proverbe Russe.
Les CHATS BLEUS de La CALLE.
( Poème de Marc Patalano + )
- La nuit, selon la formule, tous les chats sont gris.
- Enfin !... C'est le Juge de LA CALLE qui me l'a dit.
- Mais, pour nous les Merdeux à l’époque de nos jeux,
- Tous les Chats du village étaient de couleur bleue.
- Comme le ciel sans nuage pur reflet de la mer,
- On les trouvait partout, mêm'près des Cimetières.
- Oui, mais !... Ces Chats bleuis par les coups de Taouate *
- N'avaient rien de commun ac * le bleu du sulfate *.
- C'était des roturiers tous ces Greffiers mignons,
- Des Matous de gouttière, de grands mets pour d'ZAON *
- Et tous ces Mistigris de derrière les Brisants *,
- Ceux de Madame ADELE * ronronnant au printemps.
- Et tous ces Grippeminauds * de la bande d'en haut *,
- Ac ceux d'la bande d'en bas *, félin de dame ANGOT *
- Sans parler de ces bleus de derrière l'hôpital,
- Ou bien, ceux du Moulin * des Spahis à cheval*,
- Aussi, tous ces Harets * que notre Cordonnier*,
- Sans le moindre hoquet à coup de dents châtrait.
- Tous ces Pattes velues * qu'on jetait du Fortin*
- Pour voir, s'ils retombaient sur leurs quatre coussins.
- C'était aussi les Bleus de l'Usine de sardines *
- Qui, par leurs miaulement appelaient MELUSINE *.
- Le Minet de Minet * fusant de sa Gargote *,
- Qu'un coup de pied au cul bleuissait sa culotte.
- Les Bleus de la Presqu'île *, fréquentant Jean BABASSE.
- Et ceux de MINIQUEBRIQUE *, qui, sentaient la Vinasse ?
- Et le Bleu outr-mer de notre beau village,
- Que tous ces Chats marauds se léchaient le pelage,
- Pour qu'en fin de compte !... Oui !... Ces Raminagrobis *...
- Alimentent la plume de Jean-Claude PUGLISI*.
Marc di PATALANO +
– alias - Marquis de la Pépinière.
( les CHATS bleus - Anno 2002.)
Il était une fois, il y a de cela bien longtemps.
- C'était un soir, comme tous les autres soirs.
- Un triste soir de décembre, du côté du Bastion de France.
- Quelque part, là-bas, sur les côtes de Barbarie.
- C'était un soir à La Calle, pays de mon enfance, autant, qu'il m'en souvienne.
AVERTISSEMENT.
- Ce conte pourrait bien commencer par ces quelques mots, qui, mis bout à bout et souvent répétés, vont ouvrir en quelques lignes la porte d'un royaume merveilleux :
Celui du Rêve et de la Nostalgie des temps d'autrefois.
- Mais pour ceux qui prendront la peine, de tenter un moment d’interpréter ce récit d'un autre temps, auront peut-être la surprise de découvrir une réalité bien plus troublante, car, ce conte, pour le moins puérile mais rempli de symboles, semble annoncer quelques étranges prémonitions :
A chacun de les interpréter à sa façon !
- Observez attentivement les chats du Bastion de France sans négliger des lieux, le prodigieux décor et les bruits changeants de la nature environnante.
- Écoutez, méditez, soupesez ... longuement, très longuement - les paroles et réflexions intérieures des acteurs de l’instant.
- De ce grossier labyrinthe, explorez sans hésiter les moindres passages. Alors, peut-être bien que de ce conte énigmatique - vous trouverez la signification !
Le Temps de Noël,
autrefois à La CALLE de France.
- En cette fin d'Automne, l'arrivée de l'hiver était marquée par des journées si courtes, que, dés la sortie des écoles, déjà, la nuit commençait à tomber.
- Par petits groupes très animés, joyeusement, les enfants qui s'en allaient se disperser par le village, ne manquaient jamais de s'attarder un moment devant les quelques boutiques, qui, pour la circonstance, avaient revêtu leur beau manteau de Noël.
- Toutes ces vitrines parfaitement illuminées, faisaient scintiller de mille feux toute une ribambelle de guirlandes et de boules multicolores, qui concédaient au traditionnel sapin son bel uniforme des jours de fête. Parfois, on pouvait observer sur la vitre luisante des rayons de lumière bien inspirés, dessinant çà et là quelques fragments d'arc-en-ciel étincelants, qui, avec bonheur, venaient parer un Grand-père Noël peint tout de blanc par quelque artiste du Bastion.
- Dans la vitrine, comme un fabuleux trésor s'étalaient des monceaux de jouets, que les enfants émerveillés caressaient d'un œil brillant et plein de convoitises. Tous ces précieux joujoux, chacun de nous en rêvait tout en caressant secrètement l'espoir, de les retrouver prés des petits souliers au matin de Noël, lorsque sur le Bastion le jour enfin daignera se lever.
- Ce prodigieux spectacle qui attirait tous les enfants, nous retenait ainsi un long moment et puis sans hâte mais avec bien des regrets chacun regagnait son foyer, après avoir présenté ses civilités à toutes les vitrines de la cité.
- En cette saison, les rues de La Calle offraient comme de coutume, un spectacle qui nous était familier : au milieu des passants, qui rentraient chez eux pour goûter à la douceur de ce soir de décembre, quelques attardés nonchalants allaient et venaient dans la rue principale... Depuis un bon moment, les autocars de l'Algérienne avaient déversé leur flot de passagers et comme tous les soirs, Aziz, le fidèle préposé à la vente des billets, tirait prestement les rideaux de son guichet...
- Dans les cafés tous proches, les joueurs de belote continuaient leurs perpétuels combats, en frappant sur les tables à coup de cartes colorées, sans pour autant bousculer les verres de blanche Anisette, incontournable témoin de ces éternelles rencontres.
- Chemin faisant, je passais prés de la boutique du Mozabite qui comme toujours à cette heure, manipulait ses coupons de tissu cohabitant volontiers avec les caisses de dattes sèches...
- Un peu plus loin Auguste le Coiffeur, terminait en rouspétant sa dernière coupe de la journée et derrière leurs comptoirs les commerçants finissaient de servir leurs ultimes clients... Au passage, je ne manquais jamais de saluer Nicolas le Boucher, qui, tout de blanc vêtu, finissait de ranger son étal et astiquait ses outils de chirurgien.
- Pendant ce temps-là, toujours fidèle à son poste, Tarzan, le marchand de pizzas et cacahuètes, signalait sa présence par des coups de sifflet stridents, qu'il modulait d'une façon qui lui était bien particulière.
- En rentrant je notais que déjà, les ténèbres humides avaient envahi les rues du village et que le vent qui se levait de la mer, laissait présager une vilaine nuit de tempête... D'ailleurs, déjà on pouvait deviner au loin, la barre belliqueuse des vagues à l'entrée du port, lorsque soudain ! des gouttes de pluie se mirent à frapper doucement mon visage.
- Du côté port, les marins pêcheurs prudents renforçaient les amarres des bateaux et les grands chalutiers recroquevillés sur eux même, tanguaient doucement, pensifs et sereins le long des quais...
C'était à l'ancienne Douane
rue des Corailleurs.
- A l'ancienne Douane où j'habitais, les escaliers qui menaient chez nous étaient particulièrement sombres. Gravir leurs marches le soir venu était pour moi un exploit des plus fantastique, dont j'aurais laissé volontiers tous les lauriers de la gloire à d'autres héros de mon âge.
- Tout cela à cause d'un grand-père du dernier étage, qui, un soir pour me faire peur, n'avait pas trouvé mieux que de pousser dans le noir des escaliers, de sinistres grognements à la manière d’un loup-garou... Ainsi tous les soirs en rentrant à la maison c'est avec une vaillance plus que douteuse, que je gravissais prestement les escaliers en chantant à tue-tête pour me donner du courage, étant bien entendu toujours prêt à rebrousser chemin au moindre incident de parcours, avec pour toute destination la rue - comme il se doit !
- Dans le lointain, Popol alias Vellatchoum le Sacristain sonna l'Angélus et du haut de sa mosquée l’Imam appela un moment les fidèles à la prière...
- La pluie tombait très fort lorsque j'entrais à la maison.
- C'était un soir à La Calle et nous étions presque en hiver.
La maison de ma Mère.
Un soir, dans ma tendre enfance.
- A cette époque de l'année nous soupions de bonne heure, mais, Noël tout proche faisait régner chez nous, cette douce et chaude ambiance familiale qui souvent précède les fêtes.
- Ma mère prévoyante, avait depuis longtemps garni son buffet de liqueurs et friandises, sans oublier les figues, dattes, et autres fruits secs de Noël... Comme tous les ans et pour parer le traditionnel sapin, Pétronille ma grand-mère avait sorti de sa vieille armoire, l’antique carton de guirlandes dorées et de boules multicolores...
- Un peu plus loin du fond de son placard, patiemment, la blanche farine attendait la nativité, tout en rêvant de se métamorphoser en raviolis opulents et timides oreillettes... Sur une étagère bien au sec comme des bienheureuses, les Morues dormaient béatement dans leur lit de sel, en attendant sagement la Sainte nuit et comme toujours fermement persuadées, qu’elles seraient de droit les Reines d’un soir sur toutes les tables du Bastion.
- Mais là-bas, du côté du lac Mélah*, le peuple des fières Anguilles qui tenait conseil, ne partageait pas du tout la même philosophie : à La Calle en effet, il n'était pas du tout protocolaire de fêter Noël, sans convier ces délicates Impératrices à la plus belle des nuits, que le Seigneur ait choisie pour venir en ce monde.
Une Veillée dans la Tempête
Avec Vincenzo et Pétronille.
- La table familiale venait d'être desservie et dehors depuis longtemps une nuit d'encre s'était installée dans le village. Dans notre maison bien close, on percevait la tempête qui commençait à faire rage ce soir là... Mais la plainte furieuse du Bafoungne* et le grondement sourd de la mer en furie, n'arrivaient pas à troubler la paix de notre demeure. C'est ainsi que pour ne pas se coucher si tôt nous restions là, à goûter en famille la douceur du temps qui s’écoulait, par une veillée toute simple où nous aimions à nous retrouver.
- Et puis lorsque fatiguée par sa dure journée, ma mère enfin se retirait, dans la cuisine chacun tenait sa place : blotti au coin du potager, Vincenzo mon grand-père fumait tranquillement sa pipe... La casquette de marin qu'il ne quittait que pour dormir, ne faisait qu'une ombre légère sur son fin visage tanné par les embruns et la fumée qu’il tirait de sa pipe avec volupté, ne voilait même pas l’éclat d’argent de ses belles moustaches...
- Le vieux loup de mer fumait en silence, immobile, impassible... à même se demander si sa présence était une réalité. Dormait-il à moitié ? Ou bien était-il en train de rêver, à Ventotène* sa lointaine île natale perdue dans le golfe de Gaète* - tous prés de Naples ? Parfois, un murmure fusait de ses lèvres et je me demandais ce qu'il voulait dire...
- Ces gens de la mer sont parfois bien mystérieux et j'ai toujours pensé qu'ils savaient parler aux choses, avec l'accent des vagues dont ils connaissaient sûrement le langage.
- Prés du potager où le charbon de bois finissait de se consumer, installée confortablement dans son grand fauteuil de rotin, Pétronille, ma grand-mère, inlassablement tricotait les lunettes sur son petit nez... Les aiguilles qu'elle maniait avec des doigts de fée, dessinaient dans la laine de merveilleux ouvrages, qu'elle interrompait parfois pour en compter les mailles, à voix basse et dans la langue italienne...
- De taille modeste mais de corpulence heureuse, elle était souvent vêtue de sombre comme les femmes de sa Sicile natale. L’hiver sur ses rondes et basses épaules, était jetée une courte pèlerine de laine bien chaude, qu’elle gardait volontiers tout le jour. Son visage à peine ridé laissait apparaître des traits autoritaires, mais la douceur de son regard témoignait d'une grande bonté... Parfois, elle suspendait son ouvrage pour vaquer à de menues occupations ou nous adresser quelques mots et puis dans la pièce, inexorable, le calme absolu revenait.
- Quant à moi bien assis sur ma chaise, coudes sur la table et tête entre les mains, je lisais et relisais avec passion les fantastiques contes de Grimm et de Perrault...
- Ces lectures qui frappaient fortement mon imagination, loin de m'effrayer convenaient il faut le dire parfaitement à ma nature. Les lignes fabuleuses que je parcourais m'entraînaient vers l'univers étrange, des ces maisons hantées où les fantômes font dans la nuit, un vacarme infernal à glacer le sang des plus braves !
- Vacarme infernal ? Comme la tempête ! Qui ce soir-là, s'était mise à gronder sur le Bastion de France.
Le bon Génie du Kanoun.
- Pour adoucir l'atmosphère de la pièce le vieux kanoun* et sa braise ardente, étaient venus en renfort de l'âtre du potager afin de bonifier sa chaleur finissante... Certains soirs plus frais que les autres, c'était aussi le vieux kanoun qui chauffait volontiers l'eau des bouillottes, que nos lits presque glacés réclamaient à grands cris...
- Ce kanoun il faut bien le dire, n'en finissait plus de m'intriguer... posé à même le sol, parfois et à la manière d'un volcan, il projetait brusquement dans les airs une gerbe d'étincelles crépitantes, et puis, de nouveau sous sa couche de cendres blanches, tranquillement, il continuait de somnoler... Les vieilles gens du village disaient parfois qu'au sein du kanoun, il se cachait toujours un génie bienfaisant... D'ailleurs, moi, j'en étais fermement persuadé... parce que généreusement l'hiver, il ne manquait jamais de nous gratifier de sa douce chaleur, tout en mijotant les appétissantes soupes de Pétronille, sans oublier aussi ce parfum prodigieux qu'il conférait aux patates douces, qu'il laissait cuire tendrement sous ses cendres...
- Autant de grâces dispensées, seul un bon génie pouvait faire cela !
- Moi, je l’aimais bien le génie du kanoun, mais il faut dire que je m’en méfiais un peu, car, dans sa bonté, il avait parfois d'inquiétantes sautes d’humeur, que Pétronille un jour apprit à ses dépens : tous les vendredis en hiver, ma douce grand-mère suivant un rite ancestral, promenait le kanoun dans toutes les pièces de la maison... Sur ses braises incandescentes, elle répandait quelques pincées d’encens, qui en fumant libéraient ce parfum particulier comme celui qui flotte dans tous les lieux Saints. Puis, lentement, elle faisait tourner le kanoun au-dessus de chaque lit, tout en récitant à voix basse de secrètes prières...
- Ce manège hebdomadaire a dû semble-t-il courroucer le bon génie du kanoun, car, un beau jour et pris de vertige, il projeta sans pitié une braise ardente, sur la couverture toute neuve de mon lit... A partir de ce jour et superstition aidant, plus jamais nos lits ne furent encensés par ma grand-mère !
C'était mon Chat !
- Pendant que j'étais plongé dans ces réflexions, dehors la tempête redoublait de violence. Il me semblait qu'une horde de chevaux sauvages, déferlaient par vagues autour de l'ancienne Douane* et que la violence de la mer s'acharnait toujours plus fort sur les noirs rochers du Bastion : on pouvait percevoir le grondement sourd des lames furieuses, qui venait se briser avec fracas sur les puissants contreforts des grottes du lion et des brisants...
- Dans le lointain à plusieurs reprises le tonnerre donna de la voix et une averse tambourina un moment sur les volets clos... Ce tableau familier des soirs d'hiver n’était en rien altéré, par les vociférations des éléments déchaînés qui parfois dans un ultime mouvement de colère, faisaient d’une fenêtre claquer les volets, quelque part, là-bas dans le quartier.
- Prés du kanoun assoupi sous la cendre dormait voluptueusement mon gros chat, confortablement perché sur le petit banc de bois... Contrarié de toute évidence par les intempéries, il avait ce soir-là manifestement renoncé à son habituelle ballade nocturne. Couché sur le ventre ses deux pattes avants repliées sous lui-même, les oreilles en pointes et moustaches saillantes il ronronnait doucement, sans se soucier de la tempête qui était loin de se calmer... Avec majesté il laissait même choir sa queue tigrée sur le plancher : on aurait dit un Sphinx paisible scrutant l’immensité, pour tenter un moment d'en saisir tous les secrets...
- Depuis longtemps déjà, ce côté insaisissable et mystérieux du chat m'a toujours inspiré un profond respect et une admiration certaine pour cet étrange animal. D'ailleurs, ce mystère indéfinissable qui émane de toute sa personne, faisait dire à Louise, ma mère : " un chat est éternel, parce qu'il a sept âmes ! "
- C'est bien pour cela que dans l'Égypte pharaonique, le chat figurait en bonne place au rang des divinités.
- Pendant que je philosophais consciencieusement sur le chat, il me vint en mémoire une drôle d’histoire que je ne puis m’empêcher de raconter :
" C’était un soir de décembre pluvieux et venté... L’orage avait plongé notre cuisine dans le noir absolu, alors que nous étions en train de souper... Un somptueux morceau de boudin frit, était depuis un moment en sursis dans mon assiette et dans l’obscurité qui régnait dans la pièce, je ne sais pourquoi, je me mis soudain à penser au petit Jésus... mais attention ! pas le gentil Jésus qu'il y a dans les églises, mais l'autre ! le méchant, qui parfois coupe les oreilles et la langue des garnements de mon âge...
- Avec une certaine angoisse je me suis dit alors, que ce petit Jésus vengeur pourrait très bien profiter de l’obscurité, pour venir me punir de toutes mes bêtises.
- Je n'ai pas eu à chercher longtemps comment il pourrait s’y prendre et c’est pourquoi lorsque d’une main prudente j’entamais l’exploration du contenu de mon assiette, le châtiment divin était déjà tombé ! Et cela sans aucune possibilité d'appel... Vide ! mon assiette... car, comme par enchantement, mon festin mystérieusement avait disparu... Effrayé comme peut l'être un enfant, je sanglotais très fort lorsque enfin ma mère alluma la lampe à pétrole... et la lumière fût !
- Alors j'accusais à chaudes larmes, le petit Jésus d'avoir pris le boudin de mon assiette et je revois encore sur tous les visages, la stupeur et la superstition de toute la famille, devant ce plat inexplicablement vide de son contenu...
- Passés les premiers moments de surprise on trouva enfin sous la table, le chat qui sans façon terminait son repas de boudin... Quelle frayeur ce soir là ! sacripant de matou... Mais je peux te le dire aujourd'hui avec reconnaissance, que c’est à toi seul mon chat à qui je dois ma plus belle histoire d’enfant... d'ailleurs, jamais je ne lui en ai tenu rigueur... Après tout ce soir là, le petit Jésus trop affairé à jouer au boules dans le ciel, lui aurait peut-être dans un roulement de tonnerre, intimé l'ordre d’exécuter sans plus tarder sa sentence : quand aujourd'hui il m’arrive d’y penser, je me dis que c’est sûrement ça ! "
A la Lumière d'une Lampe à pétrole.
- Pendant que distraitement j'évoquais ces souvenirs, dans notre cuisine tout était calme. Au-dessus de nos têtes et dans le ciel d’orage le bon Dieu poursuivait sa partie de pétanque... pour bien montrer qu’il était en ces lieux le Maître incontesté, sans même se gêner il lançait bruyamment ses boules de feu à la tête des nuages, qui dans un tintamarre du diable raisonnait très fort en faisant trembler tous les murs du Bastion.
- D'un coup un éclair fantastique illumina la pièce, très vite suivi d'un retentissant coup de tonnerre... Comme d’habitude, l’inévitable panne de courant plongea la cuisine dans l’obscurité la plus totale, qui devait mettre en exergue le tempo monotone de la pluie et la plainte furieuse des éléments déchaînés.
- Je m'attendais encore à une punition du Seigneur, lorsque Pétronille ma grand-mère inonda les lieux d’une pâle lumière jaune, offerte une fois de plus par la vieille lampe à pétrole de la maison... Cet éclairage d’un autre temps donnait à ces lieux un aspect curieux, mais, surtout étrange, qui, en cette nuit de tempête, ne manquait pas d’exciter l'imagination d’un enfant de mon âge : sur les murs de la pièce je suivais attentivement, la sarabande d’une armée mouvante d’ombres chinoises, qui esquissait la silhouette dansante et déformée des multiples objets alignés sur la hotte du potager. On aurait dit un bataillon chancelant dans la tourmente et qui marchait avec peine vers je ne sais quelle destinée... A chaque coup de Bafoungne la flamme de la lampe vacillait et les ombres s’animaient comme des soldats sur le qui-vive, toujours prêts à faire face aux assauts de féroces ennemis...
- C’est par une gerbe d’étincelles crépitantes et multicolores, que Seigneur kanoun me tira enfin de cette rêverie, ce qui devait mettre fin cette bataille imaginaire... En cette nuit de cauchemar ces joyeux crépitements me firent comprendre, que le bon génie du foyer tel l’Ange gardien, était toujours là pour me protéger : il n’en fallait pas plus pour me rassurer !
- Sur le petit banc de bois le chat s’est alors retourné, puis, avec une paresse non dissimulée, il se mit en boule une patte sur le nez.
- Blotti dans son coin et noyé dans ses pensées, Vincenzo mon grand-père tirait en silence sur sa pipe, les yeux mi-clos et le visage figé écoutant par moments les bruits du dehors. Pétronille ma grand-mère avait repris son tricot et inlassablement à l’endroit et à l’envers, elle poursuivait sans relâche ses mailles compliquées...
- Sur son perchoir avec force tics tacs "Jazz" le réveil lui donnait la mesure, en exhibant volontiers son heure fluorescente, sans déranger pour le moins du monde les tendres canaris endormis dans leur cage.
- Quelque part dans la tempête, un moment, un chat errant miaula lamentablement. En ce soir de décembre j’ai cru comprendre au-delà des gouttières, combien sa chanson était particulièrement triste. Curieusement, un à un, les autres chats du quartier lui répondirent, sinistres, désespérés... Comme c’est étrange... A ce moment là, raide et hautain mon chat s’est dressé sur son derrière. Sa queue fouettait l’air d’un mouvement rapide et nerveux alors que dans ses prunelles figées, la lumière de la lampe donnait à son regard un éclat de braise qui me paru très inquiétant : ne dit-on pas quelques fois ? que les chat semblent percevoir dans une autre dimension, tout ce qui est invisible dans le monde des humains.
- Est-ce là ! peut-être ? le grand mystère des chats.
- Dans la pièce rien ne bougeait, sauf, la pâle lueur de la lampe à pétrole, qui, avec indolence, ondulait doucement dans sa cage de verre. Depuis un moment j’avais suspendu ma lecture et dans mes mains ma tête semblait bien lourde.
Le mystérieux récit
De Vincenzo le marin.
- A travers les brumes qui pénétraient doucement mon esprit, un moment, il m’a semblé entendre une bien mystérieuse histoire, que Vincenzo le marin marmonnait à voix basse : c’était une sorte d’évocation étrange et bizarre en tous cas insolites, un peu comme dans les contes de Grimm et de Perrault. Au-delà du vent violent qui criait à tue-tête sur le toit de la maison, il m’a semblé comprendre qu’autrefois au Bastion, par une vilaine nuit de décembre il s’était passé certaines choses, dont Vincenzo fût le principal témoin...
- Malgré la douce torpeur qui doucement m’envahissait, je prêtais attentivement l’oreille pour tenter de saisir l’incroyable récit de Vincenzo le marin - alias l’Africain :
" Dans un murmure, mon grand-père l’Africain évoquait cette époque ancienne où la famille résidait à Bône. Marin-pêcheur de son état Vincenzo avec sa grande Lancia, s’en allait régulièrement pour rallier le port de La Calle. Là dans sa vaste et longue barque, il chargeait le poisson péché par les chalutiers pour le transporter jusqu’à Bône. Ainsi au gré des saisons, Vincenzo et sa barque venaient régulièrement au Bastion, où, à vrai dire, il se sentait chez lui : en effet la population Calloise était constituée en grande partie de napolitains et de siciliens, c’est dire combien il était heureux de pouvoir rencontrer et converser avec des compatriotes qui à l’occasion, ne manquaient pas de le convier amicalement à une Macaronade ou à une Acqua-basse...
- Parfois il restait quelques jours à quai, surtout lorsque à l’entrée du port les intempéries mettaient une barrière des plus infranchissables. Alors pour passer le temps de ces longues soirées, mon grand-père s’en allait à pieds chez son cousin Samuel, lequel, exploitait une ferme sur la route de Tunis. Ainsi il passait la soirée en famille devant un bon plat de pâtes à l’ail et à l’huile d’olive, sans oublier en souvenir de Ventotène son île natale, de conclure le repas par le traditionnel quignon de pain noyé au fond du verre par un trait de vin rouge.
- Pour se rendre chez son cousin, l'Africain passait toujours par les bords de mer. Ce raccourci lui faisait longer la petite gare ferroviaire, le bâtiment des Douanes, puis, il empruntait la voie ferrée qui menait à Bône... Pendant son trajet, à gauche s'étendaient les cimetières : d'abord, celui des chrétiens avec ses cyprès et ses croix blanches qui se détachaient sur le bleu de la mer, puis, séparés par la route de la grande plage, venaient les cimetières israélites à gauche et musulmans sur la droite. Ce dernier était longé au sud, par la voie du chemin de fer qui s'en allait vers Bône... A quelque distance au-delà des cimetières la voie ferrée se poursuivait, après avoir croisé la route qui descend le long des abattoirs...
- Un environnement merveilleux s'étalait alors à tous les regards, avec pour décors en bas et à gauche la mer jouant avec les rochers et à droite vers le haut quelques modestes propriétés jardinières bien cultivées et protégées des vents du large par de longues haies de roseaux, qui n'arrêtaient pas d'onduler paresseusement au moindre souffle de brise marine...
- En ces lieux enchanteurs où les parfums de la terre se mêlaient joyeusement aux senteurs de la mer, le concert harmonieux de tous les oiseaux du voisinage était repris en cœur par le contre-chant des blanches mouettes, qui tournaient, gracieuses et légères dans l'azur du ciel...
- Vincenzo s'arrêtait parfois pour admirer vers l'Est, le grand Cap Roux qui plonge dans le bleu de la mer. Cette imposante montagne qui marque la frontière Algéro-tunisienne est d'une incroyable beauté, surtout, au soleil couchant, où sa teinte rouge sang n'est pas sans rappeler qu’autrefois en ces lieux, les sinistres Khroumirs* égorgeaient impitoyablement les infortunés voyageurs pour les dévaliser...
- Avant de bifurquer sur la droite et gravir les champs de vigne qui menaient à la ferme du cousin Samuel, l'Afrique, mon grand-père, observait toujours avec curiosité le mystérieux ravin du trésor, situé vers le bas en bordure de mer : dans le village, on disait qu'un fabuleux trésor fût découvert, là, par un ouvrier italien, lors de la construction de la voie ferrée...
- Moi, j'ai toujours pensé qu'en ces lieux solitaires, reposait le plus grand des chefs pirates de la méditerranée, au milieu de l'or et des joyaux autrefois pillés au hasard des abordages... Parfois je me demandais si ces lieux magiques, n'hébergeaient-t-ils pas non plus, le dernier sommeil de quelque Prince - ou de certain Roi ?
- Par temps clair sur l'horizon les Iles de la Galite et du Galiton pointaient parfois leurs nez par-dessus les Corallines, qui n'arrêtaient pas de courir vers le port comme une nuée de papillons blancs... Voir ces îles dans le lointain était toujours un signe précurseur de mauvais temps... C'est du moins ce que disaient les vieux marins pêcheurs du Bastion.
- A la belle saison pour mon grand-père, cette divine randonnée était un véritable enchantement. La féerie du paysage le transportait dans un monde rempli de bonté, caressé par la brise marine et le chant des mouettes... Aujourd'hui j'ai enfin compris pourquoi régulièrement il empruntait ce chemin, qui, à n'en pas douter, ne pouvait être que celui d'un petit coin de paradis Callois !
- Mais l'hiver venu et avec lui ses couleurs de deuil donnaient à ces lieux un aspect triste et des plus inquiétants, surtout le soir lorsque la nuit tombait. Vincenzo le marin bien que courageux n'était pas indifférent aux changements de la nature, aussi, à cette saison, lorsqu'il décidait de se rendre chez Samuel, il le faisait d'un pas ferme et pressé... Le coin des cimetières n'était sûrement pas pour le rassurer et le soir à la tombée du jour, il avait toujours hâte de franchir ces lieux sinistres, où par temps d'hiver le vent qui soufflait en tempête, faisait se plier et gémir les grands cyprès du Campo-Santo, mais surtout semblait apporter du plus profond des abîmes, les clameurs désespérées des Corailleurs d’antan engloutis par la mer...
- Dans notre cuisine la lueur jaune de la lampe se fit plus pâle. Ma grand-mère sur son siège s'était assoupie, les lunettes sur son nez et le tricot sur ses genoux...
- Dans son coin mon grand-père avait l'aspect d'un automate sans vie et sur le sol le kanoun faisait doucement chanter l'eau des bouillottes...
- Sur le petit banc de bois ignorant la tempête, le gros chat se tenait toujours immobile... Énigmatique et le regard fixe, l'animal méditait sur je ne sais quel sujet... A un moment il ferma ses belles prunelles, mais, dehors sur les toits, un autre matou se mit à sangloter... Le gros chat rouvrit un instant ses paupières et son regard jaune se fit si lointain et tellement triste, que j’ai cru presque qu’il pleurait...
Le Coin des Cimetières.
- L'Africain mon grand-père qui venait alors de reprendre sa complainte, racontait dans un murmure une bien curieuse histoire : ce monologue à voix basse évoquait un soir de décembre à La Calle, il y a de cela bien longtemps lorsqu'il était encore jeune.
- Voilà ce qu'il me semble avoir entendu dans un demi-sommeil... Enfin ? C'est ce que je pense :
" Comme de coutume, Vincenzo, avait décidé d'aller passer la soirée chez son cousin Samuel, mais le Bafoungne s'était levé et déjà de gros nuages sombres encombraient toutes les nues... Le chemin que parcourait l'Africain le pêcheur avait en ce soir naissant pris l'aspect d'un cauchemar : les arbres et les buissons s'agitaient vivement en d'infinis soubresauts, comme une multitude de bêtes qui agonisent sans espoir... Venant du large la plainte du vent apportait des relents, qui semblaient surgir des entrailles de l'enfer, où le cri des damnés assourdi par la vague furieuse, jaillissait désespéré - là-bas, au-delà des cimetières...
- Pour chasser l'angoisse qui montait en lui l'Afrique le loup de mer, tout en pressant le pas pensa un instant à la douce chaleur de la cheminée de Samuel et à la bonne soupe de la cousine Catherine, c'est alors que brusquement au moment même, où il longeait le cimetière arabe, qu'un curieux phénomène le figea sur place au beau milieu du chemin :
" comme par enchantement, le Bafoungne s'est arrêté de souffler et un étincelant rayon de lune perça brusquement les nuages... Le coin des cimetières fût baigné tout à coup d'un curieux clair-obscur, qui prit alors un aspect très inquiétant et les choses de la nature un visage des plus singulier... Un grand calme avait soudain envahi les lieux, comme ces silences impénétrables qui annoncent le malheur ! ... Dans un arbre, macabre, une chouette chuinta...
- Dans les collines du côté du chemin des crêtes, l'un après l'autre des chacals entonnèrent une sorte de Requiem, qui glaça le sang de mon grand-père.
- Par trois fois, il se signa pour invoquer tous les Saints du Paradis...
- Le long de la voie ferrée où, l'humidité de l’air s'évaporait doucement, en une brume fine et cotonneuse que, les rayons de lune métamorphosaient en de multiples arcs-en-ciel, tout était devenu calme et l’Afrique un moment se sentit presque rassuré.
Les Chats du Bastion de France.
- Jamais au grand jamais Vincenzo ne se serait douté, qu'une incroyable aventure allait commencer :
" dans le lointain et au même moment, une étrange rumeur qui venait du Bastion, excita vivement la curiosité de Vincenzo : c'était disait-il un bruit sourd et rythmé qui en sourdine approchait inexorablement de son chemin... Figé par une peur qu'il n’arrivait pas à définir, l'africain, encore une fois, se signa, puis, se re-signa...
- Non ! Il ne rêvait pas... Mais, quel était donc ce bruit étrange, qui arrivait jusqu’à lui ?!
- Malgré la fraîcheur de la nuit il était couvert de sueur et sans même réfléchir, il alla se blottir dans les buissons épineux qui bordent le bas-côté de la voie ferrée, peut-être, pour se protéger d'un danger imminent venu tout droit des enfers...
- De son refuge il pouvait voir la voie ferrée éclairée par la lune et délicatement voilée par une fine dentelle de brume légère... Lancinante, la mystérieuse rumeur assourdie et rythmée, approchait inexorablement de son côté, quand, soudain dans la pénombre, il aperçut cheminant lentement sur la voie, une colonne bien étrange qui venait du Bastion.
- C’était, murmurait-il dans un souffle, un spectacle étrange et incroyable : une horde de chats formant cortège, qui défilait lentement raide et fière et à pas cadencés le regard fixe et lointain...
- Malgré l'angoisse qui le tenaillait, Vincenzo se mit à observer ce tableau irréel qui passait juste devant lui : ouvrant la marche, un grand chat tigré de bien noble allure, portait sur son échine une longue cape de lumière, d'où par instants, s'échappait une fine poussière d’or qui s’en allait doucement poudrer tout le cortège...
- Puis, venaient ensuite en file par trois, neuf chats roux aux pourpoints scintillants : dressés sur leurs pattes de derrière, ils marchaient au pas cadencé, faisant rouler en sourdine des tambours de vermeil...
- Derrière eux cheminait un curieux équipage, fait de six chats noirs vigoureux harnachés de sangles flamboyantes. Ils tiraient sans effort au rythme des tambours, un chariot tout de blanc nacré à grandes roues dorées...
- Sur celui-ci, Vincenzo médusé remarqua la présence de deux chats gris en livrée et portant Gibus, qui conduisaient gravement ce convoi singulier.
- Vers l'arrière du chariot, une châsse de verre laissait apparaître une curieuse forme gisante tout de bleue vêtue et parée d'une fantastique couronne de précieux Corail...
- Du fond de sa cachette l’Africain se demandait s'il n’était pas en train de perdre la raison, devina dans le gisant du chariot de nacre un chat d'une fantastique majesté, qui semblait dormir d'un sommeil qui ne pouvait être qu'éternel.
- La douce lueur de la lune donnait à ce chat couronné une telle grâce, que dans sa simplicité mon grand-père pensa naïvement, que ce devait être là un personnage de haute lignée. D'ailleurs sur les côtés de l'étrange corbillard, trônait une figure que l’Africain ignorait : un blason couronné et paré de brins de corail, avec au centre un bel oiseau tout blanc aux grandes ailes déployées, foulant de sa patte les flammes ardentes d’un foyer... Par moments, le volatile s'évaporait doucement le long du chemin, pour sans cesse de ses fines cendres renaître à l'identique et intact un peu plus loin...
- Je sais aujourd'hui que, le bel oiseau blanc qui mêlait ses cendres à la poussière du chemin, ne pouvait être que, le fabuleux Phénix du Bastion de France ! et cela, Vincenzo le marin ne pouvait pas le savoir.
- Devant les images étonnantes et bien mystérieuses qui n'arrêtaient pas de défiler sous ses yeux, l'angoisse de l'homme fît place à la curiosité et il se mit de plus belle à observer le reste du cortège.
- Un peu vers l'arrière et par petits groupes, venait disparate une longue file de chats : les premiers, richement vêtus et pourvus d'une belle prestance, Vincenzo crû reconnaître là tous les chats des notables du village...
- Puis, suivait dans un désordre indescriptible, une bande de chats hétéroclites, les uns, en habits de jardinier, les autres, ébouriffés et mal tenus... peut-être, ceux de la route du lac ou bien les autres, ceux qui gîtent dans les rochers de la presqu’île ? pensa-t-il en désespoir de cause.
- Toute cette foule silencieuse de chats qui suivait le corbillard au rythme des tambours, était à l'évidence accablée par une douleur infinie. Le silence de mort de ce coin des cimetières et ce cortège de chats si tristes, qui manifestement enterraient un des leurs ne laissaient pas d'intriguer mon grand-père... lorsque la troupe lentement dans la nuit s’éloigna, là-bas vers le ravin du trésor...
- A cet instant et comme par enchantement, le ciel se couvrit cachant la lune sous son manteau de deuil et d'un coup le Bafoungne s'est remis à pleurer de plus belle... Dans les rochers du cimetière désespérée la mer arrachait son manteau de blanche écume et puis avec tristesse le ciel se mis à sangloter... Éberlué Vincenzo se tira avec peine des fourrés et repris prestement sa route en frissonnant de tous ses membres.
- Que s'était-il donc passé ? ... Que signifiait enfin cette horde de chats tellement tristes ? ... Et ce chat couronné sous la châsse de verre du grand chariot blanc ? ...
- Ce tableau fantastique ne pouvait être - qu’un mirage apporté par la violente tempête ! ...
- C'est sûrement ça pensa-t-il, alors qu'il gravissait péniblement le champ de vignes, où vers le haut brillaient faiblement les pâles lumières de la ferme du cousin Samuel.
Samuel et Carmen,
les Cousins du Bastion de France.
- Sur le pas de la porte Samuel attendait mon grand-père en regardant tomber la pluie et dans la petite ferme un bon feu crépitait allègrement dans la cheminée... Prés de l'âtre béatement le gros chat du cousin dormait... La lampe à pétrole illuminait doucement la table où la cousine Carmen s'affairait depuis un bon moment...
- Le cousin Samuel dit à l'Africain :
" tu sais Vincenzo ! ? je ne sais pas ce qui se passe... Mokhtar, mon ouvrier agricole, vient de me dire qu'à La Calle tous les rats sortent des égouts et qu'ils ont envahi les rues de la ville", et puis, il ajouta scandalisé : " même pas un chat dehors il y a ! ... pour casser le cou à cette vermine...il paraît que les souris et les cafards eux aussi se sont mis de la partie. "
- Mais l'Africain était trop absorbé dans ses pensées pour répondre à Samuel, cependant, il sursauta à l'annonce de cette nouvelle.
- Lorsque Vincenzo est entré dans la pièce, le matou de la maison qui dormait pelotonné sur lui-même - ne s'est même pas réveillé... A la mine défaite de l'africain le brave cousin Samuel comprit immédiatement, que quelque chose d'inhabituel venait de se passer.
- Prés de la cheminée mon grand-père obstinément restait muet et semblait noyé dans ses pensées... C’est peut-être la fatigue du chemin et la tempête ? pensèrent alors de concert les cousins...
- Passons à table ! dit enfin Samuel - pour tenter de rompre le silence... Ce soir-là, Carmen avait préparé un grand plat de Morue, accompagné de pommes de terre toutes fumantes qui embaumaient délicieusement les lieux. Au dehors, la tempête en furie était à son paroxysme : de violents coups de tonnerre faisaient trembler les vitres de la ferme et le Bafoungne par rafales projetait de violentes trombes de pluie sur le toit de la maison...
- Autour de la table chacun mangeait de bon appétit et en silence... A un moment, Samuel qui regardait son assiette, dit d'une voix de circonstance : " de la Morue ! comme pour la fête des morts ? "
- En effet, cette antique tradition venue d'Italie s'était pérennisée à La Calle... De coutume ancienne, le poisson était toujours servi pendant les jours dits maigres : les vendredis, bien sûr, mais aussi, durant les fêtes de la Toussaint et aux veillées de Noël...
- Est-ce pour cela que Samuel fit cette réflexion ! ?
- A cet instant, Vincenzo regarda longuement son cousin... Dans sa tête défilait toujours l'étrange cortège des cimetières et devant lui ce plat de Morue de circonstance qui sur la table, exhalait tout son parfum des jours de deuil...
- " Comme pour les morts ! " répéta machinalement Samuel.
- Pourtant décembre était bien avancé et Noël des plus proche, mais ce vilain soir de décembre ne pouvait que rendre propice toutes ces tristes pensées.
- Dans la pièce le tapage assourdissant des éléments déchaînés, n'avait pas empêché les enfants de s'endormir sur un coin de la table. Près de l'âtre le grand chat recroquevillé sur lui-même, continuait de dormir profondément en ronronnant de plus belle...
Vincenzo
raconte sa mésaventure.
- Le repas venait de se terminer et Vincenzo de sa main essuya machinalement ses belles moustaches, puis rangea consciencieusement son fidèle canif dans la poche de son veston. Mais, était-ce la douce chaleur de la cheminée, où celle des petits verres d'eau de vie de Samuel, qui délièrent enfin la langue de mon grand-père ? Il ne le dit pas… moi, je pense que ce soir-là, se trouvant bien en famille, son histoire ne lui parue pas ridicule, ni même grotesque à raconter : après tout, les cousins qui jusqu'alors avaient respecté son silence, n'attendaient peut-être que cela ?
- C'est ainsi qu'il conta son étrange aventure, consciencieusement et dans les moindres détails.
- Dans un silence religieux et sans même faire le moindre des commentaires, les cousins écoutaient avec attention ce récit d'un autre monde... L'histoire de l'Afrique était bien réelle et ils en étaient persuadés, car leur cousin n'était ni menteur, ni affabulateur, bien au contraire. Mais il faut le dire, que la superstition était alors bien ancrée dans les mœurs du Bastion de France et jamais personne n'aurait osé rire de cette histoire de fous : il en était ainsi sur cette terre de Barbarie...
- Vincenzo encore tout retourné poursuivait son histoire et d'une voix calme il évoquait ce mystérieux cortège funéraire, fait de tous les chats du village et de ses alentours... Que cette foule était triste, dit-il, mais, pourquoi une telle douleur, un tel chagrin ! ?
- Un moment l'Afrique se fit silencieux et à plusieurs reprises, il tira doucement sur sa pipe et finit son verre d'eau de vie de marc... Alors il fronça les sourcils et son regard se fit très lointain...
- Manifestement, Vincent le marin venait peut-être de trouver - une réponse à sa question ! ?
- C'est alors, que d'une voix assurée et plus forte que la tourmente, il s'écria en tendant ces deux bras vers le ciel :
" dans le chariot blanc aux roues dorées, ce chat défunt et couronné de corail, c'était sûrement un Roi accompagné par son peuple jusqu'à sa dernière demeure... "
- Samuel et Carmen un moment étonnés, ouvrirent très grands leurs yeux : cette affirmation de l'Afrique les avait paralysés de surprise et comme ils restaient là sans voix, figés comme des statues sur leurs sièges, mon grand-père d’un coup se leva… Les bras tendus et prenant le ciel à témoin, il hurla au-dessus de la tempête :
- " le grand Roi des chats du Bastion de France est mort ! C'est bien lui que l'on emmenait ce soir vers le ravin du trésor. "
- A plusieurs reprises comme pour bien se faire entendre par-dessus la tourmente, il ne cessait de répéter :
- " le Roi des chats est mort ! Le Roi des chats est mort ! ... Je n'ai pas rêvé ! ... Tous les chats de La Calle étaient là - pour accompagner sa dépouille mortelle. "
Le Roi des Chats est mort.
Vive le Roi !
- Alors que les cousins se perdaient en conjectures, le grand chat qui dormait prés du feu se dressa brusquement, tête haute et moustaches en bataille. La lueur du foyer devait donner alors à son pelage fauve un aspect d'une fantastique noblesse.
- Tous les yeux étaient fixés sur l'animal, lorsque méprisant et hautain comme les chats savent si bien le faire, il toisa l'assemblée d'une prunelle ardente et remplie d'orgueil... Soudain, une violente rafale de vent ouvrit la lourde porte d'entrée, entraînant dans la pièce un tourbillon de feuilles mortes...
- D'un bond fantastique et harmonieux, le grand chat gagna le pas de la porte, et là, se redressant de toute sa hauteur, il cria joyeux avec la voix des humains :
- " le Roi des chats du Bastion est mort ? !
- Mais alors maintenant ! Le grand Roi de tous les chats du Bastion de France - c'est moi, son seul et unique héritier...
- Je suis maintenant un grand Roi et il est temps de rejoindre mon peuple ! ...
- Adieu ! Pauvres humains - souffrez que je vous laisse à votre destin."
- Il disparut alors prestement dans la nuit emporté par la tempête, alors que dans les nues le tonnerre donnait une nouvelle fois de la voix... Carmen se signa et prit son chapelet... Les deux cousins stupéfiés sur leurs sièges se regardèrent un moment et pour chasser l'insidieux malaise qui s'était installé dans la cuisine, machinalement et d'un même geste ils se servirent en tremblant une large rasade d’eau de vie.
- Les enfants dormaient toujours sur leur coin de table et dans la cheminée, le feu commençait à s'éteindre...
- Jamais plus les cousins ne revirent leur chat... Même en famille on évita désormais d'évoquer cette histoire et le secret fût très longtemps bien gardé... Quant à mon grand-père, il retourna souvent chez Samuel mais en désertant définitivement la route des cimetières, surtout, les soirs d'hiver lorsque soufflait la tempête.
Quand fleurissent les contes ?
- Comme toujours l'ange qui passe avait jeté un peu de sable dans mes yeux d'enfant... La lumière était revenue dans la cuisine et la tempête s'était un peu calmée...
- Mon grand-père rangeait religieusement sa pipe et enfin retirait sa casquette pour s'en aller dormir.
- Couché sous mes couvertures malgré la douce chaleur de la bouillotte et le sommeil qui brouillait mon esprit, je me demandais où était passé mon gros chat ? Étrangement il avait disparu ! Une dernière fois je tendis l'oreille... Comme c'est curieux dehors sur les toits, les matous avaient cessé leur chanson triste...
- Dans les rochers du Lion la mer qui grondait toujours, m'a gentiment demandé de fermer les yeux et le Bafoungne tendrement m'a souhaité une bonne nuit...
- Aujourd'hui encore lorsque j'évoque ce soir de décembre, il m'arrive de me demander si l'histoire que j'ai cru entendre dans le murmure de mon grand-père - est un rêve fantastique ou une réalité ?
- Mais en ces jours de Noël, moi, j'aime mieux croire, que là-bas au Bastion de France, les contes pouvaient aussi fleurir comme le plus beau du corail - surtout, par certains soirs de décembre alors que souffle la tempête.
Épilogue.
- Ce conte de Noël, je l'ai écrit pour Claire et Benoît mes enfants chéris, mais aussi - pour tous ceux du Bastion de France.
- Même si la nostalgie n'appartient qu'à soi, vous trouverez dans cette naïve évocation toute la joie, mais aussi la souffrance d'un être humain arraché à sa patrie... Dans ce pays de mon enfance imprégné des superstitions ancestrales et au milieu des gens simples, bons et laborieux, j'ai vécu heureux avec Louise ma mère, Vincent et Pétronille mes grands-parents, mais aussi avec vous tous, mes frères et sœurs du Bastion de France : soyez ici, affectueusement remerciés.
- Si par hasard une fois seulement, il vous venait à l'idée d'aller là-bas à La Calle, pour écouter certains soirs d'hiver le concert prodigieux de la mer et la plainte du Bafoungne, du fond de votre lit ayez une petite pensée pour moi...
- Lorsque parfois il m'arrive de parler - du Bastion de France - de la mer - et du Corail… Avec cet accent d'autrefois, tendez bien votre oreille, surtout, si je murmure quelque histoire - comme Vincenzo, mon cher et regretté grand-père NAPOLITAIN… Ce que je pourrais vous conter tout simplement, c'est la chanson lancinante du Bafoungne, que dans ma tête je ne cesse d'entendre.
-
Mais il faut que vous sachiez, que je pourrais dormir en paix - tant que soufflera le Bafoungne ! …
- Comme lorsque j'étais enfant, chez nous, là-bas, autrefois à La CALLE de France.
16 Décembre 1995.
A Giens en Presqu'île. Hyères. ( Var.)
Par un vilain jour de tempête, bien triste et infiniment nostalgique.
INDEX EXPLICATIF
Du VOCABULAIRE CALLOIS.
- Popol le Sacristain : il s'agit de Paul VELLA, sacristain en chef de St Cyprien.
- Lac MELAH : Lac salé en Arabe - communiquant avec la mer.
- Bafoungne : vent du Nord-Ouest soufflant avec violence en hiver.
- Ile de Ventotène : petite île de l’archipel des îles Pontines / golfe de Gaète (Italie)
- Gaète : port de la côte Ouest de l'Italie, au Nord-Ouest de Naples.
- Kanoun : brasero de terre cuite d'origine arabe.
- Ancienne douane : bâtiment des douanes de 1882 transformé en appartements.
- L'Africain / l'Afrique : sobriquet de mon grand-père Vincent Gabriel PEPE.
- Cousin Samuel : alias, Samouère - il s'agit de M. Samuel BALZANO.
- Kroumirs : arabes faisant partie de la tribu des Kroumirs.
- Camposanto : signifie cimetière en Italien.
- Phœnix : oiseau mythique renaissant chaque fois de ses cendres : orne le blason de La CALLE.
Ce que cache ce conte énigmatique.
La première partie de ce texte, chante la vie du bastion de France à la belle époque :
- les soirées d’hiver.
- les splendeurs de la nature environnante.
- la famille.
La deuxième partie de ce texte, chante un triste requiem, qui marque le déclin du bastion de France :
- Observez l’équipage fait de chats qui tirent le chariot :
1 chat tigré portant une cap de lumière : chiffre 1.
9 chats roux faisant rouler des tambours : chiffre 9.
6 chats tirant le chariot : chiffre 6.
2 chats gris en livrée et portant gibus : chiffre 2.
Si l’on aligne un à un ces chiffres, on trouve 1962 : c’est l’année de l’exode et de l’exil où, 99% des européens Callois ont quitté définitivement leur ville natale.
- Observez le chariot blanc nacré aux roues dorées portant un blason :
1 Blason de La Calle bastion de France : je survivrai !
1 Phœnix renaissant de ses cendres signe la survivance.
Des brins de corail qui symbolisent la vocation du bastion.
1 couronne qui indique la lointaine appartenance de la cité au royaume de France.
Ce blason à lui seul symbolise La Calle et le chariot l’âme du bastion de France.
- Observez le gisant, vêtu de bleu reposant dans sa chasse de verre et coiffé d’une couronne de corail :
Majestueux : comme un roi.
Vêtu de bleu : couleur de la méditerranée.
Couronne de corail : souverain du bastion de France.
Ce gisant couronné de corail, représente la cité du corail que l’on enterre en juillet 1962 - date de l’indépendance de l’Algérie - mais qui clame toujours : "je survivrai !"
- Observez les chats qui suivent le cortège funèbre :
Les chats des notables.
Les chats des jardiniers.
Les chats des rochers de la presqu’île.
D’autres nombreux chats…
C’est toute la population européenne Calloise qui est dans le deuil, et cette image marque l’exode et l’exil de notre peuple vers la terre de France.
- Observez les propos tenus par le cousin Samuel Balzano :
Son ouvrier qui revenait du village lui a indiqué, que les rues étaient encombrées par des rats, souris, cafards en liesse.
Qu’il n’y avait aucun chat pour les chasser.
Ce sont les défilés continus qui marquaient l’indépendance de l’Algérie le 03 juillet 1962, alors que 99% de la population européenne était partie et que les 1% resté s’étaient terrés dans leur maison.
- Observer le chat du cousin Balsano :
Il dort paisiblement près de l’âtre.
Il se réveille en sursaut, lorsqu’il entend dire que le roi des chats est mort.
Il se dresse et crie qu’il est désormais le roi des chats.
Il s’enfuit très royal et jamais on ne le revit.
On retrouve dans cette image le symbole de la survivance du peuple de La Calle, que l’on ne reverra plus dans les rues de la cité du corail, mais qui renaîtra sur la terre de France en 1979 par la naissance de :
l’Amicale des Callois
et Amis de La Calle.
Jean-Claude PUGLISI
- de La Calle Bastion de France.
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
Giens en presqu’île - HYERES ( Var )
|
|
|
LES TREMBLES
Echo de l'ORANIE N°249, MARS/AVRIL 1997
|
|
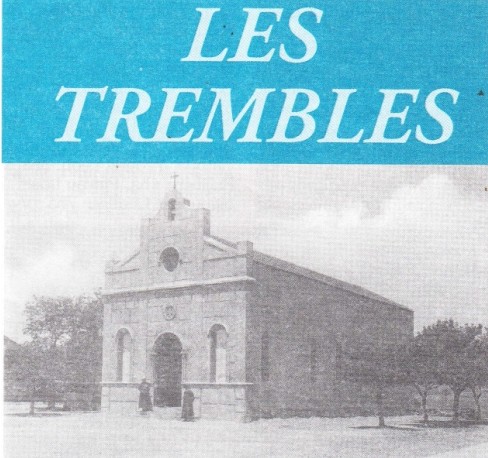 La commune des Trembles, dont le nom ancien était Sidi-Hamadouche est située à 491m d'altitude, entre les centres de Oued Imbert et Prudon, à 15 Km de Sidi-Bel Abbès. Elle a été érigée en commune de plein exercice par arrêté préfectoral en date du 25 juin 1874. Antérieurement rattachée à la circonscription militaire de Sidi-Bel-Abbès, elle comprenait les communes de Oued Imbert et Lauriers Roses qui ont été extraites entre 1880 et 1885. La commune des Trembles, dont le nom ancien était Sidi-Hamadouche est située à 491m d'altitude, entre les centres de Oued Imbert et Prudon, à 15 Km de Sidi-Bel Abbès. Elle a été érigée en commune de plein exercice par arrêté préfectoral en date du 25 juin 1874. Antérieurement rattachée à la circonscription militaire de Sidi-Bel-Abbès, elle comprenait les communes de Oued Imbert et Lauriers Roses qui ont été extraites entre 1880 et 1885.
Elle s'étend sur 13.261 hectares et comprenait outre le Centre, cinq sections de douars : Oued Mebtouch, Zélifa, Ténia, Sidi Ghalem, M'hadid-Embaba ainsi que la cité du barrage de I'Oued Sarno. Son climat continental est sain et sec : la pluviométrie de 369 mm est répartie sur une soixantaine de jours par an, d'octobre à fin novembre et de février à fin mars. De violents orages d'été peuvent survenir et même entraînent parfois des inondations dans la partie basse du terroir comme celles du 23 juillet 1929. Trois ou quatre jours par an on enregistre quelques chutes de neige peu abondantes et vite fondues. Arrosé par la Mekerra qui signifie: "endroit d'eau où on abreuve les troupeaux, née à Ras el Mâ "La tête de l'eau" au pied des monts de Daya (Bossuet) ce modeste court d'eau prend, en aval des Trembles le nom Oued Mebtouh "Humide, mouillé", puis plus loin devient l'Oued Sig.
Cette plaine était à l'origine, le domaine des jujubiers sauvages, des palmiers nains et des "trembles" ou peupliers, d'où le nom du village. La faune y était représentée par des chacals, des hyènes, des sangliers, des chèvres sauvages, des lions et des panthères. On en rencontrait encore au sud de Bel-Abbès en 1850. Peuplée de berbères nomades qui se mirent à la culture vers le IIIème siècle avant Jésus-Christ, elle fut mise en valeur par les romains qui pour se protéger des envahisseurs nomades du sud construisirent un fort sur le Djebel Tessala défendu un moment par les cavaliers de la 4ème Aile Auguste Antonine recrutée parmi les Parthes de Perse comme l'attestent les inscriptions latines. La tribu arabe des Béni Amer venue d'Arabie s'y installe mais elle est refoulée par les tribus de Tlemcen des Armana et de Sidi-Brahim. Les conflits sont constants.
En 1832 on ne trouve là que la kouba solitaire du marabout Sidi Bel Abbès. En 1839 les Beni Amer veulent s'y implanter à nouveau mais le Maréchal Clauzel les oblige à émigrer au Maroc. Les Hadjez, éleveurs nomades s'établissent alors au pied du Tessala sur 2.200 hectares. En 1840 le marabout de Sidi-Bel-Abbès est un gîte d'étape sur la route d'Oran à Bossuet. Les Béni-Amer, toujours en révolte tentent de revenir du Maroc et le Maréchal Clauzel doit diriger contre eux une expédition. En 1845, le 3ème bataillon du 1er Régiment Etranger installe prés du marabout une enceinte avec magasin de vivres et redoute. Le colonel Bedeau érige un petit village d'une dizaine de maisons. En 1849, le capitaine du Génie Prudon élabore un projet d'installation de villages agricoles pour 100 familles de colons pour une dépense de 230.000F or, avec maisons de 2 pièces à rez-de-chaussée, grande cour et clôture. En 1850 le village des Trembles est créé prés du marabout de Sidi Hamadouche : C'est le plus ancien centre de la plaine avec Boukanéfis et Sidi-Khaled (Palissy). Le village comprend alors 60 familles, dotées de 1.200 hectares cultivables.
En 1887, nous écrit Mme Knutzen, le Maire est M. Maréchal, l'instituteur : Depontellet, l'institutrice : Mlle Segui, le receveur des postes : Guilbert, les aubergistes : Espinosa, Gilles, Ignacio, Mira (père), Martinez, Vve Ponsot, le boucher : Emsalem, les boulangers : Espinosa, Mira, bourrelier : Galbès, Charrons-forgerons : Queriaux, Négre. Senac, le coiffeur : Gilles, le cordonnier : Vacher (frère), la minoterie : Jover. Viticulteurs, agriculteurs : Alberge, Davoine (dit Lavenue), Galbès, Holwech, Leblanc, Lecheneau, Machat, Mira, Monaud, Mingret, Paya, Perret, Pinot, Rebol, Reynaud, Sigonet, Verret, Vuillemain.
Au début de la colonisation, le curé de Sidi-Bel-Abbès assurait le service du culte mais étant donné la distance et les conditions pénibles des déplacements, on ne le voyait pas souvent. Plus tard, vers 1868-69 le curé de Sidi Brahim prit en charge le village ; La messe et toutes les cérémonies du culte étaient célébrées dans une pièce retirée, derrière les habitations Boulet, face à la rivière. En 1869, un certain M. Lorens fit construire un local plus spacieux qui servira plus de trente ans de chapelle où exerceront les abbés Tournier et Cambrichon. La paroisse des Trembles ne fut créée qu'en 1878 mais le premier acte inscrit sur les registres, un baptême, eu lieu le 26 novembre 1877 par l'abbé Soucarre qui devint curé de la paroisse le 16 juin 1878. Le 28 septembre, Mgr Vigne donnait comme patron à la paroisse St Rémy, évêque. L'abbé Delmas arriva en juillet 1884 alors que sévissait une épidémie de choléra. Le docteur Lelièvre qui exerçait à Sidi Bel-Abbès ne voulant pas se déplacer, l'abbé Delmas, médecin du corps et de l'âme prodiguait ses soins à ses paroissiens. La population reconnaissante fit frapper une médaille en or et le gouvernement lui décerna une médaille d'honneur remise par le maire, M. Sigouney dans la cour de l'Ecole de garçons. Mais le bon prêtre atteint des fièvres paludéennes dû quitter les Trembles définitivement en janvier 1893.
Finalement une église fut bâtie et bénie le 20 mai 1928 par Mgr Durand. Evêque d'Oran. Elle lui fut présentée par l'Abbé Le Clainche. Elle a été financée exclusivement par les paroissiens.
 Lors du "Grand Retour", le mardi 29 mars 1949. le village accueillit Notre-Dame de Santa-Cruz au cours d'une très belle cérémonie. Les pauvres et les "bons riches" s'unirent pour construire un clocher et acheter un carillon qui fut inauguré le 27 mars 1955, par le curé, le R.P. Straesslé. Le maire. M. René Schweitzer offrit la plus grosse cloche, un fa de 900Kg. Les noms des donateurs sont : Sibioude, Mariano, Sénac, Maigre, Serrano, Gabriel Lopez, Albert Miller et les marraines des 4 plus grosses cloches : Mmes Maigre, Vincent. Liberato. Rebolle. Marin, Cerdan. Ce fut une bien belle fête : "Entouré de nombreux prêtres, chanoines, R.P.. directeurs du centre professionnel de Misserghin, avec leurs élèves, leur fanfare et leur clique de tambours et clairons, les pères de Sonis, les missionnaires du St-Esprit, les curés des environs, et même le curé doyen de Tlemcen, Mgr Lacaste. Evêque d'Oran assisté du vicaire général Lecat et du chanoine Collet bénit les nouvelles cloches ornées des plus belles dentelles qu'on puisse réunir pour un tel jour. "En 1956 et 1959. Le village reçut les visites pastorales de Mgr Lacaste en tournée de confirmation. Le bon père qui le reçoit pour la 3ème fois est âgé de 75 ans et tous les gens de la commune ont bénéficié de son dévouement : Il est unanimement aimé et respecté. Lors du "Grand Retour", le mardi 29 mars 1949. le village accueillit Notre-Dame de Santa-Cruz au cours d'une très belle cérémonie. Les pauvres et les "bons riches" s'unirent pour construire un clocher et acheter un carillon qui fut inauguré le 27 mars 1955, par le curé, le R.P. Straesslé. Le maire. M. René Schweitzer offrit la plus grosse cloche, un fa de 900Kg. Les noms des donateurs sont : Sibioude, Mariano, Sénac, Maigre, Serrano, Gabriel Lopez, Albert Miller et les marraines des 4 plus grosses cloches : Mmes Maigre, Vincent. Liberato. Rebolle. Marin, Cerdan. Ce fut une bien belle fête : "Entouré de nombreux prêtres, chanoines, R.P.. directeurs du centre professionnel de Misserghin, avec leurs élèves, leur fanfare et leur clique de tambours et clairons, les pères de Sonis, les missionnaires du St-Esprit, les curés des environs, et même le curé doyen de Tlemcen, Mgr Lacaste. Evêque d'Oran assisté du vicaire général Lecat et du chanoine Collet bénit les nouvelles cloches ornées des plus belles dentelles qu'on puisse réunir pour un tel jour. "En 1956 et 1959. Le village reçut les visites pastorales de Mgr Lacaste en tournée de confirmation. Le bon père qui le reçoit pour la 3ème fois est âgé de 75 ans et tous les gens de la commune ont bénéficié de son dévouement : Il est unanimement aimé et respecté.
Au début du siècle nous dit l'Echo des Trembles, le maire est Maréchal Justin, son adjoint : Auguste Reynaud, son secrétaire Audubey. Le Garde Champêtre : Récés ; le Curé : Jean Barrère ; le médecin de la colonisation résident à Bel-Abbès : Gillet ; le receveur résidant à Bel-Abbès : Audubet ; Institutrice : Mlle Segui ; Instituteur : Depontailler ; Receveur des Postes et Télégraphe : Berth-Roger : Garde des eaux : Pénan aux Trembles et Delseney à Zélifa ; Chef Cantonnier : Galdin. Viticulteurs aux Trembles : Célestin Alberge : 39ha 50 a. Calbès Gaétan : 8ha, Holweck Charles : 20ha 55a : Les héritiers Machot : 1ha 25a ; Mercy Auguste : 7ha ; Mira Ignacio : 20ha ; Mornand Charles : 1ha 50a ; Yéogret Léon : 3ha. Vve Brisson : 6ha, Perrin Philibert : 4ha. Pineau Louis : 26ha ; Vve Rebolle : 8ha, Sigouniey Charles : 7ha. Vve Reynaud : 7ha ; Rollin Louis : 80ha ; Torres Antonio : 7ha ; Vernet : 14 ha ; Kremer Pierre : 7ha ; Vuillemin Augustine : 8ha. Viticulteurs à Ain-Oumata : Paya : 5ha ; Villemin : 25ha. Viticulteurs à Zélifa : Giraud Jules et Alphonse : 4ha : Canisares Vicente : 7ha ; Maréchal Justin : 53ha 50a : Muller Joseph : 1ha 50a ; Perrin Philibert ; 9ha, Perry Eugène : 3ha ; Quessada : 7ha ; Mme Raux : 42ha ; Vve Seguin : 1ha.
L'annuaire des Trembles année 1961-62 cite : François Albérola, commerçant : 07; Maurice Benkemoun, commerçant : 20. Chapuis-Monnier, Prop. Zélifa : 1 ; Zélifa, René Farenc forgeron : 17, Gendarmerie : 19, Gendarmerie mobile 5ème escadron : 21, Gendarmerie mobile d'oued Sarno, centre d'instruction 22, Grailhe Gilbert, représentant : 15, Joyot Augustin : 08, Hydraulique et équipement rural, barrage du Sarno : 12, Livérato Auguste, entreprise défoncement : 11, Lopez Gabriel, entreprise transports : 18, Lopez (Vve) commerçante : 02, Maigre Louis, propriétaire : 14, Mairie : 06, Millier A. agriculteur Zélifa : 2 Zélifa, Radio diffusion française, centre émetteur des Trembles (demander l'inter à Sidi-Bel-Abbés), Rebolle Mme Renée, commerçante : 13, Schweitzer René : 04, Sénac Lucien, charron-forgeron : 10. Torrès (Vve Joseph) commerçante : 03.
En 1955 la population est de 3.965 habitants dont 662 européens. Ses ressources sont essentiellement agricoles: blé, orge, avoine et vignes. Il existe une coopérative agricole annexe de celle de Sidi-Bel-Abbès ainsi que trois moulins de mouture indigène. La commune possède un foyer rural et depuis le 15 janvier une gendarmerie y a été installée. Elle est administrée par un conseil municipal composé de 22 membres dont 13 pour le premier collège et 9 pour le second et une djemaa de 10 membres. Un poste émetteur radio relais de celui d'Alger est situé au barrage d'Oued Sarno.
Nous avons pu retrouver l'histoire de certains habitants : M.René Schweitzer est né le 11 juillet 1897 à Assi-Bou-Nit. Ses grands-parents originaires de Mulhouse et du Doubs obtiennent une concession en1842 à Dar-Beïda (Oran). Leur fils Eugène. Schweitzer créera un domaine à Hammam-Bou-Hadjar qui continuera à être exploité par ses descendants. René Schweitzer sera élu Maire des Trembles en 1947 et toujours réélu. Mobilisé en 1914 il fait les campagnes de France et du Maroc au 4ème Régiment de Zouaves et sera décoré de la Médaille du Ouissam Alaouite en 1917. Il sera fait commandeur du Mérite Agricole en 1953 et décoré de la Légion d'Honneur en 1954. Durant son mandat de Maire, il ouvre des chemins, installe des trottoirs, goudronne des routes, fait faire l'adduction d'eau potable, crée 2 douars, la Caisse des Ecoles en 1948, le Foyer Rural pour les jeunes et installe une horloge publique. En 1955, était en cours de réalisation le Monument aux Morts et la réfection du réseau électrique. M. Albert Millier est né le 3 octobre 1917 à Les Trembles. Ses grands-parents, originaires de Saône-et-Loire sont parmi les pionniers en Afrique du Nord. ils s'installent à Chanzy. Son père, Jules Millier se fixe aux Trembles en 1897 à Mage dès 19 ans, il achète un lot de colonisation. Chevalier du Mérite Agricole en 1924, il agrandit son domaine et meurt en 1948. Dés 1945, ses enfants, Albert et Jules assument la gestion du patrimoine familial.
Albert Millier est mobilisé en 1938 au 9ème Cuirassier. il fait la campagne de Belgique en 1940, reçoit la Croix de Guerre au feu et deux citations. Redevenu civil. il est élu au Conseil municipal en 1953 suivant les traces de son père qui le fut pendant la presque totalité de son existence.
M. Héliodore Mirailles est né le 14 novembre 1902 à Les Trembles. Son grand-père, originaire de Monfort (Alicante) se fixe en AFN au début de la colonisation et s'installe à Oran. Son grand-père maternel ayant obtenu une concession aux Trembles. son père, Héliodore Mirailles l'exploite, puis fonde aux Trembles un commerce que ses descendants exploiteront et dés 1915, Héliodore fils en assume seul la gestion. La famille Mirailles est la plus ancienne du village. M. Mirailles a fait partie du Conseil Municipal de 1935 à 1942 sous la municipalité Halweck.
M.Emile Morin est né le 14 aout 1876 à Sidi-Bel-Abbés. Son père était originaire de Badonviller (Lorraine) il vient en AFN et se fixe à Sidi-Bel-Abbès vers 1870. Il y crée un commerce de boucherie puis étend son activité au domaine agricole, défrichant et mettant en valeur des terres incultes. A son décès, le 14 aout 1916. M. Emile Morin avec ses frères prend en main les domaines. Mobilisé pendant la guerre de 1914 dans les Zouaves il est ensuite affecté au service auto et fait toute la campagne de France. Il meurt le 18 aout 1947 à Sidi-Bel-Abbès et ses fils, René, Georges et Albert, établis à leur compte dés 1924 continueront l’œuvre entreprise. La place nous manque pour vous donner les souvenirs si pleins de vie de M. Lucien Marcel Caillat, ce sera pour une autre fois c'est promis. L'Echo de l'Oranie remercie M. Amédée Vincent qui l'a autorisé à reproduire des extraits de l'Echo des Trembles le bulletin des Tremblesiens, des Prudoniens et des Oued Imbertois ("Cabanac les Trembles" 31350 Escanecrabe) et l'historique de notre grand ami disparu, Robert Tinthoin qui y figurait, Nous remercions aussi la fille de Robert Tinthoin, Odile Pereira da Silva, notre dévouée secrétaire de ALYSGO l'amicale des anciennes du Lycée Stéphane Gsell qui m'a permis de reproduire pour notre Echo les écrits de son père ; et Jacques Gandini auteur du magnifique livre : "les églises d'Oranie "(11, grand'Rue 30420 Calvisson) ; Nous espérons que des anciens des trois villages voudront bien nous écrire leurs souvenirs et d'avance nous leur demandons de pardonner les erreurs ou omissions possibles, nos sources pouvant en comporter. Soyez gentils de nous les signaler courtoisement car notre travail de recherche n'est pas facile, nous serons heureux de publier toute remarque positive.
Geneviève de Ternant
|
|
L’ARTISANAT
ACEP-ENSEMBLE N°290
Maurice VILLARD
|
|
DANS LE DEPARTEMENT DE CONSTANTINE ET LES
TERRITOIRES DE TOUGGOURT ET DES OASIS
Depuis le début de ce siècle, de sérieux efforts ont, été engagés dans le Constantinois pour donner une vigueur nouvelle à la main-d'œuvre artisanale et remettre en honneur ses techniques et traditions.
La richesse des arts locaux, et en particulier celle des tissages à points noués, n'échappa pas à l’initiative privée ou gouvernementale. D'heureux résultats techniques et commerciaux couronnèrent les essais entrepris ; mais faute de temps et de moyens, un recensement systématique des ressources artisanales du pays faisait défaut. Cette tâche fut confiée, ces dernières années au Service de l'Artisanat.
Dans le Constantinois il convenait, en premier lieu, de dresser l’inventaire du tapis à points noués, richesse primordiale de l'activité artisanale. Ce travail permit d'établir trois zones géographique de tissage, zones riches aussi d'autres techniques qui, en grande partie, restent encore à étudier :
La zone Nord.
La zone des Hauts Plateaux
La zone des Territoires de Touggourt et des Oasis.
La zone nord. Elle comprend :
Philippeville, Constantine, Mila, Sétif, Bordj-Bou-Arréridj.
Tapis
Le tapis du Guergour, fabriqué autrefois dans la région de Sétif, a pratiquement disparu du marché depuis 1920 environ.
Sa zone d'expansion atteignait les marchés de Bougie, Constantine, Bordj-Bou-Arréridj et Khenchela. Seules quelques familles aisées possèdent encore avec fierté de beaux exemplaires de ce tissage polychrome d'inspiration turque. Son seul concurrent régional, le tapis des Maadid, au décor exclusivement géométrique a subsisté et se vend sur Ies marchés de Bordj-Bou-Arréridj et de Sétif. Il résulte d'un artisanat masculin, familial et rural. Ce tapis a perdu ses belles qualités d'autan. C'est un article pauvre, tant par sa technique que par son décor et ses colorants. Son retour vers les bonnes traditions doit être provoqué. Dans ce but, un Centre régional d'artisanat vient d'être ouvert à Bordj-Bou-Arreridj.
Quant au tapis du Guergour, oublié des autochtones, sa restauration est entreprise avec l'aide et le contrôle du Service de I'Artisanat des Centres Municipaux de Formation Artisanale de Philippeville et de Sétif, ainsi qu'à Mila. Les résultats obtenus sont encourageants. Les jeunes artisanes issues des Centres de Philippeville et de Sétif s'installeront à leur compte dans les mois à venir. A Mila, une quinzaine de métiers familiaux groupant trente femmes environ permettent d'offrir à la clientèle un tapis digne de ses origines.
Les Tissages
La zone Nord offre un choix varié de tissage aux types bien déterminés. Une prospection est en cours ; les résultats obtenus jusqu'ici permettent de discerner quatre catégories.
Les tissages de la vallée de la Soummam
( Bougie) ; ceux de Dra Larba semblent les plus caractéristiques. Ils sont tissés chez bon nombre de familles et vendus régulièrement sur les marché. Deux larges bandes, rouge garance, séparées par une bande centrale blanche plus étroite, sont divisées en compartiments garnis de décors géométriques. Quelques louches de jaune et de vert rompent la monotonie du ton. La gamme des couleurs est obtenue par teinture végétale.
Il suffit d'adopter les dimensions aux convenances européennes pour obtenir des tentures qui rencontrent le meilleur accueil de la clientèle.
Les tissages de la Petite Kabylie (région d'El-Milia, Boulafâ).
Les belles pièces d'autrefois ont totalement disparu de la région. Les tissages d'aujourd'hui bien abâtardis ne conservent dans leur décor que quelques motifs d'un goût discutable. L’école de fille de Djellaba a tenté, non sans succès, la rénovation de cette technique. Malheureusement depuis quelques années cette activité a été abandonnée.
Dès le mois d'octobre 1953 l'enseignement de ce tissage s'inscrira au programme du Centre MuniciPal de Formation Artisanale de Philippeville.
Il s'adapte bien au décor des appartements modernes. Un fond blanc, en forme de rectangle est encadré de rouge avec des motifs géométriques, parfois brodés ou ajourés
Les tissages des Maadid : région de Bordj-Bou-Arréridj et M'Sila.
Depuis une vingtaine d'années environ I'antique tradition de ces tissages de fond rouge, décorés de grands losanges, a cédé la place à des tissus à bandes multicolores sans caractère. Quelques-unes de ces pièces se vendent sur les marchés de Bord-Bou-Arréridj, Sétif, M'Sila. La restauration de ces tissages est envisagée à Sétif au Centre Municipal de Formation Artisanale.
Plusieurs Centres restent à prospecter.
Les régions de la Medjana, du Guergour et d'Ighil-Ali apporteront sans doute des éléments nouveaux dans les mois à venir.
La broderie.
Sur le littoral Constantinois, et particulièrement à Bône et Djidjelli s'exécute encore une broderie sur toile aux motifs très variés d'une polychromie puissante.
La mode occidentale aurait porté un coup fatal à cette industrie si quelques écoles de l'Académie, notamment de Bône et de Sétif, ne continuaient à enseigner cette technique. Les centres de formation Artisanale de Sétif et Philippeville forment de jeunes élèves brodeuses dont plusieurs sont maintenant installées à leur compte.
Une broderie de métal sur tulle, spécialité de Constantine, mérite une mention. Elle se porte encore en écharpe de tête, par des musulmanes. Jusqu'ici, une timide adaptation aux besoins européens a été tentée dans I'ornement de larges rideaux , d'abat-jour, d'écharpes.
La sparterie et la vannerie
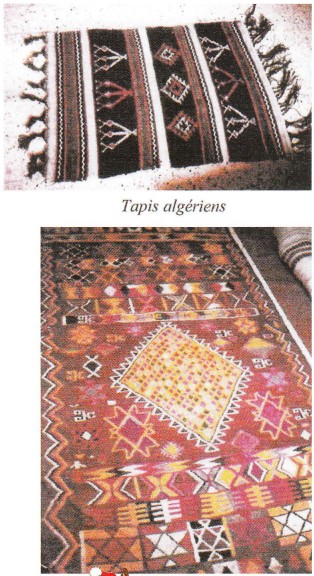 Les nattes d'alfa au décor géométrique simple, à base de losanges et de triangles, et à la gamme sobre : rouge, brun, noir, bistre, est une industrie féminine au Bou-Thaleb ( Ampère). Quatre mille nattes se vendent chaque année sur les marchés locaux. Leurs réputations justifiée permettent une exportation jusqu'aux territoires sahariens (Touggourt). Les nattes d'alfa au décor géométrique simple, à base de losanges et de triangles, et à la gamme sobre : rouge, brun, noir, bistre, est une industrie féminine au Bou-Thaleb ( Ampère). Quatre mille nattes se vendent chaque année sur les marchés locaux. Leurs réputations justifiée permettent une exportation jusqu'aux territoires sahariens (Touggourt).
Les douars Aïdoussa et Merouana ( commune mixte du Belezma) fabriquent des nattes plus grossières à simples bandes rouge. Elles trouvent acquéreur dans tout le Belezma et sur le versant Nord de I'Aurès.
A Ighil-Ali (commune mixte d'Akbou) les Sœurs Blanches ont crée un Centre important de fabrication d'articles de vannerie. Le support est en alfa et le revêtement en raphia. Le décor et la gamme des coloris sont tirés d'ornements traditionnels des tissages et poteries kabyles.
La poterie et la céramique
Une poterie utilitaire s'exécute dans les régions de Taher et d'El-Milia où cet art féminin est très vivant. Un engobe blanc couvre la surface et reçoit un décor géométrique brun-noir très discret. Parfois la base est vernie de rouge. Les quelques essais de commercialisation permettent d'envisager l'avenir de cette industrie avec un certain optimisme.
La poterie de Kherrata s'apparente à la précédente.
Plusieurs fractions de douars de la région de Bordj-Bou-Arréridj fabriquent une poterie au vernis résineux du type kabyle décorée de dessins géométriques brun - noir. La vente de ces produits ne dépasse guère le territoire de la fraction.
A Mila, un atelier de céramique produit des pièces de caractère moderne qui s'écoulent régulièrement sur le marché
Le travail du bois
Quelques ateliers de Constantine fabriquent encore, sur commande, des meubles de bois tourné et sculpté. Le fini du travail et la composition sont loin des belles traditions. Un effort de restauration est entrepris dans le but d'attirer à nouveau la clientèle vers des objets qui méritent d'être maintenus.
Le travail du cuir
La décadence des tanneries de Constantine s'accentue. Cinq ateliers, se maintiennent péniblement. Il semble difficile d'apporter un remède à la concurrence des cuirs européens qui, semble-t-il, ont définitivement conquis la faveur de l'usager.
Quelques babouchiers fabriquent encore des chaussures traditionnelles ; les autres sont transformés en revendeurs d'articles importés du Maroc. La confection des harnachements de cuir, ornés de fils d'or et d'argent, n'est plus le fait que d'un atelier.
Les bijoux
Chaque cité de la zone Nord compte quelques ateliers de bijouterie qui exécutent des pièces traditionnelles coulées ou filigranées. Le centre le plus important est Constantine, avec une centaine d'ateliers, dont trente cinq environ sont spécialisés dans le bijou coulé à l'usage des femmes des campagnes rurales et 65 environ, dans le bijou filigrané et or portés par les citadines. Le maintien et la commercialisation de cette branche ne provoque aucune inquiétude d'avenir.
Le travail du cuivre
A Constantine, environ 12 ateliers de chaudronnerie gardent leur importance. Cinq ateliers de dinanderie gravent et cisèlent le cuivre. Le marché européen est largement ouvert à cette production ; la demande dépasse souvent l'offre de beaucoup.
La zone des Hauts Plateaux
Une sérieuse prospection des Hauts Plateaux a été menée depuis 1947 pour inventorier les différents types de tapis. Une étude des tissages ras se poursuit.
L'activité commerciale de l'artisanat de ces régions repose sur le tapis. Les principaux marchés sont en pays Nemouchi et Harcati qu'il est permis de localiser entre Khenchela, Aïn-Béïda, la Meskiana et Tébessa.
Khenchela
Les tapis de Babar ont remporté les plus hautes distinctions aux derniers concours des meilleurs artisans algériens. C'est une industrie masculine de semi-nomades. L’élément géométrique et floral s'allie heureusement à une polychromie chatoyante pour les tapis de type « Zebia ». Plus sobre de couleur, puisant son décor exclusivement parmi des motifs géométriques, il faut noter également le tapis à boucle dit « Guetif »
Sous l'impulsion de la Commune Mixte de Khenchela I'industrie du tapis de la région est en pleine prospérité.
L'industrie familiale, reprenant ici les saines traditions permet de laver, filer et teindre les laines exclusivement aux produits végétaux du pays. Les artisans ne peuvent répondre aux nombreuses commandes. Plusieurs jeunes gens du pays s'inscrivent auprès des maîtres artisans en qualité d'apprentis. C'est un facteur certain de promesses d'avenir
Tébessa
Hormis quelques variantes, le tapis de Tébessa est semblable à celui de Khenchela.
Un centre de formation artisanale, géré par la Commune mixte, forme des apprentis et organise des stages de perfectionnement pour artisans. Cette méthode permet d'inculquer aux jeunes élèves et aux adultes les principes de base qui doivent leur permettre de puiser avec discernement dans la richesse du passé.
Cette formation entreprise depuis deux ans porte ses fruits. Le tapis de Tébessa s'améliore et regagne peu à peu la faveur du marché.
La Meskiana, Ain-Béïda
La Meskiana et Aïn-Béïda sont les Centres administratifs du pays Harcati.
Autrefois le tapis de cette région concurrençait dangereusement le tapis Nemouchi. Aujourd'hui, ne subsiste de son glorieux passé qu'un tapis abâtardi, confectionné par quelques tisseuses. Les marchés locaux sont approvisionnés par des pièces fabriquées le plus souvent à Chéria ( Commune mixte de Tébessa).
La Zone des Territoires
de Touggourt et des Oasis
Territoire de Touggourt Biskra
Cette ville possède un ouvroir dirigé par les Sœurs Blanches. Plusieurs artisanes sont installées à domicile et livrent leur production à cette œuvre. Le tapis fantaisie polychrome inspiré du Levant a retenu de nombreuses années l'activité de l'ouvroir. Depuis quatre ans un effort soutenu permet d'introduire à l'ouvroir et chez les artisans des modèles puisés dans la région. C'est ainsi que le tapis du Hodna, le tellis des Aurès, les teintures d'El-Kantara et de Tolga sont tissés par ce centre et progressivement s'imposent à la clientèle.
El Oued
La section artisanale de la Société Agricole de Prévoyance d'El-Oued favorise la commercialisation du tapis du Souf. Il se caractérise actuellement par une gamme de teintes neutres obtenues par mélange de laines, de poil de chameau et de poil de chèvre. C'est une industrie qui occupe une vingtaine de maîtres-artisans. Le tapis polychrome traditionnel réapparaîtra bientôt sur le marché. Cette restauration étendra les possibilités commerciales de ce tapis.
L'ouvroir des Sœurs Blanches s'est spécialisé dans la production de tentures de très bonne qualité en laine ou en poil de chameau au décor de fines bandes présentant divers motifs géométriques où domine le triangle. C'est une reproduction, pratiquement sans retouches, d'un vêtement féminin de la tribu locale des Troud.
Ouled-Djellal
Une importante production de tissage occupe deux cents femmes. Ces pièces sont apparentées aux tissages de Gafsa. Le marché européen leur est pratiquement fermé en raison du peu de solidité des teintures. Les remèdes envisagés seront appliqués dès que possible.
Ouargla
Un ouvroir important des sœurs Blanches se livre à la production de tapis dont le décor est inspiré de motifs berbères. Ils sont généralement à fond blanc et reçoivent un décor géométrique sur I'ensemble de leur surface.
Divers types de teintures, inspirées des mêmes sources et de l'art soudanais complètent cette production qui remporte le meilleur succès commercial.
L’Aurès
L'Aurès ne figure pas dans ce recensement. Ce massif, encore riche de traditions, sera étudié très prochainement
Conclusion
Ce rapide tableau des ressources artisanales du Constantinois permet d'affirmer que plusieurs industries traditionnelles tiennent encore une place honorable dans l'économie du pays.
En renouant avec le passé, l'artisanat s'oriente vers une résurrection des arts et des techniques.
Une exposition permanente s'ouvrira à Constantine dans quelques mois. Ce « catalogue » vivant permettra au public de juger qu'un article du pays peut participer activement à l'embellissement des intérieurs modernes.
Les recherches à venir et les nombreuses expérimentations pratiquées sur bien des points du territoire contribueront à recouvrer l'âme de cet art populaire et à maintenir l'artisan à son métier.
Riche - Inspecteur de I'Artisanat
|
|
|
LE MUTILE du N° 162 à 176
|
SOUVENIRS
DE MA CAPTIVITÉ EN ALLEMAGNE
(12 OCTOBRE 1914-17 JUIN 1917)
XI - 173
Il a fallu ces articles mensongers pour séduire un certain nombre de prisonniers partis comme volontaires en Turquie. Ceux-là n'étaient pas instruits, mais tous formulaient des vœux de fuir dans la suite, pour aller gagner le front russe ou anglais, combattant l'armée turque.
La solde de ces nouveaux soldats de l'année turque était de 2 F à 2 F 50 par mois. La première punition pour un soldat était la bastonnade (50 à 60 coups). Une partie d'entre eux fut envoyée dans la région du Caucase et d'autres en Métropolitaine après qu'on leur promit des régions où ils, pourraient s'acclimater. Trompés, ils décideront de déserter.
Une cinquantaine seulement réussirent à échapper à leurs chefs pour rejoindre soit l'armée russe, soit l'armée anglaise. Quant aux autres, ils furent enrôlés dans les rangs turcs et dirigés sur Constantinople. Les uns ont été fusillés par les Turcs, d'autres se sont suicidés, d'autres ont déserté dans des régions inconnues.
Une vingtaine de mille de prisonniers russes mahométans amenés dans le camp de Weihberg, à la place de prisonniers, français envoyés dans un autre camp, eurent aussi à subir l'influence des mêmes agents de propagande allemande, mais ces derniers ne réussirent à tromper que 3.000 d'entre eux qui furent dirigés sur la Turquie en trois convois pendant le mois de juillet 1916.
Les Allemands n'ont rien négligé pour nous amener, par toutes sortes de procédés à nous faire renoncer à notre serment de fidélité envers la France. Faut-il rappeler ce qui se passa au camp de Halbmondlager, le jour de la fête de l’Aïd-el-Kebir, en 1915 ? --. -, >..
Il fallait que cette fête fut comme foute autre fête musulmane célébrée avec certain éclat, mais l'Allemagne, voulut en profiter pour nous montrer que la France nous oubliait et voici comme elle agit. L'ambassadeur, Haki Pacha, donna une génisse, quelques moutons et vint nous rendre visite.
Le major Van Halden fit entrer au camp une fanfare qui joua plusieurs airs ; tous les Allemands s'habillèrent en feldgrau et prirent part à la fête.. La mosquée fut enguirlandée et illuminée la nuit par des milliers d'ampoules électriques. En vérité, il nous aurait fallu moins de manières et plus de viande et de pain. C'est alors, qu'arrivèrent au camp des caisses de provisions et de tabac de toutes sortes, que le 1er, régiment de tirailleurs avait envoyées pour les prisonniers du 1er tirailleurs algérien.
Les Allemands s'en étaient emparés à notre insu, en avaient gardés une bonne partie pour eux et nous distribuèrent le reste, mais en nous faisant hypocritement remarquer :
« La France oublie ses prisonniers musulmans, elle ne leur envoie pas de provisions comme aux autres Français, elle ne veut, pas accepter le rapatriement des amputés, ni les membres de la Croix Rouge. Mais nous ne voulons pas cependant oublier nos invités dans cette circonstance solennelle ? Vous avez là des produits de votre pays natal que sa Majesté le Sultan vous envoie, avec ses plus sympathiques et ses plus fraternels souhaits pour le triomphe de l'Islam. »
Au vol, les Allemands ajoutaient l'ignominieux mensonge. Mais il faut reconnaître qu'ils ne reculent devant aucune infamie.
Ils faisaient appel à nos sentiments religieux pour nous engager à faire parmi nos coreligionnaires de la propagande en faveur de la Turquie, à ce point que par exemple, le lieutenant Ben Chérif, pour se soustraire à leurs propos fut obligé de se déclarer libre penseur. Tous ses camarades officiers comme lui, furent l'objet de maintes sollicitations. On leur promettait les plus hauts grades dans l’armée turque. Mais tous ces officiers musulmans repoussèrent avec indignation toutes ces propositions, ils les refusèrent avec la plus grande fermeté, les lieutenants Safi Ahmed, Abdelaziz, Merseli Ben Gana et aussi Bouziane Ali qui pour avoir répondu avec vivacité vit, quoiqu'en suite bien malade, retarder son internement en Suisse...
XII - 174
Que de fois moi-même ai-je eu à repousser les promesses que nous faisait, le capitaine allemand Ghlisman, qu'accompagnait souvent, sans en avoir l'air, l'espion Mohamed ben Larbi. On s'efforçait de me faire espérer que j'aurais des galons dans l'armée ottomane. Mais officiers, et sous-officiers musulmans nous avions pour nous encourager dans notre patriotique, résistance, le réconfort de nos capitaines Raynaud et Garcin des spahis auxiliaires, prisonniers comme nous et qui s'ingéniaient à nous écrire secrètement à tous, même à leurs goumiers, pour nous inviter à résister avec la plus grande résignation aux pires souffrances.
Je passe maintenant en revue et très succinctement les atrocités sans pareilles que mes amis et moi nous avons eu à subir et dont nous souffrons aujourd'hui encore. Nous eûmes à les supporter, dans le camp de Halbmondlager et dans les différents camps de représailles de Silésie, en compagnie du camarade Bouzar, Benabid Ourabah, etc., qui vinrent rejoindre bientôt Abdelkader ben Aïssa et Bouchedja Belkacem.
J'étais employé au bureau arabe depuis février 1915 pour le service du camp : colis, mandats, etc.. La qualité de scribe qui était indispensable pour mes camarades, nous procurait certains avantages. C'est ainsi qu'en allant à la poste, nous pouvions prendre, nos colis et nos lettres déjà sérieusement, censurés, mais qui de ce fait, ne restaient pas en souffrance des dix el quinze jours comme ceux des autres prisonniers.
Enfin et c'était la question la plus intéressante, j'aidais parfois le censeur du camp à la lecture des lettres arabes et je réussissais très souvent à son insu à faire passer une ou plusieurs lettres plus ou moins compromettantes que j'avais préparées et signées moi-même à l'avance d'un signe conventionné et variable, sans éveiller l'attention de mon chef.
Mais en revanche notre emploi au bureau arabe nous occasionnait bien des désagréments. Nous étions, en effet étroitement surveillés par Mohamed ben Larbi qui nous espionnait et aussi par les employés allemands de ce même bureau. Malgré tout, cela ne nous, empêchait pas de nous voir et de parler en secret. C'est ainsi que notre ami Tarzoni, qui connaissait, l'allemand, et qui était à ce titre, interprète à l'infirmerie, venait, tous les soirs auprès de nous et nous mettait au courant des nouvelles parues dans les journaux allemands, ou bien nous traduisait un ordre, que nous avions momentanément soustrait à la kommandantur.
Nous nous confectionnâmes un carnet de poche contenant toutes les visites officielles et autres, tous les ordres du ministère 'allemand "de l'ambassade turque ; tout ce qui se passait journellement dans le camp et qui pouvait, nous intéresser. Cela dura jusqu'au mois de novembre 1915. Mais hélas, nous fûmes dénoncés par Mohamed ben Larbi.
Tarzoni eut d'abord 17 jours de compagnie de discipline, et on lui défendit de venir chez nous. Il dût aller 5 fois au tribunal de Berlin. Mais connaissant l'Allemand il se défendit énergiquement et réussi à se faire acquitter. Ce fût une vraie fêle pour nous qui avions craint de le voir passer au cachot tout le reste de sa captivité.
Le 24 janvier à 10 heures du soir, trois allemands vinrent à l'improviste dans notre bureau. Par ordre, du commandant, nous dirent-ils, vous allez mettre à notre disposition toutes vos affaires, papiers, linges, chaussures, voire même nos vivres. Nous fûmes fouillés de pied en cap puis mis tout nus et les doublures de nos habits et les semelles de nos souliers furent décousues et regardées avec soin.
Par bonheur nous avions jeté, au moment même nos carnets de notes au feu qui était encore allumé. Moi j'avais oublié une feuille où j'avais inscrit la veille les noms des quatre officiers désignés parmi les volontaires, par ordre ministériel pour diriger le 1er bataillon parlant à Constantinople. Celle feuille fut trouvée dans
Une de mes poches et présentée aussitôt au lieutenant Grobbal qui me menaça de me faire passer en conseil de guerre. Un stratagème, me sauva. Je fis croire que la note avait été perdue par un secrétaire et je l'avais simplement recopiée sans arrière-pensée.
Comme je manifestais mon étonnement de nous voir fouiller et de nous envoyer dans un camp de représailles, il nous fut répondu : «Vous avez rendu service, non seulement à vos camarades mais aussi à la France, c'est vous qui menez la campagne parmi vos coreligionnaires contre les engagements volontaires en faveur de l'armée turque, c'est la raison qui pousse l'autorité allemande à vous envoyer dans des camps de représailles. »
XIII - 175
Puis on nous conduisit comme des forçats à la salle de police où l'on nous confia à la garde de sentinelles armées. Tarzoni, il subit le même sort que nous, mais il passe seul la nuit dans une prison voisine.
Le lendemain 25 janvier, on nous réunit pour nous embarquer, à Sportau (Sibérie) où 80.000 russes avaient déjà souffert.
Il y avait, d'ans ce camp, environ 150 à 300 français avec lesquels les Allemands ne voulurent pas nous laisser communiquer sous prétexte que nous n'étions pas Français. Nous logeâmes avec les russes dans des baraques malpropres, humides, sans l'eau la plupart du temps et sans la lumière. Il neigeait, le froid était très vif et nous n'avions qu'une couverture déchirée et puante. Les paillasses contenaient de la paille vieille datant de 1914, et réduite en poussière infecte. La nourriture était excessivement mauvaise.
Les colis qui nous étaient envoyés par nos parents ou nos amis ne nous parvenaient pas. C'était la Kommandatur de Halbmondlager qui, pour se venger de nous, les détenait ainsi que nos mandats, même ceux que nous avions laissés au camp, en même temps qu'elle détenait encore toutes nos affaires : vêtements, correspondance, photographies, batterie de cuisine, etc.. Lorsque après plusieurs réclamations, les colis furent envoyés à Sportau, le contenu était avarié et inutilisable. De toutes nos affaires laissées à Halbmondlager, c'est à peine si la moitié nous fut adressée. Presque tout nous fut saisi.
Mais toutes les misères et toutes les privations, ainsi que tous les mauvais traitements dont nous étions victimes eurent pour moi de dures conséquences, je tombai gravement malade. Mais, comme dit le proverbe à quelque chose malheur, est bon. Le 18 mars 1916 je fus, en effet, désigné par la commission médicale pour l'internement en Suisse. Seulement les docteurs allemands tout d'abord s'y opposèrent, ce jeune homme est algérien et, s'il a une bronchite, c'est à cause du froid. Dans quelques jours le beau temps reviendra et il sera guéri.
Mais le temps avait beau s'écouler et nous rapprocher des jours meilleurs d'avril ou de mai ; qu'il était loin notre soleil d'Algérie et qu'il était pénible notre exil au camp de Sportau, je ne parvenais pas à me rétablir. Or, une commission de docteurs suisses, préposés à la visite des camps de prisonniers, étant venue nous visiter, demanda mon transfert en Suisse, malgré la continuelle opposition des docteurs allemands.
Le 13 mars 1916, avec quatre de mes compagnons d'infortune, je pris le train pour Constance où, à l'issue, d'une deuxième visite médicale je fus définitivement admis à faire, partie d'un convoi de grands blessés à destination définitive de la Suisse. Nous étions 500 bien déprimés physiquement, mais au fond très heureux d'échapper enfin aux horreurs de la barbarie allemande. Je pouvais espérer revoir un jour mon Sahara brûlant, ainsi que tous les êtres qui me sont chers.
Le 17 mai au soir le train quitta Constance. A peine s'ébranlait-il que des voix d'amis, de l'autre côté de la frontière s'élevaient pour nous réconforter de leur chaude sympathie.
Elles criaient «Vive la France ! » et entonnaient la « Marseillaise», des enfants promenaient des torches, dont la flamme rougeâtre et fumeuse dansait dans la nuit constellée d'étoiles.
Des fleurs nous étaient lancées en plein visage et l'on nous engageait à puiser à pleines mains dans les corbeilles de fruits gracieusement, tendues vers nous. De grosses larmes que nous ne songions même pas à essuyer coulaient sur nos joues amaigries. El ce fut ainsi partout où nous nous arrêtions, à quelque heure que ce fut. Je me rappelle, en particulier, un repas qui nous fut offert à Berne vers 1 heure du matin, au cours duquel on prit les adresses de nos familles pour les prévenir de notre délivrance.
Nous étions groupés selon la nature de notre maladie et chaque groupe avait sa destination particulière. Notre convoi s'égrenait ainsi au cours du voyage. Le 18 mai 1916, je suis arrivé à Leysin. J'ai été soigné consciencieusement par les docteurs et choyé par la population. Après 7 mois de séjour, comme je supportais mal le grand froid de la montagne, j'ai été transféré à Sierre, où j'ai trouvé une petite colonie d'Algériens. Le climat, délicieux nous rappelait notre ciel d'Afrique ; la délicatesse de nos protecteurs avait valu pour les Algériens une vie à part ; nous avions ainsi toute liberté d'action pour pratiquer rigoureusement notre religion et nous avions notre, cuisine au beurre.
M. le Gouverneur général, par deux fois nous fit l'honneur de nous envoyer du couscous que Mme Hoerni, une charmante femme suisse ayant vécu longtemps eu Algérie voulu bien nous préparer.
XIV - 176
Cette femme de cœur s'occupa de nos intérêts en Suisse avec une inlassable sollicitude. A ces repas qui étaient, pour nous de petites fêtes, assistaient des officiers suisses qui nous commandaient.
Notre chef de détachement, le capitaine Fuchs a toujours montré à notre égard le plus grand dévoilement. Il a été, en effet, le véritable organisateur de notre bien-être en Suisse. N'est-ce pas lui qui a créé à notre usage, un atelier d'arts et métiers où l'on fait de la menuiserie, des objets en raphia, des colliers de perles, etc... cela dans le but de permettre aux internés musulmans, à leur sortie du territoire suisse, de devenir de bons artisans et, aussi dans le but d'augmenter momentanément leurs revenus. Grâce à cet atelier, nous parvenions à gagner six francs par jour. J'y étais employé, en qualité, de dessinateur.
Combien aussi M. Monter, professeur à l'Université de Genève et, arabisant distingué, a été notre bienfaiteur. Il était chargé par le gouvernement, français de la surveillance, de l'entretien et du bien-être de tous les prisonniers musulmans internés en Suisse. Il venait nous visiter chaque mois ; nous avons par ses soins, obtenu bien des améliorations. Il a été pour nous un sincère et, grand ami.
N'est-ce pas lui qui nous a défendu contre les mensonges allégués par Boukabouya dans «l'Islam dans l'Armée française » et à cette brochure ainsi que je l'ai déjà dit, n'a-t-il pas opposé une autre brochure «l'Islam et la France».
Je ne saurais, ici, passer sous silence le dévouement de Mme Bey, infirmières bénévoles qui bravent les maladies contagieuses au milieu desquelles elles vivent pour apporter à mes coreligionnaires exilés le réconfort de leurs soins et de leur sollicitude, ainsi que celui de la famille Mouton qui facilite aux internés le voyage à la frontière afin de pouvoir revoir leurs parents, celui aussi des dames de Sierre secondées par des religieuses françaises et qui, après avoir raccommodé tout notre linge, s'ingéniaient à donner des fêtes à notre intention. Je suis resté à Sierre 4 mois.
Dois-je avouer que j'y serais demeuré plus longtemps avec plaisir, grâce à l'affection qui y règne, mais je voulais parfaire mon instruction. Aussi demandai-je à aller suivre des cours à Genève, ce me fut accordé. Après trois mois de séjour dans cette ville, l'offre vint de me rapatrier.
Je quittai donc Genève, le 15 juin 1917, à 1 heure du matin avec 500 camarades. Iles officiers français et suisses nous avaient, adressé d'émouvants adieux et les dames de la Croix Rouge avaient tenu à ce que chacun de nous emportât un bouquet, de fleurs et un petit, cadeau comme souvenir.
« Elles regrettaient, tant, nous disaient-elles le départ de leurs grands enfants »
La Marseillaise et les marches militaires saluèrent le départ du train. Arrivés à Pontarlier, nous passâmes devant des soldats rangés en haie et qui nous présentèrent les armes. On nous offrit un goûter, du Champagne et de nouveaux souvenirs. On nous accompagna ensuite à une station d'aviation, où les officiers avaient organisé à notre intention, une réception avec Champagne. Pendant plusieurs kilomètres, une quinzaine d'avions, en notre, honneur survolèrent notre train.
A Lyon, en présence du Gouverneur militaire de, la Place, des généraux belges et, anglais, eut, lieu une prise d'armes, des régiments d'infanterie et de, cavalerie défilèrent devant nous. Dans une salle de réception plusieurs discours furent prononcés, on nous offrit, du Champagne et un dîner à l'issue duquel on donna plusieurs distractions. Le lendemain à 3 heures, je quittai Lyon et vers deux heures du matin j'arrivai à Marseille où des autos nous attendaient, quelques-uns de mes camarades et moi, pour nous amener à l'hôpital 201, installé au Grand Lycée où j'ai passé 8 jours. Une permission de 21 jours me fut accordée, j'en profilai pour m'embarquer el aller revoir ma famille à Laghouat et, à Tadjemout.
Après une longue absence, je me retrouvais donc en mon pays natal, j'avais vécu les plus formidables événement qu'un être puisse concevoir. Mais, tel j'étais parti, tel je revenais, c'est-à-dire avec les mêmes sentiments d'amour pour l'Algérie et pour la France. Seulement ces sentiments avaient été mis à l'épreuve. L'adversité les avaient trempés d'une nouvelle force.
J'étais heureux d'avoir donné à ma patrie adoptive le meilleur de ma pensée, de ma jeunesse et de ma force».
Je ne connaissais pas auparavant la terre de France ; je l'ai vu au plus vif du danger, dans toute son énergie, dans toute son indomptable vaillance. Un pays qui montre, une telle endurance ne peut pas disparaître. C'est donc, dire la foi profonde, que j'avais en sa victoire.
Je ne rapporte en mon cœur que la satisfaction du devoir accompli et le souvenir de ce devoir m'attache, davantage à la France. Aux jours les plus pénibles de ma captivité en Allemagne, mes coreligionnaires et moi nous mettions toute notre espérance, en Elle.
Réformé N°1 par le Conseil spécial de réforme d'Alger, le 10 août 1917, et désormais rendu à la vie civile, mes devoirs envers la France ne font que prendre une autre forme. Je les accomplirai, donc d'une nouvelle manière.
Aimer s'est servir, et nous tous aimons la France, pays du droit, de la justice et de la fraternité.
TOUATI BEN YAHIA.
Ex-Maréchal des Logis
aux Spahis auxiliaires algériens.
FIN.
|
|
Algérie catholique N° 4 de Août 1936
Bibliothéque Gallica
|
Le Cardinal Lavigerie
Archevêque de Carthage
Et d’Alger Primat d’Afrique
Par S. E. Monseigneur LEYNAUD, Archevêque d Alger
De la naissance à l'épiscopat
 Né à Huires, dans le quartier Saint-Esprit, qui fait aujourd'hui partie de Bayonne, le 31 octobre 1825, de Léon-Philippe Allemand-Lavigerie, jeune contrôleur des douanes, et de Laure-Louise Latrilhe, Charles Martial fut baptisé dans l'Eglise de Saint-Esprit ; nous avons vu, non sans une vive émotion, le baptistère où il devint enfant de Dieu. Vers l'âge de dix ans, il fut envoyé au Petit Séminaire de Larressore. A Mgr Lacroix, l'évêque du diocèse, qui l'interrogeait : « Vous avez donc la vocation d'être prêtre ? » Né à Huires, dans le quartier Saint-Esprit, qui fait aujourd'hui partie de Bayonne, le 31 octobre 1825, de Léon-Philippe Allemand-Lavigerie, jeune contrôleur des douanes, et de Laure-Louise Latrilhe, Charles Martial fut baptisé dans l'Eglise de Saint-Esprit ; nous avons vu, non sans une vive émotion, le baptistère où il devint enfant de Dieu. Vers l'âge de dix ans, il fut envoyé au Petit Séminaire de Larressore. A Mgr Lacroix, l'évêque du diocèse, qui l'interrogeait : « Vous avez donc la vocation d'être prêtre ? »
— Oui, Monseigneur, répondit-il hardiment.
— Et pourquoi voulez-vous être prêtre, mon enfant ?
— Pour être curé de campagne. »
Beau rêve d'enfant !
Quelque temps après, l'abbé Dupanloup, déjà célèbre, lui procura une bourse au Séminaire Saint-Nicolas, à Paris.
Charles, doué d'une intelligence hors ligne et le plus brillant de tous, subit, comme ses camarades, l'influence considérable de ce grand éducateur : « Il s'en servait, écrira-t-il plus tard, pour nous entraîner, à la manière d'un ouragan de lumière et de feu, courbant et absorbant tout, comme c'est la loi des personnalités puissantes, égoïstes en apparence pour ceux qui ne voient que le dehors, mais en réalité chez lui tout le contraire. Car, s'il voulait tout prendre, c'était pour tout donner à Jésus-Christ, selon le plan divin tracé par Saint Paul : Omnia vestra sunt, vos autem Christi.»
Mgr Lavigerie ne traçait-il pas ainsi son propre portrait ?
En octobre 1843, nous le trouvons à Issy, au Séminaire de Philosophie, où il passe deux ans ; puis, en 1845, au Grand Séminaire de Saint-Sulpice. Plus tard, Mgr Affre l'envoie à l'école des Carmes, qu'il vient de fonder, et là, en dix mois, le jeune Lavigerie devient bachelier et licencié ès-lettres. Sous-diacre, à la Noël de 1847, diacre l'année suivante, il est ordonné prêtre, le 2 juin 1849. Mgr Sibour fait revenir alors le nouveau prêtre à l'Ecole des Carmes, pour y préparer ses thèses de Doctorat, qu'il soutient victorieusement. C'était le premier Docteur sorti de cette école. Le voilà capable maintenant de fournir une brillante carrière comme professeur : en effet, après avoir été, quelque temps, au Séminaire de N.-D. des Champs, il est nommé, dans les premiers mois de l'année 1854, à la chaire d'Histoire ecclésiastique de la Sorbonne.
Mais il étouffait dans cette chaire. Aussi, lorsque le Père de Ravignan, vers la fin de 1856, lui conseilla d'accepter la Direction de l'Œuvre nouvelle des Ecoles d'Orient, il répondit : « Si vous croyez, mon Père, que ce soit la volonté de Dieu, je suis prêt.»
Aussitôt, il entre en campagne, prêchant pendant trois ans, dans les plus grandes villes de France, pour trouver les ressources nécessaires au soulagement des malheureux chrétiens d'Orient.
L'occasion allait se présenter : à la fin mai 1860, les Druses musulmans venaient de massacrer 18.000 chrétiens du Liban et d'en chasser 75.000 de leurs villages. La France, justement émue, ayant organisé une expédition militaire, l'abbé Lavigerie ne tarda pas à la suivre, et, le 13 octobre, il était à Beyrouth.
Voyez-le, distribuant, dans tous les villages éprouvés par la persécution, des secours qui dépassèrent un million. Rien n'arrête sa charité ; aucun danger ne l'effraye, pas même l'horrible spectacle qu'il a sous les yeux, à Dehir-el-Kamar, où « tout porte l'empreinte du désespoir et de la mort » ; aucun accident ne le décourage.
Revenant ensuite par Jérusalem et Damas, il voulut voir, dans cette dernière ville, Abd-el-Kader, qui avait eu la générosité d'abriter dans son palais et de sauver un millier de chrétiens, déclarant qu'on le tuerait plutôt que de le forcer à livrer un de ses protégés. Son entrevue avec l'Emir fut émouvante : « Je l'écoutais, dit-il, avec admiration et bonheur, lui, Musulman sincère, parler un langage que le Christianisme n'eût pas désavoué. Lorsque je me levai pour sortir, il s'avança vers moi et me tendit la main. Je me souvins que c'était la main qui avait protégé contre la mort nos frères malheureux et je voulus la porter à mes lèvres, en signe de reconnaissance.
Mais cet hommage, qu'il acceptait de tous les autres, il ne voulut pas le recevoir de moi, parce qu'il voyait en moi un ministre de Dieu. Je compris sa pensée et je lui dis : « Emir, le Dieu que je sers peut être aussi le vôtre : tous les hommes justes doivent être ses enfants. » J'exprimais une espérance. Il me regarda fixement, et je le quittai plus ému que je ne saurai dire. »
L'abbé Lavigerie se rembarqua, le 21 décembre, heureux d'avoir consolé tant de misères et de douleurs, au nom de la France et de l'Eglise, heureux surtout d'avoir fait la connaissance du monde musulman et d'avoir trouvé, comme il disait, son chemin de Damas, sa vocation véritable.
Aussi bien, revenu à Paris et nommé, quelques mois après, 25 août 1861, auditeur de Rote à Rome, ne séjourna-t-il que seize mois dans la Ville Eternelle.
Pie IX, appréciant bientôt ses hautes qualités intellectuelles et son zèle ardent, le nomma, de concert avec l'Empereur Napoléon III, le 5 mars 1863, à l'évêché de Nancy, et le fit sacrer, à Rome même, par le Cardinal Villecourt, le 22 mars suivant : « Je suis sacré depuis hier, écrivait-il à son ami, l'abbé Bourret. Quel moment ! Je n'aurais jamais cru pouvoir être bouleversé et écrasé comme je l'ai été. Priez Dieu qu'il fasse de moi un bon évêque, ne forte cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar.»
A peine installé dans la capitale lorraine, Mgr Lavigerie donne un très énergique et nouvel élan aux études universitaires et théologiques, aux examens des religieuses enseignantes, au développement des Séminaires et des Collèges, et un grand éclat aux cérémonies du culte.
Son court passage à Nancy fut marqué par des institutions qui durent encore et qui perpétuent son souvenir, resté très vivant d'ailleurs au cœur du clergé lorrain. Nous en avons un témoignage dans une lettre que les premiers prêtres qu'il avait ordonnés lui adressèrent, le 3 octobre 1888, à l'occasion de ses noces d'argent épiscopales, « pour lui offrir l'hommage de leur profonde reconnaissance et de leur respectueux attachement. »
L'Archevêque d'Alger
Nommé archevêque d'Alger, le 12 janvier 1867, ce n'est pas sans un brisement de cœur qu'il s'éloigna de Nancy, le 8 avril, après avoir fait à son clergé les plus tendres adieux :
« Je ne vous aurais jamais quittés pour un évêché ordinaire, leur disait-il ; mais il s'agit d'aller évangéliser un peuple encore presque entièrement païen, et l'habituer, par la religion et la charité, au travail, à la paix, à l'amour des hommes et de la France. Ce n'a pas été la voix de la nature qui m'a appelé à ce poste. J'ai reconnu la voix de Dieu, et j'ai consenti pour l'amour de Lui. »
Et il part pour l'Afrique, bien décidé à réaliser cet apostolique programme.
Nous avons vu que, par une bulle du Souverain Pontife Pie IX, l'évêché d'Alger avait été érigé en archevêché, le 25 juillet 1866.
Le 27 mars 1867, Mgr Forcade, évêque de Nevers, était arrivé à Alger, délégué par Mgr le Nonce apostolique, pour la publication, en Algérie, des bulles d'érection de l'archevêché et des évêchés de Constantine et d'Oran. M. Comte-Calix, Vicaire capitulaire, en avait été averti et avait reçu l'ordre du jour suivant du Maréchal de Mac-Mahon :
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
Armée d'Algérie
Etat-Major Général
ORDRE
Monseigneur l'Evêque de Nevers, délégué par le Saint-Siège pour l'exécution des bulles qui érigent l'évêché d'Alger en Métropole et créent les évêchés d'Oran et de Constantine, doit arriver à Alger vers la fin de ce mois, sur un bateau spécial mis à sa disposition.
Les honneurs dus au représentant du Saint Père seront rendus à Mgr Forcade. Une salve de cinq coups de canon sera tirée par le stationnaire, au moment où le bâtiment qui porte Sa Grandeur franchira la passe. Cette salve sera répétée par la batterie de l'îlot, lorsque Monseigneur l'Evêque débarquera.
Toutes les troupes de la garnison prendront les armes et seront en grande tenue sous le commandement de M. le Général commandant la subdivision.
Sa Grandeur se rendra directement à l'archevêché où elle recevra immédiatement la visite des autorités civiles et militaires, désignées, au décret du 24 messidor an XII, comme prenant rang après les archevêques.
Au signal donné par la première salve, les détachements de la milice et des troupes prendront les places qui leur seront assignées.
Le Gouverneur Général de l'Algérie,
Signé : Maréchal de Mac-Mahon.
C'est aussi par de grands honneurs que Mgr Lavigerie fut reçu, à son tour, quand il débarqua à Alger, le 15 mai 1867, au bruit des canons, des navires et des forts.
Bientôt fut donnée, dans toutes les chapelles et églises du Diocèse, lecture de son mandement de prise de possession, dans lequel, après avoir rappelé l'histoire de l'ancienne Eglise africaine, il s'écriait :
« 0 chère et illustre Eglise Africaine, puissé-je contribuer à consoler tes douleurs et à te rendre une partie de ta gloire perdue... Puissé-je mêler mes sueurs, mes larmes, mon sang, s'il le faut, aux douleurs de ton long martyre ! »
Puis, s'adressant aux indigènes musulmans : « Je réclame le privilège de vous aimer comme mes fils, alors même que vous ne me reconnaîtriez pas pour père. En attendant, il y a deux choses que nous ne cesserons de faire : la première, c'est de vous aimer et de vous le prouver, si nous le pouvons, en vous faisant du bien ; la seconde, c'est de prier pour vous le Dieu maître et père de toutes les créatures, afin qu'il vous accorde la lumière, la miséricorde et la paix. »
Nous verrons plus tard la magnifique réalisation de ces vœux admirables.
A peine assis sur le siège d'Alger, le nouvel archevêque, à l'exemple de ses prédécesseurs, part pour Rome le 11 juin 1867 où il expose à Pie IX ses projets de conquêtes spirituelles et reçoit ses conseils et ses bénédictions ; puis, sans perdre de temps, il va voir l'Empereur, à Paris, et se rembarque, le 22 septembre, à Marseille. Tempête effroyable pendant six jours et six nuits : l'Hermus est secoué par des vagues furieuses qui menacent, à chaque instant, de l'engloutir ; son gouvernail est brisé, le navire est en perdition, et les passagers, nombreux, croient entendre leur dernière heure.
Alors, l'archevêque et le Père Abbé de la Trappe de Staouéli font, au nom de tous, le vœu de monter à Notre-Dame d'Afrique, si la Vierge Marie les sauve, et bientôt la mer s'apaise.
C'est en souvenir de cette périlleuse traversée que Mgr Lavigerie, établit, le mois suivant, dans la Basilique, une Association de prières pour les morts en mer.
Depuis ce temps, chaque dimanche, après le salut du Très Saint Sacrement, le clergé et les fidèles se réunissent sur l'Esplanade, en face des flots bleus, devant le petit mausolée élevé en souvenir des naufragés, pour assister à une absoute solennelle et toujours émouvante.
Vers la fin de l'année, nous trouvons l'Archevêque à Maison-Carrée, où il vient bénir les premières charrues à vapeur. A cette occasion, il prononce un discours qui eut un retentissement énorme : il y déclare d'abord que « rien de ce qui intéresse l'Algérie l'adoucissement de ses épreuves actuelles, la préparation de sa fortune à venir, ne saurait lui être indifférent » ; puis il exprime courageusement, en faveur des colons, trois vœux qui n'ont rien perdu de leur opportunité :
« A la France, dit-il, je demande pour l'Algérie des libertés plus larges, je veux dire des libertés civiles, religieuses, agricoles, commerciales, qui nous manquent encore. Je les attends de la raison et de la justice de la Mère-Patrie.
« A vous, je vous demande de ne pas vous désintéresser de vos destinées, de sortir de cette routine qui attend tout de l'Etat et lui demande tout, de vous montrer ainsi dignes de la liberté que vous réclamez. Je vous demande l'esprit d'initiative, de libre association pour toutes les branches ouvertes à votre activité, pour tout ce qui est utile, fécond, chrétien.
A Dieu, je demande chaque jour, et je demande surtout en ce moment, de vous bénir, en proportion de vos efforts et de votre courage, et de vous préparer, parmi les nations, une place d'autant plus glorieuse que vous aurez vous-mêmes mieux répondu aux bénédictions d'En haut. »
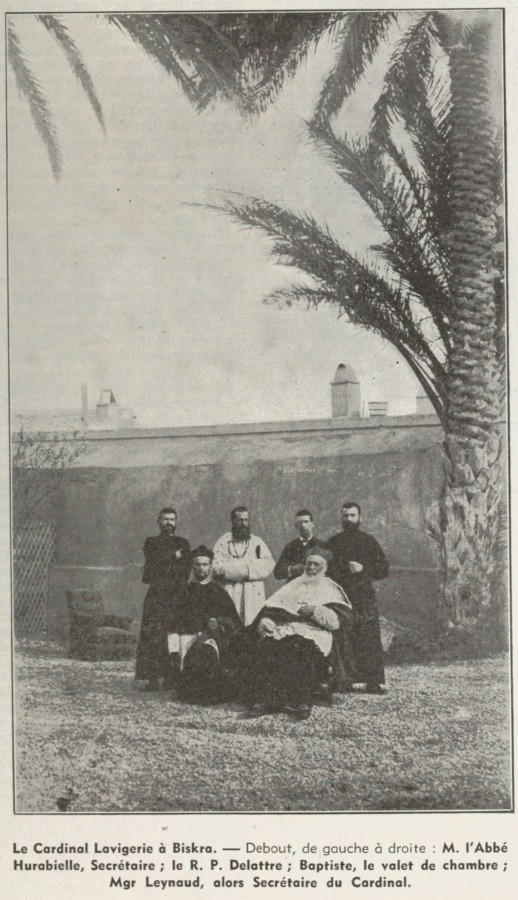 Une telle initiative n'était certes point faite pour lui gagner la sympathie du Gouvernement d'alors ; mais il ne s'en inquiète pas et, pour encourager encore les colons dans leur tâche difficile et les fixer au sol, il voulut leur donner les moyens possibles de pratiquer notre sainte religion, en poursuivant très activement la construction de nouvelles églises. Une telle initiative n'était certes point faite pour lui gagner la sympathie du Gouvernement d'alors ; mais il ne s'en inquiète pas et, pour encourager encore les colons dans leur tâche difficile et les fixer au sol, il voulut leur donner les moyens possibles de pratiquer notre sainte religion, en poursuivant très activement la construction de nouvelles églises.
Les paroisses étaient, en effet, à cet égard, dans le plus pitoyable état : sur quatre-vingt-trois, vingt-cinq d'entre elles seulement avaient des églises ; dans les autres, on célébrait le Saint Sacrifice et on réunissait les fidèles dans les granges, dans les baraques en planches, dans des maisons de colons. En 1878, il en avait construit quarante-neuf ; dix ans plus tard, soixante-huit. Il fonde aussi une trentaine de nouvelles paroisses, parmi lesquelles celles de Camp-du-Maréchal et d'Haussonvillers, pour les chers Alsaciens-Lorrains, désireux, après nos désastres, de vivre encore en terre française.
Mais les besoins spirituels de ses diocésains le préoccupaient bien plus encore : pour en juger, Nous citerons seulement ses principales œuvres : l'organisation de la maîtrise de la Cathédrale, la fondation d'une revue religieuse sous le titre d'«Echo de Notre-Dame d'Afrique », l'œuvre de Saint-Augustin pour la résurrection de la foi en Afrique, l'établissement d'un asile de vieillards à la Bouzaréa, qu'il confie aux si admirables Petites Sœurs des Pauvres, les Institutions d'enseignement secondaire, Saint-Louis, à Alger, et Saint-Charles, à Blida ; l'Association de prières pour les Musulmans, l'établissement d'un service religieux pour les Espagnols, l'Œuvre diocésaine des écoles catholiques, l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement dans toutes les églises, l'Œuvre de Sainte Monique pour les Mères chrétiennes, la fondation du Carmel, l'institution des vicaires-forains, la réouverture du Petit Séminaire de Saint-Eugène, la création d'une commission d'archéologie, la réunion de deux synodes, etc..., etc.
Le 2 juillet 1872, c'est la consécration solennelle de la Basilique de Notre-Dame d'Afrique : à cette occasion, il a la joie de déposer aux pieds de la statue les deux épées de combat du maréchal Pélissier et du général Yusuf.
Le premier dimanche du mois de Marie, 4 mai 1873, eut lieu l'ouverture du premier Concile provincial de la nouvelle église d'Afrique ; il dura jusqu'au 8 juin.
Le jour de la clôture de ces assises solennelles, le grand archevêque trouva dans son cœur les vœux les plus émouvants. Ecoutons-le :
« Et maintenant, c'est fait ! Puissent nos efforts ressusciter plus pleinement chaque jour, la vie chrétienne sur ces ruines sacrées ! Puissent le sang des martyrs, les vertus de tant de saints féconder encore une fois ce sol qu'ils ont illustré ! Puisse s'accomplir sous nos yeux, pour la moisson des âmes, le spectacle que nous donne, pour celle du laboureur, cette terre à laquelle le repos et les débris amoncelés des siècles semblent avoir assuré une fécondité sans fin ! »
Tandis qu'il s'occupait ainsi activement des intérêts supérieurs de l'Algérie et, par conséquent, de la France, il eut, à plusieurs reprises, la douleur de se voir refuser, par le Gouvernement, les subsides nécessaires à toutes ses œuvres religieuses et patriotiques. L'archevêque faillit en être découragé ; il songea même, une fois, à abandonner son siège archiépiscopal pour se consacrer uniquement aux Missions ; mais le Cardinal Préfet de la Propagande lui fit savoir que « le Saint Père, considérant le grand bien qu'il avait fait dans son archidiocèse, le priait de bien vouloir renoncer à la résolution qu'il avait prise, lui donnant l'assurance qu'en agissant ainsi il ferait une chose agréable à Dieu. »
Pour lui, nous le verrons encore plus loin, la volonté du Pape était toujours la volonté de Dieu.
D'ailleurs, tant de travaux lui avaient attiré la vénération et l'admiration du peuple algérien, si spontanément affectueux ; il put s'en rendre compte plus d'une fois, mais tout particulièrement, le 25 janvier 1885, à l'occasion de la remise solennelle du pallium de Carthage : sur la place qui porte aujourd'hui son nom, dans les rues avoisinantes, sur tous les balcons, à toutes les fenêtres, la foule se pressait, comme dans la Cathédrale : « Le voilà ! » s'écria-t-on de toutes parts, quand il parut, dans toute la majesté de la pourpre romaine. Et on se le montrait avec une sorte de fierté familiale.
Après l'Evangile, il prit la parole. Nous entendons encore sa voix grave, si prenante : « Je fonde sur vous de grandes espérances, dit-il aux Algériens, parce que je sais que vos cœurs sont généreux. »
Et il ne se trompait pas. Puis, parlant de la Tunisie : « Les armes de la France l'ont ouverte à tous les peuples. »
La sortie de la Cathédrale fut, nous nous en souvenons, un vrai triomphe et aussi une fatigue pour celui qui, à 60 ans, paraissait être déjà un grand vieillard. De fait, sa santé, fortement ébranlée de bonne heure, réclamait nécessairement des aides. Après avoir eu comme auxiliaire, pendant six ans, Mgr Soubiranne, plus tard évêque de Belley, il voulut se choisir un coadjuteur, plus habitué aux choses algériennes. Une Lettre pastorale du 1er mars 1880 annonça aux fidèles qu'il avait fixé son choix sur Mgr Dusserre, son ancien vicaire général, depuis deux ans, à peine, évêque de Constantine et d'Hippone : « Seigneur, y disait-il, vous me l'aviez donné pour fils ; mes mains ont fait descendre sur sa tête la consécration des pontifes.
Vous me le rendez aujourd'hui. C'est à vous que je demande de veiller sur lui avec la tendresse d'un père ! »
Pour comprendre toute l'affection que l'archevêque manifesta alors à son nouveau coadjuteur, il faudrait publier ce qu'il écrivit, de sa large écriture, en trente pages, que nous avons sous les yeux, sous ce titre Quelques notes pour mon vénérable Coadjuteur et qu'il terminait par ces mots : « Telles sont les observations de détail que j'ai cru devoir consigner ici. Il ne me reste qu'à formuler un vœu : c'est que Dieu bénisse le ministère épiscopal de mon vénéré et bien-aimé coadjuteur, que nous ne fassions vraiment, durant la vie, qu'un cœur et qu'une âme et qu'il soit longtemps heureux, après ma mort, sur le siège d'Alger. »
Le Grand Missionnaire Africain
Débarrassé des détails de l'Administration diocésaine et plein de confiance dans la sagesse de son cher coadjuteur, Mgr Lavigerie va pouvoir se consacrer tout entier à sa mission particulière. Cette mission, il l'avait clairement entrevue, au lendemain de sa nomination à Alger, quand il écrivait, dans son premier mandement « Faire de la terre algérienne le berceau d'une nation grande, généreuse, chrétienne, d'une autre France, en un mot ; répandre autour de nous les vraies lumières d'une civilisation dont l'Evangile est la source et la loi ; les porter au-delà du désert, jusqu'au centre de ces immenses continents encore plongés dans la barbarie, relier enfin l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale à la vie des peuples chrétiens, telle est, dans les desseins de Dieu, notre destinée providentielle. »
Quelle destinée merveilleuse, quelle sublime mission Le nouvel archevêque veut gagner à Jésus-Christ toutes les âmes, non seulement les âmes des chrétiens de son diocèse, mais encore celles de l'Afrique tout entière, plongées dans les ténèbres de l'erreur : pour leur conversion, il s'empressa d'abord de rétablir l'Association de prières fondée par Mgr Pavy, et il la fit approuver canoniquement par Pie IX, sous le vocable de Saint-Augustin.
Mais de tristes événements vinrent bientôt faire éclater aux yeux de la France et du monde entier le dévouement vraiment paternel de Mgr Lavigerie pour les chers indigènes.
Aux mois d'août et de septembre 1867, tout-à-coup, le choléra fait son apparition. En même temps, les sauterelles, une sécheresse de huit mois et la famine s'abattent sur les campagnes, tandis que le typhus fait d'effroyables ravages. On compte bientôt cent mille morts, surtout parmi les indigènes. Partout, des affamés et des orphelins. L'archevêque, immédiatement, entend l'appel de ces infortunées créatures, auxquelles il prodigue tous les secours possibles, par ses prêtres, les religieuses et les sociétés de charité. Il recueille lui-même, à l'orphelinat de Ben-Aknoun et dans les environs, jusqu'à 1.750 orphelins qu'il confie aux Sœurs de la Doctrine chrétienne de Nancy, aux Frères des Ecoles chrétiennes et, plus tard, aux Pères Blancs.
Il fait appel au Gouvernement, à l'Episcopat, à la France, au monde entier ; il envoie des quêteurs jusqu'au Canada.
Beaucoup de ces chers petits meurent, après avoir reçu le saint baptême ; mais il en reste encore beaucoup qu'il faut sauver à tout prix, car l'archevêque aimerait mieux mourir que de les abandonner.
La plupart des orphelins qui survécurent ont gardé de lui un filial souvenir : j'ai vu l'un d'eux, chez les Petites Sœurs des Pauvres de la Bouzaréa, où il s'est retiré avec sa femme, Jean Chérif, marié, à Sainte-Monique, par Mgr Lavigerie.
— Eh bien, mon ami, quel souvenir as-tu gardé du Cardinal ?
— Il était la charité même ! Et les yeux de ce petit vieillard, à barbiche blanche, brillaient d'une douce émotion.
C'est pour eux et pour leurs frères musulmans que Mgr Lavigerie fonde son héroïque Société de Missionnaires. En vérité, le P. Girard, supérieur du Grand Séminaire de Kouba, avait déjà songé à cette institution et, plus d'une fois, il avait parlé à ses élèves de l'apostolat auprès des indigènes.
Un soir de décembre 1867, qu'il était revenu sur ce thème favori, trois séminaristes se déclarèrent prêts à cet apostolat. Un mois plus tard, l'archevêque d'Alger les recevait avec la joie la plus vive et les encourageait à persévérer dans leur dessein. Le 20 septembre 1868, l'Echo de N.-D. d'Afrique annonçait l'ouverture d'un séminaire des missions, à El-Biar, et, le 18 octobre, s'ouvrait, confié aux Pères Jésuites, le noviciat de l'Institut que Mgr Lavigerie plaçait alors sous le patronage du Vénérable Geronimo.
Cependant le Maréchal de Mac-Mahon, Gouverneur général de l'Algérie, effrayé du retentissement mondial que Mgr Lavigerie avait donné aux derniers malheurs de la Colonie, avait écrit à l'archevêque, le 21 avril 1868, une lettre pleine d'injustes reproches. Deux jours après, l'archevêque envoya au Maréchal une admirable et énergique réponse, qui suffirait à immortaliser un homme, et dans laquelle, après avoir expliqué toute sa conduite, il demandait nettement « la liberté de l'apostolat : et par-là, disait-il, j'entends la liberté de la charité, la liberté du dévouement, la liberté de la mort, puisqu'on nous en menace sans cesse, pour le jour où nous irions, seuls, désarmés, au milieu des Arabes ».
Puis, répondant au reproche de s'être mis dans l'opposition gouvernementale, il ajoutait ces paroles qu'il nous serait doux, en pareille occasion, de répéter :
« Mieux que personne, Monsieur le Maréchal, vous savez que je vis dans la solitude, la retraite la plus profonde, fuyant le monde, ne m'occupant que de mes devoirs et de mes œuvres d'évêque. Si donc, comme vous me l'apprenez, la population algérienne se serre davantage encore autour de moi, c'est qu'elle considère les idées et les principes que je soutiens, comme son port de salut après tant de tempêtes.
« C'est mon troupeau, M. le Maréchal, ce sont les âmes dont je suis le pasteur, et vous leur reprochez leur confiance en moi ; et vous me reprochez de les aimer, de chercher à les sauver ; et vous me faites entendre que, si je ne me sépare pas d'eux, je ne suis pas l'ami de César ! »
Mgr Lavigerie ne se contenta pas de protester ; il en appela à Napoléon III ; mais il eut la surprise et la douleur de ne pas être compris : « Vous avez, Monsieur l'Archevêque, lui répondit l'Empereur, une grande tâche à remplir, celle de moraliser les 200.000 colons catholiques qui sont en Algérie. Quant aux Arabes, laissez au Gouverneur Général le soin de les discipliner et de les habituer à notre domination. »
C'était sa condamnation. La lutte pour la liberté de l'apostolat était donc engagée ; mais le lion africain ne craindra pas les aigles. Mgr Lavigerie se rend à Paris. Il demande à l'Empereur une audience qui lui est refusée, sous prétexte que Sa Majesté partait pour Biarritz. L'archevêque l'y suit et obtient enfin d'être reçu.
Alors, avec toute l'audace d'un véritable apôtre, il dit, au cours de l'entrevue, en parlant de la liberté qu'il réclamait : « Cette liberté, c'est celle de faire mon devoir ; si, par impossible, votre Gouvernement ne me le rend pas, il faudra bien que je la prenne... »
Vivement impressionné par cette fière réponse, l'Empereur lui fit écrire que « toute latitude lui serait laissée pour étendre et pour améliorer ses œuvres charitables auprès des indigènes. »
La cause sainte était gagnée. Il pouvait donc s'appliquer maintenant à la formation de son nouvel institut de missionnaires et lui donner ses règles (1869).
Le 2 février, dans la petite chapelle de Saint-Joseph, à Notre-Dame d'Afrique, eut lieu la cérémonie de la première prise d'habit.
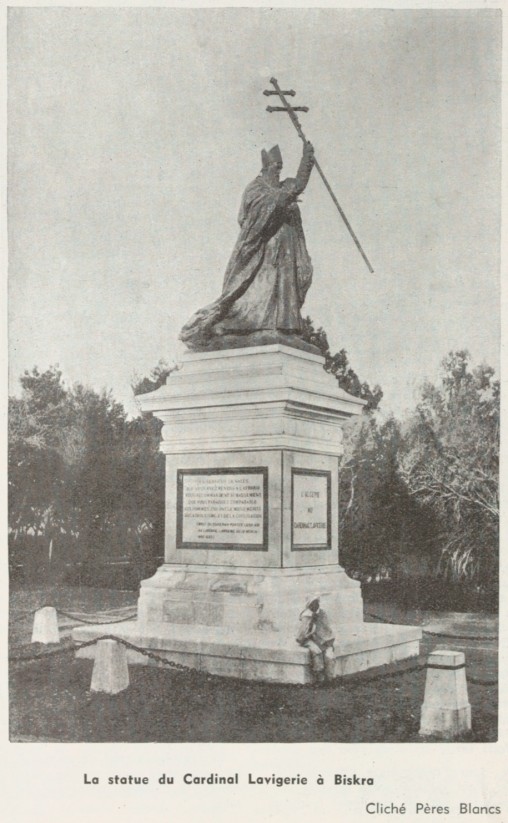 Nous connaissons tous cette gandoura blanche, ce burnous blanc, cette chéchia, ce rosaire que nous sommes heureux de saluer, dans nos villes, dans nos campagnes, dans la plaine du Cheliff et jusque sur les montagnes de la Kabylie. Nous connaissons tous cette gandoura blanche, ce burnous blanc, cette chéchia, ce rosaire que nous sommes heureux de saluer, dans nos villes, dans nos campagnes, dans la plaine du Cheliff et jusque sur les montagnes de la Kabylie.
Nous savons aussi tout le bien qu'ont déjà fait, que font encore, dans l'Afrique du Nord, au Grands Lacs, au Soudan, partout où ils se trouvent, nos chers Pères Blancs, et nos prières n'ont jamais cessé de s'unir à celles que leur fondateur adressait à Dieu pour le développement toujours plus grand de cette nouvelle armée de missionnaires.
Mais, à la prière, Mgr Lavigerie savait toujours joindre l'action et, le 1er mai 1869, il faisait appel aux séminaristes de la France entière, pour qu'ils vinssent nombreux renforcer les premières recrues.
En même temps et la même année, il fondait, avec huit jeunes filles bretonnes, débarquées à Alger, le 8 septembre 1868, la Congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, qui devait contribuer puissamment à l'évangélisation des femmes africaines. La consigne qu'il leur donnait, c'était la souffrance, généreusement acceptée pour le salut des Africains ; c'était surtout la sainteté.
Il écrivait plus tard à l'une de ses vaillantes filles, Mère Marie Claver :
« Pour une œuvre si grande et si difficile, il faut des instruments parfaits, des âmes vraiment apostoliques, des saintes. Entendez bien ce mot-là, c'est le seul que vous devez connaître et chercher è réaliser en vous. Je vous l’ai dit, je vous le répète, si vous n'êtes pas une sainte, vous ne serez rien, rien pour vous-même, rien pour les œuvres. Si vous êtes une sainte vraiment, Dieu fera par vous des choses merveilleuses. »
Les Sœurs Blanches l'ont bien compris.
Que n'avons-nous le temps de vous dire plus longuement leur dévouement, si apprécié de tout le monde, et l'accroissement rapide de leurs œuvres, sous le gouvernement de la première Supérieure Générale, la Révérende Mère Salamé ! nous les retrouvons maintenant partout où les Pères Blancs ont porté l'effort de leur apostolat.
En 1872, les Pères étaient à Laghouat, à Aumale, à Ouargla et en Kabylie, où, à la fin d'avril 1872, Mgr Lavigerie les visita lui-même.
Le 26 octobre 1874, quand il consacre la nouvelle chapelle de Maison-Carrée, la Société comptait déjà 106 missionnaires au novices, dont 50 prêtres.
Au mois de décembre de l'année suivante, trois des plus vaillants se trouvaient « chez les Touaregs, en route pour Tombouctou, avec l'ordre et la résolution de s'établir définitivement dans la capitale du Soudan ou d'y laisser leur vie pour l'amour de la Croix...». Hélas ! Le bruit de leur mort courut bientôt ; à la fin du mois d'avril 1875, tout espoir était perdu, ils avaient été massacrés.
Le 29 de ce même mois, l'archevêque d'Alfer écrivait à son ami Mgr Bourret, évêque de Rodez : « Notre mission vient de recevoir sa consécration suprême.
Trois de nos missionnaires ont été mis à mort pour la foi qu'ils allaient prêcher à Tombouctou. Ce sont les Touaregs du Sud qui les ont décapités. Nous avons chanté un beau Te Deum, le plus émouvant que j'aie entendu chanter de ma vie, au Noviciat de Maison-Carrée ; et, après le Te Deum, tous les missionnaires m'ont demandé à partir pour remplacer leurs frères martyrisés. Cher Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter de semblables grâces de la part de Dieu, et pour voir un père si misérable avoir de tels héros pour enfants ?»
Le 4 mai suivant, il adressait une-Lettre admirable, qu'on croirait signée de Saint Cyprien, aux parents des nobles victimes, «fleurs sacrées, où la blancheur du lys s'allie à la pourpre du martyre et qui, les premières, sont venues fleurir et embaumer ces déserts.»
Et maintenant, ô grand apôtre africain, vous pouvez obtenir de Rome de célébrer une messe d'action de grâces, car le sang de vos fils, morts, pour le Christ, sera certainement, une semence de chrétiens.
Déjà, en effet, dans la plaine des Attafs, où il avait acheté, en 1869, de vastes terrains, Mgr Lavigerie avait établi des ménages d'Arabes chrétiens, - en deux villages, placés sous le vocable de Saint Cyprien et de Sainte Monique ; le samedi, 5 février 1876, il y avait inauguré solennellement, en présence des autorités militaires et civiles d'Alger, un grand hôpital, nouvelle maison de Dieu, Bit'Allah, en lui donnant le nom de Sainte Elisabeth, patronne de la Générale Wolff.
Mais, pour l'archevêque missionnaire, l'Algérie n'est qu'une porte ouverte par la Providence sur un continent barbare de deux cents millions d'âmes. C'est là surtout qu'il faut porter t'œuvre de l'apostolat catholique. On n'a à y craindre ni la politique des bureaux arabes, ni l'opposition violente de la libre pensée. Tout dépend de la grâce de Dieu et du zèle des missionnaires.
«C'est ce que je crois le clergé d'Algérie appelé à tenter, un jour, écrivait-il à Mgr Maret, et ce qu'il peut tenter dès demain, s'il le veut, au péril de sa vie. »
Et l'intrépide chef de ce clergé le voulut, non sans avoir précisé aux missionnaires le sublime caractère de l'apostolat :
« L'apôtre, ne l'oubliez jamais, c'est exclusivement l'homme de Dieu et des âmes... Il faut qu'il se désintéresse de tout ce qui n'est pas sa mission propre...
Ne prenez jamais parti pour quelque cause politique ce puisse être ; ne soutenez aucun intérêt que celui de la foi et de l'humanité... Ne laissez jamais mêler ni votre cause, ni votre nom, à des intérêts humains... Si l'on vous en accuse, contre toute vérité, protestez, protestez encore, n'acceptez pas que l'on méconnaisse en vous des hommes vraiment apostoliques... Mon ambition est qu'on dise de votre Société qu'elle est catholique par excellence... »
Il ne nous est pas possible, dans ce court aperçu, de suivre l'action de Mgr Lavigerie et des Pères Blancs en Afrique Equatoriale ; mais comment passer sous silence le nom de celui qu'il chargea d'y conduire la première caravane, Mgr Livinhac ? Modèle des missionnaires par son humble et héroïque dévouement, par sa sagesse, par sa sainteté, il fut leur Supérieur général, pendant plus de trente ans.
Comment ne pas rappeler aussi les paroles de feu que Mgr Lavigerie adressa à ses fils qui partaient les premiers pour la conquête spirituelle du centre africain : « Où allez-vous, mes enfants, où allez-vous sans votre père ? Où allez-vous, prêtres, sans votre Pontife ? Vous offrirez le sacrifice, et seul le sacrificateur manquera à l'autel où votre sang viendra se mêler au sang de l'Agneau. Dieu ne m'a pas trouvé digne d'un tel honneur. »
Et plus tard, faisant allusion aux obstacles que les missionnaires avaient dû vaincre :
« Je n'écris ces noms qu'avec respect, disait-il, comme on écrivait, dans les premiers temps de l'Eglise, ceux des confesseurs et des martyrs. Si un seul d'entre eux a succombé, pendant le voyage, tous ont souffert pour Notre-Seigneur ce que souffrent les martyrs : la maladie, la faim, les angoisses, les embûches, et l'on peut bien dire de chacun d'eux ce que la sainte Eglise dit de l'un des saints de notre France : Quem et si gladius persecutoris non abstulit, palmam tamen martyrii non amisit. »
Après leur départ d'Alger, le 17 avril 1878, son cœur, qui était extrêmement sensible, les avait suivis, chaque jour ; l'un d'eux étant mort en route, ses angoisses redoublèrent et ne cessèrent que lorsqu'il apprit leur arrivée à Tanganyika, au bout de dix mois de voyage et, à l'Ouganda, après quatorze mois et vingt jours.
Quelle œuvre merveilleuse ils ont accompli, depuis un demi-siècle seulement, dans ces régions et en d'autres parties de l'Afrique, la statistique suivante vous l'apprendra :
Au 30 juin 1929, la Société comptait dans sa mission, 16 vicariats, 517 Pères, 134 Frères, 411 Sœurs, et comme coopérateurs indigènes, 70 prêtres, 294 Sœurs, 5.155 catéchistes et institutrices. Les baptisés y étaient au nombre de 515.878 et les catéchumènes de 243.747.
Devant ces magnifiques résultats, ne pouvons-nous pas prévoir que, dans cinquante ans, les chrétiens de l'Afrique centrale se compteront par millions ?
En même temps, l'archevêque d'Alger développait son œuvre missionnaire en Kabylie, où nous avons actuellement plusieurs paroisses ferventes, au Sahara et à Jérusalem, où il ouvrit, près du sanctuaire national de sainte Anne, un collège français qui devint le Séminaire destiné aux clercs orientaux.
Son zèle ne lui laissait aucun repos. Un autre projet grandiose hantait cet homme de Dieu, « ce génie, toujours prêt à remplacer le rêve réalisé par un autre rêve plus audacieux encore. »
L'Archevêque de Carthage,
Primat d'Afrique, Cardinal.
Carthage, où, depuis 1875, Pie IX l'avait autorisé à envoyer deux de ses missionnaires, pour y desservir l'humble chapelle de Saint Louis, bâtie sur un terrain acquis par Charles X, Carthage l'appelait. Le 3 juillet 1877, il y venait lui-même, pour la première fois, après avoir débarqué à la Goulette. Immédiatement il commence, comme à l'ordinaire, son apostolat de charité qui gagne les cœurs ; il annonce, deux ans plus tard, 13 septembre 1879, la fondation d'un collège, près de la chapelle du grand Saint Louis.
L'année suivante, 5 avril 1880, installé dans une très modeste villa de La Marsa, ancien faubourg de Carthage, il suit, avec le plus vif intérêt, les recherches archéologiques d'un de ses meilleurs missionnaires, le R. P. Delattre ; celui-ci, depuis cinq ans, avait entrepris ses fouilles, qu'il devait poursuivre pendant plus d'un demi siècle, avec une ardeur qui faisait dire à Mgr Lavigerie : « Il a le feu sacré. »
L'année suivante (15 février 1881), paraît un mémoire très étendu, adressé au chef du secrétariat de l'Instruction publique, sur l'utilité d'une mission archéologique à Carthage.
Mais bientôt survinrent de graves événements : le 31 mars 1881, des escarmouches avaient eu lieu, à la frontière algérienne, entre nos soldats et les montagnards de la Khroumirie. L'expédition de Tunisie était décidée. Le 12 mai, nos troupes étaient déjà sous les murs de Tunis et le Bey Mohammed Es-Sadok acceptait le protectorat de la France, par le traité du Bardo.
Mgr Lavigerie, nommé, le 28 juin 1881, Administrateur du vicariat apostolique de la Tunisie, s'appliqua à consolider l'influence française, mais par la charité. Félicitant ses missionnaires de leur action, toute d'évangélique bonté, à l'égard des Tunisiens, il ajoutait : « Secourez leurs pauvres à tous, guérissez leurs blessés, soignez leurs malades. Aimez-les comme vos frères et les enfants du même Dieu. Vous honorerez ainsi votre foi ; vous servirez la France chrétienne, car notre manière à nous de la servir et de combattre pour elle, ce n'est pas de la rendre redoutable, c'est de la faire aimer par nos vertus et par nos bienfaits. » Et lui-même donnait l'exemple du plus grand dévouement.
« Je serais allé vous voir avec bien de la joie, écrivait-il, un autre jour, à un ami, mais le choléra couve toujours à Tunis et m'empêche de m'absenter. Je ne puis pas même faire le voyage de Rome que j'avais projeté, et cela, malgré la nécessité la plus urgente... »
Le 9 avril 1882, il inaugurait la cathédrale provisoire de Tunis, dédiée à Saint Vincent de Paul ; puis il s'empressait d'appeler à son aide les Sœurs de N.-D. de Sion, les Sœurs de N.-D. d'Afrique, ses vaillantes filles, les Sœurs Franciscaines missionnaires de Marie, les Carmélites, et il entourait d'une particulière bienveillance les Sœurs de Saint Joseph de l'Apparition et les Frères des Ecoles chrétiennes, déjà établis dans la Régence.
Les œuvres se développaient ainsi rapidement et, peu à peu, le nombre des paroisses augmentait. Aussi bien, le 24 juin 1884, par une décision de la Congrégation de la Propagande, confirmée, le lendemain, par Sa Sainteté, la Tunisie était érigée en diocèse, et, dans le Consistoire du 10 novembre suivant, le grand pape Léon XIII annonçait urbi et orbi la restauration de l'ancienne Eglise de Carthage et signait la bulle Materna Ecclesiæ Caritas, qui l'érigeait en Eglise Métropolitaine, sous le gouvernement du Cardinal Lavigerie, « vir sapiens et impiger ».
C'est par ces deux mots, que le Souverain Pontife caractérisait admirablement la sagesse et la vaillance de ce grand homme d'Eglise dont la présence donnait déjà un nouveau lustre au Sacré-Collège.
En effet, le 19 mars 1882, l'archevêque avait reçu le billet officiel lui annonçant sa prochaine élévation au cardinalat et, le 16 avril, la calotte lui avait été remise, à Carthage même, dans une cérémonie solennelle qui se continua, le soir, à Tunis, au milieu d'un peuple en délire dételant les chevaux de sa voiture pour la traîner, comme le char des antiques triomphateurs.
Il n'entre pas dans notre plan de vous révéler tout le bien qu'il a fait, dans notre protectorat tunisien, par les œuvres de charité, d'enseignement et d'apostolat, ni de vous dire au prix de quel labeur exceptionnel il les accomplit ; ses historiens l'ont fait, d'autres le feront encore.
En 1890, l'influence de l’église et de la France y était solidement établie. Le monde chrétien put le constater, lorsque, le 15 mai, au milieu de solennités inoubliables, fut consacrée la nouvelle cathédrale qu'il avait fait bâtir, en l'honneur de Saint Louis, au sommet de la colline de Byrsa, d'où elle va apparaître, aux prochaines fêtes du Congrès Eucharistique International, comme le symbole éclatant de la résurrection de l'Eglise Africaine. Nous voyons encore l'Illustre Primat, notre Père bien-aimé, entrant dans la cathédrale de Saint Louis, au son des cloches et au bruit du canon tiré par les artilleurs beylicaux, entouré de tous les évêques du Nord de l'Afrique, de quelques évêques français et italiens et de toutes les autorités du pays.
Nous le voyons, assis sur son trône, écoutant son très remarquable discours, page immortelle de l'histoire de l'Eglise de Carthage, qu'il faisait lire, du haut de la chaire, par Mgr Combes, alors évêque de Constantine et bientôt son pieux successeur ; nous le voyons descendre de son trône jusqu'à la table sainte, pour achever lui-même cette lecture, avec des accents qui retentissent au fond de notre cœur :
« Et maintenant, s'écria-t-il en terminant, cloches de notre église, annoncez une Carthage nouvelle ! Ne sonnez désormais que la résurrection et la vie !
Assez de morts, assez de catastrophes, assez de combats, assez de divisions, assez de funérailles ! N'annoncez que les espérances, les consolations de la foi.
Ne parlez plus, à ces populations qui vous entourent, que de concorde, d'oubli du passé, d'affection fraternelle, de prospérité et de paix ! »
Saint Louis de Carthage ! Que n'entreprit-il pas pour faire rendre au saint roi de France et à tous les saints de l'Eglise d'Afrique des honneurs tout particuliers ? En 1880, étant administrateur du diocèse de Constantine, pendant la vacance du siège, il avait acheté, pour construire une église en l'honneur de saint Augustin, la partie supérieure de la colline d'Hippone, sur laquelle il plaça d'abord l'asile des Petites Sœurs des Pauvres ; bientôt, Mgr Combes y fit élever la splendide basilique qui réunira, cette année, après le Congrès Eucharistique international de Carthage, des foules chrétiennes, heureuses de fêter avec nous le XVe Centenaire de la mort du grand Docteur Africain.
Il recueillit pieusement, dans l'histoire, les noms des docteurs, des martyrs, des confesseurs et des vierges, et il en composa des litanies émouvantes, que nous avions l'ordre de chanter, tous les dimanches.
Et voici que, en plein centre africain, allaient s'épanouir sous ses yeux, comme des lys noirs, les martyrs de l'Ouganda, prémices de la moisson abondante que le sang et les sueurs de ses missionnaires avaient fait germer pour le ciel et pour l'édification et l'honneur de l'Eglise Catholique tout entière ; et déjà il les invoquait : « Pauvres martyrs, s'écria-t-il en apprenant leur mort héroïque, priez pour moi ! »
Puis, après avoir invité les Pères Blancs à une cérémonie d'action de grâces, il introduisit leur cause à Rome.
Quelle n'eût pas été sa joie, s'il avait pu assister, le 6 juin 1920, à la Béatification de ces martyrs noirs qui semblent effacer par leur sang la malédiction de Chanaan ; si, au-dessus de la gloire du Bernin, ses yeux les avaient contemplés montant vers le ciel, des lis à la main ; s'il avait pu chanter le Te Deum, avec la foule enthousiaste, au milieu de laquelle apparaissait le visage radieux de Benoît XV. Fête inoubliable !... Nous avions au ciel de nouveaux protecteurs.
Le grand serviteur de Dieu
et de Marie, de l'Eglise et de la Patrie
Nous venons de voir à l'œuvre, beaucoup trop rapidement, le grand apôtre que Léon XIII louait en ces termes immortels : « Les services signalés que vous avez rendus à l'Afrique vous recommandent si hautement que vous paraissez comparable aux hommes qui ont le mieux mérité du catholicisme et de la civilisation. »
Je voudrais maintenant vous le faire connaître dans l'intimité de sa vie : de loin, en effet, le vulgaire le voyait grand, sévère, comme on aperçoit une haute montagne ; mais, de près, on découvrait des fleurs charmantes dans les vallées de son cœur.
Grand, très grand, il le fut, en effet. Dieu lui avait communiqué avec largesse tous les dons, toutes les qualités naturelles qui élèvent un homme au-dessus des autres : une puissante intelligence, servie par une mémoire aussi prompte qu'impeccable ; une volonté ferme, audacieuse, capable de tout entreprendre, de tout surmonter pour atteindre les fins qu'il se proposait ; une énergie qui devenait parfois de la violence ; un cœur noble et vaste, comme nos horizons africains, aspirant toujours à faire de grandes choses, pour l'honneur de l'Eglise et le bien de l'Humanité.
Sa grande âme se reflétait merveilleusement sur son visage et dans son extérieur. D'une taille haute et bien proportionnée, il avait grand air ; ses traits étaient réguliers et fins ; il avait le front haut, le regard vif et profond, charmeur et rapide. A ces dons, relevés par une culture exceptionnelle et par la dignité du cardinalat, s'ajoutait cet ascendant mystérieux qu'exercent les grands chefs et qui leur permet de tout exiger de leurs inférieurs, jusqu'aux extrêmes limites du possible.
Il était grand par un esprit de foi admirable, rapportant à Dieu tout ce qui lui était imposé par sa gloire.
Cet homme de génie, qui avait « poursuivi la plus haute pensée spirituelle avec la finesse d'un diplomate à l'ardeur d'un conquérant » et que ses fonctions de membre du Sacré Collège, d'archevêque de Carthage et d'Alger, de Primat d'Afrique, de supérieur fondateur de deux Sociétés de Missionnaires, mettaient en relations constantes avec les Papes et avec les hommes d'Etat qui s'honoraient de recevoir ses communications, cet homme de génie qui parlait d'égal à égal aux princes et aux ministres les plus puissants, savait s'humilier profondément devant Dieu. Il n'a travaillé que pour sa gloire et le salut des âmes. Cependant, son bonheur, comme il le disait, en arrivant à Alger, fut de vivre, dans toutes les circonstances « où son devoir ne l'appelait pas au dehors, dans le recueillement de sa maison épiscopale... afin de pouvoir parler à Dieu, dans la prière », des âmes qui lui étaient confiées.
Il était grand par une tendre piété qu'il s'efforçait de cacher, semblait-il, sous les dehors d'un homme passionné pour l'action ; mais ceux qui ont eu le bonheur de le connaître dans l'intimité, de le voir seul, au pied du tabernacle, ou d'assister aux Saluts du Très Saint Sacrement qu'il faisait donner par l'un de ses secrétaires, dans sa chapelle de Saint-Eugène et de la Marsa, ou dans la petite chambre de Biskra, n'oublieront jamais avec quelle ferveur il entonnait, de sa belle voix de Pyrénéen, les chants liturgiques, et avec quel profond recueillement il inclinait sa tête blanche sous la bénédiction du Divin Maître.
Et sa particulière dévotion à la Très Sainte Vierge n'était-elle pas connue de tous ? Une de ses plus douces joies fut d'achever l'église de Notre-Dame d'Afrique, de la consacrer, de la faire ériger en basilique et de couronner la Vierge, le 30 avril 1876, au nom du Souverain Pontife : « Notre-Dame d'Afrique, écrivait-il, en annonçant cette solennité, c'est, en effet, non seulement la reine du présent, c'est aussi la reine du passé, la reine des Cyprien, des Augustin, des Optat, des Fulgence, des Félicité, des Perpétue, des Docteurs, des Pontifes, des Martyrs, des Vierges, qui ont embaumé cette noble terre du parfum de leurs vertus et de leur sang. » Et il ne manquait pas de s'arrêter dans la basilique, quand il allait de Saint-Eugène à Alger.
Dans ses voyages en France, il montait à Notre-Dame de la Garde, pour lui recommander ses travaux et ses œuvres.
Nous avons compté quarante-deux fois, sur les registres, sa large signature, qu'il faisait suivre le plus souvent d'une tendre affirmation de confiance et d'amour ou d'une fervente prière à Marie, nous nous en voudrions de ne pas en donner ici quelques touchants exemples :
Sa première signature est du 12 mai 1867, au moment où il se préparait à partir pour Alger.
La troisième, du 8 décembre, est suivie de ces mots latins que je traduis : « Charles, évêque d'Alger, sauvé avec ses compagnons, d'un naufrage imminent, le 25 septembre 1867, par l'invocation à la Vierge, mère de Dieu, Notre-Dame de la Garde, et pour accomplir un vœu suppliant, visitant le sanctuaire de la Divine Vierge, le 8 décembre de la même année. »
Le 4 janvier 1868, Mgr Lavigerie « gravit la sainte colline, malgré la neige, la glace et le froid ».
Le 15 mai de la même année, se rendant à Paris, auprès de l'Empereur, pour réclamer la liberté de l'apostolat que lui refusait le maréchal de Mac-Mahon, l'archevêque écrit ces mots, bien dignes d'un soldat du Christ : « Charles, archevêque d'Alger, qui, malgré son indignité, partant au combat pour défendre le nom de Jésus-Christ et la liberté de son Eglise, a offert ici, aujourd'hui, avec supplication, le sacrifice de la messe, en implorant le secours de Marie qui seule a écrasé toutes les hérésies. »
Le 5 septembre 1868, il signe comme délégué apostolique pour les régions du Sahara et du Soudan ; le 19 novembre 1870, comme administrateur de Constantine et d'Hippone.
Le 16 avril 1875, « il offre à Pie IX, vicaire du Christ, autre Pierre, prisonnier dans les liens, les prémices de sa mission, à savoir les Arabes convertis à la foi ».
Le 19 mai 1876, «il rend grâce à Notre-Dame de la Garde de ce qu'elle a couronné du martyre trois de ses fils missionnaires d'Alger, les établissant bons gardiens de la terre infidèle ».
Le 22 mars 1878, quinzième anniversaire de son sacre, c'est le « délégué apostolique pour l'Afrique Equatoriale » qui signe.
Le 8 mai 1882, c'est le cardinal : « Dieu a voulu que tout nous vienne par Marie. Charles, Cardinal Lavigerie, archevêque d'Alger, administrateur de Carthage. »
Le 17 juin suivant : «Dilectus tuus, ô Maria, rubicundus ! »
Le 11 juillet 1885 : «Charles, Cardinal Lavigerie, archevêque de Carthage et Primat d'Afrique, recommandant son Afrique à la bonne garde de la Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie. »
Il note, le lundi 26 avril 1886, que, « sous l'épiscopat de Mgr Robert, évêque de Marseille, il a consacré le maître-autel de la Basilique supérieure».
Deux ans plus tard, le 8 juin 1888, partant pour sa croisade anti-esclavagiste, il écrit : « La cause des esclaves les plus malheureux en Afrique, qui m'a été confiée par le Vicaire du Christ, malgré ma très grande misère (mihi miserrimo), je vous la recommande, ô Mère qui, pour racheter les esclaves, avez livré votre fils.»
Le 17 novembre 1888 : « 0 Notre-Dame, sauvez les esclaves africains qui espèrent en vous ! » + Charles, Cardinal Lavigerie.
Enfin, le 15 janvier 1889, sur le point de revenir à Alger : « 0 Marie, sauvez vos esclaves africains qui espèrent en vous ! »
Salvas fac servas tuas africanas, o Maria, sperantes in te. Carolus, Card. Lavigerie.
Je m'excuserais de donner tous ces détails, si je n'étais sûr de vous montrer ainsi, dans toute sa vérité et sa simplicité, la piété filiale du grand Cardinal Africain envers Marie.
Vous ne serez point étonnés maintenant de l'entendre dire : « Je suis persuadé, et je l'ai toujours été, que je n'ai pu faire aucun bien que par l'intercession et la protection spéciale de la Sainte Vierge, dont j'ai souvent ressenti les effets d'une manière extraordinaire...»
Et nous ne pouvons nous empêcher de penser que sa joie doit être grande, au ciel, de voir le prochain Congrès Eucharistique International placé sous le patronage spécial de Notre-Dame de Carthage.
Il était grand par une application constante au travail : « Je ne veux pas un jour de repos », disait-il.
Recevant ses secrétaires particuliers, pour la première fois, il ne manquait pas de les avertir : « Nous nous sanctifierons par le travail. » Ah ! comment oublier ce bureau qui ressemblait, le matin à une ruche laborieuse et bourdonnante, surtout quand, de sa forte voix, le maître nous rappelait sévèrement à l'ordre !
C'est là qu'il dictait, dans un style de clarté et de force, ses lettres innombrables et ses écrits qui font honneur aux lettres françaises et révèlent un écrivain de race. Quelques-uns de ses travaux sont même de vrais chefs-d'œuvre à tous égards. Pour les faire, il se levait, longtemps avant l'aurore, et même en pleine nuit, lorsqu'il s'agissait d'une œuvre pressante ou plus importante.
« — C'est un excès de travail », osait-on lui dire quelquefois. Et il répondait ce mot bien connu : « L'éternité sera assez longue pour se reposer. »
Cet homme de commandement fut grand surtout par l'obéissance. Aussi bien la recommandait-il instamment à ses missionnaires, et l'exigeait-il de tous ses subordonnés. « Entre toutes les vertus que je vous souhaite, disait-il un jour, la vertu d'obéissance est la première et même la seule véritablement indispensable, parce que rien ne la supplée et que, seule, elle assure toutes les autres. »
Lui-même en donna toujours l'exemple. La Sainte Ecriture nous enseigne que l'homme obéissant remportera des victoires. Le Cardinal fut cet homme-là.
Non seulement il n'accomplit les grandes œuvres dont nous avons parlé qu'avec l'autorisation et les encouragements du Saint-Siège, mais encore il eut toujours à cœur d'obéir aux ordres et même aux moindres désirs du Souverain Pontife.
Le 2 février 1888, après la suppression officielle de l'esclavage au Brésil, il écrivit une lettre au Pape Léon XIII pour lui exposer les horreurs de l'esclavagisme africain. Il y disait que « si l'on perdait la route qui conduit de l'Afrique Equatoriale aux villes où se tiennent le marchés d'esclaves, on pourrait la retrouver aisément à la traînée d'ossements dont elle est bordée ».
Le 24 mai suivant, à Rome, dans une audience solennelle, présentant au Souverain Pontife un pèlerinage de Lyon et le pèlerinage africain, dans lequel on distinguait douze noirs chrétiens, il dit, d'une voix qui émut tous les cœurs : « Ce que votre Sainteté a flétri avec tant d'éloquence, c'est, Très Saint Père, la propre histoire des Noirs qui sont, en ce moment, à vos genoux. Tous, sans exception, sont les témoins et les victimes de ces infamies. Tous ont été, par la violence, enlevés à leurs familles, séparés de leurs pères, de leurs mères, qu'ils ont vu le plus souvent massacrer sous leurs yeux. Tous ont été traînés sur les marchés à esclaves, sur ces routes impies dont parle Votre Sainteté avec une vérité qui fait frémir. Tous enfin ont été vendus comme un vil bétail...
« Or, ils ont laissé, dans l'intérieur de notre immense continent, tout un peuple, leur propre peuple, voué à ces effroyables misères : cent millions d'hommes, de femmes, d'enfants, condamnés à une telle vie et à une telle mort ! »
Léon XIII, répondant à cette émouvante adresse, se tourna vers l'archevêque missionnaire et, ayant rappelé les difficultés des missions Equatoriales, il ajouta : « Mais c'est surtout sur vous, Monsieur le Cardinal, que nous comptons, pour le succès de ces difficiles œuvres et missions africaines. Nous connaissons votre zèle actif et intelligent.
Nous savons tout ce que vous avez fait jusqu'à ce jour et Nous avons la confiance que vous ne vous lasserez pas que vous n'ayez mené à bonne fin vos grandes entreprises. »
C'est alors qu'il parcourut l'Europe, pour faire entendre son cri d'indignation contre les marchands d'esclaves : Paris, Londres, Bruxelles, Naples, Marseille, Rome, entendirent ses appels éloquents et angoissés qui firent tressaillir de pitié le monde entier « En face des saints autels, avec la liberté de mon ministère, s'écriait-il, je dénonce l'esclavage. Au nom de la justice, au nom de l'humanité, au nom de ma foi, au nom de mon Dieu, je lui voue une guerre sans merci et je le déclare anathème ! »
Tandis qu'il établissait, à Rome, l'œuvre anti-esclavagiste, déjà connue en France et en Belgique, le Souverain Pontife lui demanda d'aller prêcher à Milan.
On était alors au cœur de l'hiver. Sans hésiter, le Cardinal se rendit dans cette ville, malgré un froid rigoureux et bien qu'il eût déjà ressenti les atteintes du mal qui devait l'emporter. Il y prononça un grand discours et y gagna, avec de nombreuses adhésions à la cause antiesclavagiste, une nouvelle attaque d'apoplexie. A partir de ce moment, sa main droite demeura inerte et lui refusa à peu près tout service ; mais il avait donné un grand exemple : il avait obéi.
Lorsque, après cette glorieuse Croisade, il revint à Alger et que tous les prêtres de la ville et de la banlieue se réunirent, à l'Archevêché, le 31 janvier 1889, pour le féliciter et lui exprimer leur joie de son retour, après tant de fatigues « J'ai accompli, dit-il, la première partie de ma tâche, qui était de faire connaître au monde les horreurs de l'esclavage. Je partirai, vers la fin de mai, pour réunir un Congrès International. Vous le verrez, la vérité sortira de la bouche des peuples, comme elle sort de la bouche des enfants, et les peuples diront bien haut ce que leurs princes n'ont pas eu l'énergie de dire... Dans toute cette affaire, je n'ai eu que le mérite de l'obéissance. Priez, Messieurs, afin que le Bon Dieu soutienne mes forces pour le bonheur des Noirs de notre Afrique. »
Quelque temps après, le même Souverain Pontife lui confia la délicate mission d'inviter les partisans attardés des anciens régimes, en France, à accepter loyalement le régime républicain, implanté désormais dans notre pays. En leur faisant donner ce conseil impérieux, Léon XIII voulait les mettre à même le mieux servir la France ; il espérait rendre plus faciles les relations de l'Eglise et de l'Etat et ôter au Gouvernement tout prétexte de persécuter les Catholiques. Une telle mission comportait de grosses responsabilités ; mais le Cardinal n'était pas homme à reculer devant les difficultés, lorsque le Pape faisait appel à son dévouement.
On se rappelle le toste de Saint-Eugène qui résonna soudain, comme un coup de clairon, dans toute la France.
Le Cardinal Lavigerie n'ignorait pas, en le prononçant, que sa parole rencontrerait une vive opposition, dans certains milieux, et y soulèverait des tempêtes ; qu'elle lui aliènerait des sympathies précieuses, qu'elle tarirait même, dans une large mesure, les ressources nécessaires à ses œuvres. Mais ces considérations intéressées ne l'arrêtèrent pas. Il connaissait la pensée du Pape, née de la claire vision des choses et du désir du bien général ; il la partageait pleinement et, pour la faire triompher, il sacrifia sa tranquillité, ses intérêts, son honneur même, s'en remettant à Dieu du soin de sa défense et de l'avenir de ses œuvres. Peut-on concevoir une obéissance plus simple, plus désintéressée, plus héroïque ?
Au reste, toujours orienté vers la Capitale du monde chrétien, où il revenait souvent prendre barre, il recueillait, avec une piété attentive, les directives et les enseignements des Souverains Pontifes Pie IX et Léon XIII, sous lesquels se passa son épiscopat, et qui, tous deux, l'honorèrent de leur particulière estime.
Ces directives et ces enseignements, il les méditait d'abord et y conformait sa conduite, puis il les traduisait fidèlement dans ses Lettres pastorales et ses autres écrits.
Etre Romain avant tout, être avec le Pape vivant, faire écho à la grande voix du chef de l'Eglise, agir et penser comme lui, fut toujours sa devise, la norme qu'il suivit constamment et qu'il ne cessa d'inculquer à ses missionnaires et à ses prêtres.
Il fut grand par son amour pour la France dont il connaissait la merveilleuse histoire.
Pendant la guerre néfaste de 1870-71, son cœur de patriote avait souffert des humiliations et des douleurs de la patrie, qui devient plus chère peut-être à ceux qui vivent loin d'elle, et il avait offert son clergé, ses établissements religieux, les cloches de ses églises, pour contribuer au salut national. Lorsque l'insurrection de Kabylie éclata, on le vit, à côté de l'amiral de Gueydon, un grand chrétien, semant partout les encouragements et la confiance, honorant, pleurant les victimes, soulageant la pauvreté de tous ses enfants, chrétiens et indigènes. A l'exemple de Mgr Dupuch, qui avait envoyé M. Suchet vers Abd-el-Kader, Mgr Lavigerie ordonna au P. Charmetant de se rendre auprès du chef kabyle, El-Mokrani, pour lui faire comprendre son ingratitude et sa folie ; mais cette démarche n'eut pas de succès.
Le 25 avril 1875, il prononça, à la Cathédrale, à l'occasion du rétablissement de l'aumônerie militaire (3 juin 1874), un grand discours sur l'armée et la mission de la France en Afrique, dans lequel il exaltait, en termes d'une éloquence inoubliable, l'héroïsme des chefs et des soldats et la mission civilisatrice de la France chrétienne.
Ce discours lui attira, de la part de l'Armée, un surcroît de sympathie. Il est vrai qu'elle comptait alors, comme aujourd'hui, des généraux distingués qui étaient aussi d'excellents catholiques. L'un d'eux, le général Wolff, nommé commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, lui écrivait, le 29 juin 1875 :
« Je suis décoré des Ordres d'à peu près tous les souverains et j'ai fait le serment au lendemain de nos désastres de ne plus porter que les insignes de la Légion d'honneur jusqu'à ce que la France ait retrouvé des jours meilleurs ; mais je ferai exception pour l'ordre de notre Saint-Père, afin d'affirmer plus encore, si je le puis, la ferveur de mes croyances religieuses, intimement convaincu que je suis que notre malaise moral vient de notre incrédulité.»
L'amour que Mgr Lavigerie avait pour la France lui faisait désirer de la voir prospère et respectée, étendant de plus en plus les frontières de ses possessions africaines ; son regard d'aigle la voyait s'établir au Maroc et déjà il s'intéressait même au Transsaharien. En effet, il écrivait, en 1890 :
« J'ai toujours considéré la question de la pénétration du Sahara et du Soudan comme capitale pour les intérêts de la France et pour ceux de l'Algérie.
«A la vérité, le but que j'ai poursuivi, dès l'origine, dans le continent africain, et pour lequel mes missionnaires ont déjà versé tant de sang et affronté tant de fatigues et de souffrances, est d'un ordre supérieur à celui de la politique. La cause dont je poursuis le triomphe est la cause de l'humanité, de la justice, de la liberté, de la vérité ; mais, lorsqu'il s'agit de la France chrétienne, ces deux causes s'identifient, et je ne puis, par conséquent, que m'intéresser très vivement au succès de votre grande entreprise du Transsaharien ».
Et il télégraphie au Général Philibert, à Bordeaux : «Puisque vous acceptez d'être membre du comité de patronage du Transsaharien, je ne veux pas me séparer de vous et je vous prie de vouloir bien inscrire mon nom, à côté du vôtre, voulant donner du moins mon appui moral à une aussi patriotique et grande entreprise. »
Puis, il écrit : « Je m'associe à une œuvre généreuse de civilisation chrétienne ; je ne pourrais, à aucun degré, m'associer à une spéculation vulgaire, si elle venait à se produire : l'armée que je commande est trop pure et trop noble pour que je consente jamais à la mêler à une question d'argent. Charles, Cardinal Lavigerie, Primat d'Afrique.»
Mais précisément, parce qu'il désirait la prospérité de la France, le Cardinal, grand Français, aurait voulu la faire revenir pleinement à la religion qui a fait sa force et sa gloire dans le passé.
Que de fois, avec l'autorité particulière qui s'attachait à sa parole, il adjura le Gouvernement de la République de s'arrêter sur la voie de la persécution religieuse et de revenir aux vieilles traditions françaises ; mais sa voix ne fut pas écoutée. Un vent d'impiété soufflait sur nos dirigeants, et ses dernières années furent attristées par l'attitude, chaque jour plus hostile, du Gouvernement et des Chambres envers l'Eglise et le clergé.
Ce fut sa suprême douleur, qu'il exprimait, dans son testament de 1885, en termes émouvants, lorsque, faisant allusion à l'union, qu'il jugeait nécessaire, de l'Eglise et de l'Etat, il écrivait : «J'ai tout fait, dans la mesure de mes forces et de mon intelligence, pour maintenir cette concorde si désirable. Je puis dire, en vérité, que j'en meurs, car la maladie qui me conduit au tombeau est la conséquence des fatigues surhumaines que je me suis imposées, l'été dernier, à Rome et à Paris, pour empêcher une rupture éclatante que tout semblait rendre inévitable. Et là, je travaillais encore plus, dans un sens, pour ma pauvre et chère patrie que pour l'Eglise...
«Oh ! si je pouvais lui parler encore du fond de ma tombe ! Si je pouvais, avec ce désintéressement de toutes choses, qui est le propre de la vie à venir, lui représenter, une dernière fois, comme je l'ai fait souvent à ceux qui la gouvernent, ce qui peut lui donner la paix !
Je la vois avec une amère douleur descendre, chaque jour, du rang où l'avaient placée dans le monde, la foi et les vertus de nos pères, la politique sage et persévérante de nos rois.»
Prions Dieu pour que la paix, si ardemment souhaitée à la France par le Cardinal Lavigerie, y règne toujours et s'y affermisse de plus en plus, dans l'union de tous ses enfants, dans l'amour de Jésus-Christ et de son Eglise. Elle ne pourra alors que prospérer et grandir.
Les derniers jours. La mort.
Le 22 mars de l'année 1888 ramenait le vingt-cinquième anniversaire de la consécration épiscopale du Primat d'Afrique. De sa modeste résidence de Biskra, où, depuis quatre ans, il avait l'habitude d'aller passer les mois d'hiver, dans un plus profond recueillement et dans un travail intense, il adressa à ses diocésains une Lettre pastorale où il se remettait en mémoire les grâces particulières reçues de Dieu et qu'il terminait par ces mots, de la plus touchante piété : «Priez pour que Dieu me pardonne les fautes qu'il trouvera dans ma vie, avec les faiblesses de la pauvre nature humaine. Priez pour qu'il m'accorde de les pleurer dignement, avant de paraître devant Lui comme Augustin mourant les pleurait dans son Hippone, avec tant d'amertume. Priez enfin pour que je termine dans sa grâce une vie plus longue et que je puisse ainsi, moi-même, durant l'éternité, continuer à vous aimer et à prier pour vous. »
A Alger, la fête fut d'une solennité extraordinaire et son souvenir est resté ineffaçable dans la mémoire de tous ceux qui y assistèrent : Mgr Averardi, premier conseiller de la Nonciature à Paris, accompagné de dix autres prélats, y représentait le Nonce lui-même. Plus de cent cinquante prêtres étaient présents. Quelle émotion, en entrant dans la Cathédrale, où deux cents voix, sous la direction du bon abbé Pascouaud, maître de chapelle, entonnèrent l'Ecce sacerdos magnus ! Quelles acclamations, à la sortie de la Cathédrale ! Je les entends encore.
Il y parla en faveur des pauvres de la ville : «Ce sont, disait-il, les fils bien-aimés de mon cœur. Autrefois, je vous disais : donnez pour l'amour de Dieu ; je vous dis aujourd'hui : donnez pour l'amour de Dieu et aussi pour l'amour de moi. » Il bénit ses enfants fidèles et aussi ceux qui ne sont pas encore entrés au bercail : « Ah ! s'écria-t-il, quand pourrai-je vous presser tous entre mes bras et dans une commune charité ! »
Ce jour-là, en pensant à l'action considérable que le Cardinal Lavigerie exerçait autour de lui et dans le monde, elle nous parut bien vraie la parole de l'un des évêques présents, Mgr Géraïgiry, évêque de Panéas : «L'homme, qui ressemble maintenant le plus au grand pape Léon XIII, c'est le grand Cardinal Lavigerie ! »
Cette fête du 22 mars 1888 fut son dernier triomphe à Alger.
Les épreuves du toste dont nous avons parlé allaient venir, qui « empoisonnèrent les deux dernières années de sa vie et, probablement, hâtèrent sa fin».
Le 23 novembre 1892, il reçut, à Saint-Eugène, le cher Père Delattre, le savant archéologue, archiprêtre de la Cathédrale de Carthage, et l'abbé Bombard, vicaire à Tunis : « Enfin, voilà mes Tunisiens ! » s'écria-t-il, en les apercevant.
L'abbé Bombard a raconté comment se passa cette journée : «Le Cardinal était assis dans un fauteuil très bas, les jambes allongées, vêtu de sa soutane noire à boutons rouges ; la calotte rouge avait remplacé la clémentine d'antan.... Le R. Père Delattre et moi, nous nous agenouillons pour baiser sa main et demander sa bénédiction.
Le Cardinal soulève ses deux bras, visiblement pour nous donner une preuve de sa force et de sa santé, et nous embrasse ; puis il fixe longuement sur nous ses regards. Je remarque la contraction des nerfs de la face ; l'œil n'a plus l'éclat d'autrefois ; seules, les facultés intellectuelles sont dans leur plénitude : «Je vous remercie, nous dit-il, après un instant, d'avoir bien voulu venir auprès de moi ; vous serez mes deux gardes-malades. Depuis quelque temps, je sens que je vais mieux ; j'ai voulu avoir, auprès de moi, deux anciens de la Tunisie ; vous m'aiderez à guérir ; nous parlerons des choses de mon grand diocèse de Carthage que j'ai quitté, depuis longtemps... Adieu, mes enfants.»
Nous baisons, à genoux, la main du vénéré malade et nous nous retirons en silence.
Une heure après, le Cardinal fait appeler le R. Père Delattre et s'entretient avec lui, jusque vers le moment du repas. Le timbre ne sonne ensuite qu'à quatre heure et demie ; Frère Optat me prévient que le Cardinal me demande : « Il faut que nous travaillions un peu, me dit-il ; cherchez à terre, à côté des journaux ; il y a une lettre à laquelle je veux répondre de suite. »
Je m'agenouille pour chercher la lettre en question dans un déluge de journaux, jetés pêle-mêle sur le tapis ; il me suit du regard. Je lui présente plusieurs écrits : «Est-ce cela, Eminence ?» — « Non... donnez-moi mes lunettes, mon enfant. »
Je me lève, prends les lunettes sur le guéridon voisin et je les lui donne ; mais il a de la peine à se les mettre et je l'aide.
— « Ici, mon enfant », me dit-il aussitôt, en me montrant, à sa gauche, la lettre recherchée, arrivée de la Procure de Rome, dans la matinée. Le Cardinal la parcourt un instant, pose ses lunettes et se met à me dicter le brouillon de la réponse, lentement, mais sans aucune reprise. Après chaque phrase, il s'arrête et me parle successivement des hommes et des choses de Tunis... Personne n'est oublié ; rien n'est oublié ; il est d'une étonnante mémoire et me rappelle des faits de 1882 dont j'avais moi-même perdu le souvenir.
Dans la dictée, rien ne trahit de la fatigue. Cette dictée, ainsi entremêlée de digressions, souvent fort longues, mais qui ne lui font nullement perdre le fil de la réponse, dure certainement plus d'une heure et demie.
Comme je me levais pour partir : « Mais il y a encore à écrire une autre lettre ; asseyez-vous, mon enfant.» Et, presque sans interruption, il me dicta une lettre énergique et lucide dans laquelle il annonçait son intention de venir bientôt en Tunisie, pour se mettre personnellement au courant de tout ce qui s'était passé, depuis son départ.
La lettre achevée, je laissai Son Eminence qui me bénit, en me donnant l'ordre de venir de bonne heure, le lendemain matin. »
Ce fut son dernier acte d'administration. Le même jour, il remit au Père Michel la somme de mille francs pour le comité organisateur du Congrès Eucharistique de Jérusalem. Comment ne pas rappeler ce geste généreux et sa dernière pensée, en cette année au Congrès Eucharistique International de Carthage qu'il a été le premier à préparer, par les travaux de ses fils, depuis 1875, et qu'il bénit du haut du ciel !
Le lendemain, après la sainte communion, faite au lit, et l'action de grâces, le Cardinal s'affaissait, au moment de mettre pied à terre : « Vous êtes venu pour en voir de belles ! » dit-il au Père Delattre. Quelques minutes après, il éprouvait les premiers symptômes de la crise qui le devait emporter, malgré les efforts de son inébranlable volonté pour dompter et vaincre les prodromes de l'attaque redoutée.
Dans la journée, le mal s'accentua rapidement et la parole devint très difficile. Le vendredi,25 novembre, il reçut en pleine connaissance, des mains du Père Michel, Supérieur du Scolasticat, le sacrement de l'Extrême-Onction. Le soir, à dix heures, il entrait en agonie et, le samedi 26, un peu après minuit, le grand apôtre africain rendait pieusement son âme à Dieu.
Nous ne vous parlerons pas des funérailles triomphales qui lui furent officiellement faites par le Gouvernement français, sur la demande de M. Cambon, Gouverneur Général de l'Algérie, le samedi 3 décembre, ni du discours éloquent par lequel Monseigneur Combes, évêque de Constantine, saluait avec émotion le grand cardinal dont la mort ne pouvait éteindre la gloire, «gloire de l'apostolat, de la sainteté, de la charité, de la sagesse que donne l'Esprit de Dieu, gloire de la noble fermeté qui se traduit par l'accomplissement austère de ce qu'il y a de plus sacré dans le devoir ; gloire des dévouements sans réserve aux intérêts de Dieu, de l'Eglise et de la Patrie ; gloire de la résurrection des peuples assis à l'ombre de la mort ; gloire des grands fondateurs ; gloire de l'affranchissement de l'humanité des horreurs des esclavages et de la païenne perversité».
Nous ne répéterons pas les émouvantes paroles par lesquelles le Gouverneur Général voulut lui dire adieu, au moment où toute la ville d'Alger, l'Armée, la Marine, la Magistrature, le Clergé et les évêques, entourant jusqu'au dernier moment sa dépouille mortelle, l'accompagnaient sur le croiseur de l'Etat, le Cosmao, qui devait la transporter à Tunis.
A son arrivée à la Goulette, nous nous empressâmes d'aller la saluer, vous devinez avec quelle émotion douloureuse, et de la suivre jusqu'à Tunis, avec les prélats venus d'Alger. Le mercredi, 7 décembre, la capitale de la Régence lui fit, à son tour, des obsèques officielles, et, le soir, le corps du Cardinal, notre bien-aimé Père, était porté dans le chœur de la cathédrale de Carthage où, le lendemain 8 décembre, après un office funèbre solennel, il fut déposé au fond du caveau que, de son vivant, il avait fait construite.
Son testament de 1885 nous rappelle les magnifiques paroles qu'il laissait tomber de la chaire d'Alger, dans son grand discours sur l'Afrique et sur l'Armée française, où il exprimait son espérance de voir l'Afrique redevenir chrétienne :
«Lorsque enfin ces vœux seront exaucés, ma cendre refroidie tressaillie au fond de sa tombe ; et, déjà perdu dans les clartés éternelles, j'entendrai, avec des transports nouveaux, les noms que je viens de vous redire et que je veux porter sans fin, gravés dans son cœur, l'Eglise, la France, la terre africaine : l'Eglise, dont je suis le ministre, la France, dont je suis le fils, l'Afrique, dont Dieu m'a fait le pasteur. »
Voici, en effet, comment il exprimait son amour pour l'église : «Ceci est mon testament spirituel. Je le commence en déclarant, en présence de l'éternité qui va s'ouvrir devant moi, que je veux mourir dans les sentiments où j'ai toujours vécu, à savoir : ceux d'une obéissance et d'un dévouement sans bornes au Saint-Siège apostolique et à Notre Saint Père le Pape, Vicaire de Jésus-Christ sur la terre.
«J'ai toujours cru, je crois ce qu'ils enseignent. J'ai toujours cru, je crois qu'en dehors du Pape ou contre le Pape, il n'y a et il ne peut y avoir, dans l'Eglise, que trouble, confusion, erreur et perte éternelle. Lui seul a été établi comme le fondement de l'unité et par conséquent de la vie, en tout ce qui tient au salut éternel.»
Paroles admirables, dignes d'être longuement méditées !
Après avoir exprimé, dans les termes que j'ai cités plus haut, son amour pour la France et son ardent désir de la voir devenir plus chrétienne, il donne sa dernière pensée à l'Afrique qui fut sa grande passion :
«C'est à toi que je viens maintenant, ma chère Afrique ! Je t'avais tout sacrifié, il y a dix-sept ans, lorsque, poussé par une force intérieure, qui était visiblement celle de Dieu, j'ai tout quitté pour me donner à ton service. Depuis, que de traverses, que de fatigues, que de peines !... Je ne les rappelle que pour pardonner et pour exprimer encore une fois mon indicible espérance de voir la portion de ce continent, qui a autrefois connu la religion chrétienne, revenir pleinement à la lumière, et celle qui est restée plongée dans la barbarie, sortir de ses ténèbres et de sa mort.
« C'est à cette œuvre que j'avais consacré ma vie. Mais qu'est-ce qu'une vie d'homme pour une semblable entreprise ? A peine ai-je pu ébaucher ce travail. Je n'ai été que la voix du désert appelant ceux qui doivent y tracer les routes à l'Evangile. Je meurs donc sans avoir pu faire autre chose pour toi que souffrir, et, par mes souffrances, te préparer des apôtres ! »
Nous avons voulu vous faire entendre encore sa voix, au moment où il se mettait en présence de la mort, car c'est à cette heure-là que l'homme, oubliant les vanités de la terre, exprime avec le plus de franchise ses intimes et dernières pensées.
Evêques, prêtres, fidèles, gardons-en un éternel souvenir.
Vous avez travaillé, vous avez souffert, ô grand et bien-aimé Cardinal ; et des apôtres plus nombreux sont venus qui ont l'ardent désir de continuer votre œuvre, de vivre et de mourir, à votre exemple, pour l'Afrique et pour la France, pour l'Eglise et pour Dieu.
N.D.L.R. — Nous devons à la haute bienveillance de S. Exc. Monseigneur Leynaud d'avoir pu mettre sous les yeux de nos lecteurs l'article qu'on vient de lire. Il est extrait d'un volume publié par l'Imprimerie Polyglotte de Maison-Carrée et intitulé Deux glorieux Centenaires.
Nul plus que Monseigneur Leynaud n'était qualifié pour retracer l'œuvre glorieuse du grand Cardinal et faire revivre sa noble figure, en l'éclairant de traits précis et de souvenirs personnels puisés au contact journalier de l'illustre Archevêque d'Alger.
|
|
Langella Antoine
Bonjour, N° 132 du 2 septembre 1934
journal satyrique bônois.
|
|
Gagne le grand prix Armor
sur Cycle Armor
On sait combien nous nous intéressons à tous les sports. Le cyclisme est un des plus complets qui soient surtout le cyclisme sur route qui demande à l'athlète des qualités complètes : entraînement, vigueur, ténacité, tactique, endurance, etc. Notre journal avait mis sa voiture à la disposition des organisateurs et ce fut un régal que de suivre cette course.
Le parcours, Bône-Philippeville et retour, compte 200 kilomètres et au départ se sont présentés 18 coureurs.
Le plus grand plaisir que nous avons éprouvé ce fut, dans la voiture pilote, de suivre Langella dans les 85 kilomètres où il dut lutter contre la malchance et les incidents, tout seul. Ses jambes, telles les bielles d'une admirable machine montaient et descendaient avec une régularité impressionnante. Le champion, il mérite ce titre, s'en allait d'une allure aisée en cette fin de course comme s'il se fut agit d'une promenade. Mieux, dans les derniers kilomètres, il força l'allure, ce qui nous montra qu'il était demeuré au-dessous de ses moyens. Nous avions enregistré au compteur de notre voiture un train soutenu de 40 à l'heure et vers la fin nous avons constaté du 45 et, de temps à autre, du 50 ou presque. Il ne faut pas que Langella Antoine demeure à Bône où il n'a plus de concurrents sérieux. Il faut que notre coureur bônois s'en aille en France. Nous serions bien surpris s'il n'y faisait pas parler de lui.
Voici les détails de la course
.
Malgré l'heure matinale de nombreux curieux stationnaient rue P. Dubourg où M. Longo du Y.C. B. après avoir fait l'appel des coureurs donnait à 4 heures 20 le signal de l'envolée.
La course offrit un spectacle assez captivant. Elle peut se résumer ainsi ; De Bône à Philippeville, train au ralenti avec un petit intermède dans la fameuse côte de Bissy où les Langella, Rabah, Tabet, Cucu, Piacentino montrèrent leurs qualités d'excellents grimpeurs.
De Philippeville à Bône : chasse éperdue derrière Langella Antoine qui s'échappe dans Bissy, prend 800 mètres sur ses suivants immédiats, est victime d'une crevaison à la sortie de Jemmapes fait une chute après Aïn-Mokra et parvient au but avec plus de 6 minutes d'avance sur le peloton qui le poursuit depuis 80 kilomètres.
Véritable match de poursuite, captivant au possible, qui donna, au jeune crack d'Armor, l'occasion d'affirmer une fois de plus sa classe indéniable.
Cependant Antoine Langella n'était pas au mieux de sa condition. Il y a huit jours courant dans l'épreuve Sétif – Kerrata - Sétif, il faisait une chute assez grave dans un virage et se blessait sérieusement. Les nombreuses plaies qu'il portait sur tout le corps ne l'empêchèrent pas de faire une excellente performance en terminant à un quart de roue du vainqueur l'Algérois Mano.
Incomplètement remis portant encore des traces apparentes de son accident,, il tint à participer au Grand Prix Armor pour lequel, il n'avait pu pourtant se préparer sérieusement. Pour toutes ces raisons, sa belle course mérite d'être souligné. Nous l'en félicitons chaleureusement.
La course
Sur la route bitumée qui nous éloigné de Bône la caravane tel un long serpent file à travers la plaine. Derrière les coureurs les voitures des officiels suivent de nombreux suiveurs et supporters. L'allure manque ne rapidité et quelques accidentés comme Rhali et Tabet qui cassent leur chaîne n'ont aucune peine à rejoindre.
Nous passons à Aïn-Mokra à 5 h. 20 soit 3, kilomètres dans t'heure. Le village est encore endormi. On note-une échappée de Mérad qui n'insiste pas devant la poursuite vite organisée. Bou-Maïza est traversé à 5 h. 47. Jemmapes 67 kilomètres est atteint à 6 h. 46 par le peloton au complet et qui est emmené par Langella. Lecuziat tombe dans la traversée de ce centre, où une foule nombreuse assiste au passage des coureurs.
Dans les premiers raidillons de Bissy Langella s'arrête pour arranger son dérailleur. Devant le peloton, Rabah suivi de Tabet poussent très fort et c'est la dislocation.
Langella, sans effort apparent, remonte tous les traînards et rejoint les 2 premiers au tiers de la côte.
A Bissy (sommet de la côte) passent derrière les 3 leaders Cuccu, Piacentino, Cordina, Mancuso, Colombo, Daoudi Tahar etc. tous échelonnés. Oliviéri ferme la marche. Daoudi Ali se fait remorquer par une automobile. Mais surpris il déclare abandonner.
A 4 kilomètres de Philippeville, neuf coureurs se regroupent et franchissent à temps le passage à niveau. L'arrivée à Philippeville a lieu à 7 heures 47, peu de curieux, Daoudi Tahar passe avec 2' 20" de retard, Faibli, Lachichi et Rabah avec 3' 20".
Nous rejoignons le groupe de tête dans Bissy où Amroun Rabah a déclenché une vive attaque tandis que Langella, Tabet, Colombo répondent bien, les autres sont de suite distancés.
Le vainqueur de l'épreuve continue l'effort et s'en va seul vers le sommet du col qu'il atteint avec près de 2 minutes d'avance sur Rabah, 3 minutes sur Colombo Et 4 sur Piacentino, Cordina, Mancuso, Dacudi, Cuccu.
Dans la descente, Langella augmente encore son avance, mais à la sortie de Jemmapes il voit un de ses pneus rendre l'âme. Va-t-il être rejoint ? Non, Rabah est encore à 400 mètres quand le fugitif se remet en selle.
A Auribeau, il a repris de l'avance. Derrière, la chasse s'organise et Mancuso revient très fort. Mais Piacentino, Daoudi et Cordina ne peuvent le seconder.
Cependant ce groupe rejoint Rabah après Bou Maïza, Cordina fatigué a perdu du terrain ainsi que Colombo qui abandonne. Rhali qui avait rejoint le peloton s'arrête pour changer sa roue avant. Derrière Langella on fait de sérieux efforts pour se rapprocher; à Aïn Mokra est trop fortement aspergé et tombe, ce qui lui fait perdre de précieuses minutes pour remettre son vélo en état mais il les reprendra avec une énergie peu commune.
A partir d'Oued Zied (17 Km de l'arrivée Langella active l'allure et prend encore du terrain à ses poursuivants.
Nous gagnons l'arrivée où une foule nombreuse attend les vaillants coureurs mais voici Langella que les spectateurs acclament frénétiquement pendant qu'il franchit l'arrivé en un sprint impressionnant.
Résultats techniques
1er Langella Antoine V.C.B. les 200 km en 6 h 32 minutes - 2ème Announ Rabah S.M.B. - 3ème Mancuso V.S. B. – 4ème Daoudi Tahar S.M. B.. – 5ème Piacentino V.C.B. - tous en 6 heures 38 Minutes 20 secondes - 6ème Rhali S.M.B. en 6 h 39 minutes 40 secondes – 7ème Cordina V.S.B. même temps - 8ème Lachichi en 6 heures 55 minutes – 9ème Tabbi en 7 heures 10 minutes – 10ème Hamen
Amar en 7 heures 15 minutes.
Ont abandonné Lecusiat bris de pédales, Daoudi Ali chute, Tabet bris de chaînes, Olivieri, Bonali, Cuccu, Colombo et Mérard.
Nous avons le plaisir de remarquer parmi l'assistance la présence de M. Delage Sous-Préfet qui ne manque aucune occasion de manifester tout l'intérêt qu'il porte aux sports ainsi que M. Baldetti donateur de l'épreuve, Antonietti, Falzon, Ginestar, Longo, Bétro, Carbonara, Locastro, Favier du Vélo Club Bônois.
L'organisation impeccable et le contrôle parfait sont tout à fait à l’honneur des dirigeants du Vélo Club Bônois que nous félicitons bien sincèrement ; merci aussi à M. Raoul Baldetti agent des Cycles « Armor » pour avoir offert une épreuve aussi belle et aussi magnifiquement dotée.
Pierre MARODON.
| |
ALGER ETUDIANT
N°26, 29 mars 1924 Source Gallica
|
| LA VISITE A LA
ZAOUÏA D’EL-H'AMEL
Nous venions de quitter la route de Djelfa — L'auto roulait maintenant sur l'étroite piste qui de là conduit à la zaouïa. Dans leur nudité affreuse d'argile et dé pierre, les montagnes éblouissaient au soleil pourtant voilé... puis ce fut la vallée desséchée de l'oued, les touffes des lauriers roses non encore fleuris, enfin l'étonnement des étroits vergers, perdus dans ce prélude du désert — neiges des amandiers et touffes rosées des pêchers en fleurs. Alors au pied de la montagne violette, érodée par le vent, la zaouïa parut, toute blanche, couronnant le village couleur de terre...
Nous descendîmes de l'autobus. La pente devenait par trop déclive. Après avoir traversé le lit presque sans eau de l'oued nous commençâmes notre ascension. Une autre voiture, plus légère, nous précédait. Nous distinguions maintenant plus nettement la foule massée sur l'étroite terrasse précédant le bordj du cheikh. Inattendus, des cavaliers entourèrent l'auto, pétaradant autour d'elle de leurs fusils, tandis que les femmes hululèrent en signe de joie, alors ce fut pour nous la course pour gravir la colline glaiseuse afin de ne rien perdre de cette réception impromptue dans la très célèbre, très vénérée zaouïa d'El-Hamel, de la très sainte confrérie des Rah'-Mania.
Comme il est étrange ce sanctuaire, couvent et séminaire, centre de pèlerinage, perdu dans une vallée aux limites du désert, dans les lieux où déjà la vie ne vient plus. Quel enchaînement de circonstances l'ont fait s'établir ici ? Tout ce qui touche à la vie y semble factice et peut-être que dans ces lieux appauvris, la Prière vers un Dieu est-elle plus élevée et plus touchante... Sur l'étroite petite place entre le Marabout, éblouissant sous sa parure de chaux et le bordj du cheikh rougeoyant de ses murs d'argile, toute la population s'est massée; manteau rouge du caïd, burnous blanc du saint, c'est le même contraste entre les Hommes qu'entre les Pierres, entre la Vie séculière et la Vie méditative... Une vieille aveugle, les yeux morts pourtant rehaussés de khôl, trépigne Une danse ahurissante au son nasillard des raïtas et des tambourins; les étendards sacrés flottent au vent qui emporte les cris des femmes au loin dans la vallée... !
Ils seraient amusants les petits croquis d'album que l'on pourrait tracer d'ici. D'abord tous les oripeaux bariolés de cette foule de mendiants qui sont venus chercher la paix contemplative et presque la sécurité matérielle, à l'ombre du Marabout.
L'une des étroites salles basses, où juché, sur son estrade, un taleb enseigné; la feuille à la main, les. sept prononciations sacrées du Coran, et le Dzikr (1) aux novices ; Il a une étrange figure énigmatique ; avec dès yeux lointains et ses lèvres murmurent une insaisissable, prière.
— La cuisine — antre à peine éclairée, par une cheminée étroite — et sur des pierres, grises des cendres d’un foyer où s'endorment les braises, les immenses jarres de cuivre — décor de quelque conte inédit, de la Mille et deuxième nuit où Ali Baba, revenu, aurait rassemblé ses jarres dans l'officine secrète de ce couvent...
— Et pour terminer, le café servi par l'actuel Marabout Sid Belkacem dans la grande salle de son bordj. Oh! ce n'est sans doute pas la plus pittoresque des visions que nous a réservé cet après-midi étouffante. Mais l'accueil de cet homme saint, est si affable, si bienveillant et inattendu dans le lieu qu'on ne put s'empêcher d'en être ému... Il a fait pour répondre aux paroles de remerciements prononcées, un discours très rapidement débité avec des balancements de tête. L'interprète le traduit.
Il y a des paroles que l'on est surpris d'entendre. « Le lumineux flambeau de la civilisation française » n'est pas un vain mot pour les lèvres de celui dont l'aïeul refusa, en 1871, lors « de la levée des boucliers des Rah' maniyya » de se joindre aux insurgés (2). Et quand il invoque, sur la tête de ses visiteurs, la baraka qu'il détient de Lella Zineb, qui fut avant lui, celle qui assuma la direction spirituelle de la zaouïa, on ne peut s'empêcher de croire, qu'un rayon de la Bonté céleste est resté dans ses mains dispensatrices sur la terre de tant de bontés !
Les derniers cahots de la piste.... et nous revoilà sur la route de Djelfa, vers le Nord, tandis qu'au loin, la très Sainte, très Vénérée zaouïa d'El-Hamel, disparaît dans la poussière blonde de ce coin d'Islam.
El Hamel, 17 mars 1924.
Jean MAZARD.
(1) Litanie spéciale à chaque confrérie (cf. Morand, introduction à l'étude du droit musulman, p. 185).
(2) G. Doutté, L'Islam algérien en 1900, page 91.
|
|
LA « CONQUÊTE DE L’EST ALGERIEN »
ACEP-ENSEMBLE N° 291
|
|
PAR UNE FAMILLE DE COLONS
Une énigme ?
II est curieux de constater sur une carte de l'Algérie l’irrésistible progression vers l'Est des descendants de la famille J.P.
A l'inverse des pionniers du Far West, cette branche des Perrier a bâti sa fortune en « émigrant » toujours plus vers I'Est. Partant de la région de Sétif (où sont attribués les premiers lots de Colonisation en 1,574), les dernières propriétés sont achetées (entre 1910 et 1940), aux alentours de Constantine, Soit une «translation », en plusieurs étapes, d'environ 150 kilomètres. Rien à voir, bien sûr, avec l'ampleur des déplacements dans les Grandes Plaines américaines !
Mais cent ans plus tard, on peut se demander pourquoi nos grands-parents ne sont-ils pas restés « sagement » sur place, pourquoi ont-ils été tentés – ou obligés - de quitter leur « point de chute» initial ?
Il y a certainement plusieurs explications à cet épiphénomène. Est-il le fruit du hasard ? Constitue-t-il une exception ?
L’attribution des lots de colonisation, un peu d'histoire
Extraits du Décret du 15 juillet 1874.
Art. 2. - Le Gouverneur général est autorisé à consentir, sous promesse de propriété définitive, des locations de terres domaniales, d'une durée de cinq années, en faveur de tous Français d'origine européenne ou naturalisés qui justifieront de la possession de ressources suffisantes pour vivre pendant une année.
Art. 3. - La location est faite à condition de résidence personnelle sur la terre louée pendant toute la durée du bail.
Art. 4. - Le locataire paiera annuellement et d'avance, à la caisse du receveur de la situation des biens, la somme de 1 franc, quelle que soit l'étendue de son lot.
Art. 5. - La contenance de chaque lot est proportionnée à la composition de la famille, à raison de 10 hectares au plus et de 3 hectares au moins, par tête (hommes, femmes, enfants, - les gens à gages ne comptant pas). Les célibataires pourront être admis aux concessions ; ils ne jouiront sur leur lot que d'une superficie maximum de 10 hectares.. Le complément leur sera remis après seulement qu'ils auront contracté mariage...
L'étendue d'une concession ne pourra être moindre de 20 hectares ni excéder 50 hectares, si I'attribution est comprise sur le territoire d'un centre de population ; elle pourra atteindre 100 hectares, s'il s'agit de lots de fermes isolées.
Art. 6. - A l'expiration de la cinquième année, le bail sera converti en titre définitif de propriété, sous la simple réserve de ne point vendre pendant une nouvelle période de cinq ans à tous indigènes non naturalisés ...
Extraits des conditions et formalités à remplir pour obtenir une concession ...
Les concessions sont attribuées de préférence aux cultivateurs, chefs de famille et possédant un avoir d'au moins 5000 francs.
Le capital est indispensable pour pouvoir construire une maison et des bâtiments d'exploitation, acheter un cheptel et des semences et vivre en attendant les premières récoltes.
Les familles attributaires reçoivent un acte provisoire de concession. Ce titre donne droit :
1. En chemin de fer. - Au transport à demi tarif en 3e classe pour les membres de la famille indiqués sur le titre, et au transport gratuit de 100 kg de bagages par personne.
2. Sur les paquebots du service postal partant de Port-Vendres ou Marseille. Au transport gratuit en 3e classe des personnes de la famille indiquées sur ce titre, et au transport gratuit de 80 kg de bagages par personne.
Les étapes de la progression
1874 : J.P émigré en Algérie le 25 décembre 1874, avec sa mère, ses 2 sœurs et son frère M. Il a obtenu un lot de colonisation de 51 hectares environ à Ouled Nabet, près d'Ain Abessa (à 20 km au nord de Sétif).
1882 : titre définitif de propriété délivré le 4 août 1882.
1883 : confirmation du titre de propriété du lot d'agrandissement n° 97 de 18 hectares 90, que Joseph avait obtenu sur le territoire d'Aïn Abd el Beg (et où il a édifié sa maison).
1891 : achat d'une propriété à Tacherin, à 20 km d'Ain Abd el Beg, devenu plus tard Mac Donald (à 20 km à l'est de Sétif, l. décède le 17 janvier 1891, Marie sa veuve épouse en secondes noces PG, garde champêtre domicilié à Ain Abd el Beg. La propriété de Tacherin sera exploitée par les 2 frères P et E, orphelins à 7 et 6 ans. MMjp aura avec P un troisième enfant : F G.
1908 : première progression vers l'est, avec l'achat de 3 lots de colonisation à Berteaux de 280 hectares. E débute seul dans cette nouvelle propriété ; il construit une maison de bois, puis commence la construction d'une maison de pierres, qu'il ne cessera d'agrandir. La propriété, vendue en 1940, atteindra une superficie totale de 600 hectares.
1911: vente des propriétés de Mac Donald et de Tacherin. Deuxième progression, avec l'achat d'une propriété, à Ouled Rahmoun, au sud de Constantine (618 hectares). P. P l'exploitera, puis son fils R.
1927 : achat de la ferme Khanéba, à 3 km d'El Aria (village situé à 20 km à l'est de Constantine), d'une superficie de 1307 hectares. Avec l'acquisition ultérieure des fermes B et C. El Aria marque la limite extrême de la progression vers I'est. La propriété de Khanéba sera exploitée par FG, puis par P. Elle a été incendiée par les fellaghas pendant les " événements ».
1926 : partage des propriétés P / G : F, G obtient Khanéba (son père P est décédé le 11 mai 1925), P. et E restent en association, et héritent de Berteaux et Ouled Rahmoun.
1927 : Emile achète la ferme B, à 4 km du village d'EI Aria, d'une superficie de 1012 hectares. Cette propriété est exploitée par son fils, puis par son petit-fils en 1956.
1937 : E achète la ferme C, dont les bâtiments d'exploitation sont situés dans le village même d'EI Aria. D'une superficie de 257 hectares, cette propriété est exploitée par son fils L.
1940 : vente de Berteaux, E. P se retire à Constantine, il continue de gérer la ferme d'Ain Lehma, Près de Berteaux Cette propriété, appartenant à la famille J. était exploitée par son gendre décédé le 25 février 1938. Son petit-fils E. l'exploitera à son tour en 1955.
Les raisons de la marche vers l’Est
La lecture des conditions d'attribution des lots de colonisation laisse entrevoir une évidence, la superficie allouée par l'administration à chaque famille, entre 30 et 50 hectares en moyenne, ne permet pas des revenus suffisants. Les premières années sont toujours difficiles tout est à acheter : matériel, semences, il faut construire sa maison, les bâtiments d'exploitation, et vivre en attendant la première récolte (si récolte il y a, car il faut compter avec les faibles rendements à l'hectare, la sécheresse, les sauterelles, et autres calamités agricoles ... !). Pour ceux qui ont pu surmonter ces premières difficultés, la nécessité de s'agrandir s'est vite imposée. C'est la condition de la survie ! Cette fuite en avant dans l'acquisition de terres disponibles provoque certainement leur rareté, et s'accompagne inévitablement de leur renchérissement, (ces terres disponibles sont bien sûr celles des familles qui n'ont pu passer le cap des premières années).
Quand toutes les possibilités d'agrandissement « sur place » sont épuisées (plus rien n'est à vendre ou à des prix qui ne se justifient plus !). il reste l'achat de terres éloignées dans des régions où leur prix reste abordable.
Pourquoi l'Est ? : il faut supposer que les régions situées à l'est de Sétif, et aux alentours de Constantine sont moins densément peuplées, il y reste encore des terres « vierges » ou disponibles la « colonisation » y a été plus tardive, ou moins importante ?).
C'est un fait que les propriétés achetées dans ces régions sont plus grandes, et même de plus en plus grandes avec le temps. l'effet boule de neige aidant. Et les friches ou parcours représentent souvent près de la moitié de leur superficie totale.
Enfin, le goût de I'entreprise et la volonté permanente des descendants de JP d'agrandir leur Patrimoine, les poussent à investir sans cesse dans la terre et le matériel. Ne se contentant pas de I'acquis, ils achètent le plus souvent à crédit, vérifiant l'adage « qui paye ses dettes s'enrichit » ...
Et pour répondre aux deux interrogations posées en Préambule : Plutôt que le hasard, c'est plus la nécessité et le réalisme qui ont motivé cette marche vers l'Est (qui a failli être le grand Ouest, puisque le Maroc a été un moment envisagé). Quant à l'exception, elle reste vraie dans la famille, les descendants de JP étant les seuls à n'être pas restés sur leurs lots de colonisation, attribués par l'administration en 1874.
|
|
Petites devinnettes
Envoyé Par Eliane
|
Deux canards qui se disputent
Si deux canards se disputent, qu'est-ce que ça donne ?
Un conflit de canards !
Moutons
Pourquoi les moutons aiment-ils le chewing-gum ?
C’est bon pour la laine.
Serrurier
Quel est le comble pour un serrurier ?
C'est d'être mis à la porte.
Footballeur
Que demande un footballeur à son coiffeur ?
La coupe du monde s’il vous plaît.
Menuisier
Quel est le comble pour un menuisier ?
C'est d'être payé avec un chèque en bois.
Journaliste
Quel est le comble du journaliste ?
Être à l'article de sa mort.
J'ai fait une blague sur Carrefour, mais elle n'a pas supermarché
|
|
|
PHOTOS BÔNE
Envois divers
|
|
Rivet et son sanatorium
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°180 Décembre 2009
|
Dès 1845, le comte Guyot, pour réaliser son programme de colonisation de la bordure de I'Atlas, avait projeté de créer ce centre entre le Fondouk et L'Arba, au lieu dit le Maraboutine, non loin de I'Haouch Khadra. Mais I'insuffisance de crédits pour I'acquisition des terres nécessaires à la constitution de son territoire retarda de onze ans sa naissance. On lui donna le nom de Rivet en I'honneur du Général mort à Sébastopol.
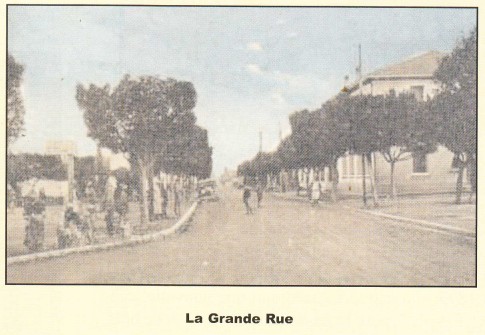 Ce village destiné à quarante-trois familles comprenait un territoire de cinq cent quatre-vingt-dix hectares formés de terres fertiles et égayés par quelques belles plantations d'orangers. Les lots de jardin étaient irrigables. Les nouveaux colons furent choisis surtout parmi les Mahonnais et ne comptèrent que quelques familles françaises installées depuis un certain temps en Algérie : Camps, Coll, Gomila, Sintes, Moll, Pons, Lapalud, Piris etc. Ce village destiné à quarante-trois familles comprenait un territoire de cinq cent quatre-vingt-dix hectares formés de terres fertiles et égayés par quelques belles plantations d'orangers. Les lots de jardin étaient irrigables. Les nouveaux colons furent choisis surtout parmi les Mahonnais et ne comptèrent que quelques familles françaises installées depuis un certain temps en Algérie : Camps, Coll, Gomila, Sintes, Moll, Pons, Lapalud, Piris etc.
À la fin de 1856, Rivet était peuplé de cinquante habitants, douze maisons étaient déjà construites (les quatre premières constructions de maisons reçurent une prime : Pretus Michel deux cents francs, Camps Jean cent cinquante francs, Piris Mathilde soixante-quinze francs, Trouilloux Antoine soixante-quinze francs) et cinq en construction, quatre-vingt sept hectares étaient ensemencés. Pour assurer son alimentation en eau, I'Administration capta la source d'Aïn-Amara et fit une dérivation de I'Oued Bakalem.
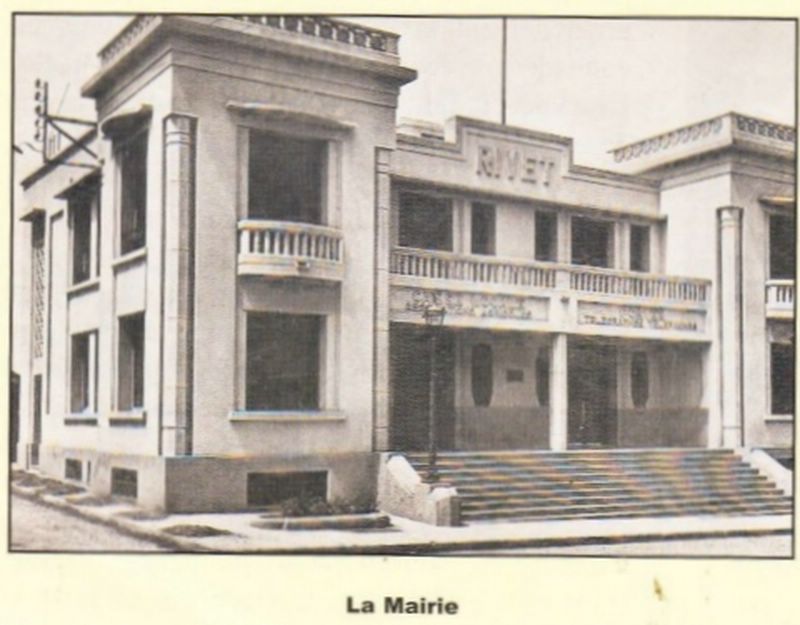 L'année suivante, presque toutes les maisons du village étaient construites, cent trois hectares étaient cultivés et, à la fin de 1859, la population s'élevait à cent quatre-vingts personnes et trois cents hectares étaient en culture. L'année suivante, presque toutes les maisons du village étaient construites, cent trois hectares étaient cultivés et, à la fin de 1859, la population s'élevait à cent quatre-vingts personnes et trois cents hectares étaient en culture.
La construction d'une route qui devait venir rejoindre celle de L'Arba à Maison-Carrée et mettre ainsi Rivet en communication directe avec Alger, allait contribuer encore au développement de ce centre.
Par décret du 23 mars 1880, le village a été érigé en commune de plein exercice d'une superficie de sept mille cent quarante cinq hectares.
La vie du village
D'une superficie de 6.845 hectares, Rivet était situé à 95 mètres d'altitude au pied des montagnes de I'Atlas et du djebel Bot-Zegza, température minimale : 30° au-dessous de zéro, avec un maximum à 32°.
Le village était desservi par la gare de I'oued Smar à 10 kilomètres au nord. Courriers hippomobiles (corricolos) d'Alger à Rivet par Maison-Carrée.
Bonne eau d'alimentation. Marché hebdomadaire du dimanche. Le douar Arbatache. était rattaché à la commune.
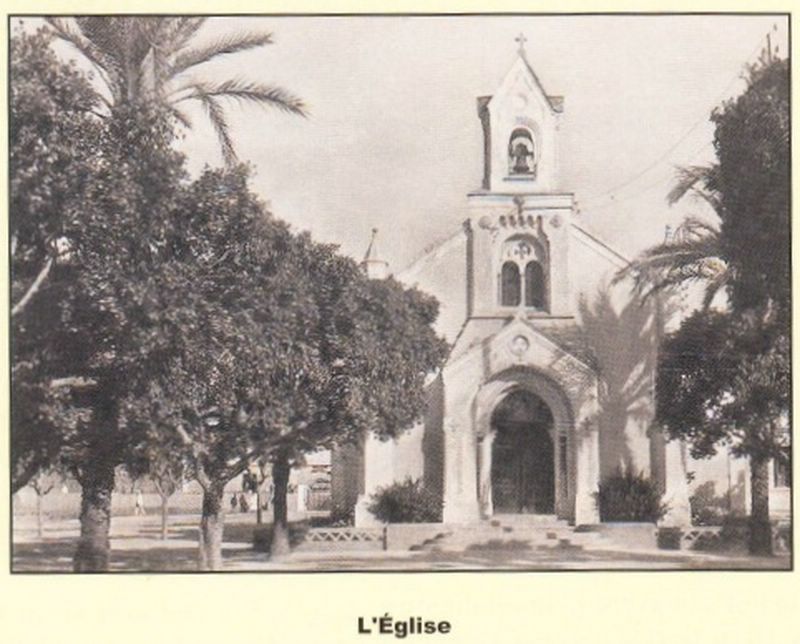 Un vignoble de 129 hectares, composé de cépages Carignan, Cinsaut, Alicante, Bouschet, donne un bon vin de coteaux. Un vignoble de 129 hectares, composé de cépages Carignan, Cinsaut, Alicante, Bouschet, donne un bon vin de coteaux.
Dans les années trente, Guy MOLL petit-fils de Guillaume (un des fondateurs du village), était à la course automobile française ce que sont aujourd'hui toutes proportions gardées, des pilotes comme Alain Prost, Jean Alési, ... Il y décèdera accidentellement lors d'une de ces courses. Cela sera un véritable drame local.
En 1955, Rivet avait une population de 12.370 habitants.
La plaine de Rivet était renommée pour ses cultures de tabac, pommes de terre, et ses vergers d'agrumes, orangers, mandariniers, clémentiniers. Terres très fertiles, céréales, blé dur, blé tendre, maïs.
À 513 mètres d'altitude, au flanc du djebel Zeroulez, le sanatorium, inauguré en 1940 sur un terrain, offert par M. Alexandre VANONI, était visible de la plaine
Le sanatorium
La question des sanatoriums antituberculeux nord-africains font, dès la fin de la Grande Guerre, couler beaucoup d'encre tant dans les journaux médicaux que d'Anciens Combattants, très actifs à cette époque.
Dès 1932, le Docteur Laquière lance dans le journal "La tranchée" un cri d'alarme, fustigeant I'implantation de l'Ecole Normale d'Instituteurs à la Bouzaréah et demandant que soit créé sur cet emplacement le premier sana d'Algérie, insistant sur le fait que les malades n'ont souvent pas les moyens d'entreprendre un voyage en France, coûteux certes et qui les éloigne de leur famille pendant de longs mois.
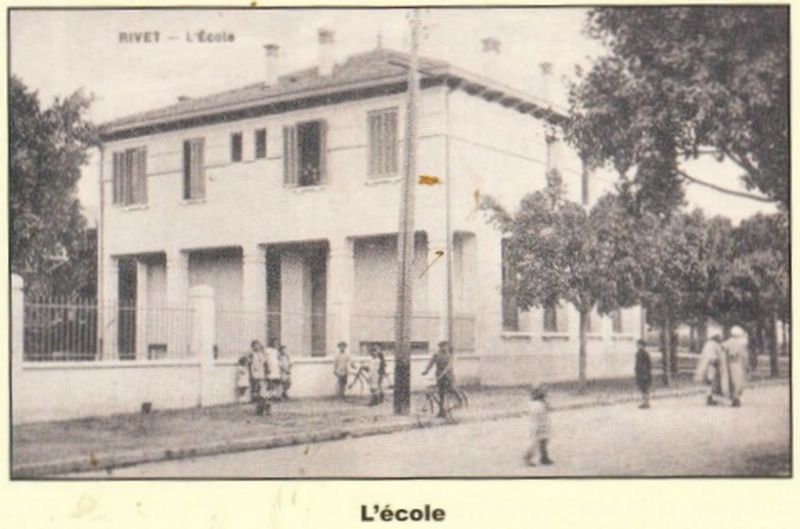 "L'Afrique du Nord Illustrée" publie par la suite l'article du Professeur Georges Aubry expliquant la cause principale de ce fléau qui fait d'inquiétants progrès. "L'Afrique du Nord Illustrée" publie par la suite l'article du Professeur Georges Aubry expliquant la cause principale de ce fléau qui fait d'inquiétants progrès.
Les populations rurales sont durement touchées. Le facteur principal en est l'exode des travailleurs indigènes et particulièrement kabyles vers les centres industriels de la Métropole. Entassés dans des taudis, mal nourris, minés par I'alcoolisme, ces sujets neufs fournissent à la tuberculose un terrain favorable où I'infection se développe sous des formes envahissantes et hautement contagieuses. Le retour de ces malades au foyer primitif dans des villages dépourvus d'hygiène est désastreux. À cette cause principale s'en ajoutent bien d'autres facilités de déplacements donc multiplication des occasions de contagion.
Bref, dans tous les milieux, la tuberculose' se Propage. Cette extension n'est pas particulière à l'Algérie elle est seulement plus manifeste.
En France, la loi Bourgeois sur les dispensaires et la loi Honnorat sur les Sanatoriums ont organisé I'armement antituberculeux et en ont rendu le développement obligatoire. L'Algérie, bien plus menacée peut-être est restée en arrière. pour donner une idée de I'importance du fléau, on compte pour Alger seulement, 800 à 900 décès par an, ce qui permet d'évaluer pour I'agglomération algéroise entre 8.000 et 9.000 le nombre de malades.
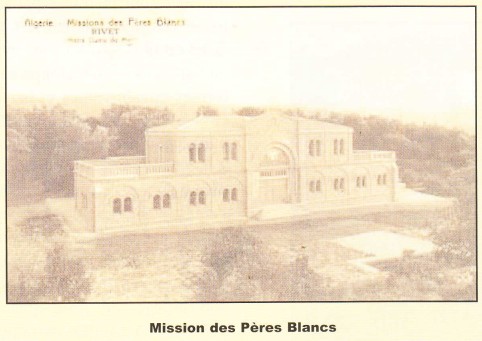 Or I'armement antituberculeux est inexistant. Pourquoi ? La première raison et la plus tristement valable est que I'effort financier à envisager est considérable. Le prétexte avancé par tous ceux qui veulent écarter ou seulement ajourner I'importante question de l'organisation de la lutte contre la tuberculose est qu' on ne peut pas la traiter en Algérie. Or I'armement antituberculeux est inexistant. Pourquoi ? La première raison et la plus tristement valable est que I'effort financier à envisager est considérable. Le prétexte avancé par tous ceux qui veulent écarter ou seulement ajourner I'importante question de l'organisation de la lutte contre la tuberculose est qu' on ne peut pas la traiter en Algérie.
C'est pour étudier à fond la question que se crée après la Grande Guerre "L'Association ALGERIENNE CONTRE LA TUBERCULOSE" qui compte immédiatement parmi ses animateurs des représentants de la Faculté, des Hôpitaux, des philanthropes éclairés. Se tenant sur un terrain essentiellement pratique.
L'Association soutient, dès ce moment, qu'un grand nombre de tuberculeux peuvent guérir en étant soignés en Algérie. Des études techniques sont réalisées dont le résultat est positif. "L'ASSOCIATION ALGERIE,NNE CONTRE LA TUBERCULOSE," entre alors dans la voie des réalisations. Pour y parvenir, elle fonde avec " L'INTER-FEDERATION DES VICTIMES DE LA GUERRE " dont le Président est M. Eugène-Lucien CANNEBOTIN une ASSOCIATION des SANATORIUMS d'ALGERIE dont le siège est 1 Bd de France à ALGER.
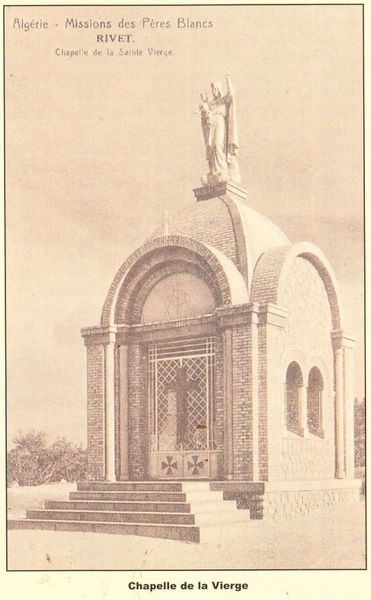 L'établissement sera un hôpital sanatorium. organisme infiniment plus large, ce que le Professeur LEBON appellerait un hôpital auxiliaire spécialisé. Dans cette formation, une moitié des lits sera réservée aux tuberculeux de guerre, ainsi qu'aux veuves de guerre et aux pupilles de la Nation. Le choix du site, effectué par une commission technique se porte sur la forêt de St-Ferdinand. Un avant-plan est dressé et en 1930 le Gouverneur Général Bordes pose la première pierre de l'établissement. Mais I'Association ne possède pas à cette époque I'argent nécessaire à la construction. L'établissement sera un hôpital sanatorium. organisme infiniment plus large, ce que le Professeur LEBON appellerait un hôpital auxiliaire spécialisé. Dans cette formation, une moitié des lits sera réservée aux tuberculeux de guerre, ainsi qu'aux veuves de guerre et aux pupilles de la Nation. Le choix du site, effectué par une commission technique se porte sur la forêt de St-Ferdinand. Un avant-plan est dressé et en 1930 le Gouverneur Général Bordes pose la première pierre de l'établissement. Mais I'Association ne possède pas à cette époque I'argent nécessaire à la construction.
Enfin, les Délégations Financières votent un crédit de 1.000.000 de francs alors que I'Office National des Mutilés, sur intervention de M. CANNEBOTIN, vote un crédit de 4.000.000 de francs. De généreux donateurs réunissent la somme de 1.300.000 francs. On est donc en mesure de commencer l'édification d'un premier établissement prévu pour 160 lits environ. Le Futur SANATORIUM DE RIVET se trouvera donc situé dans le DJEBEL ZEROULEZ à 450 mètres d'altitude, en bordure de la MITIDJA au-dessus du village de Rivet.
Desservi par une bonne route à 32 km d'Alger, par conséquent d'accès et de ravitaillement faciles. La vue est magnifique et la faible altitude des hauteurs voisines lui évite condensations et brumes. La distance qui le sépare de la mer lui évite le voisinage maritime immédiat tout en lui permettant de bénéficier en été des brises rafraîchissantes d'est-nord et d'éviter le sirocco.
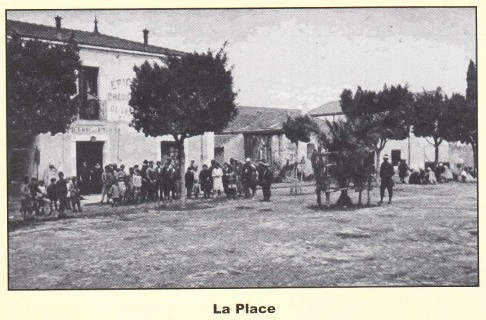 Monsieur Bienvenu, architecte diplômé est choisi par le Gouverneur Général pour réaliser les travaux, et il présente tout d'abord une maquette. Le bâtiment central se prolonge de chaque côté par deux ailes en alignement rectiligne. Il comporte 180 lits, 100 pour les hommes dans I'aile ouest, 80 pour les femmes dans I'aile est. La séparation entre les sexes étant réalisée par la partie médiane réservée aux services généraux. Dans chaque aile sont disposées les chambres des malades avec leur galerie de cure orientée au sud. Monsieur Bienvenu, architecte diplômé est choisi par le Gouverneur Général pour réaliser les travaux, et il présente tout d'abord une maquette. Le bâtiment central se prolonge de chaque côté par deux ailes en alignement rectiligne. Il comporte 180 lits, 100 pour les hommes dans I'aile ouest, 80 pour les femmes dans I'aile est. La séparation entre les sexes étant réalisée par la partie médiane réservée aux services généraux. Dans chaque aile sont disposées les chambres des malades avec leur galerie de cure orientée au sud.
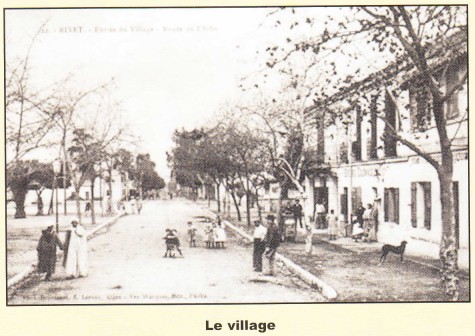 Toutes les chambres sont dotées du confort moderne, elles comportent 3 lits (80%) 2lits ou 1 lit. Les lavabos s'intercalent entre les chambres. Ces chambres ouvrent directement sur la galerie de cure par des portes pivotantes qui font de cette galerie un prolongement de la chambre. Toutes les chambres sont dotées du confort moderne, elles comportent 3 lits (80%) 2lits ou 1 lit. Les lavabos s'intercalent entre les chambres. Ces chambres ouvrent directement sur la galerie de cure par des portes pivotantes qui font de cette galerie un prolongement de la chambre.
Pour éviter I'ensoleillement excessif, I'architecte a étudié un dispositif d'écrans permanents qui entre automatiquement en jeu selon la saison et la hauteur du soleil. Toutefois, une galerie ouverte au nord peut être utilisée pendant les journées les plus chaudes. Les chambres avec leurs galeries forment 2 étages et demi du côté des hommes et 2 étages du côté des femmes, à cause de la déclivité du terrain. La partie médiane comporte les salles communes salles à manger séparées, salles de réunions...
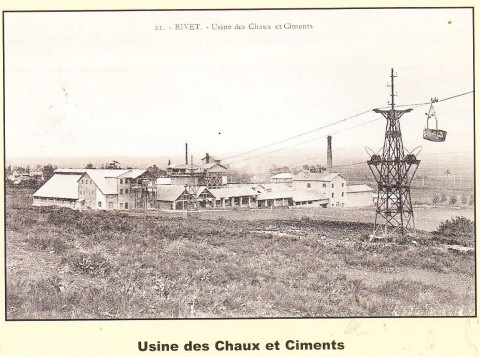 Les services généraux sont au-dessous : consultations, radiographie, pharmacie dans les sous-sols sont les cuisines, chauffage, buanderie, ateliers... Tout est prévu au mieux et la construction, réglée par un cahier des charges minutieux, durera environ 2 ans et reviendra à 7.000.000 de francs. Une somme de 500.000 francs est réservée pour la première année de fonctionnement. De nouveaux donateurs s'ajoutent aux précédents et le SYNDICAT PROFESSIONNEL des JOURNALISTES fait un don de 2.000.000 de francs. Les services généraux sont au-dessous : consultations, radiographie, pharmacie dans les sous-sols sont les cuisines, chauffage, buanderie, ateliers... Tout est prévu au mieux et la construction, réglée par un cahier des charges minutieux, durera environ 2 ans et reviendra à 7.000.000 de francs. Une somme de 500.000 francs est réservée pour la première année de fonctionnement. De nouveaux donateurs s'ajoutent aux précédents et le SYNDICAT PROFESSIONNEL des JOURNALISTES fait un don de 2.000.000 de francs.
Le Conseil d'Administration du SANATORIUM de RIVET Enfin terminé avant la guerre de 39-45, se compose ainsi : Président : Professeur Georges AUBRY de la Faculté de Médecine d'Alger, Officier de la Légion d'Honneur Vice-Président : Mme Tramoy de l'Aubepie, d'A1ger, Propriétaire, Chevalier de la Légion d'Honneur - Docteur Larmande de Bougie, Chevalier de la Légion d'Honneur - M. Laforest de Constantine Contrôleur de la Propriété indigène Secrétaire Général : M. Cannebotin, d'Alger, propriétaire, Officier de la Légion d'Honneur Trésorier Général : M. Lebhar Administrateur de la Banque d'Algérie, Chevalier de la Légion d'Honneur Administrateurs : Professeur Lebon, Professeur Benhamou, Docteur Lemaire, M. Jean Germain, Docteur Argenson, Docteur Biscos. Docteur Levi-Valensi, M. Hatinguais.
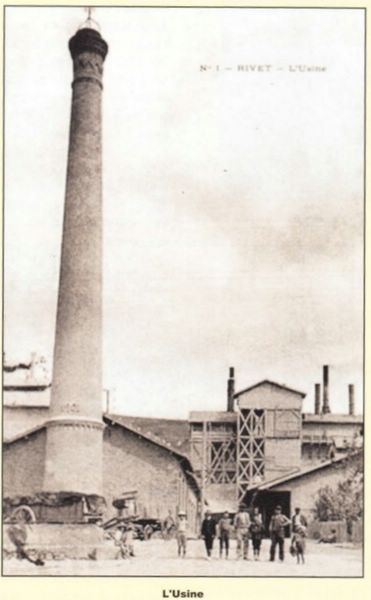 En 1940, l'édifice est inauguré par le Gouverneur Général Lebeau en présence du Maire de Rivet, M. Vanoni, d'un rePrésentant de la Préfecture et du Conseil d'Administration, mais la guerre ne permet pas de donner à la cérémonie tout l'éclat qu'auraient mérité tant d'efforts et de détermination. En 1940, l'édifice est inauguré par le Gouverneur Général Lebeau en présence du Maire de Rivet, M. Vanoni, d'un rePrésentant de la Préfecture et du Conseil d'Administration, mais la guerre ne permet pas de donner à la cérémonie tout l'éclat qu'auraient mérité tant d'efforts et de détermination.
Jusqu'en 1962, le Sanatorium de Rivet n'a cessé de fonctionner et ses installations de subir de nombreuses améliorations. Soulignons à nouveau qu'il était en grande partie destiné aux populations indigènes et qu'avec la découverte de nouvelles thérapies la tuberculose était en très nette régression sinon en voie d'éradication.
Qu'en est-il aujourd'hui ? Renseignements pris auprès du corps médical, cette terrible maladie fait à nouveau de nombreux ravages de même que le trachome. Paupérisation, sous-alimentation, manque de Personnel qualifié, manque d'entretien pour les bâtiments et le matériel médical. Les jeunes médecins algériens venus faire leurs études en Europe s'installent ailleurs, ne rejoignant pas l'Algérie. D'autre part on se rend compte qu'en France également il y a recrudescence de la maladie, du fait du nombre croissant de travailleurs immigrés.
Enfin si le Sanatorium existe toujours, il se trouve maintenant dans la commune de Meftah (Rivet) et dépend du Ministère des Affaires Sociales et du Ministère de la Santé.
Cette remise en mémoire de ce village et des hommes et femmes des plus humbles aux notables qui le créèrent n'a pour but que de leur rendre hommage afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli ce qui serait leur deuxième mort.
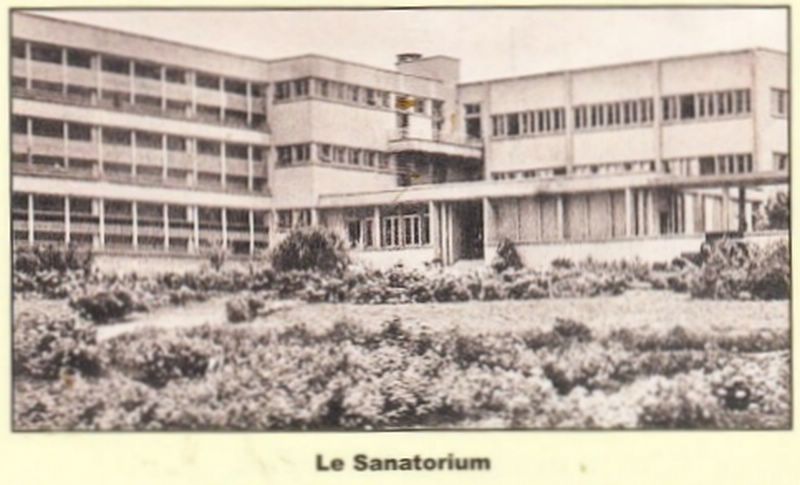 Nelly Moniet-Cannebotin
Nelly Moniet-Cannebotin
|
|
MINISTERE de l’ALGERIE 1957
Envoyé Par M. C. Fretat, pages de 149 à 160 et 1 à 19 (2ème partie)
|
PROPAGANDE DU FLN ET MNA
A L’ETRANGER
PROPAGANDE F.L.N.
La doctrine :
Les objectifs.
Les moyens.
Les méthodes :
Les délégués itinérants.
Les délégués permanents.
Les auxiliaires de la propagande :
Organisations pro-communistes ;
Centrales syndicales « anti-colonialistes » ;
Organisations et mouvements divers.
La solidarité arabe.
Le mécanisme de la propagande :
Une démonstration par l'absurde.
L'ACTION DU M.N.A. A L'ETRANGER.
LA DOCTRINE
Les objectifs. Les objectifs de cette propagande et les moyens qu'elle requiert ont été définis et précisés lors du congrès du 20 août 1956 tenu dans la vallée de la Soummam.
1°) Il s'agit de : exhorter les puissances de Bandoeng à exercer des pressions diplomatiques et économiques sur la France.
2°) Rechercher l'appui des pays et nations européens y compris les Etats scandinaves, des démocraties populaires et des Etats d'Amérique latine.
3°) Susciter l'aide des immigrants arabes dans les pays d'Amérique latine. »
Les moyens. « A cette fin, le F.L.N. a accru les effectifs de sa délégation à l'étranger : il faut à l'heure actuelle
A) Un bureau permanent auprès des Nations Unies et aux Etats-Unis.
B) Une délégation en Asie.
C) Des délégations itinérantes qui devront se rendre dans les diverses capitales et participer aux manifestations culturelles, syndicales, universitaires et autres.
D) Des documents de propagande dont nous assurerons la publication : bureaux de presse, rapports, documentations, films et photos.»
LES MÉTHODES
Disposant de moyens financiers importants, grâce notamment au concours des pays arabes et des organisations islamiques ou panarabes, le F.L.N. a mis en place à l'étranger un réseau de propagande très dense.,
Son action s'exerce par l'intermédiaire de délégués permanents ou itinérants qui font preuve d'une activité intense soit sur le plan diplomatique, en multipliant les interventions auprès des gouvernements des pays étrangers, pour les intéresser à leur cause et obtenir leur soutien, soit en agissant sur l'opinion de ces pays par les déclarations publiques, des conférences de presse, des réunions d'information, des interviews... Ces délégués recherchent tous les contacts avec les milieux officiels, les organisations syndicales, la presse...
Les délégués itinérants.
Le F.L.N. a dépêché dans tous les pays des « missionnaires ». les plus importants sont
Ferhat Abbas
Ahmed Francis
Abderrhaman Khiouane
Hocine Lahouel
et le Dr Lamine Debaghine.
Exemples de l'activité de ces délégués
Tournée de MM, Ahmed Francis et Khiouane dans le Moyen-Orient.
En mai 1957, venant de Damas et Bagdad et en route pour Kaboul et Karachi, ces deux délégués furent pris en charge à Téhéran par l'ambassade d'Egypte qui, sur les fonds alloués par la Ligue arabe, assura la couverture de leurs dépenses. L'ambassadeur d'Arabie Séoudite leur ménagea les contacts qu'ils souhaitaient prendre. lIs se rendirent ensuite à Ankara où, dès sa descente d'avion, M. Francis, dans une déclaration publique, établit un parallèle entre l'action menée dans le passé par la Turquie pour la conquête de son indépendance et l'action actuelle du F.L.N.
Voyage du « colonel » Ouamrane à Bagdad. — Le 29 juin 1957, Omar Ouamrane, représentant de « l'Armée de Libération Algérienne au Caire » et M. Ahmed Boudaa, représentant du F.L.N. à Bagdad, ont été reçus par le roi d'Irak. Omar Ouamrane. avait pris contact à Tripoli avec le secrétaire général de la Ligue arabe.
Délégation du F.L.N. en Arabie Séoudite (juin 1957).
Voyage de M. Chanderli en Argentine (décembre 1956).
Tournées de M. Ferhat Abbas en Amérique latine (1956 et 1957) Voyage de M. Ferhat Abbas en Espagne (juin 1957).
Mission de M. Khiouane en Suède. — Avant l'ouverture, en janvier 1957, .du débat sur le problème algérien à l'O.N.U., M. Khiouane fut dépêché en Suède — on il retrouva M. Haleyi, se disant représentant du F.L.N. en Scandinavie — avec mission d'intéresser les pays scandinaves à sa cause par le moyen de conférences de presse et de réunions d'information.
Voyage de MM. Ahmed Francis et Khiouane dans les pays scandinaves (été 1957). — Partis de Suisse au début de juillet 1957, ces délégués, en route pour la Norvège et le Danemark, ont rejoint Stockholm le 28 du même mois, après être passés à Helsinki.
Délégués permanents :
Le F.L.N. dispose également de représentants permanents dans de nombreux pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Extrême-Orient, d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'auprès de l'organisation, des Nations Unies.
— Une délégation permanente, conduite par M. Yazid, siège à New-York au Centre d'information arabe. Ses membres multiplient les interventions auprès du gouvernement américain et de l'O.N.U., leur adressant mémoires et télégrammes où ils dénoncent « les méfaits de la France en Algérie» et sollicitent une aide eu faveur de leur mouvement.
Exemple : fin juin 1957, M. Chanderli, délégué adjoint du F.L.N. à New-York, a adressé à M. Foster Dulles un télégramme dans lequel il regrette que les Etats-Unis n'aient pas accepté de suspendre l'aide militaire à la France.
Les délégués permanents sont égaleraient particulièrement actifs dans les pays nordiques, en Amérique latine, et en Allemagne occidentale. Les principaux sont :
Mohammed Yazid (Etats-Unis)
Abdelhamid Mahri (Syrie)
Ben Yahia (Djakarta).
D'autres représentants permanents sont installés à Madrid, Ryad (Arabie Séoudite), Bagdad, Amman, Karachi.
Tout leur est occasion à manifester leur présence et à attirer l'attention sur le problème algérien et la « légitimité » de la cause du F.L.N. Leurs meilleurs auxiliaires sont les organisations pro-communistes et les centrales syndicales « anti-colonialistes ».
Les auxiliaires de cette propagande.
Organisations pro-communistes.
Participation de deux étudiants algériens au Congrès national de la Zengakuren à Tokyo (31 mai 1957).
MM. Taleb Shaid et Negad Mustapha se sont rendus à Tokyo (via Prague) pour participer au Congrès de la Zengakuren (Fédération japonaise d'étudiants de tendance communiste).
Ils ont exprimé l'espoir que le Japon soutiendrait la cause algérienne devant les Nations Unies et annoncé leur intention de prendre contact avec les organismes nippons susceptibles d'aider le « peuple algérien ».
- « Semaines de solidarité avec les combattants algériens. »
En Allemagne orientale comme dans les autres Etats du «bloc socialiste» a été, à la demande de la Fédération Syndicale Mondiale, du 7 au 14 avril 1957, organisée une semaine de solidarité avec les combattants algériens de l'indépendance ». A cette occasion, l'émir Abd-el-Kader a pris la parole à plusieurs reprises, et s'est fait interviewer par les journaux (voir : Unité d'inspiration de la propagande du F.L.N., des pays communistes et des pays arabes).
— Festival mondial de la jeunesse à Moscou (participation d'une délégation de jeunes soldats de l'armée de libération algérienne »).
Centrales syndicales « anti-colonialistes ».
La propagande F.L.N. s'exerce également à travers certaines organisations syndicales qui, au nom de « l'anti-colonialisme », appuient les revendications nationalistes.
Participation d'agents du F.L.N. au défilé du 1er mai organisé à Stockholm par la Confédération des Syndicats suédois. Ces agents étaient porteurs de panneaux portant diverses inscriptions dont : « La guerre en Algérie est un danger pour la Paix », « L'Algérie aux Algériens », « Le peuple algérien lutte pour la démocratie »...
La C.I.S.L. -- Le soutien le plus actif est apporté par la Confédération internationale des syndicats libres aux thèses du F.L.N. Il suffit de signaler l'action militante de M. Irving Brown, représentant en Europe des syndicats américains, non seulement au sein des organisations syndicales, mais encore au sein de l'Internationale socialiste en prévision des congrès internationaux de Tunis et de Vienne.
II suffit également de prendre connaissance de la résolution sur l'Algérie votée, en juillet 1957, par le congrès de la C.I.S.L. à Tunis et qui se fait l'écho fidèle des revendications du F.L.N.
Organisations et mouvements divers.
Divers mouvements et organisations donnent leur patronage à l'action de propagande des agents du F.L.N. à l'étranger (Mouvement des citoyens du monde, American Comittee on Africa, Movement for Colonial Freedom, etc...).
Le 28 octobre 1956 sur la chaîne N.B.C. a été présenté par M. Chet Huntley à New-York, au début de l'émission de télévision « News Round up », un film sur « la vie des soldats de l'armée algérienne de Libération Nationale ».
LA SOLIDARITÉ ARABE
Le F.L.N. bénéficie de l'appui total de tous les Etats arabes et des organisations islamiques ou panarabes qui lui permet d'utiliser avec le maximum d'efficacité le dispositif qu'il a mis en place.
Les pays arabes font preuve sur le plan diplomatique d'une intense activité en faveur des rebelles algériens et multiplient les occasions d'exalter au cours de manifestations de tous genres (notamment visites (le chefs d'États arabes ou nord-africains) l'action du F.L.N. dont ils se déclarent solidaires. Il n'est pas utile de rappeler les campagnes de presse et les émissions radiophoniques, qui se signalent par leur extrême 'violence a l'égard de la France et leur absence d'objectivité.
En Amérique, le F.L.N. dispose d'auxiliaires précieux : les 2 000 étudiants arabo-asiatiques des universités américaines, sans compter quelque 300 000 citoyens américains d'origine arabe.
Des étudiants sélectionnés et répartis dans les universités américaines reçoivent chaque semaine, par les soins de leurs ambassades, des questionnaires et documents qu'ils diffusent largement.
LE MÉCANISME DE LA PROPAGANDE
Elle se définit par son caractère systématique ; le choix de quelques slogans simplistes que l'on assène jusqu'à les rendre lancinants, et dont la grossièreté assure le succès ; le mépris de l'auditoire qui se traduit par l'usage des mensonges les plus invraisemblables, mais dont il reste toujours trace dans les esprits ; le recours à des faits invérifiables et relevant de la plus haute fantaisie. Tout est occasion à discréditer la France, son action actuelle et passée en Algérie, à lui donner mauvaise conscience, dût la vérité historique ou la simple vérité en souffrir. La perfidie le dispute au cynisme.
Exemple : 300 000 Algériens seraient prisonniers en France.
On retrouve là le mécanisme de la propagande des nazis et des pays totalitaires : déformation systématique des faits, impudence dans le mensonge et mépris systématique de l'opinion.
Une démonstration par l'absurde.
Pour saisir le processus de la propagande F.L.N., il suffit de citer en exemple un cas « limite » qui en accuse tous les traits : il s'agit de l'affaire de Melouza. Dans la nuit du 28 au 29 mai, tous les hommes au-dessus de quinze ans, soit 302 personnes, des mechtas du douar des Beni liman, sont rassemblés à la mechta Kasba et sauvagement massacrés. Les responsables de la tuerie sont, sans contestation possible, des éléments F.L.N., les témoignages des survivants sont formels sur ce point. Quelles sont les réactions des dirigeants F.L.N. devant ce crime abominable, ce « génocide » ?
Les bureaux du F.L.N. à Tunis et Washington, qui ont vraisemblablement appris le massacre par le canal des agences de presse et de la radio, donc par des informations de source française, à l'exclusion d'autres renseignements, imputent froidement la responsabilité de la tuerie aux troupes françaises.
La délégation du F.L.N. adresse même à S.S. Pie XII un télégramme lui demandant d'user de son influence pour faire cesser les massacres. Lorsque des éléments d'information supplémentaires parviennent aux bureaux de Tunis et de Washington, ces derniers persistent à affirmer que le massacre est l'œuvre des troupes françaises, sans toutefois donner de précisions sur les conditions dans lesquelles il s'est déroulé.
Au cours de la conférence de presse tenue au début du mois de juin, à Tunis, sous la présidence du docteur Fanon, ce dernier déclare :
L'odieuse machination de Melouza, élaborée pour discréditer aux yeux du inonde civilisé le Front de Libération Nationale, donne la mesure du cynisme et de la perfidie monstrueuse des autorités françaises » et évoquant la tuerie de Wagram, il ajoute : « Là encore le souci de signer F.L.N. un massacre horrible et absurde est évident. »
Lorsque la responsabilité du massacre fut établie sans qu'aucun doute ne puisse subsister, après que les journalistes du monde entier eurent interviewé les rescapés qui, unanimes, désignèrent des groupes F.L.N. comme les assassins, que fait le F.L.N. ? Niant l'évidence, il s'enferre dans son mensonge et sous prétexte d'exiger l'envoi d'une commission d'enquête qui le laverait de cette accusation injuste, il réclame par un biais l'intervention de l'O.N.U. Mais il n'en demeure pas moins que, malgré ses efforts, le F.L.N. a été pris à son propre piège, dans sa précipitation à accuser la France et qu'il a ainsi dévoilé le véritable caractère de sa propagande qui ne se fonde que sur le mensonge et la calomnie.
L'ACTION DU M.N.A. A L'ÉTRANGER
Sur le plan international, le M.N.A., qui ne dispose pas de moyens aussi importants que le F.LN., se trouve, malgré ses efforts, largement dépassé par son rival.
Son activité se limite, en effet, à celle de Messali, de son secrétaire générai Moulay Merbah, et de son délégué à Londres, Mohamed Sadoun. Il convient de rappeler, à ce propos, que les deux représentants du M.N.A., Chadly et Mekki et Ahmed Mezerna, ont été appréhendés au Caire par les autorités égyptiennes, dès le mois de juin 1955, sur demande des dirigeants du F.L.N., et sont emprisonnés dans cette ville depuis lors, malgré les protestations réitérées et les démarches incessantes effectuées par Messali et Moulay Merbah pour obtenir leur libération.
Quoi qu'il en soit, les mémoires, notes et documents divers adressés par Messali et Moulay Merbah aux instances internationales, aux Etats étrangers et aux organisations mondiales sont particulièrement nombreux et abondants.
UNITÉ D'INSPIRATION DE LA PROPAGANDE REBELLE, DES PAYS COMMUNISTES ET DES PAYS ARABES
Moscou fait chorus à la campagne des tortures.
Moscou lance la campagne de solidarité des travailleurs du monde entier avec le F.L.N.
Le thème la guerre d'Algérie ruine la France.
Moscou adopte la thèse du F.L.N. au sujet de Melouza.
Le spectre de Dien-Bien-Phu.
Une étude approfondie et systématique des émissions radiophoniques des pays arabes et de l'U.R.S.S. montrerait à l'évidence qu'il existe un parallélisme constant entre les campagnes soviétiques contre la France et celles des pays arabes,
En certains cas, les radios soviétiques fournissent les thèmes d'une campagne, les slogans ; le plus souvent, elles se contentent d'adopter les thèses de Radio-Damas ou du Caire et de leur fournir un appui total sans réserve aucune.
Examinons seulement la période du 1er avril au début de mai 1957 ; les conclusions que nous pouvons tirer de cette étude, à savoir, en particulier, la concordance absolue des thèmes de propagande, sont valables en général.
Moscou en arabe, 8 avril 1957, 15 h. 30.
Moscou fait chorus à la campagne des tortures.
« ... Ce ne sont pas cette fois-ci des hitlériens qui commettent de tels crimes, mais les armées françaises réactionnaires qui ont décidé d'étouffer à tout prix les aspirations du peuple algérien à la liberté et à l'indépendance nationale... »
Moscou en arabe, 9 avril, 15 h. 30 : « ... Des milliers et des milliers de nationalistes algériens étudiants, médecins et instituteurs, jetés dans les prisons et les camps de concentration, subissent le sort de Boumendjel.
« La torture est devenue dans ces camps chose courante, comme l'ont indiqué de nombreuses personnes qui ont réussi à échapper, par miracle aux parachutistes du général Massu.
« Il n'y a pas longtemps, le général français de Bollardière démissionné en signe de protestation contre les tortures infligées aux détenus.»
Moscou en français, 18 h.: «Toutes les couches de la société prennent conscience de l'iniquité de cette guerre, de la honte dont la France s'est entachée par les atrocités de la politique de « pacification par la force ».
Moscou lance la campagne de solidarité avec le FLN.
Moscou en arabe, 6 avril 1957, 17 h. 30 :
Prague : L'Union syndicale mondiale a invité les travailleurs de tous les pays du inonde à organiser une semaine de solidarité internationale avec l'Algérie dans la période qui va du 7 au 1l avril courant... de «
« ... L'appel ajoute que la cause du peuple algérien est une cause juste qui triomphera irréductiblement.
Cet appel est repris le même jour par Radio-Damas en espagnol et en arabe, ainsi que par la radiodiffusion nationale du Maroc, qui cite l'émission arabe de Moscou ; le même jour, le Caire en arabe reprend un message de soutien des ouvriers chinois à l'U.G.T.A.
Varsovie en français, le 8 avril 1957, 21 h. 30, reprend la déclaration de M. Prasad Rahak, secrétaire général du syndicat des travailleurs agricoles de l'Inde, à l'occasion de l'ouverture de la semaine de solidarité avec les ouvriers et le peuple algérien.
La « Voix des Arabes » du 11 avril 1957, à 5 h., donne une large orchestration à la semaine de l'Algérie.
Le thème : la guerre d'Algérie ruine la France.
L'argument financier lancé par RadioMoscou en langue française et destiné à décourager les Français et à les amener à abandonner leurs efforts, est repris par les radios arabes.
Radio-Moscou en français, le 10 avril 1957, 21 h. : « ... L'année dernière cette guerre engloutit 185 milliards de francs. Chaque jour de guerre contre l'Algérie coûte autant que l'installation de deux hôpitaux de cinq cents lits chacun et l'installation de l'eau courante chez vingt-cinq familles rurales... »
Voix des Arabes, 17 avril 1957, 22 h. : « Ajoutez à cela d'autres protestations qui émanent de la France impérialiste elle-même et des impérialistes eux-mêmes dénonçant les conséquences dangereuses, économiques et militaires qu'occasionne à la France la guerre d'Algérie, et trouvant donc nécessaire qu'il soit mis fin à cette guerre... »
Moscou adopte la thèse du F. L. N. au sujet de Melouza.
Radio-Moscou en français, le 3 juin 1957, à 18 h., reprend la thèse du F.L.N. concernant Melouza et appuie la campagne lancée par l'état-major rebelle.
Radio-Moscou en français, le 5 juin 1957, à 22 h., prend la défense du F.L.N. et s'attache à le laver de la responsabilité du massacre : « Il est parfaitement évident que les accusations portées par la presse réactionnaire contre le Front de Libération Nationale sont absolument dénuées de fondement. La direction du F.L.N. a refusé de façon rigoureuse et catégorique toute participation du Front de libération nationale au crime de Melouza. »
Tous ces thèmes se retrouvent, développés et amplifiés, dans toutes les émissions des radios arabes.
Le spectre de Dien-Bien-Phu
Le thème Dien-Bien-Phu est évoqué, jour après jour, par toutes les radios arabes. Pour ne citer que deux exemples parmi des milliers :
Radio-Damas (24.3.57 - 13 h. 30) :
...Tous vos crimes ne vous profiteront pas, vous avez transformé en assassins le corps des parachutistes, et les parachutistes paieront cher les crimes qu'ils commettent impunément. »
« ... Les dirigeants français, dans notre Algérie, veulent un Dien-Bien-Phu, ils l'auront et certainement plus rapidement qu'ils ne le pensent, parce que nous sommes pressés maintenant, nous, d'imposer notre solution. La dernière chance est offerte aux dirigeants français : ou bien la négociation sur la base de la reconnaissance de l'indépendance avec la sauvegarde de tous les droits, ou bien le désastre militaire et politique que rien ne pourrait empêcher et qui effacera jusqu'au souvenir de Dien-Bien-Phu.
Voix des Arabes (11.4.157 - 22 h.) :
« Les impérialistes ne feront des reproches qu'à eux-mêmes lorsque se produira un nouveau Dien-Bien-Phu en Algérie. Celui-ci se renouvellera fatalement. »
Radio-Moscou reprend ce slogan dans son émission du 15 mai 1957 (15 h. 30) en russe :
« Le peuple français n'a pas oublié les leçons de l'histoire. Ces derniers temps les Français se posent de plus en plus souvent la question suivante : Est-il vraiment nécessaire d'attendre un nouveau Dien-Bien-Phu qui mettrait fin à la guerre en Algérie Y... »
Pareille analyse pourrait être faite à propos de tous les thèmes de propagande des radios arabes. La concordance entre ces radios et celle de Moscou ou des satellites de l'U.R.S.S. est, en effet, totale et constante. Il va de soi que les journaux communistes français et étrangers témoignent aussi d'un accord parfait avec Moscou et, de ce fait, avec les radios arabes. Par une sorte de processus circulaire, on voit des thèmes, des slogans, partir de Moscou, passer par le Caire ou Damas, ou Tétouan, revenir dans la presse française de gauche, et de là retourner à nouveau sur les ondes des radios arabes. L'origine peut varier, mais le circuit reste le même.
Un exemple remarquable, le thème de la guerre bactériologique qui fut déjà utilisé, on s'en souvient, par Moscou et les communistes, pendant la guerre de Corée. Ce slogan revient périodiquement sur les ondes de Moscou ou des radios arabes, connue on voit dans cette émission de la « Voix des Arabes » du 12-1-57 (22 h.) : « En Algérie, la France recourut à la guerre bactériologique. Elle infesta certains villages de microbes, de typhus et de choléra.
Ainsi voit-on que la campagne psychologique dirigée contre la France est menée, à l'échelle mondiale, grâce à la parfaite collaboration des puissances communistes et des pays arabes.
Radio-Damas du 9-4-57 (13 h. 30) affirme : « Une campagne est organisée à l'échelon mondial pour venir en aide au peuple algérien. » Et la « Voix des Arabes » du 19-1-57 (22 h.) définit le but de cette campagne : « Appuyer le peuple algérien dans sa lutte et chasser de l'Algérie les impérialistes.
PACIFICATION RÉFORMES
But et moyens.
— Déclarations gouvernementales.
— Pouvoirs spéciaux.
- Pacification.
— Directives à l'armée.
— Action psychologique.
— Mesures et bilans.
— Commission de sauvegarde.
- Réformes.
— Réformes politiques.
— Réformes administratives.
— Réformes sociales.
— Réformes dans le domaine agricole.
DÉCLARATIONS GOUVERNEMENTALES
Extraits de l'exposé fait le 9 mars 1956 par M. Guy Mollet, président du Conseil, à l'Assemblée nationale.
Extraits de l'exposé fait le 2 juin 1956 par M. Robert Lacoste, ministre résidant en Algérie, devant l'Assemblée nationale.
Extraits de l'exposé fait le 23 octobre 1956, par M. Guy Mollet, président du Conseil, devant l'Assemblée nationale.
Extraits de la déclaration d'investiture de M. Bourgès-Maunoury, président du Conseil, devant l'Assemblée nationale, le 12 juin 1957.
Extraits du discours prononcé à Mulhouse le 9 juillet 1957 par M. le Président de la République.
EXTRAITS DE L'EXPOSÉ
fait le 9 mars 1956
par M. Guy Mollet
à l'Assemblée Nationale
« Sur un même sol cohabitent deux collectivités nettement distinctes, l'une d'origine européenne, l'autre musulmane — encore que la distinction ainsi présentée soit trop simple et un peu factice --- l'une comme l'autre numériquement importantes et économiquement inter-dépendantes.
« Les deux collectivités ont, l'une et l'autre, des droits sur l'Algérie, et elles le savent. Allons-nous les laisser se replier sur elles-mêmes, chacune sur soi, s'ignorer, se dresser l'une contre l'autre dans la violence ? »
Une communauté franco-musulmane
« La volonté du gouvernement, la volonté, de la nation, c'est de rétablir la confiance entre les deux collectivités d'Algérie ; c'est de les associer en une communauté franco-musulmane qui puisse elle aussi avoir pour devise celle de la République, une communauté où le mot « fraternité » ne sera pas vide de sens. Telle est la préoccupation permanente du gouvernement ; telle est sa perspective d'avenir.
Bien entendu, le respect mutuel des droits des deux collectivités sera garanti dans la loyauté et la justice... »
EXTRAITS
de l'exposé fait le 2 juin 1956
par M. Robert LACOSTE,
Ministre résidant en Algérie,
devant l'Assemblée Nationale
Une politique de pacification.
« Je répéterai, aussi souvent qu'il le faudra, sans jamais me lasser, car c'est la vérité, que nous menons une action de pacification et non une guerre d'extermination.
Qu'est-ce qu'une politique de pacification ? C'est une politique qui a pour but de préserver la vie de chacun, de libérer les populations de la terreur organisée qui leur est appliquée, de rapprocher les deux communautés locales en leur redonnant confiance l'une dans l'autre et à toutes les deux dans la France.
« ... La politique de pacification aura atteint son but quand nous aurons pu déclencher le ralliement de vastes portions de population.
Ralliement à quoi, en faveur de quoi : Qu'on ne dise pas : eu faveur du maintien du statu quo. Cela est faux, archi-faux. L'armée n'est pas en Algérie pour maintenir les privilèges et les injustices sociales. L'armée est là-bas pour défendre les liens indissolubles entre l'Algérie et la France ; elle est là-bas pour permettre la construction d'une Algérie nouvelle dans le sein de la communauté française. Car nous voulons faire une Algérie nouvelle — la France s'est engagée d'honneur dans cette voie — une Algérie dans l'ensemble français. Voilà le terme ultime de ce que nous appelons la politique de pacification. »
Réformes réalisées « ... Est-il négligeable, premièrement, d'avoir augmenté de 25 % les salaires agricoles ; deuxièmement, d'avoir institué par la loi une allocation-vieillesse aux économiquement faibles en Algérie, là où il n'existait rien ; troisièmement, d'avoir décidé la réforme du métayage musulman ; quatrièmement, d'avoir amélioré les conditions de contrôle de l'octroi des crédits agricoles, pour défendre le fellah ; cinquièmement, d'avoir décidé la création d'une caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, qui a pour mission d'acquérir en Algérie des biens fonciers il vocation agricole, d'en confier la mise en œuvre à des exploitants dépourvus ou insuffisamment pourvus de terres, le Gouvernement Général pouvant prononcer, au profit de la caisse, s'il n'y a pas d'accord amiable en vue de ces acquisitions, l'expropriation pour cause d'utilité publique ; sixièmement, d'avoir organisé la gestion collective pour les ouvrages d'irrigation et de défense contre les eaux ; septièmement, d'avoir limité, dans les périmètres irrigués, la superficie totale des parcelles appartenant à une seule personne à 50 ha, plus une superficie de 20 ha par enfant vivant, sans pouvoir excéder 150 ha, les terres en excédant devant être expropriées au bénéfice de la caisse d'accession la propriété rurale.
Le gouvernement se propose également de soumettre au parlement trois projets de loi :
« Le premier tend à favoriser en Algérie l'accession à la petite propriété rurale par le retour à l'Etat des grands domaines agricoles.
« Le second tend à permettre le retour à l'Etat des grands domaines forestiers dont le produit ira alimenter la caisse d'accession à la propriété rurale.
« Le troisième tend à demander aux exploitations d'alfa des redevances équitables dont le produit alimentera également la caisse d'accession à la propriété rurale.
« Quant aux réformes et aux actes politiques, est-il utile de souligner l'importance de la réforme favorisant l'accession des Musulmans à la fonction publique.
« Peut-on compter pour rien les mutations dans le haut personnel de la police et de l'administration, la promotion de fonctionnaires musulmans, les décrets actuellement soumis au conseil d'Etat réformant le Gouvernement général en supprimant nombre de ses rouages.
« Cette administration de coordination et d'impulsion doit retrouver son efficacité dans un allègement de sa masse et une réorganisation de sa charpente.
« Les directions générales se substitueront aux organes actuels. La plus importante d'entre elles, dont je demande la création immédiate, serait la direction générale des affaires politiques, qui permettra d'agir directement sur la vie locale et les populations musulmanes.
« Parmi les actes politiques, compte-t-on pour rien le refus de certains ultimatums du comité de coordination et, de même, compte-t-on pour rien la dissolution de l'Assemblée algérienne.
« Ces actes et ces réformes ont rencontré l'approbation de la plus grande partie des Européens. »
EXTRAITS
du discours de M. Guy Mollet,
Président du Conseil
à la séance de l'Assemblée Nationale
du 23 octobre 1956
L'Offre de «Cessez-le-feu».
« ... Tirant les conséquences de ces événements sur la situation algérienne je déclare à l'Assemblée que ceux-ci, contrairement à la crainte ou à l'attente de certains, nous confirment plus que jamais dans notre volonté d'aboutir à une solution pacifique et politique du drame algérien. Malgré — certains diront peut-être : à cause — de la position de force que peut nous donner la capture des chefs du F.L.N., l'offre de cessez-le-feu sans condition politique préalable que j'ai maintes fois renouvelée à cette tribune demeure plus que jamais valable dans les conditions que j'ai fait connaître à l'Assemblée.
« Si cette offre n'a pas été suivie d'effet jusqu'ici, c'est parce que nos adversaires ont constamment posé des conditions politiques à leur renonciation à la force et à la violence. Cela, il fallait que ce fût dit à cette tribune, pour l'opinion française comme pour l'opinion internationale.
« A des hommes qui n'acceptent d'ouvrir les discussions que les armes à la main — et, en fait, sur les conditions de notre départ — nous proposons une libre confrontation dans la paix pour l'établissement d'une coexistence durable. A des hommes qui réclament l'indépendance de la population musulmane pour placer sous sa dépendance la collectivité européenne, à des hommes qui réclament la liberté pour la population musulmane dans le but de mettre fin aux libertés de la collectivité européenne, nous proposons, nous, que soient réalisées l'indépendance réelle et l'égalité dans la paix, dans la justice, dans la dignité, de tous les individus, femmes comme hommes, qui vivent sur la terre d'Algérie, et ce, quelles que soient leur origine, leur race ou leur religion.
« Telle est notre volonté de paix. Telle est notre détermination. J'ai confiance qu'un jour — et peut-être un jour prochain — elles l'emporteront sur le fanatisme et sur la violence.. »
EXTRAITS
de la déclaration d'investiture
de M. BOURGES-MAUNOURY,
Président du Conseil,
à l'Assemblé Nationale, le 12 juin 1957
« ... Le drame algérien a la première place dans nies préoccupations.
Un faux dilemme.
« Nous n'avons pas aujourd'hui le choix entre deux voies dont l'une serait la poursuite à tout prix d'une lutte interminable et absurde, et dont l'autre déboucherait soudain, comme par miracle, sur la concorde et la prospérité.
« Nous devons mener le combat aussi longtemps qu'il nous sera imposé et, dans le même temps, aider des millions d'hommes à construire ensemble une Algérie nouvelle.
« Le gouvernement de M. Guy Mollet a su faire prendre conscience au pays et à l'opinion internationale de cette double nécessité... »
Le pays poursuivra son effort.
« ...Je le dis solennellement à l'ensemble des populations d'Algérie : notre pays poursuivra son effort aussi longtemps qu'il le faudra. Il le peut. Il le veut.
« Nous prenons un autre engageaient solennel, celui d'entreprendre, sans attendre plus longtemps le bon vouloir de nos adversaires, la construction d'une Algérie nouvelle. C'est bien là le problème qui se pose désormais à nous. Il faut que, confiante dans l'avenir que nous pouvons lui assurer, et lasse des crimes de la rébellion, la population isole cette rébellion et participe avec nous à son élimination définitive.
« Le gouvernement précédent a fixé un objectif final : « Maintenir et renforcer l'union indissoluble entre la France métropolitaine et l'Algérie ; en même temps, reconnaître et respecter la personnalité algérienne, tout en réalisant l'égalité politique de tous les habitants d'Algérie.
« Par notre continuité dans la volonté et dans l'action, nous démontrerons à l'opinion algérienne, comme à l'opinion internationale, que notre promesse d'établir en Algérie un nouvel état de choses n'est pas une déclaration d'intentions sans lendemain.
« La tactique des rebelles est bien claire. On refuse le cessez-le-feu. On évite des élections libres, donc. la discussion du statut. On se tourne en même temps vers l'opinion internationale pour dire que rien n'a progressé et que les engagements de la France ne sont pas tenus. L'assassinat, les événements sanglants de ces derniers jours, à Alger par exemple, rendent tragique cette hypocrisie. Nous ne nous laisserons pas déborder par une telle manœuvre. Nous ne nous laisserons pas entraver dans la construction d'une Algérie nouvelle.
Un projet de loi Cadre.
« C'est pourquoi, en conservant tous les objectifs qu'avait définis le président Guy Mollet dans sa déclaration d'investiture, l'appel au cessez-le-feu restant valable, j'ai pris la décision de déposer aussitôt que possible un projet de loi-cadre qui servira de base à la 4aise en place progressive de structures politiques nouvelles. Celte mise en place partira de l'échelon local, elle passera ensuite à l'échelon départemental, puis à celui de la région. Chaque région deviendra une entité politique provinciale.
« C'est à partir des provinces et de leurs organes politiques propres que sera élaborée la structure de « l'ensemble Algérie ».
« Lorsque les élections seront possibles, les représentants élus de la population seront appelés à examiner cette loi-cadre, pour l'adopter, ou y proposer les modifications qu'ils estimeraient souhaitables.
« Elle sera ainsi mise en tenure avec le concours de tous les hommes de bonne volonté.
« Cette réforme politique sera précédée d'une réforme administrative profonde, dont les bases ont déjà été jetées, et qui aura pour effet essentiel de rapprocher les organes administratifs des populations dont ils ont la charge ; elles aboutiront à la suppression progressive du Gouvernement Général de l'Algérie et à la décentralisation des pouvoirs sur les régions...
EXTRAITS
du discours prononcé à Mulhouse
le 9 juillet 1957 par M. le Président de la République
La France au premier rang de l'aide aux pays sous-développés.
« En ces trois dernières années, de 1953 à 1956, c'est, au total, pour notre production industrielle, une progression d'un tiers par rapport au niveau que la France avait atteint en 1953. Résultats d'autant plus remarquables que, depuis la fin de la guerre mondiale, l'armée française n'a jamais cessé d'être au combat et que, d'autre part, la France s'est imposée pour le développement économique et social des territoires de l'Union française des charges qui, dépassant 5 milliards de dollars, donnent à notre pays par rapport à son revenu national, le premier rang de tous les pays du monde pour l'aide aux pays sous-développés. »
Hommage à la jeunesse combattante.
Le Président de la République aborde alors le problème algérien :
Quelle promesse que l'énergie avec laquelle les nouvelles générations abordent une vie souvent bien difficile pour elles ? Qui pourrait douter d'elles au spectacle de ces 600 000 de nos jeunes gens qui, pour la première fois dans notre Histoire, alors que l'ensemble du pays continuait à vivre en paix ont été rappelés ou maintenus sous les drapeaux pour s'en aller en Afrique du Nord où, face à ses tâches pénibles, ils ont vraiment été et sont admirables ?
« Je ne commettrai pas l'inconvenance d'en tirer des conclusions politiques sur un problème qui est bien douloureux, mais qui est aussi bien difficile et qui, comme tel, peut être légitimement controversé. Pas au point, toutefois, de diviser profondément, passionnément, ceux qui ont au cœur un même amour de la patrie. Je leur dis que, pour la plupart, ils sont au fond plus d'accord qu'ils ne le paraissent et qu'ils ne le croient.
La France n'est pas colonialiste
« Aux Etats qui osent accuser la France, de colonialisme, est-il un Français qui ne soit fier de pouvoir répondre :
« Quel est donc parmi vous le pays où il y a moins d'impérialisme, moins de racisme, moins d'asservissement que dans le nôtre ? Quel est celui qui se montre plus largement humain que la République française ?
« En est-il un dont tous les ressortissants puissent être, comme sur toute l'étendue de notre territoire, sans distinction d'origine, de confession, d'instruction ou de statut civil, de véritables citoyens appelés à élire leurs représentants au Parlement national, d'où tous les postes même les plus hauts, leur sont ouverts ? La France ne s'en est d'ailleurs pas tenue là. Elle a voulu que les populations autochtones qui sous l'administration française ont évolué soient appelées, selon les termes mêmes de notre Constitution, à « gérer démographiquement leurs propres affaires ».
« Dans ce département où est particulièrement honorée la mémoire d'un noble Alsacien, Victor Schoelcher, qui fit abolir l'esclavage dans nos plus lointaines colonies, quand il subsistait encore dans les Etats métropolitains de grandes démocraties, il me plaît de rappeler à nos détracteurs que, par des élections au suffrage universel et au collège unique, dont nul n'a pu contester la parfaite régularité, près de 30 millions d'Africains viennent, en ratifiant le nouveau régime d'autonomie qu'ils souhaitaient, d'affirmer leur attachement à la mère patrie.
« Est-il possible que la France, selon qu'il s'agisse de l'Afrique noire ou de l'Algérie, soit animée d'un esprit différent, qu'elle veuille être moins libérale et moins généreuse pour les uns que pour les autres ! Mais, et c'est encore un peint essentiel sur lequel je n'aperçois guère entre les Français de désaccord : c'est un fait indiscutable que l'Algérie est un pays différent, non seulement de l'Afrique noire, mais aussi de tous les autres pays auxquels on est enclin à la comparer.
Le mensonge de l'indépendance.
« L'Algérie, ce sont avant tout deux groupes ethniques, l'un plus nombreux, qui aura bientôt quintuplé depuis que les Français sont en Algérie, l'autre qui a pris et prend encore une part capitale à la création, au progrès et à l'essor de l'Algérie moderne. Assurer la co-existence et la nécessaire coopération de ces deux collectivités, sans que l'une puisse opprimer l'autre, voilà le vrai problème algérien. Comment l'indépendance pourrait-elle le résoudre !
« Ne nous laissons pas prendre à la magie d'un mot.
« Quand les rebelles font de ce mot la condition préalable d'un cessez-le-feu, cela signifie en réalité que cette prétendue indépendance se traduirait immédiatement par leur domination sur les Algériens, sur les musulmans d'abord, dont ils redoutent que des élections libres n'attestent qu'ils sont en majorité fidèlement attachés à la France, sur ces musulmans qu'ils ont principalement entrepris de terroriser et dont plus de 5000 ont été traîtreusement assassinés selon des ordres que les chefs de la rébellion n'ont pas eu honte de proclamer eux-mêmes à la radio.
« Comment la France pourrait-elle, sans se déshonorer, livrer ces populations aux égorgeurs de tant d'hommes et de femmes, de vieillards et d'enfants ? Cette souveraineté du nationalisme le plus arriéré et le plus hideux, est-il une démocratie digne de ce nom qui puisse, sinon par ignorance, la confondre avec cette liberté de la personne humaine qui est notre commun et suprême idéal ?
Qu'on ne compte pas sur nous pour sacrifier 1.000.000 de français.
« Et les quelque 1.040.000 Algériens de souche européenne, dont la plupart ont leurs parents et leurs aïeux qui reposent en terre algérienne Oh ! pour eux, c'est plus simple encore. Les rebelles leur offrent le choix : ou bien quitter cette terre qu'ils ont fondée et fécondée, ou bien y rester comme étrangers à la merci du fanatisme.
« C'est non pas aux Français, mais à l'opinion publique des peuples civilisés que je pose cette simple question : S'il s'agissait d'un tel nombre de vos compatriotes établis là ou ailleurs depuis aussi longtemps sur la fois de votre nation, qui de vous serait assez lâche pour les abandonner ? Qu'on ne compte pas sur nous pour le faire. Qu'on ne compte pas sur nous pour sacrifier de l'autre côté de la Méditerranée une nouvelle Alsace-lorraine.
Que les Français ne se fassent inconsciemment les auxiliaires des rebelles.
« Nous savons bien de quel poids le drame algérien pèse sur la situation internationale, mais est-il donc une nation sur laquelle il pèse plus lourdement que la nôtre ? Plus que toute autre, elle souhaite ardemment y mettre un terme par une solution libérale et équitable. Dire : Non à la rébellion ne suffit évidemment pas à bâtir cette Algérie nouvelle, à construire démocratiquement cette solidarité, cette fraternité franco-musulmane que s'acharnent à saboter les rebelles et leurs complices étrangers. Leur but est clair. Une fois de plus, j'adjure tous les patriotes de le bien comprendre pour ne pas s'en faire inconsciemment les auxiliaires.
« A force de crimes qui soulèvent l'indignation, la colère, l'exaspération, on veut troubler et surexciter les esprits, leur faire perdre ce sang-froid qui, dans la guerre qui nous est faite comme dans toutes les guerres, est la condition de la victoire ? On veut que nos discussions deviennent des dissensions. On veut que la France, se déchirant elle-même de ses propres mains, se montre impuissante à rétablir la paix, l'ordre et la justice en Algérie.
« Ici parmi cette population alsacienne qui a tant souffert de ces « deux arrachements », que M. le Président du Conseil général a si noblement évoqués, je rappelle que c'est grâce au sang-froid de nos chefs, de nos troupes, de tout notre peuple qui, pendant quatre mortelles années où aucune issue ne fut eu vue, apprenait, jour après jour, que par centaines de milliers, ses fils étaient tombés, morts ou blessés, je rappelle que c'est grâce à l'union sacrée et à la discipline civique qu'elle implique que la France a connu la plus grande joie de son Histoire : celle de recouvrer enfin, avec les plus chers de nos compatriotes, l'intégrité de notre territoire national. »
LES POUVOIRS SPECIAUX
La loi du 16 mars 1956.
La loi du 26 juillet 1957.
Les attributions du ministre résidant...
...Et celles du ministre de l'Algérie.
La loi du 16 mars 1956.
Pour faire front à une situation d'exception, des moyens exceptionnels étaient nécessaires.
Le Gouvernement a dû tout d'abord établir un régime politique et juridictionnel provisoire de nature à permettre le rétablissement de l'ordre,
Il a ensuite jeté les bases :
- d'une réforme agraire ;
- de réformes sociales qui vont jusqu'au bouleversement des règles traditionnelles de la fonction publique ;
- de réformes administratives,
et posé les principes destinés à servir de base à l'évolution politique du pays.
C'est la loi du 16 mars 1956 qui a conféré au Gouvernement les pouvoirs spéciaux lui permettant de réaliser celte action.
Elle dispose, en effet :
« Article premier. — Le Gouvernement pourra, par décrets en Conseil des ministres, sur rapport du ministre résidant en Algérie et des ministres intéressés, et après avis du Conseil d'Etat, prendre en Algérie toutes dispositions relatives à :
« 1°) La poursuite de l'expansion économique au moyen de mesures appropriées concernant notamment les investissements, les travaux publics, l'équipement scolaire et sanitaire, la recherche scientifique, technique et économique, la construction de logements, l'équipement agricole et rural, l'aménagement foncier, la réorganisation de la propriété foncière, le remembrement ou l'extension des exploitations rurales, l'accession à la petite propriété rurale, la réorganisation du crédit agricole en vue d'une distribution plus large et plus efficace des fonds destinés à l'équipement individuel, l'accélération de la mise en valeur par l'irrigation des terres comprises dans les périmètres irrigables au moyen des grands barrages-réservoirs, la révision de baux à part de fruit et de certaines formes archaïques de sociétés agricoles ;
« 2°) La normalisation et l'abaissement des coûts de production, notamment par la réduction du prix de l'énergie, l'allègement ou l'aménagement en vue d'une meilleure productivité des charges et obligations sociales et fiscales pesant sur les entreprises et sur les salaires sans que, en matière sociale, les prestations de sécurité sociale et les prestations familiales puissent être réduites ;
« 3°) L'élévation du niveau de vie des populations et la coopération économique et financière entre la Métropole et l'Algérie, notamment :
« En édictant des mesures destinées à faciliter, pour les citoyens Français-musulmans, en leur garantissant des conditions de carrière normale, l'accès à la fonction publique et leur emploi dans les services publics, dans les entreprises bénéficiant d'une participation ou d'une aide de l'Etat, de l'Algérie et des collectivités publiques, en Algérie ;
« En favorisant le plein emploi par le financement des investissements nécessaires au développement des productions agricoles, industrielles et minières ;
« En mettant en oeuvre un plan cohérent d'industrialisation comportant une série de mesures propres à aider à l'implantation d'industries nouvelles et à protéger celles qui existent ;
« En adoptant un ensemble de dispositions financières, administratives et économiques destinées à faciliter la mise en valeur des ressources naturelles du Sahara ;
« 4°) L'accélération du progrès social, notamment :
« En améliorant la condition de l'ouvrier agricole par une réglementation des conditions de travail par la création ou le perfectionnement d'institutions sociales telles que celles relatives aux congés payés, aux allocations familiales, au régime des assurances sociales ;
« Dans le secteur non agricole, en étendant à l'Algérie, après les avoir adaptés dans la mesure nécessaire, des textes législatifs ou réglementaires applicables dans la Métropole concernant la réglementation du travail et de la main-d'œuvre, les congés payés, le régime des allocations familiales, les prestations dues au titre de la réparation des accidents du travail et les régimes d'assurances sociales ;
« 5°) La réorganisation des institutions administratives, notamment par une réforme de l'organisation territoriale, et en particulier du régime des régions sahariennes, par la réorganisation des collectivités locales et par la réforme de l'administration centrale du Gouvernement Général.
« Art. 2. — Ces décrets pourront modifier ou abroger les dispositions législatives existantes. Ils entreront en vigueur dès leur publication au Journal Officiel de la République Française, mais ne deviendront définitifs qu'après leur ratification par le Parlement auquel ils seront soumis dans le délai d'un an à compter de leur date.
« Ils pourront prévoir, soit les peines édictées par les lois antérieures relatives aux même matières sans que puissent être modifiés la qualification des infractions relevées, la nature et le quantum des peines applicables, soit les peines prévues par l'article 471, 15° du Code pénal.
« Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé à ouvrir, par décrets pris sur le rapport du ministre des Affaires économiques et financières, et après avis des commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Conseil de la République, les autorisations de programme et les crédits de payement correspondant aux dépenses qui pourront être engagées en application des articles précédents. Ces décrets seront sou-mis à la ratification du Parlement dans te délai d'un an à compter de leur date.
« Art. 4. — Le Gouvernement pourra, en toute matière, par décret pris en Conseil des ministres, sur le rapport du ministre résidant en Algérie et des ministres intéressés, le Conseil d'Etat entendu, étendre à l'Algérie, en y apportant les adaptations nécessaires, des lois et des décrets en vigueur dans la Métropole.
« Art. 5. — Le Gouvernement disposera, en Algérie, des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle commandée par les circonstances en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire.
« Lorsque les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent auront pour effet de modifier la législation, elles seront arrêtées par décret pris en Conseil des ministres.
« Art. 6. — Les pouvoirs accordés par les articles précédents prendront fin à l'expiration des fonctions du présent gouvernement. Toutefois, en cas de démission du Gouvernement ou de vacance de la présidence du Conseil, le nouveau Gouvernement devra demander la confirmation par le Parlement de la loi accordant des mesures exceptionnelles prises en vertu des pouvoirs conférés par l'article 5, dans un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a obtenu la confiance de l'Assemblée Nationale.
« Si cette demande n'est pas présentée dans le délai prescrit, la loi sera caduque.
« La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.»
Loi du 26 juillet 1957.
Elle porte reconduction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un programme d'expansion économique, de progrès social et de réforme administrative et l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire.
Art. 1. — Les dispositions de la loi n" 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le Gouverneraient à mettre en œuvre en Algérie un programme d'expansion économique, de progrès social et de réforme administrative et l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et de la sauvegarde du territoire, sont reconduites jusqu'à l'expiration des fonctions du présent gouvernement.
Le prochain Gouvernement devra obtenir, par un vote du Parlement, la reconduction des dispositions de la présente loi dans un délai de dix jours après son investiture.
Art. 2. — Jusqu'à l'expiration des pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 5 de la loi n" 5G-258 du 16 mars 1956, et en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire eu Algérie, pourra être astreinte, par arrêté du ministre de l'Intérieur, à résider dans les lieux qui lui seront fixés sur le territoire métropolitain, toute personne qui sera condamnée en application des articles 75 à 108, 209 à 218, 220, 305 à 308 et 400 du code pénal, de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, des articles 2 et 1 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes et munitions de guerre, de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée par la loi du 18 décembre 1893 sur les explosifs, de l'article 8 de la loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite, de la loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées, des articles 26, 28, 31, 32 et 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Cette assignation à résidence, qui pourra être prononcée nonobstant l'exercice d'une voie de recours contre la décision judiciaire, cessera de plein droit si un acquittement intervient.
Art. 3. — Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque ne se sera pas soumis aux dispositions d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 2.
Art. 4. — Pendant la période visée à l'article 2 de la présente loi et pour celles des infractions énumérées audit article qui sont punissables de moins de deux ans d'emprisonnement, la durée de cinq jours prévue à l'alinéa 2 de l'article 113 du code d'instruction criminelle est portée à vingt et un jour.
Art. 5. — Pendant la période visée à l'article 2 et dans la limite de son champ d'application, en vue de rechercher les auteurs des infractions qui y sont énumérées, il pourra être procédé à des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit.
Art. 6. — Peut être décidée, par décret pris dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la loi du 16 mars 1956, la fusion entre les corps métropolitains homologues. La présente disposition a valeur interprétative.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Les attributions du Ministre Résidant...
Il était absolument indispensable que le responsable de la politique algérienne fût à la fois à la tète de l'Administration algérienne et au Conseil des ministres. Le responsable de l'Algérie, ministre résidant à Alger (décret du 16 février 1956) qui prendra par la suite le titre de Ministre de l'Algérie (décret du 15 juin 1957) est aussi Gouverneur Général. Il a l'initiative des mesures générales intéressant l'Algérie.
Sur le plan juridique, différents textes donnèrent au ministre résidant en Algérie l'initiative des réformes et mesures exceptionnelles ainsi que le contre-seing des autres mesures, tandis qu'ils réservaient au Secrétaire d'Etat à l'Intérieur les attributions courantes exercées auparavant par le ministre de l'Intérieur.
Sur le plan politique, celle intervention du secrétaire d'Etat à l'Intérieur dans l'Administration coulante de l'Algérie ne lui conférait nullement un droit de contrôle sur la politique du ministre résidant. En effet, celui-ci restait le seul responsable de la politique algérienne, puisqu'il était seul, en principe, à avoir accès au Conseil des ministres.
Le ministre résidant disposait des pouvoirs les plus étendus ; il détenait en effet, outre ces attributions exceptionnelles, toutes les compétences qu'exerçaient auparavant le Gouverneur Général de l'Algérie (décret du 15 février 1956) et l'Assemblée Algérienne (décret du 12 avril 1956). Il s'était vu remettre (décret du 17 mars 1956) des pouvoirs analogues à ceux que confère la législation sur l'état de siège. Enfin, il pouvait déléguer ses pouvoirs aux préfets ou à l'autorité militaire.
Et celles du Ministre de l’Algérie
Le décret dei 13 juin 1957, portant nomination des membres du gouvernement Bourgès-Maunoury, substitue au ministre résidant un ministre de l'Algérie assisté de trois secrétaires d'Etat. Leurs attributions respectives sont précisées par quatre décrets du 29 juin 1957.
Indépendamment des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 15 février 1956, le ministre de l'Algérie reçoit les attributions transférées au président du Conseil des ministres en ce qui concerne l'Algérie. La direction des Affaires d'Algérie du ministère de l'Intérieur est mise à la disposition du ministre de l'Algérie et placée à Paris sous son autorité pour constituer avec les directions et les services en Algérie l'administration de son ministère.
Attributions des secrétaires d'Etat à l’Algérie.
Trois décrets du 29 juin 1957 précisent les attributions des trois secrétaires d'Etat à l'Algérie : M. Marcel Champeix, secrétaire d'Etat à l'Algérie, assiste le ministre de l'Algérie notamment pour l'étude et le règlement de l'ensemble des affaires politiques et administratives intéressant l'Algérie.
Pour l'exercice de ces attributions, il dispose des directions et services constituant à Paris et à Alger le ministère de l'Algérie.
M. Chérif Sid Cara, secrétaire d'Etat à l'Algérie, assiste le ministre de l'Algérie pour les affaires relatives à l'action sociale et médicale et notamment pour celles concernant le fonds de solidarité prévu au décret du 24 novembre 1956, l'accession des Français-musulmans à la fonction publique et les questions intéressant la jeunesse musulmane. Il connaît en outre toutes les affaires qui lui sont confiées par le ministre de l'Algérie. Pour l'exercice de ces attributions, il dispose des directions et services constituant à Paris et à Alger le ministère de l'Algérie.
M. Abdelkader Barakrok, secrétaire d'Etat à l'Algérie, assiste le ministre de l'Algérie pour les affaires concernant la réforme agraire et la réforme communale. Il connaît en outre de toutes les affaires qui lui sont confiées par le ministre de l'Algérie. Pour l'exercice de ces attributions, il dispose des directions et services constituant à Paris et à Alger le ministère de l'Algérie.
Algérie 1957, ministre de l’Algérie
|
|
Louis Comfort Tiffany l’orientaliste
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui -N°180 - Décembre 2009
|
|
Louis Comfort Tiffany (né le 18 février 1848 à New York - décédé le 17 janvier 1933 à New York) est un artiste américain célèbre pour ses œuvres en verre teinté dans le style Art nouveau. Il a également peint, et a conçu des bijoux et des meubles.
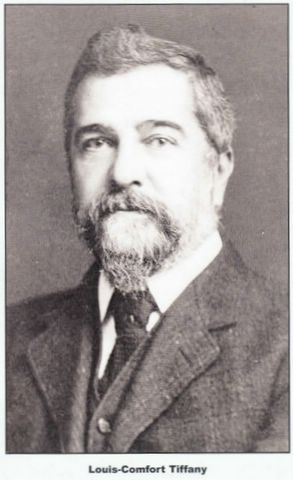 La maison Tiffany La maison Tiffany
Fils de Charles Lewis Tiffany, fondateur de la célèbre maison Tiffany & Co à New York, figure incontestablement parmi les plus talentueux créateurs américains de tous les temps. Son regard"de peintre en matière de couleur et de composition, sa passion pour I'exotisme et ses innovations dans le domaine du verre font de lui, dès 1900, un chef de file du design américain et dont la réputation s'étend jusque dans les grandes capitales européennes où il rivalise avec les plus grands verriers européens de la fin du XIXe siècle. Au Palais du Luxembourg, actuellement, une exposition présente environ 160 œuvres : vases, luminaires, objets, bijoux et Rue marchande à Alger, mosaïques, dessins, aquarelles et photos d'époque...
Biographie
Vous pourrez également admirer un ensemble exceptionnel de vitraux - dont un magnifique vitrail réalisé par Tiffany d'après un dessin de Toulouse-Lautrec - qui révèlent la remarquable contribution de ce créateur, tant à I'industrie du verre qu'à I'ensemble des arts décoratifs.
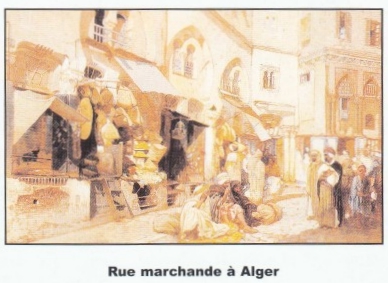 Il étudia en 1866 à la National Academy of Design. Sa première réalisation est une peinture réalisée alors qu'il est élève de George Inness en 1867. A 24 ans, il s'intéresse au travail du verre. C'est à cette période qu'il rencontre Mary Woodbridge Goddard, qu'il épousera le 15 mai 1872. Il étudia en 1866 à la National Academy of Design. Sa première réalisation est une peinture réalisée alors qu'il est élève de George Inness en 1867. A 24 ans, il s'intéresse au travail du verre. C'est à cette période qu'il rencontre Mary Woodbridge Goddard, qu'il épousera le 15 mai 1872.
Il étudie d'abord à New York puis à Paris chez Léon Bailly. Il fut influencé par les arts de L'extrême-orient, en particulier du Japon. Ses œuvres peintes datent d'avant 1900. Il a laissé des scènes d'Egypte, du Maroc et d'Algérie. Il se consacre ensuite à la verrerie d'art.
Il crée, en 1885, sa propre entreprise de travail du verre et invente un procédé pour fabriquer des verres opalins, auxquels d'autres artistes préfèrent le verre teinté en Clair. Chaque point de vue est motivé par les idéaux du mouvement Arts and Crafts fondé par William Morris en Grande-Bretagne. Un des concurrents de Comfort est le verrier John La Farge (1835-1910).
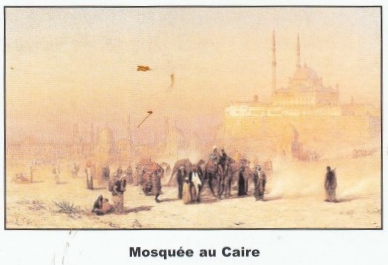 En 1893, son entreprise introduit une nouvelle technique, " Favrile ", pour la fabrication de vases et de bols. Ce nom est dérivé du latin fabrilis, voulant dire " fait à la main ". Il réalise par ailleurs des vitraux (notamment à l'église Church of the Incamation, Madison Avenue, à New York), tandis que son entreprise crée une gamme complète de décorations intérieures. Il use de tout son talent pour la conception de sa propre maison, Laurelton Hall, à Oyster Bay, Long Island, terminée en 1904. En 1893, son entreprise introduit une nouvelle technique, " Favrile ", pour la fabrication de vases et de bols. Ce nom est dérivé du latin fabrilis, voulant dire " fait à la main ". Il réalise par ailleurs des vitraux (notamment à l'église Church of the Incamation, Madison Avenue, à New York), tandis que son entreprise crée une gamme complète de décorations intérieures. Il use de tout son talent pour la conception de sa propre maison, Laurelton Hall, à Oyster Bay, Long Island, terminée en 1904.
Il crée de nombreuses entreprises : L. C. Tiffany & Associated Artists (créée en 1879), entreprise de décoration intérieure (à laquelle collabora notamment Stanford White), la Tiffany Glass Co (créée en 1885), Tiffany Glass and Decorating Co, Tiffany Studios, Tiffany Furnaces et L.C. Tiffany Furnaces.
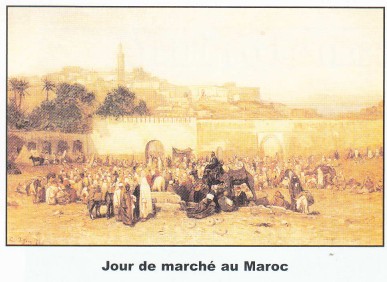 Il se retire progressivement des affaires à la fin des années 1920. Sa firme Tiffany studios fait faillite en 1932, un an avant son décès. Il se retire progressivement des affaires à la fin des années 1920. Sa firme Tiffany studios fait faillite en 1932, un an avant son décès.
Louis Comfort Tiffany a été enterré au cimetière de Green-Wood à Brooklyn (New York).
Le verre
C'est le domaine où il est le plus connu, dans toutes ses formes : vitraux, vases, lampes, bijoux, objets divers. Il1 s'y intéresse dès 1870 en débutant une collection d'antiquités. Il introduit plusieurs nouveautés dans la technique de verrier dont certaines ont fait I'objet de brevets : " verres drapés " où la pâte en fusion est repliée sur elle-même, emploi de plusieurs couches superposées, inclusion de morceaux de verre coloré... Son apport le plus remarquable est la création de son " verre Favrile " qui inclue des sels métalliques.
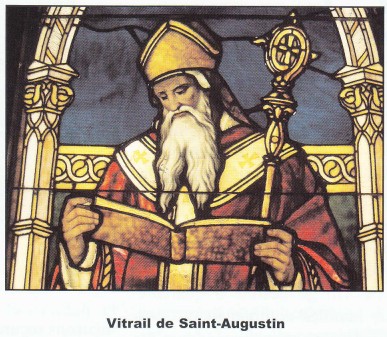 La création de vitraux a été une activité importante pour Tiffany qui a produit plusieurs milliers d'exemplaires dans son atelier. Concevant le dessin, il a été aidé pour cela par son équipe, dont les membres les plus connus furent Agnès Northrop et Frederick Wilson. Les thèmes prédominants étaient la religion et les paysages. La création de vitraux a été une activité importante pour Tiffany qui a produit plusieurs milliers d'exemplaires dans son atelier. Concevant le dessin, il a été aidé pour cela par son équipe, dont les membres les plus connus furent Agnès Northrop et Frederick Wilson. Les thèmes prédominants étaient la religion et les paysages.
Ses multiples lampes restent I'une de ses créations les plus connues, même si Tiffany ne goûtait guère à la production de masse qu'elles impliquent, préférant implicitement la fabrication d'œuvres uniques. Elles coïncident avec I'apparition de l'éclairage électrique. Leurs décors floraux ont fait une partie de la réputation de l'artiste.
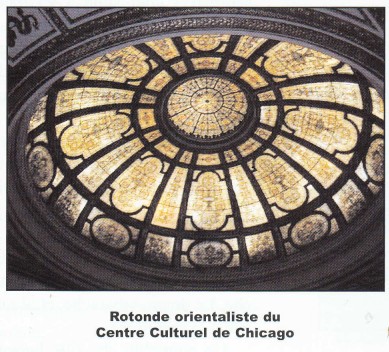 L'architecture intérieure L'architecture intérieure
Ses entreprises et lui-même ont conçu l'aménagement de plusieurs maisons ou appartements.
Parmi ces derniers, il y a naturellement son propre appartement à New-York ainsi que la vaste demeure qu'il s'est fait construire peu après la mort de son père (aujourd'hui détruite), mais aussi la maison de Mark Twain ainsi que plusieurs salons de la Maison Blanche. Son style se caractérise naturellement par I'emploi du verre (mosaïques, vitraux...) ainsi que par un goût pour l'orientalisme.
|
|
| ABUSIVEMENT
De Jacques Grieu
| |
« L’abus, en toute chose, est un vilain défaut »
Aurait dit Confucius, un jour, fort à propos.
Il avait trop mangé de cervelle de singe
Et donc sa digestion lui bloquait les méninges.
On ne peut abuser que des meilleures choses,
Et Confucius, ici, avait forcé la dose.
La trop bonne santé nous incline aux abus :
C’est pourquoi les malades ont des têtes chenues,
Et que les bien portants, très rapidement, meurent !
Les régimes foisonnent, mais les abus demeurent…
Avec modération, sans abus de l’alcool !
Alors qu’on boit partout jusque dans les écoles !
De confiance, l’abus est le pire de tous :
C’est vile tromperie, trahison qui repousse.
Mais fausse modestie est aussi un abus :
Un abus de confiance envers les convaincus.
L’abus de la malchance avilit le tragique,
Mais l’abus de la chance est tout aussi inique.
Comme un appât sournois, l’abus tisse sa toile
Tapit, tel un démon bien masqué sous ses voiles.
S'insinuant en nous, ce venin nous assiège.
Déguisé en ami, on ne voit pas ses pièges
Car son poison subtil brouille nos impressions
Et bien des dictatures en sont l’échantillon.
Si tous les despotismes abusent de royauté
De la démocratie, l’anarchie est l’excès.
Le pouvoir absolu, abuse absolument !
Si l’abus de l’impôt dévore le présent,
Tout abus du crédit va tuer l’avenir.
Notre époque en a-t-elle encor le souvenir ?
Le pouvoir sans abus perdrait-il de son charme ?
A en croire certains, il deviendrait sans âme.
N’est pas toujours payant, l’abus de réflexion,
Qui nous conduit souvent à totale inaction.
Sur l’abus de langage, évitons de gloser ;
Péché comme vertu : ne pas en abuser !
Jacques Grieu
|
|
|
L’Aviron et le canoë-Kayak d'Algérie
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°180 - Décembre 2009
|
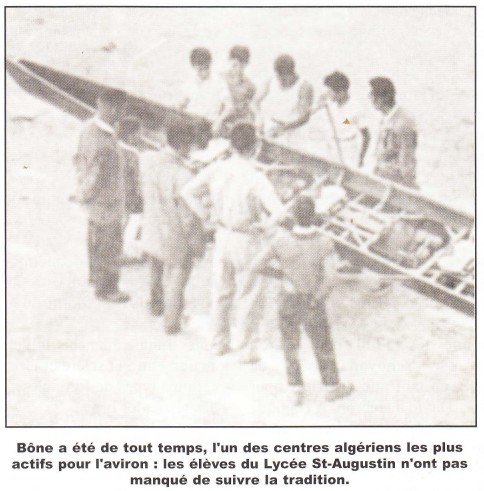 En Algérie, dès avant 1910 une section du sport nautique d'Alger réunissait des fervents de la rame. Mais le premier club algérien exclusivement voué à l'aviron, le Rowing Club d'Alger, ne fut fondé qu'en 1922. Peu après un autre Rowing était créé à Bône et les premières régates à être courues dans les eaux algéroises se disputaient le 22 juillet 1923. L'année suivante voyait de nouveaux clubs naître à Oran, Arzew, Philippeville, Bougie et Mostaganem. En Algérie, dès avant 1910 une section du sport nautique d'Alger réunissait des fervents de la rame. Mais le premier club algérien exclusivement voué à l'aviron, le Rowing Club d'Alger, ne fut fondé qu'en 1922. Peu après un autre Rowing était créé à Bône et les premières régates à être courues dans les eaux algéroises se disputaient le 22 juillet 1923. L'année suivante voyait de nouveaux clubs naître à Oran, Arzew, Philippeville, Bougie et Mostaganem.
L'Algérie a fourni son contingent de champions. Chacun se souvient des succès prestigieux des fameux équipiers bônois en " deux barré " qui, champions de France, ont brillamment représenté la France aux Jeux olympiques de Berlin en 1936.
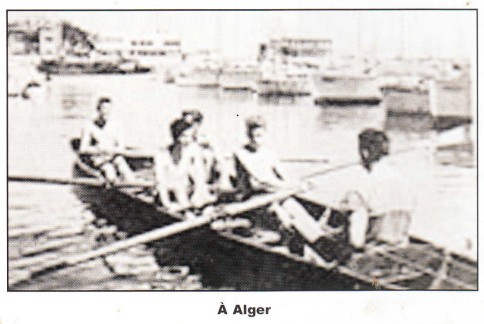 Ils s'appelaient " Tapie et Fourcade " et leurs noms dans les esprits ne peuvent être dissociés car ils ne faisaient qu'un, une "équipe" dont les exploits restent gravés dans les mémoires et demeurent un exemple que chacun s'efforce de suivre et d'imiter. Georges Tapie, en canoë simple, réussissait en outre I'exploit d'être champion de France en 1928, 1929,1930 et 1933, tandis que son club, le Rowing Club de Bône, enlevait le titre national en " quatre " et en " huit " en 1928 et 1930, et le " quatre " en 1929 et 1933, en yole de mer. Le même Rowing Club de Bône fut encore un brillant champion de France en 1938 en "quatre barré" et en "huit", performance unique pour un club en championnat de France " outriggers ". Ils s'appelaient " Tapie et Fourcade " et leurs noms dans les esprits ne peuvent être dissociés car ils ne faisaient qu'un, une "équipe" dont les exploits restent gravés dans les mémoires et demeurent un exemple que chacun s'efforce de suivre et d'imiter. Georges Tapie, en canoë simple, réussissait en outre I'exploit d'être champion de France en 1928, 1929,1930 et 1933, tandis que son club, le Rowing Club de Bône, enlevait le titre national en " quatre " et en " huit " en 1928 et 1930, et le " quatre " en 1929 et 1933, en yole de mer. Le même Rowing Club de Bône fut encore un brillant champion de France en 1938 en "quatre barré" et en "huit", performance unique pour un club en championnat de France " outriggers ".
En 1937, c'était I'athlétique " quatre " du Club Nautique d'Arzew qui s'adjugeait le titre national. Plus près de nous, le Rowing Club d'Alger s'octroyait à Alger même, en 1949, le titre de champion de France à " huit " (yole de mer), tandis que le même jour, le rameur Walgren, du Racing Universitaire d'Alger, enlevait le titre national en " canoë simple ". Depuis, et dès 1950, le Rowing d'Alger a participé à presque toutes les finales des championnats de France, manquant à deux reprises, et de quelques centimètres, le titre à "huit", le plus envié. Enfin, en féminin, le " quatre " dames de l'Aviron Oranais était champion de France 1952 et ne perdait son titre l'année suivante que d'une fraction de seconde.
Les clubs d'aviron, tous placés dans les ports et pratiquant sur les plans d'eau de ces havres où ils doivent disputer leur parcours aux bateaux de commerce, aux remorqueurs, aux pêcheurs, aux pilotes, ou faire la part du temps. disposent maintenant d'un instrument incomparable. La Ligue d'Algérie d'aviron a pu, en effet, mener à bien l'aménagement du splendide plan d'eau constitué par le barrage du Hamiz prés d'Alger, en vue de la pratique de ce sport. Deux kilomètres de parcours sur une eau constamment calme, protégée par les collines qui I'encadrent, dans un site enchanteur. Ce bassin paraissait avoir été réalisé pour les besoins de I'aviron tant il correspond aux normes exigées du bassin idéal pour la pratique de ce sport. Sa régularité naturelle a frappé et conquis tous les connaisseurs. En 1954 une structure nationale, la Fédération Algérienne des Sociétés d'Aviron, coiffant les trois ligues régionales d'Alger, d'Oran et de Bône, a été instituée.
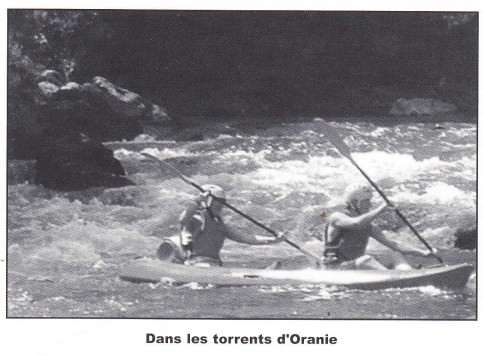 Depuis 1956 l'aviron n'a cessé de progresser aussi bien du point de vue des effectifs que de la qualité sportive. Le 26 novembre 1957 a eu lieu le premier Championnat Nationale avec vingt six équipages du Rowing Club d'Alger, du Sport Nautique d'Alger, de I'Aviron Oranais et du Rowing Club Bônois qui se sont affrontées. Depuis 1956 l'aviron n'a cessé de progresser aussi bien du point de vue des effectifs que de la qualité sportive. Le 26 novembre 1957 a eu lieu le premier Championnat Nationale avec vingt six équipages du Rowing Club d'Alger, du Sport Nautique d'Alger, de I'Aviron Oranais et du Rowing Club Bônois qui se sont affrontées.
J.M.L
|
|
PHOTOS DIVERSES
Envois divers
|
|
| À PEU PRÊT
De Jacques Grieu
|
Prêter est tout un art et souvent un dilemme
Où l’on doit… « s’apprêter » à subir des problèmes :
Refuser de prêter, c’est perdre des amis ;
Accepter de prêter vous crée des ennemis…
S’il ne faut pas prêter, alors, il faut... donner ?
S’il en coûte moins cher, pourquoi donc s’en priver ?
Donner fait des ingrats ? Oui, mais pas d’ennemis !
Cela prête... à sourire, mais la vie est ainsi.
Du mot latin « praesto » qui nous dit « sous la main »
Le prêt est comme l’homme et tout aussi ancien.
Qui n’est pas prêt à tout, en fait, n’est prêt à rien
Et près d’être un gredin, il n’est qu’un plaisantin.
Endormi dans les banques, il somnole dans les coffres
Façonnant des destins, il refuse ou bien offre.
Arme à double tranchant, certains prêts sont vaillants
Quand d’autres sont frileux, tendant des guet-apens.
« Celui qui donne aux pauvres, ainsi il prête à Dieu »,
Nous dit le vieux dicton plein de conseils fort pieux.
Mais qui donne à l’État prête surtout… à rire !
Et sans un résultat, ne pourra qu’en rougir.
Si pauvres sont certains que personne autour d’eux
Ne leur prête… attention ou n’écoute leurs vœux.
D’autres prêtent à Dieu de basses intentions :
C’est la mauvaise foi que je prête à leur ton.
Si les « prêts-à-porter » ne sont pas des porteurs,
Le « prêt à emporter » ne crée pas des prêteurs…
De même un « prêt salé » ne vient pas d’usurier !
Barrer au « prêt serré » n’accuse aucun banquier !
Jamais « prêter l’oreille » aucun sourd n’a aidé
Ni fait qu’il soit tout prêt à vous en remercier.
On se prête à autrui : on se donne à soi-même.
« Courir la prétentaine » est un autre système…
Être « prêt de ses sous », ce n’est pas investir
Et peut « prêter le flanc » à bien des repentirs.
Volontiers votre banque, un parapluie vous prête,
Mais dès qu’il va pleuvoir, veut que cela s’arrête.
Je suis prêt à parier qu’après les avoir lus,
À ces vers tourmentés, on prêtera des vues.
Prêter n’est pas donner : je peux donc protester,
Prétextant que leurs fins sont mal inter… prêtées.
Jacques Grieu
|
| |
FABLE TRADUITE DE L'ARABE.
Gallica : Revue d’orient, 1854-2 ; Pages 469
|
LA BOURSE ET LES TROIS AMIS.
J'avais, dit Ouâkédy, deux amis, dont l'un appartenait à la famille de Hâchem ; et notre affection mutuelle était si vive, que nous ne faisions pour ainsi dire qu'une seule âme. A la fête du beïram, une gêne extrême étant survenue dans mon ménage ; ma femme me dit : « 0 mon maître ! Quant à nous, nous pourrions bien supporter la misère et l'adversité ; mais mon cœur est brisé de chagrin et de pitié relativement à nos enfants, qui voient ceux de nos parents et de nos connaissances déjà parés pour la fête et remplis de joie. Je crois qu'il ne serait pas mal d'aviser au moyen de leur acheter quelques vêtements. » Ces paroles me parurent très justes, et sentant mon cœur subjugué par le récit de ma femme, je me mis à réfléchir ; puis j'écrivis à mon ami le Hachémite, pour le prier de me secourir en m'envoyant ce dont il pourrait disposer. Il me fit parvenir une bourse contenant mille dirhems; mais elle ne demeura pas longtemps entre mes mains, car je reçus de mon autre ami une lettre dans laquelle il se plaignait d'une gêne semblable à celle dont j'avais informé le Hachémite. Je lui envoyai donc la bourse telle quelle, et me rendis ensuite à la mosquée, n'osant paraître devant ma femme. Toutefois, lorsque j'allai la trouver et qu'elle eut connaissance de mon action, elle ne m'en fit aucun reproche.
Sur ces entrefaites, le Hachémite vint rapporter chez moi la bourse dont le cachet était intact, et il me dit : « Explique-moi donc ce que tu as fait de ce que je t'ai envoyé ? » Je lui racontai franchement l'affaire, et il reprit : « Tu m'as demandé de te secourir, mais je te jure que je ne possédais alors rien autre chose que la bourse que je t'ai envoyée. Bientôt après, je me suis vu forcé d'écrire à notre ami pour qu'il m'aidât, s'il le pouvait. Or, il est venu lui-même me remettre cette bourse encore scellée de mon cachet que je te rapporte aujourd'hui. Comme il est évident que nous sommes tous trois dans le besoin et que nous n'avons plus que cette bourse, eh bien! Il faut nous la partager. » Ouvrant aussitôt la bourse, le Hachémite donna cent dirhems à ma femme et répartit le reste entre nous, savoir : trois cents dirhems pour moi, trois cents pour notre ami, et les trois cents derniers pour lui.
La nouvelle de cette aventure étant parvenue aux oreilles du khalife Almàmoùn, il me fit appeler et me questionna sur l'affaire, que je lui racontai dans tous ses détails. Ensuite, il envoya chercher mes deux amis, et fit donner à chacun de nous mille dinars, plus mille dinars pour ma femme.
A. P. Pihan
|
|
MINISTRE de l’ALGERIE 1987
(Envoyé par M. C. Fretat) pages 21-56
|
|
DIRECTIVES
Directives générales destinées aux officiers et sous-officiers des armées de Terre, de Mer et de l'Air stationnés en Algérie.
Directives générales no 1 (avril 1956).
Directives générales n' 2 (août 1956).
Directives générales n" 3 (novembre 1956).
Directives générales n" 4 (avril 1957).
Directives particulières sur les relations humaines entre les citoyens des diverses communautés de I'Algérie (mai 1.957).
Directive aux responsables civils et militaires de I'Algérie (juin 1957).
DIRECTIVE GÉNÉRALE N°1
destinée aux officiers et sous-officiers
des armées de Terre, de Mer et de l'Air
stationnés en Algérie
De manière à vous permettre d'agir à tous les échelons avec le maximum d'efficacité, je juge nécessaire de vous définir personnellement, avec autant de précision que possible, I'action politique que j'entends mener en Algérie au nom du Gouvernement de la République. Cette directive n'est que le premier élément d'un contact que je désire établir avec tous les officiers et sous-officiers d'active ou de réserve en service ici.
Les droits imprescriptibles de la France
Je tiens, pour commencer, à exprimer avec une netteté absolue que les droits imprescriptibles en Algérie ne comportent dans mon esprit aucune équivoque.
Le souvenir des vains sacrifices consentis en Extrême-Orient, certaines campagnes de presse, des intrigues regrettables, des menaces même venant de l'Etranger ont pu donner à penser à l'Armée que, lancée dans une aventure sans issue en Afrique du Nord, elle ne bénéficiait ni du soutien de l'opinion publique française, ni de l'appui total des Pouvoirs publics.
Je tiens donc à affirmer de façon péremptoire ici que les troupes d'Algérie peuvent à tout moment compter sur mon appui inconditionnel dans leur action pour le rétablissement de l'ordre et la pacification de ce pays. En contrepartie, je leur demande de me faire confiance pour le guider progressivement dans le sens que j'expose ci-dessous. J'ai enfin le plus grand espoir que l'opinion nationale alertée sur l'importance du problème d'Algérie, appuiera de plus en plus nos efforts en vue de rétablir ici la paix dans la justice.
Il ne faut pas s’illusionner sur la facilité avec laquelle nous résoudrons le problème algérien ; ce problème est immense et de nature complexe, à la fois politique et militaire. II ne faut s'attendre à aucun miracle. Mais je suis absolument persuadé qu'il est soluble et qu'il est à la mesure de notre pays. Cela demandera, sans doute, du temps et de grands efforts dans tous les domaines, ainsi que beaucoup de foi et d'abnégation. Tout cela je sais que I'Armée peut le donner ; je lui demande plus : elle doit servir d'exemple à tous les éléments de la population algérienne.
Les nouvelles formes de l'association Métropole - Algérie.
Il est nécessaire que vous sachiez sur quelles idées générales repose I'action politique et psychologique à laquelle l'Armée doit participer.
En premier lieu se pose le problème des modalités d'association entre la Métropole et le territoire algérien. Le parlement a reconnu explicitement une certaine « personnalité algérienne ». Tous les Français sont d'ailleurs unanimes aujourd'hui pour estimer que le département d’Oran, par exemple, ne peut avoir le même statut que I'Ardèche ou le Lot-et-Garonne.
La cohabitation de deux communautés (française de souche et musulmane) impose d'ailleurs à l'Algérie un statut particulier.
Ce dernier existait depuis 1947, mais il faut avoir le courage de reconnaître qu'il n'a jamais été complètement appliqué. cependant, il est aujourd'hui dépassé. Il faut donc en établir un nouveau. Le Gouvernement s'est engagé à ne pas en décider sans le concours de représentants élus de l'Algérie - de manière à amener la population locale à discuter non pas de sa présence dans la communauté française (posée en postulat formel), mais des formes de l'association « Métropole-Algérie ».
Il faut pouvoir arriver à une période de détente en Algérie pour réaliser cette réforme de base.
Les éléments d'une politique nouvelle.
Faut-il attendre ce moment qui tardera sans doute pour promouvoir une politique nouvelle ? Je ne le crois pas, parce que c'est très largement dans la mesure ou nous appliquerons cette politique que l'Algérie pourra retrouver une stabilité qui, je le précise, ne peut en aucune manière amener un retour à la situation précédente.
Un fait brutal s'impose à nos yeux aujourd'hui. Une masse de quelque 8 000 000 de Français-musulmans, dont une grande partie est sous-évoluée, sous-administrée, sous-employée et sous-alimentée, subit un accroissement important qui l'augmentera encore d'un quart en dix ans. Cette masse est travaillée par une propagande d’origine étrangère, xénophobe et fanatique. Cette propagande, servie malheureusement par d'innombrables erreurs ou hésitations de notre part, a commencé à creuser un profond fossé entre cette masse et une communauté française dite « de souche », minoritaire mais dynamique, vivante et jalouse des droits qu'elle s'est acquis sous le légitime prétexte des efforts consentis pour développer le pays. Ces droits se sont parfois, d'ailleurs, traduits en fait par un régime préférentiel.
Ces deux communautés ont tendance, chacune, à se replier sur elles-mêmes. Dans certaines régions, c'est un fait complètement acquis.
Les Français dits de souche ont souvent, en effet, des réflexes de conservation leur faisant oublier que la coexistence leur est imposée et que cette coexistence ne peut valablement s'appuyer sur la force seule. Il faut absolument qu'ils se pénètrent de cette réalité.
Les Français-musulmans, sous l'influence de propagandes faciles, ne se rendent pas compte que les formes sous lesquelles d'aucuns veulent les faire évoluer sont incompatibles avec la vie moderne dont, cependant, ils revendiquent de plus en plus les avantages matériels. Soumis à une propagande guidée de l'extérieur qui tente de se couvrir d'un prétexte religieux pour développer une agitation xénophobe, ils regardent avec attention l'évolution rapide - trop rapide - de deux jeunes Etats voisins en se demandant si le fait d'avoir la même Foi ne leur confère pas « ipso facto » une nationalité différente de la nôtre. Terrorisés par les crimes d'une atroce sauvagerie, ils se laissent glisser vers une passivité totale en doutant de la volonté de la France et de sa justice.
De ces constatations, il peut se dégager les éléments d'une action qui s'inscrit bien évidemment dans une politique générale sur le plan international qu'il ne m'appartient pas de définir ici, mais qui implique l'abandon d'un certain nombre de slogans périmés qui, par un hasard déplorable, sont souvent contraires à nos intérêts, et une solidarité interalliée dont on a pu parfois douter.
Ce qui se passe en Algérie n'est qu'un aspect d'un conflit mondial gigantesque où certains pays musulmans, avant de s'effondrer dans le désordre, cherchent, suivant des méthodes hitlériennes, à instaurer une dictature envahissante sur une partie du continent africain.
Nous livrons dans ce pays un combat qui est celui de I'Occident, celui d'une civilisation contre I'anarchie, de la démocratie contre la dictature. Il faut s'en pénétrer pour en comprendre toute l'importance. Nous défendons non seulement les droits acquis par la France en Algérie, mais le droit des gens à disposer d'eux-mêmes, autrement que sous la terreur. Nous luttons pour la liberté.
La préoccupation dominante de ma politique est déterminée par la nécessité de rapprocher les deux communautés locales en leur redonnant confiance I'une dans l'autre et toutes deux dans la Métropole.
Etant donnée la situation réelle et insuffisante des Français-musulmans, il est normal qu'un puissant effort politique, économique et social soit fait en leur faveur.
Cet effort doit présenter l'aspect suivant :
1°) Il faut transformer, révolutionnairement l'économie de ce pays afin de lui permettre :
a) d'assumer la vie de tous ses habitants suivant un standing suffisant ;
b) de répondre aux exigences d'une démographie « galopante » qu'il est moralement et matériellement impossible d'endiguer..
2°) Il faut transformer socialement ce pays afin de l’amener à un niveau comparable à celui des pays occidentaux, en bouleversant une armature périmée, et, dans ce but, il convient :
a) de lui donner une Administration, non pas pléthorique à sa tête, mais au contraire fortement étoffée dans ses prolongements sur le terrain ;
b) de mélanger Ies deux communautés au sein de cette Administration, pour éviter que l'une ait l'impression d’être gouvernée exclusivement par l'autre.
3°) Il faut enfin donner une éducation politique élémentaire à des masses sous-développées, afin de leur permettre ensuite de participer valablement à la gestion des affaires algériennes et, plus loin encore, de la communauté nationale.
Tout cela suppose donc la promulgation de réformes politiques, administratives et économiques dont j'entends vous donner les grandes lignes ici même.
Réformes d'ordre politique.
J'entends promouvoir, dans un délai très bref (et sans attendre le retour au calme de l’ensemble du pays), une réforme des institutions municipales ou communales qui sera appliquée aussitôt dans toutes les régions calmes ou pacifiées.
Le but poursuivi est de découper les actuelles communes mixtes en groupes de douars ou villages qui auront à élire des délégués locaux du plus petit échelon ; à défaut d'élections, dans les zones troublées, ces délégués pourront être désignés. C'est à ce stade que nous pourrons donner l'éducation civique évoquée plus haut. Des conseillers subsisteront à l'échelon groupes de villages, mais le corps caïdal sera supprimé.
Si la pacification totale tardait à se produire, j'envisage de proposer au Gouvernement la recherche, à travers ces responsables locaux et suivant un mode de désignation qui reste à préciser, des représentants dont nous pourrions avoir besoin pour définir le statut général évoqué plus haut et qui remplacera celui de 1947. Ce statut devrait s'insérer dans un ensemble auquel il convient de penser dès à présent et qui conférerait à la République une armature moins rigide, laissant à l'Algérie en particulier toute son originalité.
Je tiens à préciser à ce sujet, de la façon la plus nette, que le fait d'avoir été hier un « interlocuteur » du gouvernement, sur le plan de l'Algérie, ne confère, dans mon esprit, aucun droit à être, demain, un représentant de ce pays à un titre quelconque.
Réformes d'ordre administratif et social.
Une grande partie de nos difficultés d'aujourd'hui provient de la sous-administration de ce pays, dont, je n’ai pas besoin de souligner les énormes inconvénients. En outre les Français-musulmans ne figuraient jusqu'à présent que dans des proportions infimes parmi les grades supérieurs de l'administration.
Dans le but de remédier à cet état de fait, les mesures suivantes ont été prises :
a) La création de huit départements nouveaux, auxquels s'ajouteront les territoires du Sud, sans préjuger du statut particulier qui sera donné à ces derniers, vient d'être décidée.
Cette armature départementale s'appuiera notamment sur le corps des officiers S.A.S. qui va être porté de 400 à 600 officiers, lesquels serviront de guides et de tuteurs aux régions jugées les plus intéressantes.
b) Le décret du 17 mars 1956 favorise, transitoirement, l'accès de la fonction publique aux Français-musulmans. Ces derniers, en effet, se trouvaient jusqu'à présent désavantagés, en fait, par rapport aux français de souche en raison d'une part de I'insuffisance de la scolarisation, ensuite par le milieu «linguistique » dans lequel ils vivaient.
Le décret du 17 mars prévoit transitoirement, pour eux, un recul de cinq ans des limites d'âge et, par dérogation exceptionnelle, un recrutement sur contrat (au lieu des concours traditionnels) portant au maximum sur la moitié des emplois vacants.
Enfin, les deux tiers des emplois vacants d'auxiliaires de l'Administration seront recrutés désormais, parmi les Français-musulmans, avec priorité aux anciens combattants, pour lesquels en fait jusqu'à présent n'existait guère de préférence et auxquels je désire porter rapidement le plus d'attention possible.
c) Dans un ordre d'idée différent, un décret tendant à unifier et à simplifier le régime de l'Assistance médicale gratuite, jusqu'ici fort insuffisante dans les campagnes, a été soumise à l'approbation du ministre des Finances.
Les dépenses afférentes à ce budget seront prises en compte désormais par le budget général de I'Algérie, ce qui évitera que les municipalités, par souci d'économie, n'entravent le fonctionnement du régime d'assistance générale. On peut attendre de ce décret une très importante amélioration.
d) Enfin, une mesure extrêmement importante, au point de vue psychologique, est la décision d'instituer, en Algérie, une « retraite des vieux » à l'instar de ce qui va être en vigueur en métropole. Je n'ai pas besoin de souligner ce que cet effort financier a de considérable, et on peut en attendre de grands résultats.
Réformes d’ordre économique.
Il ne peut être question de donner ici le détail du plan de développement de I'Algérie que je viens de mettre en route : il porte sur dix ans et entend suivre les lignes générales suivantes :
a) Développement intensif de I'agriculture, pilier fondamental de l'économie de ce pays avec, en priorité, une action massive en faveur de l'agriculture musulmane traditionnelle, refonte complète du crédit agricole, effort pour le prolétariat agricole (salaires), etc., etc...
b) Industrialisation systématique de I'Algérie. Il est bon de souligner, à cette occasion, que non seulement les projets sont abondants, mais que même à cette époque, les demandes d'investissements de capitaux privés en Algérie sont Ioin d'être arrêtées... et que, contrairement à ce qu'on estimait il y a quelques années, les possibilités sont importantes.
L'ensemble des réformes énumérées ci-dessus ne constitue qu'un court début ; il est loin d'être limitatif. Je n'ai voulu faire état que de ce qui a été décidé ou promulgué à la suite de la loi sur les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire depuis environ deux mois.
c) Résorption de l'excédent massif de la main-d'œuvre par une éducation professionnelle rationnelle et par l'organisation méthodique de l'émigration..
Rôle de l’Armée.
Mais tout ceci ne peut être valablement développé que si la confiance renaît, et, par suite, si l'ordre revient.
Pour ce faire, l'action de l'Armée est décisive et capitale.
Par sa présence d'abord, et par sa fermeté ensuite, l'Armée doit rétablir l'ordre dans ce pays. Je connais assez son esprit et ses traditions pour savoir qu'elle saura ne pas abuser de cette directive.
Je suis sûr que vous aurez à cœur de rester constamment humains ainsi que l'exige l'honneur de la France. D'autre part, il convient absolument de se garder des provocations des rebelles qui, en développant le terrorisme, visent à déclencher des actes incontrôlés de représailles qu'ils montent en épingle, afin de créer les apparences d’une guerre d'extermination et dresser contre nous l'opinion internationale et les grandes puissances dont ils recherchent le concours sur le plan diplomatique. C'est par une discipline consciente et sans faille et des actions concertées, qu’il convient de répondre au terrorisme.
Tout en détenant la force, l'Armée représente, en fait, un des éléments de contacts les plus valables que je possède avec la population.
Je désire que chaque officier et sous-officier soit, dans sa sphère, le défenseur des idées que j'expose ici (et que je compléterai), même s'il n'y apporte lui-même qu'une adhésion morale limitée. Je vais même plus loin : je désire, d'accord avec vos chefs, que vous surveillez l'exécution de certaines de ces mesures, en vous assurant qu'elles sont diffusées et même appliquées.
Je n'entends pas vous expliquer, ici, comment je souhaiterais que s'exerce sur le terrain votre action militaire. Bien qu'elle ne me soit pas indifférente, c'est, dans ce domaine, l'affaire de vos chefs. Avec eux, je recherche, dès à présent, les formes les plus adaptées pour gagner plus vite cette guerre des nerfs qui nous est imposée et je pense qu'il faut donner à votre action un sens aussi complet que possible.
On a dit et répété que tout conflit est, à la base, un conflit d’idéologies. Mais, contrairement à ce qui pourrait se passer en d’autres lieux, et même si, derrière eux, se dessinent l’inquiétante propagande communiste et la passion conquérante de l'Islam, nos adversaires d’aujourd'hui, les terroristes, les rebelles n'ont d’autre idéologie que celle d’évincer la France d'Algérie. Ils n’ont, dans ce conflit « intérieur » qu’ils veulent transformer en conflit « extérieur », ni théorie, ni armature valables. Ils tentent de remplacer par un véritable racisme (que l’action inconsciente de certains Français a, hélas ! parfois favorisé) l’absence de toute doctrine politique. Ils cherchent à justifier, par une parenté religieuse, l'ingérence inadmissible de l’étranger.
A cette absence d'idéologie, nous pouvons opposer non pas une idéologie particulière, mais celle que l'épreuve actuelle peut revigorer, l'idéologie « nationale », l’amour de ra France. L’immense capital de culture et de générosité de notre pays est, en effet, à peine mis à contribution pour l'Algérie. Il vous appartient de m’aider à l’attirer ici. Car nous ne bâtirons une Algérie nouvelle qu’en donnant à cette population franco-musulmane, encore souvent fruste, l’égalité intégrale des droits et des devoirs avec la France métropolitaine pour satisfaire sa dignité et son légitime amour-propre.
Il nous faut prendre ces trois mots de « Liberté, Egalité, Fraternité », issus de la Révolution française, comme la définition de notre présence ici. Personne ne peut prétendre que nous puissions donner mieux à l'Algérie.
Pas d'ingérence étrangère en Algérie.
Je ne puis passer sous silence l'influence, considérable pour l'Algérie, de ce qui se passe en Tunisie et au Maroc.
Il est évidemment bien tentant pour tous ces jeunes états voisins de chercher, sur notre dos et à notre dépens, des dérivatifs spectaculaires aux réalités souvent ingrates d'une indépendance qu’ils ont réclamée si fort. Pourtant il est bien dangereux pour eux de rechercher ainsi un brevet de panarabisme auprès de donateurs qui ne leur accordent pour appui que des excitations à la haine et des armes pour assassins.
Ce que j'affirme avec certitude, c'est que le maintien intégral de la présence française en Algérie conditionne formellement l’existence des régimes tunisien et marocain qui, sans elle, s'effondreraient dans l'anarchie, et je sais que leurs dirigeants le savent même s'ils ne peuvent en convenir
Je tiens cependant à dire ici, avec fermeté, que je ne tolèrerai aucune immixtion tunisienne ou marocaine en Algérie, dussé-je m'y opposer par la force, Il en sera de même, et je I'ai déjà montré, de toute ingérence étrangère, d'où qu'elle puisse venir.
Je sais enfin tout l'écart qui sépare Alger de l'Algérie, et mon bureau des vicissitudes quotidiennes de tous les habitants de ce pays. Je tente, dès cette semaine, de le combler par le déplacement d'envoyés spéciaux au courant de mes intentions et munis de pouvoirs étendus.
En ce qui vous concerne, je crois savoir vos difficultés, vos inquiétudes, vos doutes et même vos colères. Quand on ne me les apprend pas, je crois que je les devine, et, ancien combattant de 14-18, j'évoque en pensant à vous la fameuse légende de Forain : « Pourvu qu'ILS tiennent ! »
Pour vous donner la confiance, je tiens à vous dire que la mienne est immense. Certes, nous aurons, demain encore, de très grandes épreuves à surmonter dans ce pays où le calme ne renaîtra pas soudainement. Mais ces épreuves ne doivent pas vous effrayer puisque comme moi vous croyez dans notre Patrie et que cette foi est votre raison suprême de porter l'uniforme.
Je vois dans l'épreuve algérienne une raison de croire à un renouveau de la France.
Il est toujours sorti quelque chose de grand des tempêtes de notre Histoire.
Robert LACOSTE.
Avril 1956.
DIRECTIVE GÉNÉRALE N°2
destinée aux officiers et sous-officiers des armées de Terre, de Mer et de l’air stationnés en Algérie
Voici trois mois que, dans une première directive générale, j'ai tracé à votre intention les grandes lignes de l'action que j'entendais mener avec vous en Algérie. (Voir dossier : Algérie 1956 « Pacification »)
Il est nécessaire de faire aujourd'hui le point, en examinant d'abord, scrupuleusement et honnêtement, comment s'est exercée cette action pour déterminer ensuite en quel sens nous devons la poursuivre.
L’adhésion de la métropole.
Un événement considérable s'est produit au cours du dernier trimestre : la Métropole tout entière, consciente de l'importance de cette lutte, a consenti un immense effort pour en assurer le succès. Sac au dos, bataillons après bataillons, près de 200 000 hommes ont débarqué en Algérie, doublant les effectifs déjà stationnés sur ce territoire.
Tous ces hommes qui ont été enlevés à leurs foyers et à leurs travaux et qui avaient pu être ébranlés par une propagande subversive ou défaitiste, ont compris, dès leur arrivée, le sens de leur présence et montré un courage et un dévouement auxquels je tiens à rendre hommage une fois encore :
Le Français est ainsi fait que les circonstances périlleuses régénèrent et renforcent son patriotisme.
L'effort consenti est lourd : effort financier et surtout effort humain. Mais tout le monde doit savoir que la France unanime entend le poursuivre: la voie que nous suivons est sans retour.
Après la libération des « disponibles », nos effectifs demeureront à peu près inchangés. Nos adversaires se bercent d'illusions s'ils croient que notre effort militaire est temporaire. Les effectifs d'Algérie ne varieront guère jusqu'au retour au calme.
Pas d'hésitations devant Ies influences extérieures.
La réalisation de nos projets n'est pas toujours facile. Assez paradoxalement, ce n'est pas tout d'abord en Algérie que je rencontre des difficultés, mais dans les inquiétudes maladives de certains milieux d'origines diverses qui, avec une légèreté coupable, propagent l'impression d'une certaine hésitation de la France devant le terrorisme algérien. Ils offrent ainsi l'occasion à l'Etranger de tenter de s'immiscer inconsidérément dans I'affaire spécifiquement française qu'est l'affaire algérienne. Ainsi les récents commentaires portés sur l'Algérie par trois chefs d'Etat étrangers ne méritaient qu'un haussement d'épaules alors que certaine presse inquiète les a mis au contraire en vedette.
Nous nous heurtons, en effet, à des influences extérieures importantes : du Caire on attise la révolte et il se trouve assez d'âmes crédules parmi les populations d'Algérie pour se laisser séduire par les faux paradis du panarabisme et entraîner par les appels haineux du colonel Nasser.
Les intrigues de grandes puissances autour de la Méditerranée et dans le Moyen-Orient ne facilitent pas toujours l'action de la France. Mais je forme l'espoir que ces nations comprendront que l'éviction de la France en Afrique du Nord constituerait la pire menace pour la paix.
En ce qui concerne la Libye, il n'y a pas lieu de penser que la position définie le 14 juin dernier au conseil des ministres puisse être modifiée tant que ce pays conservera son attitude actuelle : nos troupes n'abandonneront pas les garnisons du Fezzan conquises par Leclerc tant que la Libye continuera à accorder son aide à la rébellion. Quant aux autres pays voisins, la surveillance que nous exerçons à nos frontières réduit considérablement l'appui que certains de leurs habitants et leurs organisations panarabes tentent d'apporter aux rebelles algériens. De plus, il semble que ces Etats aient compris notre détermination dans l'affaire algérienne. on est en droit d'espérer qu'ils en admettront toutes les conséquences : en effet, à mesure que la paix reviendra en Algérie, la Tunisie et le Maroc (où d'inquiétants soubresauts se produisent encore), recouvreront, j'en suis persuadé, une sérénité conforme à leurs propres aspirations qui assurera la sécurité de nos intérêts légitimes.
Ce qui a été fait depuis trois mois.
a) sur le plan militaire : tout en assurant la mise en place du vaste «quadrillage » dont j'ai parlé plus haut et qui doit assurer à tous les Français, musulmans et européens, une protection efficace, les forces armées ont effectué, dans tous les secteurs, d'innombrables actions de maintien de l'ordre, sauf dans certaines régions bien déterminées, l'action des rebelles s'est dispersée et leurs bandes ont éclaté.
Il convient de noter que si une amélioration sensible s'est manifestée dans certaines régions, d'autres, par contre, ont été gagnées par la rébellion. Cela parce que les bandes rebelles, durement éprouvées, essaient de se reformer en d'autres régions et aussi parce que notre dispositif militaire n'a été mis en place que tardivement.
Si nos pertes sont douloureuses, elles sont faibles en comparaison de celles de l'adversaire ; mais combien sont encore nombreuses les imprudences ; en effet, sur trois soldats tués, un l'est par imprudence et un autre par accident.
De nombreux officiers et sous-officiers participent à I'administration du pays, en dehors même des S.A.S. Certains font revivre des écoles abandonnées. L'assistance médicale gratuite, déjà donnée par 140 médecins militaires qui secondent les médecins civils, vient de recevoir un nouveau renfort fourni par des centaines de médecins militaires.
75 jeunes Français-Musulmans volontaires servent déjà en métropole dans des écoles d'officiers. D'autres sont recrutés chaque jour.
En général, je suis satisfait de l'esprit que manifeste l'Armée dans sa mission de pacification. Toutes les personnalités de passage en Algérie en ont été frappées et ont tenu à me le dire.
b) sur le plan administratif :
La création de départements nouveaux est décidée et en cours de réalisation, cependant que I'administration centrale a été profondément remaniée.
Le découpage des communes mixtes s'exécute et, à partir du 15 septembre, je serai en mesure d'instituer les nouvelles communes.
c) sur le plan de la fonction publique :
L'accès aux emplois des Français-Musulmans en Algérie n'est plus une promesse mais une réalité : 2 300 candidatures ont été enregistrées dont 750 ont été déjà retenues ; parmi les nouveaux promus on trouve des administrateurs civils, des attachés de préfecture, des secrétaires d'administration, etc... Leur mise en place se poursuit.
d) sur le plan économique et social :
Les préfets ont reçu des crédits importants afin de réaliser des travaux d'équipement et d'employer le plus grand nombre possible de travailleurs.
La commission destinée à réaliser la réforme agraire a été constituée et a commencé ses travaux ; en ce domaine, d'amples réalisations vont intervenir dans un proche avenir.
La revalorisation des salaires agricoles a été réalisée. L'armée a très opportunément signalé, dans certaines régions, Ies infractions à son application.
Nous ne faisons que commencer ; il n'est pas possible de faire tourner à plein rendement, du jour au lendemain, une énorme machine comme l'Algérie. Mais l'impulsion initiale est donnée. Le mouvement ne fera que s'accélérer.
Ce qu'il faut faire maintenant.
Il ne m'appartient pas de m'immiscer dans la conduite des opérations militaires. Je m'en remets de cela à vos chefs directs qui ont toute ma confiance. Je désire cependant qu'à tous les échelons de votre hiérarchie le maximum d'initiative soit laissé aux subordonnés, dans les limites de la prudence, pour que, en cas de besoin, ceux-ci puissent réagir instantanément et avec efficacité sans être retenus par le formalisme administratif.
J'ai donné à vos chefs, voici quelques semaines, des instructions précises concernant I'organisation et la pacification. Comme j'entends que tous, à tous les échelons, participent à cette tâche, j'en rappellerai ici l'essentiel (Lettre du 10 juillet 1956 aux officiers généraux exerçant un commandement en Algérie).
Contact avec la population musulmane.
Rétractée et fermée dans les villes, meurtrie et malheureuse dans les campagnes, terrorisée partout, la population musulmane se trouve souvent dans l'impossibilité de faire les premiers pas vers un rapprochement avec la communauté française de souche : il convient donc d'aller au-devant d'elle.
Dès maintenant et partout où est présente l'Armée, cette prise de contact devra être recherchée systématiquement, à tous les échelons et par tous les moyens. lI y aura peut-être même lieu, dans certaines régions, de conférer un caractère d'obligation aux rencontres des Français des deux communautés.
Je désire que partout ou se trouve un corps de troupe, soit recherché le contact individuel personnel et humain avec les Français-Musulmans et particulièrement avec les anciens combattants.
Je n'ignore pas les difficultés pratiques, matérielles ou linguistiques auxquelles vous vous heurterez et je devine certaines réticences. Il convient de les surmonter. Seuls les actes comptent : c'est en bâtissant, en travaillant auprès des Musulmans, en les aidant à améliorer leurs conditions de vie que l'on parviendra à gagner leur amitié et leur confiance.
Dans les agglomérations importantes, pour seconder l'effort des organismes civils, je désire que les militaires servent de trait d'union entre les deux communautés et je ne peux ici que vous demander à tous de faire preuve dans ce domaine d'imagination et d'initiative.
Je tiens cependant à faire à nouveau ici des réserves très nettes concernant la nature de ces contacts sur le plan « politique » : il ne saurait être question d'exclure a priori tous les représentants franco-musulmans valables qui ont jadis travaillé à la mise en valeur de ce pays ; je pense cependant qu'il faut aussi tirer de l'anonymat le plus grand nombre possible d'hommes nouveaux. Ils existent, je le sais, et peu m'importe leur origine ou leur niveau social. Je désire que soient recherchés des contacts avec des gens qui ne puissent être soupçonnés par leurs coreligionnaires ni par nous-mêmes d'être « tarés », bref avec des hommes neufs. (Il ne devra même pas leur être reproché d'avoir pu, à un moment donné, douter de la France).
Dans un domaine différent, je viens de donner des instructions afin que tous les jeunes Français métropolitains servant en Algérie soient informés des possibilités qui leur sont faites de s'implanter dans ce pays s'ils le désirent à l'expiration de leurs obligations militaires.
Je fais étudier d'urgence les moyens de leur offrir un avenir dans l'administration algérienne dont le déficit considérable ne saurait être comblé par le seul recrutement de Français-musulmans, si accéléré soit-il.
Pour pallier dans l'immédiat la sous-administration dont souffre l'Algérie, il est indispensable que les officiers et sous-officiers prennent l'initiative d'aider sur le terrain, chaque fois que cela paraîtra nécessaire, I'administration civile, encore trop peu nombreuse. L'administration préfectorale a reçu des directives à cet effet. Dans ce domaine l'Armée peut jouer un rôle considérable en secondant l’effort entrepris pour créer systématiquement de l'emploi pour la masse de Français-Musulmans en chômage partiel ou total. Présente partout en Algérie et au contact direct de la population, I'Armée doit compléter l'action de l'administration par I'ouverture de chantiers et la mise en route de nombreux « petits travaux ». A titre d'essai et dans cet esprit, je viens de faire déléguer à une préfecture une dotation exceptionnelle dont l'emploi sera décidé sur initiative des autorités militaires locales, après simple avis de l'autorité civile correspondante pour éviter les doubles attributions.
Interpénétration des populations métropolitaine et franco-musulmane.
Il importe enfin de favoriser le plus possible, l’interpénétration des populations métropolitaine et franco-musulmane d’Algérie. Toutes les initiatives dans ce but doivent être encouragées ou stimulées. C’est ainsi que l'envoi de jeunes Musulmans dans les écoles professionnelles de la métropole, la création de colonies de vacances, les échanges d'étudiants, etc., sont de nature à favoriser la politique que j'entends promouvoir. Le parrainage de certaines cités, voire même de certaines petites localités est une excellente initiative, à condition toutefois qu'il ne soit pas uniquement symbolique, mais s'attache à développer des échanges fructueux et l'appui matériel des collectivités métropolitaines.
Foi, initiative.
Nous entrons maintenant dans une phase décisive pour l'exécution de la « Directive générale » du 19 mai dernier : depuis quelques jours notre dispositif militaire est en place et l'armée est à peu près partout. Je m'assure actuellement qu'elle sera relayée en temps opportun par une administration civile plus dense que par le passé. Nous avons donc tous les moyens de pacifier l'Algérie.
Mais j'entends aller vite, car il ne faut pas laisser davantage dans la crainte et l'incertitude les populations menacées par le terrorisme. Ceci requiert de votre part Foi et Initiative.
De la Foi, car c'est en vous pénétrant de votre mission en Algérie que vous ferez rayonner autour de vous l'amour de la France.
De l'Initiative, car c'est une somme d'efforts individuels et particuliers que nous réussirons auprès de populations que les vastes programmes laissent indifférentes.
Plus que jamais je crois en la mission de la France ici. Je suis sur qu'elle se reconnaît aujourd'hui en vous.
Robert LACOSTE.
Alger, le 18 août 1956.
DIRECTIVE GÉNÉRALE N° 3
destinée aux officiers et sous-officiers des armées"
de Terre, de Mer et de I'Air stationnés en Algérie
Six mois se sont passés depuis que je vous ai tracé les grandes lignes de la politique de la France en Algérie (Directive générale du 19 mai) que je vous ai ensuite précisée (Directive générale n" 2 du 18 août).
Je pense qu’il est utile de faire aujourd'hui, à nouveau, avec vous, le point de la situation générale, afin de vous définir ensuite quelle action il convient de mener au cours des mois à venir.
Volonté française.
Il est tout d'abord un premier fait qu'il convient de souligner, c'est le changement de climat psychologique qui entoure maintenant l'affaire Algérie. Après des mois d’hésitations, de scrupules, de doutes, de craintes, notre peuple a compris le formidable enjeu que représente l'Algérie dans la vie nationale. Ses réactions, en face de pressions extérieures inadmissibles, ont été celles d'une nation fière de ses traditions et de son droit. Le défaitisme a changé de camp : les rebelles et tous ceux qui les soutiennent, directement ou indirectement, savent maintenant qu'ils n'obtiendront plus de victoire par les armes : leurs chefs capturés l'ont officiellement avoué.
Le deuxième fait très important est qu'à travers la tempête, l'Algérie a continué et continue de vivre et que ceci est non seulement une preuve de la persévérance et de la foi de ses habitants, mais surtout une justification très puissante de tous nos espoirs. Les récoltes sont en nette progression sur I'an dernier, la construction se développe, la masse générale des salaires augmente, etc', etc"'
Certes, localement, certains d'entre vous discernent, à I'endroit où sont, des indices parfois complètement opposés à ceux que j'indique ici.
Certes, des régions peu surveillées ont pu être gagnées récemment par la lèpre de la rébellion.
Certes, beaucoup de critiques, parfois justifiées, peuvent être faites à notre action...
Il n'en reste pas moins que lorsqu'à I'échelon suprême du commandement en Algérie, nous nous penchons sur la situation d'ensemble de ce pays, il est parfaitement net qu'une amélioration substantielle s'est produite : s'acheminant lentement vers le retour au calme. Des inquiétudes pèsent encore sur le développement de cette amélioration : menace aux frontières, intrigues donnant à douter de notre esprit de détermination. Comme je vous le disais il y a six mois, il ne faut s'attendre à aucun miracle.
Enfin, convient-il de ne pas nous laisser trop influencer par le terrorisme et, notamment, par le terrorisme urbain dont les effets affreux et spectaculaires ne doivent pas nous décourager. Ils démontrent au contraire à la face du monde, par les meurtres de femmes et d'enfants innocents, la lâcheté de nos adversaires et leur impuissance pour s’attirer, par des voies normales, I'adhésion de la population.
Je tiens à souligner à cette occasion à quel point il est dangereux d'assimiler la ville d'Alger à l'Algérie et combien il faut se garder de formuler une opinion précipité.
Situation internationale.
Dans mes directives précédentes, j’ai toujours insisté sur l'importance qu'avait en Algérie la situation internationale et notamment le rôle des pays voisins.
II convient de commenter aujourd'hui quelques événements récents :
L'attitude des deux jeunes Etats voisins, la Tunisie et le Maroc, ne s'est pas améliorée à notre égard. Nos frontières sont I'objet de violations incessantes de la part d'éléments troubles qu'ils paraissent tolérer trop facilement. Certains propos officiels constituent autant d'ingérences dans les affaires intérieures de notre pays. J'éprouve une certaine stupéfaction à constater qu'en parlant si fort d'indépendance, ces Etats ne respectent pas toujours celle de la France qui leur a donné naissance et oublient trop volontiers l'importance de l'aide matérielle que leur apporte notre pays.
Quoi qu'il en soit, je viens de prendre des décisions destinées à faire respecter plus strictement I'intégrité de nos frontières.
Quant à l'Egypte, dont l'ingérence dans les affaires françaises a été démontrée de façon éclatante par l'arraisonnement de l'« Athos » qui apportait soixante tonnes d'armes aux rebelles, son gouvernement vient de subir une série de leçons qui, on peut I'espérer, calmera ses appétits déraisonnables :
Le désastre militaire que lui a infligé une petite nation voisine et l'occupation internationale du canal de suez imposée par notre intervention armée sont des éléments positifs et nets qui n'ont pas assez été mis en vedette. L'arrestation spectaculaire des chefs rebelles algériens, outre qu'elle portait un coup terrible à la rébellion, a prouvé par ailleurs à ceux qui voulaient encore en douter la complicité et le soutien que l'Egypte accordait à celle-ci.
Il serait incomplet de parler de l'influence extérieure dans les questions d'Algérie, sans souligner: l'évidence, aujourd'hui démontrée, de la collaboration communiste avec la rébellion. La récente arrestation de terroristes communistes qui n'ont pas hésité à assassiner haineusement des femmes et des enfants, prouve à quel point I'influence de Moscou tendrait à s'étendre sur le continent africain si nous n'y mettions obstacle : puissent les yeux de certains de nos alliés traditionnels s’ouvrir à temps sur ce problème.
Quant à I'O.N.U. où certains pays, à peine parvenus aux limites inférieures de la civilisation, prétendent nous imposer leurs conseils, la France n'a pas l'intention de reconnaître sa compétence dans l'affaire algérienne, et encore moins de s'y justifier en coupable : elle veut seulement profiter de sa tribune pour présenter quelques exemples de civilisation que tous pourront méditer en ramenant, par la même occasion, cette organisation à son rôle véritable.
La plupart des différentes réformes d'ordre politique, économique et social prévues par mes directives précédentes, sont en cours d'application. Mais comme je vous l'ai dit, cette application sera forcément longue et leurs résultats ne seront pas immédiatement perceptibles. Aussi ne vais-je vous développer aujourd'hui que la mise en œuvre de la plus importante.
La réforme communale : consignes.
C'est par la base que j'entends entreprendre de construire avec vous une Algérie nouvelle. Rien de solide ne peut être fait sans fondations. Trop de cerveaux bouillants et passionnés jettent au vent des solutions chimériques et vagues sans réaliser qu'aucune institution politique valable ne peut être mise en place dans ce pays, sans-fondements profonds.
Ces fondements, j'entends les trouver, comme je vous I'ai déjà dit, dans la mise en place d'une réforme communale qui est entrée dans les faits et qui se réalise en ce moment.
Soixante-dix-huit « communes mixtes » (je ne parle aujourd'hui que de celles-ci) et 158 centres municipaux couvrant les 4/5ème de la superficie totale de l'Algérie et groupant 5 800 000 habitants (soit plus des 3/5ème de la population) sont actuellement divisés en 1100 communes nouvelles environ, qui vont acquérir de plein droit leur autonomie de gestion.
Près de trois cents communes nouvelles sont déjà nées et les autres suivront. Leurs municipalités provisoires auront à assurer le plus tôt possible, les responsabilités que leur confère la loi. Partout où la mise en place définitive ne pourra se faire, il sera procédé à la désignation de responsables pour chaque « unité communale » ; ceux-ci s'entoureront d'un conseil de quelques membres.
Ainsi j'entends faire participer les populations (qui, je le sais, portent un intérêt profond à cette réforme), à la gestion de leurs affaires locales et même à leur propre défense.
Comme je vous l'avais dit, il y a six mois, c'est à travers ces municipalités que je conçois l'assise nécessaire du dialogue avec les populations. Ce dialogue est commencé, il a beaucoup plus d’importance que les imprécations ou les intrigues de certains pseudo-intellectuels.
Ce n'est pas faire œuvre de démagogie que d'aider la population française-musulmane à faire avec nous sa révolution en trouvant des hommes nouveaux pour remplacer ceux qui se sont gardé de courir les risques soit avec nous, soit contre nous, modelant leur attitude sur les vicissitudes de la lutte et les événements extérieurs.
Cette organisation communale doit être aidée par une administration diligente et efficace.
Ceci suppose un développement et un rajeunissement de cette administration qui sont entrés dans les faits.
Une instruction du président du conseil oriente désormais vers l'Algérie les jeunes gens sortant des écoles civiles, cependant que la majorité de l'Ecole nationale d'Administration arrivera en stage dans ce pays en janvier. Un décret du 27 octobre nous autorise à recruter des contractuels, afin de pourvoir à tous les postes de titulaires vacants.
Je vous rappelle enfin que les jeunes soldats démobilisés peuvent ainsi trouver une carrière ouverte cette administration est désormais répartie entre les douze départements nouveaux groupés eux-mêmes en trois inspections générales centrées sur Oran, Alger et Constantine.
Elle disposera, sur le plan communal, d'un puissant stimulant donné par la récente extension à l'Algérie des dispositions de la loi sur le Fonds national de solidarité : dans les communes fonctionnant normalement toute personne âgée de plus de soixante-cinq ans bénéficiera désormais d'une allocation annuelle de 21 000 francs (pour une personne seule et 36 000 francs pour un ménage), si ses ressources n'excèdent pas 200 000 francs par an. C'est dire à quel point va être bouleversé au fur et à mesure de la pacification, le régime de vie de certaines populations.
Ces populations vont, sur un autre plan, bénéficier de la réforme agraire. 115 000 hectares sont en cours de distribution par lotissements de grandes propriétés. Des centaines de milliers d'autres suivront.
Rôle de l’armée.
Quel est le rôle de l'Année dans cette politique de coopération ? Je n'entends pas reprendre ici les termes des instructions qui vous ont été adressées à ce sujet sur ma demande, par voie hiérarchique, mais j'estime, là encore, votre rôle capital, car à ces nouvelles créations vous pouvez apporter vos conseils, vos encouragements, et une protection nécessaire.
Dans le dialogue à entamer avec les notabilités locales, l'Armée, par le prestige qu'elle a su conserver, doit s'engager aux côtés de l'administration et, quand cela est nécessaire, à sa place. Je vous préciserai dans les jours à venir, quelles mesures de détail je compte promouvoir pour que chacun, dans la responsabilité que je lui donnerai, sache bien ce qu'il à faire.
Je sais qu'on vous demande tout aujourd'hui : protéger les populations, les soigner, les instruire, les faire travailler, parfois les administrer. Je vous prie maintenant de les aider dans leur politique locale puisque, dans cette étrange forme de conflit, l'action psychologique et politique se juxtapose étroitement à l'action militaire.
Enfin, il convient que I'effort produit cette année pour l'agriculture se poursuive sans relâche ; vous devez par tous les moyens favoriser l'ensemencement des futures récoltes.
Persévérance et espoir.
La phase purement militaire de votre action en Algérie s'achève en effet et tend à être progressivement remplacée par une phase politico-militaire ou la recherche du contact avec les Français-Musulmans à travers des institutions spécifiques sera le fil conducteur. Je vous réitère mes instructions précédentes pour rechercher dans tous les domaines le plus de contacts humains possible. Je sais qu'ils commencent à se multiplier.
J'espère que nos appels à la raison seront entendus. J’ai donné des ordres précis concernant les conditions de reddition des rebelles. (1).
Mais de façon générale pour tous les égarés non criminels qui viendront à vous en rappelant seulement qu'ils sont Français, sachez montrer cette indulgence dont notre pays peut être fier.
Je ne prétends pas détenir seul la vérité absolue en ce qui concerne ce qui doit être fait en Algérie. Je suis persuadé cependant que nul Français de cœur ne pourrait faire d'autre politique à ma place, parce que cette politique ne s'embarrasse pas d'intrigues, mais tente de s’inspirer du simple bon sens. Il n'est d’ailleurs pas besoin de génie pour avoir le sens national. Je prétends seulement avoir celui-ci, comme tous les soldats que vous êtes.
Il me semble que par l'effet de notre obstination et de la continuité dans notre action, I'Algérie va pouvoir sortir du tunnel obscur de la rébellion.
Je vous salue vous tous qui combattez en Algérie pour que la France règle seule, en nation souveraine, un problème angoissant, sans avoir besoin des conseils intéressés de pays encore arriéré. Je salue tout particulièrement les Français-Musulmans en civil ou en uniforme qui n'ont jamais désespéré de la cause qu’ils défendent en combattant à nos côtés, le fusil à la main. A ceux-là, je promets que demain leurs sacrifices ne seront pas oubliés.
Ces dernières semaines ont vu, sur le plan international, un certain nombre de faits qui ont permis de juger, comme à tous les instants critiques, les réflexes de la nation, et je sens que notre armée se sent de plus en plus appuyée par la confiance de celle-ci. Je suis persuadé que si nous avons de l'énergie et de la patience dans ce pays, nous vaincrons la rébellion et nous construiront tous ensemble une Algérie nouvelle.
Robert LACOSTE.
Alger, le 30 novembre 1956.
1) REDDITIONS EVENTUELLES DE REBELLES.
1°) La reddition est un acte volontaire qui comporte la remise de l’arme ou à défaut un témoignage non équivoque de sincérité.
2°) Toute autorité régulière civile ou militaire peut accepter une reddition. Elle délivre aussitôt au rebelle qui se rend une attestation-provisoire valable jusqu'à une date limite et renouvelable. Cette attestation vaut fiche d’identité provisoire et sert de sauf-conduit à l’intéressé.
3°) Les attestations provisoires visées au paragraphe précédent sont remplacées par des pièces définitives à la diligence de l’autorité préfectorale.
DIRECTIVE GENERALE N°4
destinée aux officiers et sous-officiers des armées
de Terre, de Mer et de I'Air stationnés en Algérie
Nous avons pris l'habitude de faire ensemble, périodiquement, le point de la situation. Je vais donc tâcher aujourd'hui de vous dire aussi exactement que possible où nous en sommes maintenant en Algérie.
La Situation d’hier.
Dans ma dernière Directive Générale, je faisais état des excellents résultats obtenus, surtout dans certaines régions pendant la campagne d'automne.
Quelques jours après, une recrudescence d'activité de la rébellion remettait en cause ces premiers résultats de pacification et une vague générale d'insécurité en Algérie et de doute en France compromettait notre action.
Que s'était-il passé ?
Ayant mis au point un instrument politico-militaire que nous aurions tort de négliger, les chefs de la rébellion avaient porté tous leurs efforts sur l'internationalisation du problème algérien avec l'espoir que les Nations-Unies interviendraient dans nos affaires intérieures. Ils avaient soigneusement préparé une grève insurrectionnelle spectaculaire en portant au paroxysme un terrorisme aveugle dont la permanence décourageait la population.
Parallèlement, la Tunisie et le Maroc, misant sur notre traditionnelle indulgence, avaient laissé s'accroître sensiblement l'aide à la rébellion algérienne à partir de leur territoire.
Sous l'effet de ces facteurs conjugués, notre action a fléchi un instant. Mais vous savez, comme moi, que dans cette étrange forme de conflit (de même que dans les guerres classiques) il est des alternances d'avance et de recul.
Nous avons tenu bon et renforcé nos efforts. Nous avons été récompensés.
Les différentes couches de la population algérienne ont pris aujourd'hui conscience de notre détermination et réalisé que notre lutte contre la rébellion ne peut s'achever dans l'équivoque. Cette détermination est certainement le facteur principal du succès.
Après la dure période de tension des mois de décembre et de janvier, nous avançons à nouveau, selon un progrès constant, vers les buts que nous nous sommes assignés : pacifier l'Algérie en lui donnant une physionomie nouvelle.
La situation d’aujourd’hui.
Les chefs de la rébellion ont, en effet, échoué dans leur dessein d'internationaliser le problème algérien. Non seulement l'Assemblée des Nations-Unies n'a voté aucune résolution hostile à la politique française, mais encore leur tentative a cimenté en France un sentiment national qui se réveille chaque fois que I'Etranger paraît vouloir se mêler de nos affaires.
Il convient de noter surtout que nos amis américains ont compris enfin la sincérité de nos projets et la portée de nos efforts, et se sont expressément opposés aux entreprises des pays soutiens de la rébellion.
Cet important résultat fut facilité par l'échec de la grève générale et des projets insurrectionnels, échec suivi d'une rigoureuse offensive menée contre les bandes rebelles et contre l'infrastructure politico-militaire de la rébellion. Cette offensive a été couronnée par la destruction d'une partie importante de son appareil central de direction et la prise d'un nombre considérable d'armes et d'engins de guerre. Il en est résulté notamment une indiscutable détente dans les grands centres urbains ou la fréquentation scolaire, par exemple, est à nouveau normale.
Sur les frontières, notre système de surveillance et de défense s'améliore maintenant de jour en jour.
Dans la Métropole, je note une fois de plus que si certains milieux soi-disant responsables demeurent maladivement attachés à des solutions d'abandon et se livrent à une incessante opposition à notre action, par contre la majorité de l'opinion publique fait confiance à nos efforts.
Le chiffre total des exactions rebelles est en régression constante depuis deux mois et la vigueur du travail militaire et policier à Alger même a changé complètement l'atmosphère de cette ville. La «bataille d'Alger » que la rébellion nous a imposé en février a été gagnée par une action énergique. Cette victoire a évité une sanglante insurrection.
II convient de se féliciter d'avoir ainsi échappé à de graves dangers qui eussent pu renverser la situation générale à notre détriment.
Il serait dangereux toutefois de relâcher notre effort au vu de cette amélioration générale et notable ; notre tâche reste difficile, mais j'espère que la conviction de tous dans le succès final est maintenant établie.
Les réformes.
Je reviens à nouveau ici sur les principales réformes entreprises afin de vous montrer que nous avons continué à bâtir dans la tempête. Je vous invite à relire mes précédentes directives pour mesurer le chemin accompli.
a) Accès des Musulmans à la fonction publique.
Plus de 5 000 demandes de Français-Musulmans pour accéder à la fonction publique tant dans l'Administration centrale que dans les collectivités locales, ont été déposées. Plus de 2 000 fonctionnaires ont pu être ainsi nommés à ce jour.
Parallèlement, sur le plan militaire, près de 250 élèves-officiers français-musulmans sont entrés, ou déjà sortis avec leurs galons, de nos écoles militaires.
b) Réforme communale.
1107 communes nouvelles ont été créées ; elles procèdent comme vous le savez du découpage des anciennes communes mixtes. 419 « délégations spéciales » sont installées dont 292 sont présidées par des Musulmans.
Ces nouvelles collectivités sont pourvues maintenant d'un crédit de démarrage qui leur permet de s'initier aux responsabilités locales.
Par ailleurs, les 333 conseils municipaux des anciennes communes dites de plein exercice ont été dissoutes pour être remplacés progressivement par des organismes de gestion permettant une représentation paritaire entre les deux communautés de la population. Ceci est déjà fait pour 70 communes environ.
c) Réforme agraire.
Le lotissement et la répartition des grands domaines expropriés se poursuit.
Par ailleurs, une série d'expropriations va permettre la constitution d'une série importante de petites propriétés de quatre hectares qui vont permettre le recasement imminent de 35 000 personnes environ
Il n'est pas jusqu'aux Territoires du Sud ou 300 lots sont en cours d'attribution. Mais toutes les précautions nécessaires pour que cette réforme soit une réussite entraînent, il faut en convenir, des délais assez longs dont ne s'étonnent pas ceux qui ont étudié à l'étranger des réformes agraires en voie de réalisation.
d) Fonds spécial d'aide aux personnes âgées.
Près de 300 000 personnes âgées peuvent bénéficier désormais de ce fonds créé en Algérie par l'extension de la loi sur le fonds national de solidarité quelque 40 000 personnes âgées (en très grande majorité des Musulmans) perçoivent déjà leur allocation trimestrielle.
Je ne traite ici que quelques-unes des grandes rubriques sur lesquelles on nous fait fréquemment grief de piétiner : il est certes facile de tout critiquer de façon systématique quand on n'a aucune responsabilité et surtout quand on ne connaît ou qu'on ne veut connaître qu'une partie des éléments du problème. Mais ces critiques ne te découragent pas. L'opposition acharnée que ces réformes rencontrent de la part du F.L.N. montre d'ailleurs que nous sommes dans la bonne voie : il suffit, ici comme ailleurs, de tenir.
La Sous-administration.
Comme je vous l'ai signalé dès ma première directive, un des fléaux de ce pays est sa sous-administration, mal chronique qui n'a fait qu'empirer depuis le début des troubles en Algérie.
Il y a environ 50 000 fonctionnaires ici. Pour une population égale en nombre, la Belgique en a 250 000 et sa population bien plus évoluée est loin d'avoir nos besoins.
II est normal de constater que l'insécurité qui règne en Algérie décourage quelque peu les fonctionnaires métropolitains de venir ici, mais il faut trouver des remèdes rapides, car Ies populations pacifiées doivent être administrées avec diligence.
Outre les mesures que je vous ai précédemment signalées, j'ai donc demandé au gouvernement de provoquer, si cela est possible, un véritable « dégel » de la fonction publique métropolitaine au profit de l'Algérie et en tout cas d'envoyer ici par priorité tous les jeunes fonctionnaires.
Ceci risque d'être encore insuffisant; en tout cas, les effets de cette mesure ne sauraient être immédiats. Il appartient encore à l'Armée de faire un nouvel effort pour sortir de cette ornière d'accord avec vos chefs, je viens de décider que dans deux départements-pilotes sera instituée à la base une véritable administration civile et militaire où le commandement mixte appartiendra aux chefs de secteurs. L'Autorité militaire locale essaiera, dans toute la mesure du possible, de suppléer, avec les moyens dont elle dispose, à l'insuffisance de l'Administration civile.
Mais il faut bien reconnaître que, malgré ces palliatifs, la sous-administration de l'Algérie restera longtemps un phénomène angoissant.
C'est cependant dans le sens d'une très large « décentralisation » que j'ai orienté I'administration.
En superposant sur la cellule de base qui est la commune, les arrondissements et les départements jusqu'aux trois Inspections Générales d'Alger, Oran et Constantine, je pense que nous respecterons cette mosaïque naturelle d'intérêts divers et de territoires différents qui composent I'Algérie à des paliers variés d'évolution.
Ainsi peut s'entrevoir la structure même de ce pays qu'une centralisation outrancière à bridé trop longtemps.
Nouvelle orientation.
Comment faut-it maintenant orienter votre action ?
Tout d'abord il faut vous convaincre profondément, à tous les échelons, de ce que la « guerre révolutionnaire » que nos adversaires nous obligent à mener, nécessite une vigilance et une attention constantes. La rébellion a cherché à implanter partout une infrastructure clandestine politico-militaire dans le but de s'approprier le pouvoir réel et d'entraîner toute la population dans une action de subversion générale ou d'étouffement de la présence française. Cet appareil, qui est le moyen essentiel et le plus efficace de la guerre moderne, doit permettre de l'adversaire de gagner définitivement la partie même s'il la perd militairement. Il convient de l'extirper et de le détruire, sinon tout effort est stérile.
Mais le travail psychologique et politique que j'attends aujourd'hui de l'Armée en Algérie est aussi important que son activité purement opérationnelle.
Il vous faut partir d'un postulat simple mais formel : à une population française-musulmane souffrante et terrorisée par la rébellion, nous ne devons demander qu'une chose : la reconnaissance de la Patrie française et de notre drapeau, et c'est tout. On peut concevoir, en effet, que les habitants de ce pays soient hostiles à la politique du gouvernement, opposés aux méthodes de I'Administration, défavorables aux projets variés de statut étudiés pour l'Algérie ; c'est leur droit, puisque nous entendons conserver à nos compatriotes ou qu'ils soient la liberté de penser et de s'exprimer. Mais il convient absolument qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent vivre sans une Métropole avec laquelle des liens impératifs ne sauraient être tranchés.
Je vous réitère «l'autre part des instructions précédentes concernant la nécessité de prendre des contacts humains nombreux et directs avec la population française-musulmane, qu'elle soit rurale ou urbaine.
Je pense que vous devez orienter ces contacts en opposant aux slogans chimériques et enflammés de la rébellion ce que la F'rance apporte dans ce pays : la libération réelle et la promotion individuelle de chacun de ses habitants, hommes et femmes.
Nous entendons, en effet, dans les années à venir, et progressivement, aider à s'émanciper de leurs vieux préjugés et des servitudes de la misère des masses encore ignorantes ou mises à l'écart des bienfaits de la civilisation. De plus, une atmosphère se créera peu à peu qui incitera la population féminine à réclamer elle-même les changements qu'imposent la vie moderne et le besoin d'émancipation. Il convient de travailler dès maintenant à fait le naître cette atmosphère ; je fais étudier actuellement, sur le plan juridique, les possibilités de modifier la condition légale de la femme musulmane.
Vous prendrez par ailleurs comme directive que l'amour-propre et la dignité de la population française-musulmane locale doivent être strictement sauvegardés. Un siècle de coups d'épingles a rendu son épiderme sensible ; sachons le reconnaître avec équité et agir en conséquence. Dans le domaine pratique, je prie aujourd'hui, à titre d'exemple, les militaires comme les fonctionnaires (et de façon générale tous les Européens de ce pays) de cesser d'employer le tutoiement systématique avec les français-Musulmans comme on le fait trop souvent au nom d'un usage désuet et périmé.
Enfin je ne saurais répéter assez ce que je vous ai déjà dit : la mise en place des nouvelles communes et le démarrage de leur activité nécessite la promotion d'hommes neufs et jeunes ; cette mise en place requiert de votre part une sollicitude absolue et prioritaire.
Une attention particulière sera donnée à la jeunesse musulmane. vous encouragerez la formation de groupements sportifs ou éducatifs, bref de groupements « constructifs » qu'il conviendra de guider.
J'attache beaucoup d'importance à la scolarisation ; mais la scolarisation totale est matériellement impossible en Algérie dans un avenir rapproché. Il faut cependant réaliser : nous nous orientons donc vers une simplification de l'enseignement et de la construction des classes qui, je l'espère, portera bientôt des fruits. Il nous suffit, en effet, provisoirement, d'arriver au niveau des temps modernes la partie de la population qui est encore au stade moyenâgeux ; ceci est d'ailleurs vrai dans tous les domaines.
Une nouvelle donnée du problème.
Un événement capital est enfin de nature à modifier considérablement le destin de I'Algérie et de la France : la découverte de considérables ressources minières et surtout pétrolières du Sahara. Ces découvertes, qui sont, semble-t-il, à l'échelle mondiale, doivent confirmer notre pays dans sa vocation africaine et justifier davantage tous les efforts de la métropole pour ramener le calme dans cette Algérie qui est la clef du Sahara.
Le Sahara algérien, en effet, ou se trouve jusqu'à présent la quasi-totalité des nouvelles découvertes, doit entrer dans une communauté économique française plus vaste, dont le développement aidera considérablement la mise en valeur de l'Algérie septentrionale.
Par-là notre Patrie doit retrouver les éléments de puissance et l'indépendance qui lui faisaient défaut depuis longtemps.
Avec ces nouveaux éléments, elle peut reprendre tout naturellement la place qui lui revient en Europe et dans le monde.
L'Afrique du Nord tout entière est normalement promise à une vocation « occidentale » et seule notre civilisation est capable de la tenir hors du chaos. Seule aussi une Algérie profondément unie à la France peut empêcher les pays voisins de sombrer dans le désordre, puis dans le communisme qui anime maintenant quasi officiellement la subversion.
L'Armée française est aujourd'hui plus que jamais garante de notre présence en Afrique. Elle porte presque seule sur ses épaules le poids de la lutte contre la rébellion algérienne et je crois qu'elle en a conscience. Elle va trouver dans cette tâche l'occasion de devenir une des armées du monde les mieux initiées aux concepts modernes de la guerre « en surface » et de la « guerre révolutionnaire », tout en restant profondément humaine.
Le pays tout entier a les yeux fixés sur les troupes d'Algérie - et la France retrouve aujourd'hui par vous cet esprit patriotique que certains croyaient disparu.
Je vous renouvelle toute mon affectueuse confiance : Nous resterons en Algérie, non parce que nous sommes les plus forts, mais parce que nous avons raison.
Robert LACOSTE.
Alger, le 3 avril 1957.
DIRECTIVE PARTICULIERE
sur les relations humaines entre les citoyens
des diverses communautés de I'Algérie
Dans ma Directive générale n° 4 du 3 avril 1957, adressée aux Forces armées, j'ai rappelé la nécessité d'éviter, par des attitudes ou propos maladroits, de heurter la dignité de la population française-musulmane.
J'ai demandé à titre d'exemple que les militaires comme les fonctionnaires cessent d'employer le tutoiement systématique avec les Français-Musulmans comme cela se fait encore trop souvent au nom d'un usage désuet et périmé.
Je vous renouvelle aujourd'hui cette recommandation en vous demandant d'engager une sérieuse action psychologique dans un domaine qui ne doit pas être considéré comme secondaire au regard des événements actuels.
L'amour-propre des Français-Musulmans leur fait ressentir le tutoiement systématique comme un manque d'égard et de considération. Ils sont facilement tentés d'y voir une atteinte à l'égalité pourtant proclamée par les lois françaises et ce fait constitue à lui seul un obstacle sérieux à la politique de rapprochement et de compréhension mutuelle que nous devons réaliser à tout prix.
Il a déjà été dit avec raison que si le problème algérien revêtait des aspects complexes à la fois économiques, sociaux et politiques, il était également un problème de relations humaines.
Or, le premier but à atteindre, si l'on veut le régler durablement, est de parvenir à créer une ambiance de respect humain entre tous les citoyens et les communautés de ce pays quelles que soient leur langue, leur race ou leur religion.
En conséquence, j'invite instamment tous les fonctionnaires et agents des Services publics, à tous les échelons de la hiérarchie, et particulièrement ceux qui sont de par leurs fonctions mêmes en contact avec le public, à bannir de leur attitude et de leur langage aussi bien la condescendance que la vulgarité méprisante.
Les Français d'origine européenne doivent se convaincre de l'importance psychologique de leur comportement et du retentissement qu'il peut avoir sur les sentiments de loyalisme que la grande majorité de la population musulmane éprouve envers la France, en dépit des violences et de la terreur que voudraient faire régner les hors-la-loi.
L'ère de l'égoïsme inconscient et de la fausse supériorité est définitivement révolue. L'Algérie nouvelle, démocratique et française, est en marche.
Robert LACOSTE.
Alger, le 1er mai 1957.
DIRECTIVE
aux responsables civils et militaires de L'ALGERIE
L'hypothèque que la crise faisait peser sur notre action en Algérie est désormais levée : la volonté française d'édifier une Algérie nouvelle, liée indissolublement à la France, est à nouveau confirmée, en même temps que s'évanouissent les espoirs insensés de ceux qui pensaient infléchir notre politique algérienne vers des solutions d'abandon, à la faveur de la confusion provoquée par l'équivoque de certaines attitudes et de la pression de ceux qui, consciemment ou non, ont partie liée avec la rébellion.
Les responsables civils et militaires doivent, en conséquence, affronter avec une résolution accrue les obstacles qui nous séparent encore des buts assignés à la pacification, c'est-à-dire ramener le calme afin que s'épanouissent dans un climat de confiance et d'égalité les institutions nouvelles qui mettent à la disposition de tous les hommes de bonnes volonté de puissants instruments de coopération et du rapprochement.
Notre tactique doit s'inspirer des nécessités de la guerre subversive : face à un adversaire impitoyable qui, par tous les moyens, tend à s'assurer la maîtrise des populations, nous devons développer notre action générale en conjuguant étroitement moyens civils et militaires : d'une part, neutralisation des bandes rebelles et de I'infrastructure politico-administrative de la rébellion ; d'autre part, mise en place continue des institutions de coopération faisant appel à des hommes nouveaux, représentants authentiques des populations algériennes : tel est le double aspect d'une politique globale qui doit être étroitement animée et coordonnée de tous les échelons de la hiérarchie.
Notre adversaire a pris nettement conscience de l'enjeu décisif des prochains mois ; jusqu'à l'ouverture de la session de l'ONU, en qui la rébellion doit, cette année encore, placer ses espérances, il va s'efforcer d'intensifier son action dans le but de reprendre en mains une population qui veut participer à l'effort commun de libération. Nous devons, en conséquence, prévoir un redoublement d'activité rebelle qui, dans tous les domaines, risque de se manifester au moyen de violences accrues, et il nous appartient d'y faire face.
C’est pourquoi je recommande à tous la plus extrême vigilance et je rappelle I'obligation impérieuse de lutter, sur tous les fronts, contre un adversaire qui ne recule devant aucun excès. J'insiste sur l'intérêt capital de mener la lutte dans le bled et dans les villes avec une égale vigueur : l'agent de renseignements, le collecteur de fonds, le terroriste complètent et soutiennent l'action des bandes almées ; les uns et les autres sont les agents de la terreur qui pèse sur les populations et les empêche encore d'adhérer complètement, en dépit des signes multiples et renouvelés de leur bonne volonté, aux solutions démocratiques que nous édifions peu à peu.
Je vous demande donc d'agir sans ménagement en vers tous ceux qui prolongent inutilement les souffrances et les épreuves d'une population qui mérite notre confiance et notre estime.
Pour vous aider dans une tâche dont, chaque jour, je mesure les difficultés, le Gouvernement a préparé ou pris des décisions qui ne tarderont pas à faire sentir leurs effets ; il a, en particulier, demandé la reconduction de la loi du 16 mars 1956 sur les pouvoirs spéciaux.
Grâce à des renforts prélevés sur les troupes stationnées en Tunisie et au Maroc, grâce à I'amélioration de leur mise en état de défense, nos frontières seront mieux gardées, rendant ainsi plus périlleux un trafic d'armes auquel nous devons à tout prix mettre fin.
Soucieux de la nécessité d'assurer un juste équilibre entre moyens civils et militaires, et conscient des besoins accrus que, dans le domaine de l'administration civile, font naître les progrès de la pacification, je vais demander au Gouvernement d'envoyer en Algérie les renforts civils nécessaires, en commençant par les policiers.
J'ai demandé, en outre, de faire inscrire au prochain modificatif du budget de l'Algérie un volume important de crédits d'urgence qui permettent de développer, dans les zones pacifiées, les résultats acquis, grâce à l'action des forces armées.
Enfin, vont être sans délai entreprises les études au cours desquelles sera mis au point le projet de loi-cadre qui avec l'accord de tous les partis nationaux, définira le régime provisoire de I'Algérie, compte tenu des réalités naturelles et des institutions mises en place au cours des derniers mois.
La France a engagé son honneur et son destin en Algérie : tous ceux qui ont ici une part de responsabilités doivent durcir leur volonté afin de hâter le moment où, dans la paix retrouvée, notre patrie pourra guider les communautés d'Algérie vers un avenir de liberté et de prospérité.
Pour atteindre ce résultat, je compte sur le dévouement sans réserve et la pleine compréhension de tous.
Robert LACOSTE.
Juin 1957.
Algérie 1957, cabinet du ministre de l’Algérie
|
|
MON PANTHÉON DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE
DE M. Roger BRASIER
Créateur du Musée de l'Algérie Française
|
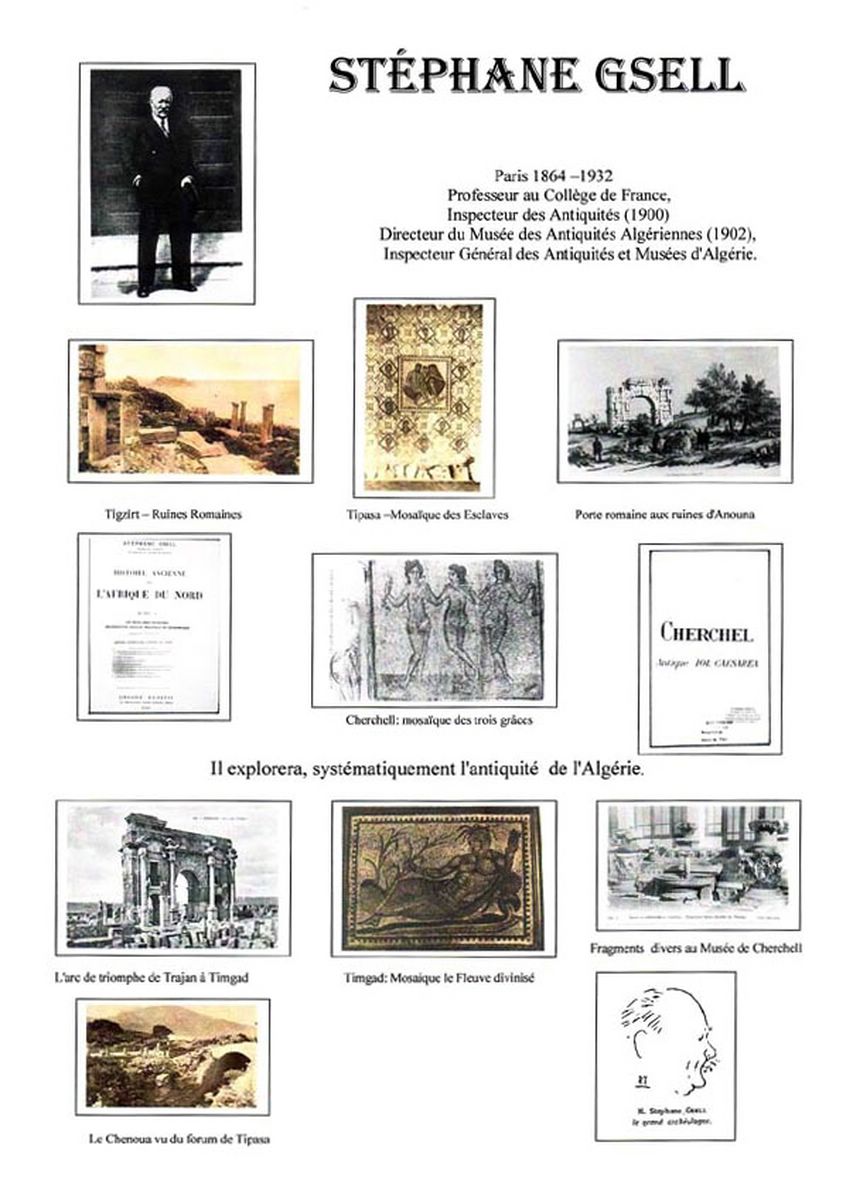 A SUIVRE
A SUIVRE |
|
PHOTOS DIVERSES
Envois divers
|
|
| ABSENTÉISME
De Jacques Grieu
|
Du latin « absentia », l’absence nous côtoie.
Le plus mauvais des choix est l’absence de choix.
« Briller par son absence » est… brillant contre sens
Et qui ne risque pas d’assurer la présence.
Si l’absence de preuve est preuve d’innocence,
La preuve de l’absence arrange la défense.
L’absence est signifiante et souvent décisive.
Jamais de vacuité vraiment inoffensive.
La critique la pire : absence de critique !
Qui pour certains auteurs est injure publique.
Si l’image est mensonge, absence de l’image,
Est encore mensonge. Il y a enfumage.
L’existence de Dieu ne serait qu’une absence ?
Mais l’absence éternelle est l’Enfer en puissance !
L’absence de raisons qui seraient bonnes à croire,
Fait que les hommes adhèrent à celles sans espoir.
Nier de Dieu l’existence est une prétention,
Qui fait que Son absence serait révélation.
Le bonheur serait-il, absence de soucis
Comme notre santé, absence en maladies ?
L’absence de désir est la morosité
Mais l’absence de doute est la sérénité.
La mémoire est miroir où l’on voit les absents
Où les trous de mémoire nous les tuent sûrement.
« Mieux vaudrait mauvais goût que l’absence de goût »,
Assurent des esthètes exempts de tout dégoût.
De certains, on supporte aussi mal la présence
Que la terrible absence. Est-ce une délinquance ?
De bien des expériences, les absences nous fondent
Mieux que de toutes celles éprouvées et fécondes.
Jacques Grieu
|
| |
« Mon Légionnaire »
Envoyé par Mme Annie Bouhier
|
« pour une réforme de la citoyenneté française ».
 Défilé des sapeurs lors de la Fête de la Légion, le 30 avril 2025,
Défilé des sapeurs lors de la Fête de la Légion, le 30 avril 2025,
Aubagne, France. JONATHAN BELIN/POOL/SIPA
« On entre dans la citoyenneté
par la langue, la culture et le mérite. »
Par Jean-Paul Brighelli.
Cet article est paru dans Causeur le 25 août. Avec le talent et l’intelligence qu’on reconnaît à Jean-Paul Brighelli, il dit à peu près tout ce que nous pensons sur le manque de discernement et de mesure avec lequel on accorde la nationalité française sous le régime actuel. On y entre d’abord par héritage, donc par naissance, dans une communauté historique constituée depuis de longs siècles. Dans quelle mesure, et sous quelles conditions, peut-on y entrer en venant d’ailleurs ? C’est ce que Jean-Paul Brighelli expose ici — et qui devrait être soumis, ce qui n’est plus le cas, au strict respect de l’héritage historique commun. Je Suis Français
Droit du sol, droit du sang, citoyens français par-ci, naturalisations par-là — et puis quoi encore ? s’interroge notre chroniqueur, plus radical que jamais. Ne serait-il pas temps de n’accorder la nationalité française qu’à ceux qui, d’une façon ou d’une autre, auront servi la France — par leur travail, par leur sens du devoir, ou par leur sang versé ?
Le 13 juillet dernier, trois légionnaires ont été admis à la citoyenneté française pour services rendus au pays de Montesquieu et de Clemenceau. La cérémonie a été empreinte de solennité et d’émotion, et les témoignages des trois nouveaux Français sont éloquents : la France, pour eux, n’est pas un dû, mais un devoir, et un espoir.
Droit du sol, dit la Constitution. Vous êtes né par hasard dans l’Hexagone, ou dans l’une de ses dépendances, et vous voici français. Belle performance ! Neuf mois de gestation involontaire, et vous voici citoyen d’un pays dont trop souvent vous n’avez que faire. C’est la version laïque du baptême que recevaient les nourrissons, une façon de vous intégrer a priori dans une communauté sans que vous l’ayez voulu. À ce compte, Giscard d’Estaing, né à Coblence, eût été allemand — et Balladur, né à Izmir, serait turc.
Droit du sang, disent les Allemands. Vous pouvez habiter l’Allemagne depuis trois décennies, y être né, y avoir eu vos enfants, travailler assidûment dans le pays, ni eux ni vous ne serez allemands : vous resterez Turcs, Tchétchènes — ou Français. Wolfgang passera toujours devant Orhan, fût-il prix Nobel de littérature.
Les deux solutions sont des pis-aller, des choix administratifs qui ne sont fondés sur rien de bien solide. Du coup, des enfants d’immigrés nés dans l’Hexagone se disent Algériens — ce qu’ils ne sont en rien, mais parce que leurs allégeances imaginaires vont à ce pays. Et pourquoi pas ? Pourvu qu’ils le soient réellement, sans prétendre aux avantages des Français de souche. Ou pourvu qu’ils y aillent.
C’est une question de droits et de devoirs. Un Français a le droit d’être inscrit gratuitement à l’école de la République, publique, universelle et laïque. Et il a le devoir d’en respecter les règles, par exemple de ne pas y apporter les oripeaux et les certitudes de ses superstitions. Un Français a droit à un certain nombre de prestations sociales — parce que ses parents et lui-même ont payé pour lui, au fil de leur vie et de leur carrière. La Sécurité Sociale et les aides diverses ne sont pas un dû, mais un rendu. À qui n’a rien donné à la France, la France ne doit rien.
« Je n’ai pas une goutte de sang français, mais toute la France coule dans mes veines », disait Romain Gary, né à Vilnius, naturalisé français à 21 ans, et Compagnon de la Libération. Apollinaire, né à Rome et naturalisé français en 1916, l’année où cet engagé volontaire fut grièvement blessé en première ligne, devait en dire autant, tout comme le légionnaire Blaise Cendrars, Suisse naturalisé Français par son héroïsme au combat, où il perdit un bras. Tous sont entrés dans la citoyenneté française par leurs actes, par la langue, par leurs œuvres, faisant là un grand romancier, ici un immense poète. Parce que parler français est à mes yeux un pré-requis. On entre dans la citoyenneté par la langue et par la culture. Et par le mérite.
Que méritent tous ceux qui exhibent leur nationalité française quand ça les arrange, et crachent sur la France à la première occasion ? Que méritent tous ceux qui se gavent d’aides diverses et ne rendent rien au pays, par leur travail ou leurs talents ? Que méritent les racailles qui, en arrivant à leur majorité, sont déjà « connus défavorablement des services de police », selon la formule consacrée ? Pourquoi auraient-ils droit aux mêmes douceurs judiciaires que les citoyens français respectueux de la loi ? La déchéance de nationalité, prévue depuis 1791 par la Constitution et le Code pénal, n’est pas assez appliquée. La privation des droits civiques — à commencer par les multiples subventions à la paresse et à la malfaisance — devrait être systématique en cas d’infraction grave. Et l’expulsion vers le pays de son choix, où l’on pourra vivre en toute liberté sous un joug religieux sévère, devrait être systématisée.
« Français », quel beau nom ! « Français », La Fontaine, Voltaire, Condorcet, Hugo et Flaubert. Ou Marie Curie, née Polonaise. Françaises, les armées qui sous la Révolution et l’Empire ont parcouru l’Europe en exportant partout ce qui s’attachait à ce nom — la liberté d’abord. Nous avons exporté la France dans des contrées qui ignoraient tout de cette liberté — à commencer par la liberté de penser et celle de ne pas croire : c’est cela d’abord, l’acquis positif de la colonisation. La IIIème République a fort justement décrété que c’était par l’instruction obligatoire que l’on s’attachait à un pays. Jules Ferry et ses amis n’auraient jamais imaginé qu’un jour, des pédagogues mépriseraient ce devoir de culture, inciteraient les enfants à raviver la flamme des cultures étrangères de leurs parents, et organiseraient le ramadan dans des écoles publiques.
Cessons de distribuer de façon automatique la nationalité française, si chargée de sens et d’émotions. Et accordons-la libéralement aux étrangers qui ont servi la France, par leur travail ou leur héroïsme — comme Mamoudou Gassama, qui en 2018 avait sauvé un petit garçon suspendu dans le vide à Paris. Ou Lassana Bathily, qui a reçu ses papiers de citoyen français onze jours à peine après avoir aidé à se cacher des clients de l’Hypercasher de la Porte de Vincennes — des Juifs sauvés par un musulman malien, pendant qu’aujourd’hui de prétendus Français versent dans l’antisémitisme de gauche et applaudissent la barbarie à visage inhumain. On doit être Français au mérite, et pas autrement. ■
|
|
CUJUS REGIO, EJUS RELIGIO
ACEP-ENSEMBLE N°294
|
|
« Telle la religion du pays, telle celle des hommes »
Voilà des décennies, plus d'un demi-siècle, que les Français sont les spectateurs anesthésiés de la colonisation de peuplement de leur pays par des populations extra-européennes de confession mahométane et pour la presque totalité d'entre elles, par des migrants originaires du Maghreb, du Machrek et de ressortissants natifs de pays sub-sahariens.
Il va de soi que ce n'est pas la religion musulmane en tant que telle qui nous inspire un quelconque rejet, n'est-elle pas elle aussi une religion monothéiste enseignée aux arabes par Mahomet (570-632), un prophète de la même inspiration divine, qu'Abraham, Moïse ou Jésus, mais l'entrée en Gaule depuis les années 1970, d'un grand nombre d'immigrants, autour de 15 millions d'individus indisciplinés pressés d'imposer en France leurs us et coutumes existentiels, aux antipodes, de nos traditions et valeurs républicaines.
Opportunément à cette conjoncture, souvenons-nous de la détestation que les bikbachis laïcs et religieux, maîtres à penser et à attiser les indépendances maghrébines, portaient à Marianne et aux Français, au point de prendre les armes contre notre pays. En fait, un djihad déjà, Une guerre sainte commencée en Tunisie en I'année 1952, et concomitamment à la même époque au Maroc, pour se poursuivre en Algérie le 1er novembre 1954, jour commémoratif au cours duquel la communauté catholique honore ses Saints. Pour se terminer en juillet 1962, après huit années d'un conflit mortifère, par l'exode des Français et I'aveu spontané des pyromanes : « NOUS ne sommes pas des gaulois ».
Aujourd'hui, les Gaulois de circonstance qu'ils sont devenus, évoluent sans aucune retenue dans notre espace hexagonal, en pays presque conquis, avatar plus que fâcheux que nient les « bons esprits » qui nous guident et ne voient, dans cette escalade, contrairement à l'avertissement pertinent de Clausewitz, théoricien militaire et auteur d'un traité célèbre intitulé « De la guerre » : « Le conquérant est toujours ami de la paix. Il préfère entrer chez nous sans combattre », qu'une péripétie de I'histoire exagérément grossie par les franchouillards xénophobes.
Du reste, comme tous ceux qui ne veulent ni voire ni entendre, nos bons samaritains et doctrinaires d'une France mixée et diversifiée vont, pour mieux faire passer leur message, jusqu'à oublier i'échec de la tour de Babel ; un épisode de la genèse. Les hommes de ce temps voulaient construire tous ensemble une tour aussi haute que possible pour atteindre Dieu. Une idée abracadabrantesque aussi saugrenue que toutes celles qu'accouche chaque jour le pouvoir en place à la satisfaction de ses thuriféraires. Aujourd'hui, nous comprenons mieux leur oubli de s'y référer quand on apprend que le rêve insensé de Babel se termina par un bide magistral reposant principalement sur la disparité ethnique et linguistique de ses promoteurs et locataires, nous comprenons encore moins leurs dispositions à accueillir à bras ouverts toute la misère du monde en déclarant : Aujourd'hui, en France, si nous pouvons nous réjouir de vivre dans une société qui est en paix selon certains critères de la paix biblique, Il nous reste à devenir les artisans de la justice pour tous ».
Bien sûr, tous ces encenseurs de la diversité ethnique, culturelle et cultuelle exercent leurs « activités de termite, c'est-à-dire d'insecte rongeur par l'intérieur » au sein de la classe politique, gauche et droite confondues. Depuis de longues années, cette caste d'intouchables n'a pas été capable de maîtriser ni même d'endiguer la vague déferlante de l’immigration, à croire qu'elle s'accommodait et s'accommode toujours de cette situation corrodante et inévitablement dommageable pour la Nation à terme. De nos jours, « les maîtres à penser correctement » vont encore plus loin et n'hésitent pas à abuser les Français une fois de plus, en leur faisant prendre Ies vessies pour des lanternes : I'islam est intégrable affirment-ils parce qu'il est tolérant par nature et constitue une religion comme les autres. Comment faire confiance à ces supposés bons pasteurs alors que l'histoire démontre qu'il n'y a pas deux islam, un islam agressif qui serait le fait d'une infime minorité d'extrémistes, les engins incendiaires, grenades et roquettes n'étant que les joujoux de « sauvageons » désœuvrés et un islam tolérant, le vrai, auquel adhérerait la majorité des musulmans.
En fait, I'islam a deux faces, l'une tolérante quand il n'est pas en position de force, un hadith recommanderait au croyant de baiser la main qu'il ne peut couper, l'autre intolérante et agressive en période d'expansion et de situation dominante [Ne faiblissez pas ! Ne faites pas appel à la paix quand vous êtes le plus fort [Sourate XLVII ? Verset 55].
L'islam a pour doctrine essentielle l'affirmation de l'unicité et de la transcendance absolues de Dieu, adoré sous le nom d'Allah. Par-là, il a conscience de rejeter dans le camp de l’idolâtrie les autres croyances et de s'imposer comme la seule religion digne de ce nom.
Pour les ASSOCIATEURS, « le père, le fils et le Saint-Esprit, nom donné par les mahométans aux catholiques, l’islam n'est pas une religion comme les autres. Il diffère en tout point du christianisme qui distingue le temporel du spirituel alors que L’islam puise sa force dans la théocratie, mode de gouvernement dans lequel l'autorité émane directement d'Allah, puissance relayée par les ayatollahs ou imams maîtres dans I'art de manier le cimeterre ou la dialectique dans le dessein d'amalgamer les sphères politique et privée dans la sphère religieuse.
Qu'importe, par le biais du laxisme exercé par les pouvoirs du moment qu'accompagnent les bigots des Eglises progressistes, les initiés des Loges et les castrats du politiquement correct, ce sont des millions de musulmans, qui sont entrés dans l'Hexagone le plus souvent sans frapper, soit entre dix, quinze, et vingt fois plus que durant les années 50/60. En son septennat, 1974/1981, Valéry-Giscard d'Estaing, à grands coups de petites phrases et de circulaires, avait tenté, sans grande volonté et souvent freiné par les démagogues de son premier cercle, Chirac pointait déjà son nez, de restreindre la colonisation de peuplement qui se dessinait. Rien n'y fit ; I'arrêt officiel de l’immigration en mai 1975, l'aide au retour initiée par Lionel Stoleru, un million de centimes (10.000 Frs de 1975) à celui qui retournerait au bled, l'arrêt de la délivrance de toute nouvelle carte de travail, la suppression de l’immigration familiale pendant trois ans ne connurent aucun prolongement.
La fermeture des frontières ne fut qu'une illusion. Les portes de la France restèrent entrebâillées, sinon ouvertes aux réfugiés, aux familles, aux étudiants, aux saisonniers, aux faux touristes et aux clandestins de tous poils. Quant à la circulaire de juillet 74 qui interdisait toute arrivée de nouvelles familles, elle ne fut jamais appliquée et le lobby pro-immigration accueillit avec « joie » le décret du 29 avril 1976 rétablissant officiellement l’immigration familiale, communément appelée : « regroupement familial »...
Présentement, plus de trente ans après, l’immigration extra-européenne se poursuit. Une seule raison à cela, la résolution prise par la paire GISCARD-CHIRAC de rétablir le regroupement familial. La mesure, approuvée par les libéraux et le patronat de leur entourage, fut un choix aberrant. Ce choix fut d'autant plus insensé, que six ans après le décret rétablissant le regroupement familial, « I'envoûteur » Jacques Chirac déclarait le 13 juillet 1983 : « le seuil de tolérance est dépassé, il faut contrôler I'immigration ».
Or, à ce jour rien n'a été fait dans ce sens, la situation perdure d'une manière gravissime, attendu que ce type d'immigration fut le cheval de Troie de l'entrée en France, « fille aînée de l'église catholique », de I'importante communauté islamique actuelle, dogmatiquement opposée à nos valeurs au risque de mettre en danger la cohésion nationale et, partant, la paix civile.
Quant à l'attitude des gouvernements de gauche, leur façon de concevoir les problèmes de l’immigration fut telle qu’elle ne mérite même pas qu'on s'y attarde. Leur manière d'agir fut à l’image de la permissivité de leurs lois et du laisser-aller de ses dirigeants. De plus, la profession de foi de François Mitterrand sur le sujet fut suffisamment claire : « ils sont chez eux, chez nous ».
De ce fait, la messe était dite et ne soyons pas surpris si, entre 1981 et 1995, des centaines de milliers d'immigrés sont entrés sans autorisation dans notre pays, avec la complicité des bons apôtres de « la religion des droits de I'homme », au nez-et à la barbe des gabelous et policiers découragés. Et ceci, avant que les décideurs politiques, porteurs du virus de la soumission, ne parrainent leur régularisation dans Ies Préfectures. D'autres immigrés, les plus nombreux, ont tiré avantage du regroupement familial, d'autres encore ont bénéficié du droit d'asile.
Il est urgent que le flou, savamment entretenu autour de l’immigration subie et de ses corollaires inacceptables, entre autres l’islamisation du pays, se dissipe et que les « beaufs », nom qu'utilisent les lyncheurs de banlieue pour désigner les Français, soient informés du nombre exact de musulmans résidant en France.
Combien d'entre eux sont de nationalité étrangère ; combien d'entre eux ont obtenu la nationalité française par naturalisation ; combien d'autres sont nés dans l'Hexagone et, de ce fait, sont devenus Français par le « droit du sol». Quel est le coût exact de la philanthropie obligatoire des contribuables.
Quoiqu'il en soit, nous savons et les imams le déclarent avec orgueil : I'islam est la seconde religion pratiquée en France. Dès lors, la communauté parle fort, revendique « son droit » d'ériger des mosquées, orchestre les prières publiques provocatrices, tente par la contestation de nos lois de nous imposer les siennes, celles dictées par la charia, à savoir l'ouverture d'écoles coraniques, le port du voile, l'interdiction du mari à sa femme de consulter un médecin masculin, la suppression du porc dans les cantines des écoles de la République (Astérix, le petit gaulois, gros mangeur de porcs sauvages, doit se retourner dans sa B.D...), la polygamie, les égorgements d'ovins et de bovins, etc. Cette communauté, par son art de vivre importé des pays d'origine, ghettoïse et orientalise les quartiers dits sensibles : folklore bruyant, boucheries halal, hammam, cafés maures, librairies islamiques, gargotes, épiceries et pâtisseries orientales etc, sont ouverts au public sans aucun contrôle des services de l'hygiène, de la sécurité, ni de ceux de l'inspection du travail et parfois, chéchia rouge sur le gâteau, une fatwa contre l'un ou l'autre d'entre nous, telle celle qui visait Robert Redeker, philosophe et enseignant Français, pour son livre intitulé « Face aux intimidations islamistes, que doit faire le monde libre ? » et sans oublier, évidemment, les réactions hostiles suscitées par les hommes d'ég1ise sur l’islam et la violence.
Mais il y a plus grave, l’ingérence des prosélytes dans les prisons, dans l'armée, dans les quartiers sensibles et parfois au cœur des cités lors d'émeutes impromptues ou de manifestations programmées en incitant les manifestants à rejoindre le courant activiste au cri de « Allah Akbar » qui signifie : « Dieu est le plus grand ». A quelle fin ces appels ?
Calmer ou encourager les émeutiers ? Compte tenu de l'engagement des aboyeurs auprès de la confrérie radicale des Frères Musulmans, la seconde hypothèse nous semble la plus vraisemblable.
Certes, il ne s'agit pas encore d'intifada. Cependant des voitures brûlent chaque jour, des pompiers et des policiers sont agressés et I'insécurité est permanente dans les banlieues dites sensibles... Il ne s'agit pas non plus d'appels formels à la guerre sainte, mais les « missionnaires barbus» qui parcourent les quartiers et labourent les âmes s'activent dans un but bien précis, celui de tester sur le terrain leur chance de propager I'islam dans le dar al-harb, c'est-à-dire dans le territoire non encore soumis à la religion islamique.
Doit-on conclure que nos sont aveugles ceux qui ne veulent rien voir, sourds ceux qui ne veulent rien entendre, car tout est prétexte aux pêcheurs en eau trouble pour entretenir l'unité des croyants et exalter leur foi en ALLAH, le seul Dieu, et en son prophète Mahomet.
Également tout leur est prétexte pour éprouver les conditions plausibles d'un djihad à la faveur de crises internationales liées à la guerre en Irak, en Afghanistan, en Palestine ou pour réclamer à cor et à cri l'autorisation de bâtir des mosquées en France et pour beaucoup d'entre eux de préserver l'économie souterraine dont ses profits sont générés notamment par la vente des véhicules et matériels volés à l'extérieur de nos frontières et par le trafic de drogue à l’intérieur.
A notre grand désespoir, la revendication de mosquées, prétention commune aux courants majoritaires de I'islam (chiite, sunnite et kharidjite) susceptibles de mobiliser les masses, rencontre déjà dans la communauté européenne l'approbation de tous ceux qui sont atteints du syndrome munichois. Quelle tristesse quand on sait que cette attitude de soumission face à la démonstration de force imposée par Berlin en 1938 et qui semble se répéter aujourd'hui par la faute des frileux et arsouilles bien pensants, fut le prélude aux décombres de notre pays en 1940. Il nous paraît que la leçon n'a toujours pas été retenue.
Cette fiévreuse appétence qu'a la communauté musulmane d'édifier des mosquées cathédrales en France n'est pas innocente. Il faut savoir et se rappeler principalement que ces édifices religieux furent de tout temps le premier champ de manœuvre de I'Islam. C'est de ces lieux de prière que partirent les grandes « épopées islamiques », entre autres celle qui se répandit autour du bassin méditerranéen. Guerrières ou pacifiques, ces odyssées se traduisirent par l’islamisation des pays conquis et leur purification des « souillures chrétiennes ». A ce sujet, nous rappellerons aux incrédules la déclaration que prononça Toufik el Madani, ancien responsable de l'association des Oulémas d'Algérie, devenu ministre des Habous, prenant possession d'une chapelle désaffectée à Constantine, le 28 août 1964, devant un parterre d'élèves de I'Institut islamique : « ...les traces les plus insupportables de la présence chrétienne dans notre ville auront disparu ». L'exemple étant officialisé, d'autres églises et cimetières furent profanés, les crucifix arrachés et les clochers rasés.
Ce détail fera peut être sourire les zélateurs de l’islamisation de la France. Nous les entendons défendre El Madani sur un ton badin : « Ce n'était qu'une déclaration de mauvaise humeur d'un Ministre Algérien, trop longtemps victime de la colonisation et des « tortionnaires de I'armée Française...durant les années de braise... ».
Ce fait, n'est pas sans nous rappeler le sort que les musulmans réservèrent à la basilique Sainte Sophie à Constantinople. Construite par Constantin en 336, enlevée par les musulmans Ottomans en 1453, transformée par les turcs en mosquée, la basilique est convertie en musée aujourd'hui. Rien de bien surprenant. La décolonisation nous a enseigné que la continuité s'inscrit dans la volonté de l'islam de « purifier » son espace. En effet, plus près de nous, la basilique Saint Louis à Carthage connut un sort identique. On se souviendra que le roi Louis IX y mourut de la peste devant cette ville alors qu'il entamait la huitième et dernière croisade.
Au lendemain de l’indépendance de la Tunisie, le premier geste politique de Habib Bourguiba dit, le « Combattant suprême », encensé par nos médias et présenté par les agents d'influence comme un musulman tolérant, fut de déboulonner, place de la Porte de France à Tunis, la statue du Cardinal Lavigerie, primat d'Afrique, fondateur des Pères Blancs, puis de « désaffecter » la basilique de Carthage, « métamorphosée » en musée paléochrétien. Ironie de l'histoire, on accède aux vestiges de l'ancien lieu de culte par l'avenue Mendés France, nom du bradeur de la Tunisie et médicastre de la décolonisation. C'est lui, en sa qualité de Président du Conseil, glorifié par les lobbyistes de la décolonisation, qui accorda I'autonomie interne à l'ancienne régence le 31 juillet 1954, trois mois après la chute de Diên-Biên-Phu 7 mai 1954 et trois mois avant le début de la rébellion algérienne le 1er novembre 1954.
Ainsi, à l'aube de la fin de notre Empire disparut la primatiale de feu l'Afrique chrétienne dans le silence complice des pharisiens.
En écoutant discourir certains hommes politiques, les néo-collaborateurs, encore et toujours, sur le « sexe des anges », nous nous interrogeons : quelle idéologie nébuleuse tentent-ils d'inoculer à notre société, chrétienne dans sa majorité, en vantant les bienfaits de l’immigration pour la France. Qu'attendent-ils de l'Islam ? Nous imaginons qu'ils ont oublié les leçons dispensées par leurs professeurs, par leurs confesseurs sur la mémorable histoire de I'Afrique chrétienne, celle de Cyprien, d'Augustin, de sa mère sainte Monique, et de tant d'autres. Comme il est probable qu'ils ont enfoui dans les oubliettes de l'histoire les leçons qui leur furent enseignées sur la manière cruelle dont la Berbérie chrétienne fut islamisée par les envahisseurs Arabes. Nous supposons qu'ils ont reçu une culture latine pour la plupart et de ce fait, qu'il leur arrive parfois de se remémorer l’œuvre colossale accomplie par Rome, dans cette partie du monde, sans oublier la façon dont son héritage fut dilapidé par les incursions arabes successives ?
Hors de leurs obligations politiques, ils ont le devoir de s'interroger sur les événements plus récents, et entre autres, sur le sort que réservèrent aux églises chrétiennes les Républiques de Tunisie, d'Algérie et le royaume Marocain, au lendemain de leur indépendance. Pour un clocher encore debout, peuvent-ils nous dire ce que sont devenues les églises des baptêmes, des communions et des mariages de tous ceux de nos compatriotes qui y vivaient ; Que sont devenues les sépultures de ceux qui y sont décédés après des générations de labeur ? Combien de lieux de prière, dédiés à la Vierge ou au Christ, sont consacrés chaque année dans chacun de ces trois pays du Maghreb. Que répondent-ils à nos questions ?
En Tunisie, les pauvres, les infirmes et les vieillards durent abandonner la Maison de Dieu, celle qui se trouvait à proximité de leurs demeures. Ces chapelles et églises disparurent dès la signature (10 juillet 1964) par le Saint Siège du modus vivendi imposé par la République Islamique tunisienne. Dans l'article 6, paragraphe B du document, l'église consentait, doux euphémisme, à céder définitivement et à titre gratuit à l'état tunisien les lieux de culte et autres biens. En réalité, il s'agissait ni plus, ni moins que de la spoliation des biens de l'église au profit de l'Islam.
Dans sa « magnanimité » (article 6, paragraphe C), l'état tunisien autorise la célébration habituelle du culte dans des locaux n'offrant pas les aspects extérieurs des lieux de culte... Nous passons sous silence toutes les contraintes, telle celle (article-7) qui dit que : « les acquisitions d'immeubles à titre onéreux et les dispositions à titre gratuit en faveur de l'église catholique en Tunisie ne pourront avoir I'effet qu'après autorisation du Gouvernement de la République tunisienne. Tout appel à la générosité publique, sous quelque forme que ce soit, effectué en dehors des églises, reste soumis à la réglementation générale ».
La " braderie paroissiale" fut grandiose ; elle fut à l’image de la générosité de la France vantée par De Gaulle deux années auparavant : 164 églises, presbytères, salles paroissiales, la Cathédrale de Carthage, une maison de retraite, un séminaire, un musée, une colonie de vacances, une clinique, des dispensaires, des garderies, des terrains agricoles, des immeubles, des milliers de m2 de terrains non bâtis, 33 écoles ou pensionnats furent généreusement "offerts" à la « tolérante Tunisie ». Nous n'avons pas la liste des biens cédés gratuitement par les Pères Blancs, les Lazaristes, les Maristes, les sœurs de Sion, celles de Nevers, elles enseignaient aux jeunes filles musulmanes, chrétiennes et juives et autres congrégations. Nous ne possédons pas non plus la liste des biens abandonnés par l'église au Maroc, ni celle des biens laissés par l'église chrétienne à ce bon et autre pays tolérant, l'Algérie. On peut tout imaginer et rester pourtant en deçà de la réalité.
Nos dirigeants pensent-ils comme tous les sots, au tempérament lissé par les roucoulades arabo-andalouses des chanteurs à la mode ou au caractère anémié par les 5°, 6° ou 7° colonnes de la subversion mondialiste, qu'il faille donner satisfaction à l'Islam et lui permettre d'édifier en France des mosquées aux minarets conquérants ? Croient-ils que ce geste sera interprété par les bénéficiaires comme un acte de charité ? Nous ne croyons pas nos dirigeants aussi naïfs, ils savent fort bien que les musulmans considèreront ce geste comme une soumission du Christianisme, comme une victoire de l'Islam sur les Associateurs.
Ceux qui nous gouvernent ne trouvent-ils pas indécent que la Mecque soit interdite, sous peine de mort, à tout non-musulman. Cette interdiction a sa source dans le Coran. L'édification de mosquées un peu partout, dont une à Rome, capitale du catholicisme, alors que les musulmans n'autoriseront jamais l'édification d'une église à la Mecque ne les interpelle-t-elle pas ? L'incapacité congénitale de l'Islam à supporter autrui sur ses terres ne les révolte-t-elle pas ?
Il est une règle constante en Islam, celle de diviser le monde en deux territoires, le premier dit Dar el-Islam (demeure de I'Islam) c'est-à-dire sa propriété dans laquelle règne exclusivement le droit coranique. Le second appelé Dar el-harb (harb = guerre), un territoire que le musulman a mission de conquérir. En théorie, le combat ne doit jamais être interrompu ni prendre fin avant la soumission totale à l'Islam de ces pays et de ses habitants, les Harbis.
Il est temps que les "Harbis" que nous sommes se préoccupent des mésaventures qui nous guettent, et sanctionnent tous ceux qui, consciemment ou non, se plient aux exigences de l'Islam, à travers l’immigration, comme tous ceux qui, a[teints du syndrome munichois, sont prêts à toutes les capitulations devant le sixième pilier informel de la religion islamique : le Djihad, la guerre sainte.
Si les Français méritent que l'on se soucie de leur avenir et la France, fille aînée de l'église, que l'on se préoccupe de son lendemain, il est fondamental que nous fassions nôtre, malgré la laïcité qui nous entoure, cette maxime latine : « Telle la religion du pays, telle celle des hommes ».
J.Y.C
|
|
PIERRE GUILLAUME
VERITAS N°69 janvier 2003
|
|
OU L’INALTERABLE ESPERANCE
« Je n'avais pas envie de brûler mon uniforme et de me mettre en civil. Tous mes espoirs vont dans ceux qui ont continué la lutte pour que jamais le drapeau FLN. ne flotte sur Alger... au-delà de l'intégrité du territoire national et de la perte de l'Algérie Française, c'est l'âme du pays qui se détruit lentement. Nous avons provisoirement échoué et cela seul je le regrette ».
Lieutenant de Vaisseau Pierre GUILLAUME
A ses traditions familiales – son père fut un adjoint direct du général Lyautey au Maroc – s’est ajouté l’empreinte scoutisme qui, entre les deux guerres, a formé tant de jeunes âmes à l’esprit du sacrifice.
Pendant les terribles bombardements anglo-américains de ta deuxième guerre mondiale, il se dévoua pour porter secours à ses compatriotes éprouvés. II passa par l'Ecole Navale, au sortir de laquelle, il fut promptement envoyé en Indochine. Pierre Guillaume servit, en particulier, sur ces petits navires qui remontaient les fleuves et rivières de la péninsule, chassant les rebelles qui infestaient les rizières ou la jungle. A la fin du drame, il joua un rôle capital pour sauver des milliers de ces catholiques tonkinois que le pouvoir parisien avait livrés à leurs impitoyables bourreaux.
Il poursuivit sa carrière dans la Marine jusqu'au grade de Lieutenant de vaisseau. En 1957, son frère, Jean-Marie, ayant été tué à la tête de son commando parachutiste en Oranie, il demanda et obtint autorisation tout à fait extraordinaire de servir dans l'Armée de terre.
Il a repris le commando de son frère et poursuivi cette guerre jusqu'à s'infiltrer dans les zones tenues par l'ennemi. Le Lieutenant de Vaisseau Pierre GUILLAUME s'impliqua dans la mutinerie du 22 avril 1961. Après le naufrage de celle-ci, il passa dans la clandestinité. Il fut un des deux adjoints du Général Jouhaud, plus particulièrement chargé du Bled oranais. Après son arrestation et les années passées en prison, il exerça les activités les plus diverses.
Dans les huit dernières années de sa vie, l'émission qu'il animait toutes les semaines à Radio-Courtoisie, et qui était régulièrement suivie par des milliers d'auditeurs, lui a permis de faire passer un message admirable de vérité, de fidélité, de courage et de patriotisme.
On sait que ce sont ses aventures qui ont inspiré le roman et le film « Le crabe tambour ».
Notre association lui a décerné, au mois de mai, LE PRIX VERITAS 2002 pour sa contribution au « LIVRE BLANC DE L'ARMEE FRANÇAISE EN ALGERIE ». Il en a souvent parlé, témoignant de sa légitime fierté.
Dans un monde de bureaucrates et de marchands, Pierre GUILLAUME était un soldat, un marin et un homme d'aventure. Après que le destin eut brisé une carrière militaire qui s'annonçait brillante - au vu des honneurs dont il était chargé dès l'âge de 36 ans - il a mené une vie d'aventures dont les activités l'armateur en Afrique, de renfloueur d'épaves ou de conseiller pour les questions hydrographiques et maritimes auprès du Royaume saoudien ne représentent que quelques jalons.
Auparavant, pendant sa carrière militaire, courageux et valeureux, il se conduisit comme s'il aimait la bataille. Comment en douter quand on sait qu'à l'issue de son premier séjour de 27 mois en Indochine, quotidiennement affronté aux forces du Viet-minh, il demanda de ne pas bénéficier de la relève pour pouvoir rester face à l'ennemi ? Il n'a pas aimé la bataille comme un mercenaire, comme un être belliqueux, comme un desperado. S'il a su affronter des années durant des dangers mortels de tous les instants, c'est parce qu'il était animé par les plus pures vertus de notre race. Mais, avant d'évoquer celles-ci, rappelons que suivant les meilleures traditions de la Royale, il savait s'offrir les joies d'un « dégagement ». C'était un homme heureux qui avait su rire, boire et chanter.
Pierre GUILLAUME était un patriote qui aimait son pays, comme ses ancêtres avaient aimé le Royaume de France, comme les chouans qui mouraient pour Dieu et pour le Roi, comme la génération de ses parents qui avait, sans sourciller, affronté l'holocauste de la Grande Guerre.
Son attachement passionné à la France ne s'est jamais limité à l'Hexagone. Il eut, d'emblée, une vocation d'Empire. Il aimait d'autant plus la France qu'elle était plus grande, qu'elle était plus vaste et qu'elle rayonnait sur les cinq continents. Contre tous les menteurs de notre temps, il était persuadé que l'Empire présentait à la fois la meilleure chance de la France et la meilleure chance des peuples qui vivaient à l'ombre de son drapeau. Il déplorait véhémentement que la France tirât si peu parti et défendît si mal son immense domaine maritime, ruinât sa pêche et laissât péricliter sa marine marchande.
Son nom ne comportait pas de particule, il était banal comme un prénom. Cependant, Pierre GUILLAUME était un seigneur. Fils d'un général prestigieux, promis lui-même par ses exploits à une carrière brillante, comme les nobles de l'Ancien Régime, il était très proche de cet humble peuple breton, de ces pécheurs, de ces marins, de ces paysans qu'il appréciait tant et avec lesquels il aimait tant converser. De même, dans la meilleure tradition de la vieille noblesse de France, sa vie a été dominée par le souci de combattre pour protéger et tenter de sauver les « manants » de l'adversité, sous la forme, au XXème siècle, des guerres révolutionnaires. N'étaient-ils pas des manants - au sens étymologique de « ceux qui demeurent, ceux qui restent » - ces Indochinois, ces Français d'Algérie de toutes confessions, ces Harkis, que des gouvernements indignes allaient abandonner. sur place, au plus cruel des destins ?
Une anecdote est éclairante. Emprisonné à Rouen, il fut atterré par la déshérence spirituelle des jeunes gens incarcérés dans la même maison. Il demanda au Directeur de la prison l'autorisation de s'occuper d'eux. En peu de temps, à force de gymnastique, d'évocations historiques et géographiques, grâce à son enthousiasme, à sa chaleur communicative, à son charisme. à sa charité agissante, il parvint à réveiller l'âme de ces malheureux, trop souvent considérés comme irrécupérables. Lors de son transfert à Tulle, tous le regrettèrent et beaucoup l'ont pleuré.
Pierre GUILLAUME était un homme d'honneur. Sa parole, une fois donnée, était un engagement à la vie à la mort. Mais, en outre, il considérait que la parole donnée par l'Armée, donnée par la France, l'engageait tout autant, lui, personnellement. Nul plus que lui n'aurait pu redire la fière parole du maréchal Pétain : « Je tiens mes promesses, même celles des autres. ». Quand le félon de l'Elysée a trahi et renié tous ses serments, tous ses engagements les plus solennels et quand. à son aval. l'administration civile et militaire a du faire de même, pour défendre les populations abandonnées corps et âme, pieds et poings liés, à leurs pires tortionnaires, il entra dans la clandestinité.
Il a tout sacrifié : sa carrière, sa réputation auprès des Français égarés par une propagande mensongère et auprès de ses collègues, officiers obéissants - désormais souvent simples fonctionnaires en uniforme -, ses moyens de subsistance et ceux de sa famille.
Et puis, il affrontait le risque quotidien d'être abattu comme une bête, comme l'a été, par exemple, le capitaine Le Pivain, par un gendarme rouge ou un barbouze chanceux. Avec ses compagnons de l'O.A.S., il a poussé l'esprit de sacrifice au paroxysme. Bientôt, dans un Palais de Justice, des perroquets chamarrés ont prononcé, contre lui, l'injustice, pour assouvir la rancune de celui dont ils étaient les laquais. Condamné à des années de réclusion, il pouvait affirmer, le front haut : « Tout est perdu, fors l'honneur ».
Chez Pierre GUILLAUME, il y avait une sorte d'incorruptibilité spirituelle. Sur Radio-Courtoisie où nous avons eu la chance qu'il s'exprimât jusqu'à ses derniers jours, il proclamait, avec une conviction sans défaillance, son attachement à des valeurs que toute notre époque considère comme ringardes : fidélité inconditionnelle à la Patrie, admiration à l'égard de l'Empire qui avait fait émerger des millions d'hommes des ténèbres millénaires de la peur, de l'esclavage, de la famine, de la maladie. Le raz de .marée du mensonge et des fausses valeurs n'a jamais eu la moindre prise sur son esprit.
Il y avait en lui une pureté, une jeunesse, une sorte de naïveté, poignantes chez cet homme qui avait tant vécu, connu tant d'horreurs, affronté tant de bassesses. Jusqu'à son dernier jour, il n'a pas cessé de s'indigner et de dénoncer comme « stupéfiantes » des abominations réelles mais si banales que nous y sommes tous, hélas, accoutumés.
Soldat de chrétienté, toute sa vie de combat fit de lui un croisé du XXe siècle, humble, héroïque, anachronique. A l'instar des preux qui l'avaient devancé, il savait que son devoir n'était que de combattre, car Dieu seul peut donner la victoire. Trop souvent contre toute évidence humaine, il n'a jamais perdu la vertu d'espérance. Son esprit était imprégné de sacré, dans la période la plus désacralisée de l'Histoire de France.
Merci à toi et adieu, Pierre GUILLAUME.
Georges DILLINGER
Le Président, le Vice~président et le Comité VERITAS tout entier, s'associent avec émotion à la perte incommensurable de celui qu'Anne Cazal appelait très affectueusement « Le dernier fils de Clovis » car il défendait avec fougue, envers et contre tous, nos valeurs ancestrales. Plus jamais nous n'entendrons un langage semblable à celui de Pierre Guillaume s'élevant avec force contre les « intellectuels et les rhéteurs. »
A tous ses proches, et à l'Adimad R.P. dont il était Vice-président, nous présentons nos condoléances sincères et profondément affectées.
|
|
COLLABOS
PAR MANUEL GOMEZ
27 août 2025
|
| La trahison de l’Église catholique espagnole
L’Église catholique d’Espagne serait-elle complice des islamistes ?
L’Église catholique d’Espagne serait-elle complice de la politique socialiste de Pedro Sanchez ?
Serait-elle surtout coupable d’oublis mémoriels ?
Si tous les ans de très nombreuses villes espagnoles fêtent les anciennes confrontations entre « Mauros y Christianos » dans la joie et l’allégresse, les catholiques espagnols ne doivent pas oublier que durant des siècles ce furent des affrontements meurtriers effroyables contre ceux qui occupaient par la force leur pays.
Ils doivent se souvenir également qu’ils ont dû faire appel au général Franco, et a son armée, afin qu’il les délivre de l’oppression que leur faisaient subir la gauche socialo-communiste lors de la 1re République espagnole dès 1931 et jusqu’en 1936 et combien, cette guerre civile, ensuite, fut meurtrière.
Pourquoi ce bref préambule ? Parce que l’Église espagnole vient de s’opposer vivement à la décision d’un élu du parti de droite VOX, conseiller municipal de la ville de Jumilla (27.000 habitants), dans la région de Murcie (connue par son vignoble de très grande qualité) qui a réussi à faire interdire, par la municipalité dirigée par le PP (Parti Popular), la mise à disposition du gymnase municipal à la communauté musulmane afin qu’elle puisse y pratiquer deux fois par an « sa prière religieuse et les prêches de ses imams ».
Le feu aux poudres a été allumé par un communiqué de la Confrérie épiscopale : « Qui s’unit à la « Commission islamique d’Espagne » pour défendre sa liberté religieuse » qui serait garantie par la Constitution Espagnole et par la déclaration des droits de l’homme et qu’elle estime « marquer une discrimination qui ne peut avoir lieu dans des sociétés démocratiques ».
La réponse du président de VOX, Santiago Abascal, ne s’est pas fait attendre : « Je suis profondément attristé face à une partie de la hiérarchie catholique pour sa position, en matière d’immigration, face à l’islamisme extrémiste qui avance mais, également, devant leur silence face aux nombreuses politiques de ce gouvernement socialiste « alors qu’elle ne parle que très peu des politiques du genre, du droit à la vie des anciens en fin de vie. Je ne sais pas si ce sont les subventions publiques de l’Église qui l’empêche de combattre certaines politiques du gouvernement ou les revenus qu’elle reçoit dans le cadre du système d’aide à l’immigration illégale » (allusion à l’action sociale d’ONG catholique comme CARITAS).
Il est important de noter que sur les 15 % de voix obtenues par VOX, 72 % de ses électeurs s’identifient comme catholiques et que le parti VOX progresse rapidement au sein de l’électorat catholique grâce à sa proposition de déportations massives, très éloignée des thèmes de l’Église : plus de 350.000 nouveaux de vrais électeurs catholiques « inquiets de la progression de l’Islam en Espagne ».
Selon Monseigneur Planellas, suite à cette réponse : « Un xénophobe ne peut pas être un vrai chrétien ».
Si la xénophobie est désormais identifiée comme « être opposé à l’immigration invasive illégale et contre la chrétienté » l’on peut craindre que l’Église espagnole se vide d’un grand nombre de catholiques !
|
|
Avec Bernard Zeller,
retour sur l’échec du putsch des généraux en Algérie
Par CAMILLE GALIC | 3 septembre 2025
Envoyé par Mme A. Bouhier
|
https://www.polemia.com/avec-bernard-zeller-retour-sur-lechec-du-putsch-des-generaux-en-algerie/
C’est une plongée au cœur d’une page terrible de l’Histoire française que nous proposent Camille Galic et Bernard Zeller dans cet entretien. Les relations franco-algériennes se font toujours plus mauvaises au fur et à mesure des années et le traumatisme de la Guerre d’Algérie est à la racine du discours éternellement victimaire du gouvernement algérien. Dans l’entretien que les lecteurs de Polémia découvriront ci-dessous, Bernard Zeller revient sur cette période troublée, avec ses drames et ses zones d’ombres. Un témoignage engagé et très critique du général de Gaulle par moment. Un ton qui étonnera certains et qui porte la marque de l’engagement familial, tant il est vrai que la blessure de l’Algérie française reste vive pour de nombreuses personnes qui ont payé le prix fort lors de cette guerre. C’est définitivement un sujet ancien… qui n’en finit pas de revenir dans l’actualité.
Bernard Zeller, fils de général putschiste
Né en 1946, ingénieur en chef de l’armement après avoir fait toute sa carrière dans l’industrie spatiale et de défense, Bernard Zeller s’est consacré depuis sa retraite à rétablir la vérité sur la (triste) fin de l’Algérie française et notamment sur son père, le général André Zeller, l’un des auteurs du putsch d’Alger dont il fit éditer le Journal d’un prisonnier (éd. Tallandier, 2014), ainsi que sur Raoul Salan dont, en collaboration avec Jean-Paul Angelelli, lui-même auteur de Une guerre au couteau (éd. Picollec, 2004), il se fit le biographe (éd. Pardès 2016). Nul n’était donc mieux placé que lui, qui avait personnellement connu nombre de protagonistes, pour replacer dans leur contexte et détailler les conditions dans lesquelles Charles de Gaulle revint au pouvoir à la faveur des « treize complots du 13 mai » 1958, et les ressorts qui, trois ans plus tard, le 22 avril 1961, poussèrent à la révolte les étoilés André Zeller, Raoul Salan, Edmond Jouhaud et Maurice Challe — dont le sursaut, s’il avait été suivi, aurait peut-être évité l’indépendance de l’Algérie avec pour résultat un marasme qui provoque depuis 1962 une immigration si incontrôlée vers l’ex-métropole que l’actuel président algérien Tebboune affirmait sur France 24 en juillet 2020, en une menace implicite : « Nous avons près de six millions d’Algériens qui vivent en France. » Sous le titre Un quarteron de généraux avant le putsch (1), Bernard Zeller a écrit un livre factuel mais passionnant, étayé par un remarquable appareil de notes, que devraient lire tous les férus d’histoire contemporaine. Et, bien sûr, tous ceux ayant eu des attaches avec la province perdue.
Des profils différents
Camille Galic : À première vue, le seul point commun entre les quatre chefs de l’insurrection, dont vous retracez les brillantes carrières, est qu’aucun n’avait entendu l’appel dit du 18 juin 1940. Comment et pourquoi, après avoir atteint le grade de général d’armée, ces officiers si différents en vinrent-ils à la rébellion ?
Bernard Zeller : C’est précisément l’objet de l‘ouvrage. En effet leurs parcours avaient été bien différents. Zeller, à part la Syrie et cinq années en Algérie en 1934-1935 et en 1940-1943, est plutôt « métropolitain ». Salan est séduit par le Tonkin et le Laos et passera, en plusieurs épisodes, près de vingt ans de sa vie en Indochine. Challe a une carrière essentiellement métropolitaine à part deux années au Maroc. Jouhaud, lui, connaît l’Afrique noire, l’Indochine et l’Algérie. Challe et Jouhaud, qui se suivent à un an d’intervalle, sont les seuls qui se connaissent dès leur jeunesse.
Arrivés à des postes de haute responsabilité dans la deuxième moitié des années cinquante — Zeller est chef d’état-major de l’armée de terre, Salan commandant en chef et délégué général en Algérie, Challe major général des armées puis successeur de Salan en Algérie, Jouhaud adjoint de Salan puis chef d’état-major de l’armée de l’air – ils sont directement confrontés au problème algérien qu’ils prennent à bras-le-corps.
Quand le dessein de De Gaulle apparaît lors du discours du 16 septembre 1959 annonçant sa politique d’autodétermination de l’Algérie et se précise au cours de l’année 1960 sous la forme d’une Algérie algérienne indépendante, tous quatre sont conscients que le résultat en sera une Algérie livrée au FLN, organisation indépendantiste pratiquant un terrorisme systématique à l’encontre de la population. C’est pour tenter d’empêcher cet abandon des Algériens à une clique antifrançaise conduisant au massacre généralisé des partisans de la France et à l’exode de centaines de milliers d’habitants que se sont rebellés ces généraux.
La duplicité de Charles de Gaulle ?
Camille Galic : A peine réinstallé au pouvoir grâce aux tenants de l’Algérie française, de Gaulle prend à son cabinet Bernard Tricot et René Brouillet, notoirement acquis à l’indépendance de l’Algérie, et, dès février 1960, alors que la guerre est pratiquement gagnée sur le terrain, il évoque l’« Algérie algérienne ». En décembre 60, il admet que « sur le terrain, c’est gagné » pour nos armées, mais il ordonnera peu après « l’arrêt des opérations offensives ». Comment l’expliquez-vous ?
Bernard Zeller : La duplicité de Charles de Gaulle est la marque constante de sa politique algérienne. Il a précisé lors de ses nombreux discours de 1958 à 1961 tout ce qu’il ne fallait pas faire en Algérie, les conséquences catastrophiques qui en découleraient si malgré tout on le faisait et… il l’a fait :
· Reconnaître le Front de Libération Nationale comme seul interlocuteur pour traiter de l’avenir de l’Algérie: « Les insurgés voudraient être reconnus d’avance comme étant l’Algérie, le gouvernement algérien. Ils voudraient que nous leur passions la main. Ce n’est pas possible. Cela je ne le ferai jamais. » Le 14 juin 1960, De Gaulle appelle le FLN à la négociation. Celui-ci envoie une délégation à Melun. De facto, le FLN est reconnu comme le représentant de l’Algérie et le restera.
· Entamer des négociations politiques avec le FLN avant d’avoir obtenu un cessez-le-feu: « Mais avant toutes conversations officielles d’ordre politique, il est nécessaire que s’établisse la trêve des combats et des attentats. » Le FLN exigeant de mener en même temps négociations sur l’avenir politique de l’Algérie et discussions sur le cessez-le-feu, De Gaulle cède et le cessez-le-feu n’est proclamé qu’à l’issue des négociations, le 19 mars 1962.
· Céder le Sahara au FLN: De Gaulle veut conserver le Sahara, essentiellement pour garder la main sur les réserves d’hydrocarbures découvertes et exploitées par la France depuis 1956 et pour continuer à disposer des sites d’essais de missiles et de lanceurs spatiaux ainsi que du site d’expérimentation de bombes atomiques. Là encore, les exigences du FLN le font céder : le 5 septembre 1961, il cesse de revendiquer la souveraineté de la France sur le Sahara.
· Abandonner l’Algérie: « À quelles hécatombes condamnerions-nous ce pays si nous étions assez stupides et assez lâches pour l’abandonner ! » Les accords d’Évian de mars 1962 scellent l’abandon de l’Algérie au FLN.
Outre le discours du 4 juin 1958 à Alger, « Je vous ai compris… », à Bône, le 5 juin 1958, de Gaulle déclare à la foule, Européens et musulmans mêlés : « Je considère l’armée française avec sa loyauté, son honnêteté et sa discipline comme la garante que la parole de la France sera tenue (…). Venez à la France ! Elle ne vous trahira pas !»
À la foule oranaise, le 6 juin 1958, il déclare : « Oui, Oui, la France est ici avec sa vocation (…) Elle est ici pour toujours ! » et à Mostaganem : « Vive l’Algérie française ! »
Au général Zeller qui, dès septembre 1958, s’inquiète des ambiguïtés de sa politique algérienne, il répond : « Ai-je jamais abandonné quelque chose ? Voilà de quoi vous rassurer, vous et vos amis. » De même, à Alger, au début du mois d’octobre à une vingtaine de capitaines, anciens d’Indochine, ayant un commandement dans le bled, il s’exclame : « Ai-je l‘air d’un homme qui ait jamais abandonné quelqu’un ? »
Le 29 janvier 1960, il déclare encore, à destination des habitants de l’Algérie : « Comment pouvez-vous écouter les menteurs et les conspirateurs qui vous disent qu’en accordant le libre choix aux Algériens, la France et de Gaulle veulent vous abandonner, se retirer de l’Algérie et la livrer à la rébellion ? »
Les exemples de duplicité, tangentant parfois la grossièreté, sont nombreux, en particulier entre ce qu’il dit ou écrit aux généraux et ce qu’il fait ou lâche à leur propos en petit comité. Échantillons : alors qu’il a exprimé au commandant en chef en Algérie son entière satisfaction quelques instants plus tôt : « Ce Salan, un drogué, je le balancerai après les élections. » Alors qu’il vient de signifier à Jouhaud la confiance qu’il lui fait en le nommant chef d’état-major de l’armée de l’air : « Ce Jouhaud, un gros ahuri. » Quant à Massu qui, à Alger, le 13 mai 1958 a ouvert la voie au retour au pouvoir du général de Gaulle : « Massu ? Un brave type, Massu, mais qui n’a pas inventé l’eau chaude »
En fait, de juin 1958 à avril 1961, toute la tactique du général de Gaulle concernant sa politique algérienne est fondée sur l‘écart entre ce qu’il dit ou écrit et ce qu’il fait, utilisant également son premier ministre, Michel Debré, pour introduire l’équivoque sur ses réelles intentions.
Camille Galic : Dans les remous qui agitent alors les forces opérationnelles, les « centurions » tels Godard, Gardes, Robin, Degueldre, sont très actifs. Est-ce dû au traumatisme, qu’ils ne veulent pas revivre, de l’humiliation subie en Indochine en 1954 ?
Bernard Zeller : Ces quatre officiers ont combattu en Indochine. Lors de cette guerre, les gouvernements successifs n’ont pas eu de politique définie. Et de 1947 à 1954, chaque année, plusieurs centaines d’officiers, surtout des jeunes — l’équivalent d’une promotion de saint-cyriens — étaient tués au combat dans l’indifférence de la métropole. Il s’agissait, comme ce sera le cas en Algérie, d’une guerre politique où la conquête des populations avait un rôle encore plus important que celle du terrain. Cela n’était pas compris des dirigeants français de l’époque (ni, plus tard, en Algérie de De Gaulle). Le tout s’est terminé par la défaite de Dien Bien Phu, l’abandon du Tonkin aux communistes et le retrait piteux de la France de l’Indochine. Et surtout l’abandon des populations locales ralliées au combat anti-communiste. Cela, ceux qui avaient participé à cette guerre ne voulaient absolument pas le revivre.
Salan a été le premier meurtri car le Vietnam était devenu sa seconde patrie. Jouhaud, qui commandait l’Air en Indochine après Dien Bien Phu a vécu sur place l’exil de centaines de milliers de Tonkinois catholiques vers le sud. Zeller, nommé en août 1955 chef d’état-major de l’armée, dans son premier discours aux officiers, s’exprime ainsi à propos de l’insurrection en Algérie : « Cette fois-ci, ce ne sera pas comme pour l’Indochine (…) Il n’y aura pas de nouvel abandon. »
L’échec du putsch
Camille Galic : Les causes de l’échec du putsch sont multiples : hostilité générale des médias (étrangers compris) et des syndicats, hâte des familles de voir revenir les mobilisés, affolement de l’Hexagone à l’idée de voir « les paras sauter sur Paris », réticence voire hostilité sur place de nombreux commandants d’unité. Ne pensez-vous pas qu’a joué aussi en France le choix de se débarrasser du « fardeau de l’homme blanc », alors que la décolonisation et les désastres qui en ont vite suivi dans les anciennes colonies africaines ont rendu ce fardeau plus pesant que jamais, sur notre sol même ?
Bernard Zeller : De Gaulle a évidemment joué sur la lassitude de la métropole qui ne voyait pas venir la fin des opérations en Algérie. Pour lui, l’Algérie était un boulet financier et un boulet politique qui l’empêchait de mener la politique internationale – entre les deux blocs – qu’il voulait mettre en œuvre. Le FLN, en faveur duquel le temps jouait, a aussi tablé sur la lassitude des Français. Le contexte de l’époque n’est évidemment pas favorable à une action telle que celle menée par les quatre généraux : décolonisation, début de la société de consommation, généralisation de l’attrait pour les biens matériels, disparition d’idéal dans la jeunesse, soutien moral et matériel d’une partie de la gauche au FLN. L’abandon de l’Algérie au FLN en 1962 marque une rupture profonde dans l’histoire de la France, qui l’a menée où elle est aujourd’hui.
La cause directe de l’échec est l’absence de ralliement des officiers généraux présents en Algérie, une quarantaine le nombre d’officiers généraux présents en Algérie en avril 1961.
On avait certifié à Challe que la majorité d’entre eux se rallierait à lui. Seuls deux généraux l’ont fait. Gouraud à Constantine se rallie puis se rétracte ; Pouilly à Oran est pour l’Algérie française mais ne se rallie pas ; Vézinet à Alger est neutralisé. La quasi-totalité s’est réfugiée dans l’attentisme, se réservant de voir dans quel sens la situation allait évoluer. Ailleret fait même voter ses officiers pour déterminer sa position. Très peu s’opposent fermement au putsch.
Challe dira plus tard : « Ce sont les officiers de l’armée française qui, finalement, par leurs atermoiements et leur lâcheté d’une façon générale, m’ont fait perdre dans cette révolte. » Et il ajoutera : « Je ne sais pas me battre contre un édredon, je regrette beaucoup, je crois savoir faire un certain nombre d’actions de guerre, mais pas celle-là. »
Camille Galic : Vous êtes l’auteur de « L’autre visage d’Edmond Michelet » (éd. Via Romana, 2012) et vous animez un blog (2) sur ce gaulliste, ministre de la Justice lors du putsch. Pouvez-vous nous éclairer sur ce saint homme dont la cause de béatification fut officiellement introduite en 2006 mais qui apparaît sous un autre jour dans « Un quarteron de généraux avant le putsch » ?
Bernard Zeller : D’Action Française dans sa jeunesse Edmond Michelet vire vers la démocratie chrétienne dans les années 1930. Résistant pendant la guerre, il est arrêté en février 1943 et déporté à Dachau en septembre. De retour en France après l’armistice, il est en novembre 1945 choisi par de Gaulle, président du gouvernement provisoire et ministre de la Défense nationale, pour être son ministre des Armées ! Dès lors, Michelet devient un gaulliste intégral et dira de son idole : « Il était pour moi le monarque. »
Député puis sénateur sous la IVe République, il écrit régulièrement dans l’hebdomadaire Carrefour qui tient une ligne “gaullisme et Algérie française”, y compare le FLN au nazisme et soutient à fond l’action de l’armée française en Algérie.
En juin 1958, de Gaulle, de retour au pouvoir, le nomme ministre des Anciens combattants, ce qui le conduit, lors d’un discours devant des anciens combattants algériens réunis à Paris pour le 14 juillet, à déclarer que leur présence « affirmait qu’il n’y avait, d’un bord à l’autre de la Méditerranée, qu’une seule France, retrouvée dans l’unité, une France libre, égale et fraternelle. »
Par la suite, ministre de la Justice, il calque ses positions sur l’Algérie sur celles de son monarque, ce qui ne l’empêche pas de proclamer en septembre 1959 au général Zeller venant le saluer avant son passage en 2ème section et qui s’inquiète de l’avenir de l’Algérie : « Mon cher général, comme vous connaissez mal ce régime ! Dans 50 ans, le drapeau tricolore flottera sur Alger ! »
Nonobstant, son entourage proche est truffé de partisans du FLN ; l’un de ses conseillers, Hervé Bourges, rejoindra dès l’indépendance de l’Algérie le cabinet de Ben Bella à sa prise de pouvoir en Algérie et, le jour du premier anniversaire de l’indépendance, accèdera à la nationalité algérienne !
En juin 1960, il profite de la réforme du Code pénal pour faire rétablir subrepticement la peine de mort en matière politique, abolie depuis 1848, ce qui lui permettra, lors du procès des généraux Challe et Zeller, d’enjoindre au procureur général de la réclamer. Le procureur ne l’ayant pas requise et les juges ayant considéré qu’il y avait des circonstances atténuantes, il est furieux tant contre ceux-ci que contre celui-là
Dès son décès en 1970, son entourage lui tresse une auréole, ce qui a conduit à entamer en 2006, à Tulle, le processus diocésain de sa béatification. Le dossier complet a été transféré à Rome en 2015. Il est au Vatican, entre les mains du postulateur auquel l’auteur n’a pas manqué de faire parvenir l’ouvrage que vous citez. Le rétablissement de la peine de mort en matière politique et son injonction au procureur du procès Challe-Zeller, difficilement interprétables comme l’expression d’une parfaite charité chrétienne, ne plaident pas en sa faveur.
1) Un quarteron de généraux avant le putsch. 430 pages avec index : Éditions Perrin, juin 2025.
2) edmond-michelet.blogspot.com/
Entretien avec Bernard Zeller, réalisé par Camille Galic
Plemia - 03/09/2025
|
Arrêtons la repentance,
elle est en train de nous tuer !
Eric de Verdelhan, 6 septembre 2025
Envoyé par Mme Bouhier
|
«… Cette Indochine-là est morte… Ces survivances féodales héritées du colonialisme français ont été promptement liquidées… pas de salut hors des masses populaires, du socialisme scientifique basé sur le matérialisme dialectique enrichi par le grand Lénine et le génial Staline, du centralisme démocratique, du déterminisme historique et tutti quanti… ! Ainsi va le monde ! »
(Pierre Schoendoerffer)
J’avoue humblement ne pas comprendre les gens, les naïfs, qui s’étonnent que nos banlieues soient devenues des zones de non-droit ; que le trafic de substances illicites y soit florissant ; que des barbares allogènes gangrènent nos rues et osent s’attaquer à nos flics ; qu’ils saccagent et pillent les commerces ; et qu’ils affichent leur détestation et leur haine à l’égard d’un pays pourtant si généreux à leur égard. En fait, nous sommes les seuls responsables de cette situation : nous avons honte de notre passé colonial. Nous passons notre temps à nous auto-flageller et à faire repentance.
Depuis quinze ans, j’ai commis quelques livres et moult articles sur notre ex-empire colonial. Je ne prétends pas pour autant être un spécialiste de la question, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi nous aurions à rougir, à nous justifier, à battre notre coulpe et à avoir honte de notre passé colonialiste ? Assez régulièrement, je me vois dans l’obligation de « remettre les pendules à l’heure » et de dénoncer les mensonges, les affabulations ou les allégations fantaisistes véhiculés par certains médias, soit par ignorance, soit pour flagorner une « diversité » issue de l’immigration. Je n’érige pourtant pas l’agressivité en modèle, ni la polémique en vertu, mais il me semble nécessaire, utile, salutaire voire indispensable, que les jeunes générations sachent qu’elles n’ont pas à rougir du passé de leur pays. Il serait bon, au contraire, qu’elles en soient fières car on ne bâtit pas une nation solide sur la détestation de son histoire. Pour apprendre à aimer son pays, pour être prêt à le servir, et il faut impérativement avoir la fierté de ses racines. On peut toujours philosopher, après coup, sur la nécessité ou non de coloniser une contrée plus ou moins lointaine. On peut aussi – on doit aussi – admettre que tout ne fut pas idyllique dans nos guerres de conquête mais gardons-nous de juger les siècles passés avec nos mentalités d’occidentaux ramollis du XXIe siècle, c’est trop facile !
Aujourd’hui, pour vous parler de notre ancien Empire, je commencerai par l’Indochine. Dans un autre article, je traiterai le cas de notre Algérie française. Certes l’Algérie est devenue française avant l’Indochine, mais c’est notre cuisante défaite de Diên-Biên-Phu, suivie des accords de Genève, qui a marqué le début du « détricotage » de tout notre empire colonial.
La fille du général « Bob » Caillaud – qui était capitaine avec mon père à Diên-Biên-Phu – m’a offert un livre intitulé « Le Dieu Blanc est mort à Diên Biên Phu » (1). Le titre de ce livre résume bien son contenu : la suprématie de l’homme blanc a amorcé son déclin après Diên-Biên-Phu.
Rien ne prédestinait ces contrées lointaines à devenir des colonies ou protectorats français.
Étiré sur 1600 km le long de la mer de Chine, l’Annam relevait de la civilisation chinoise. Il était l’héritier du puissant empire d’Angkor – dont l’apogée se situe entre les IXe et XIIIe siècles – lové au cœur même de la péninsule indochinoise, le royaume khmer était, comme les deux principautés qui se partageaient le Laos, de culture indienne et de religion bouddhiste. Les deux régions n’avaient rien en commun sinon d’avoir subi l’impérialisme chinois. Mais celui-ci s’était fait sentir plus lourdement en Annam. L’Annam avait, entre le IIIe siècle av. J.-C. et le Xe siècle, fait partie de l’empire chinois. Devenu indépendant en 939, il n’avait jamais cessé de reconnaître la suzeraineté chinoise. Ce lien de suzeraineté s’accompagnait de la conviction d’appartenir à une même civilisation.
L’arrivée de la France dans la région eut aux yeux des Chinois le caractère d’une agression. Elle mettait fin à une domination millénaire. On peut se demander ce que nous venions chercher en Indochine ? La péninsule était une région lointaine. Les sollicitations de la Compagnie des Indes, qui avait envisagé d’y établir des comptoirs, étaient restées sans suite pendant deux siècles. Elle n’avait rien non plus d’un pays dont on puisse espérer beaucoup de richesses. Alors pourquoi la coloniser ?
Napoléon III avait, comme son oncle, des rêves de conquête et de grandeur. Il fut poussé à la guerre, en 1857, par l’aventurisme qui était la ligne directrice de sa politique étrangère.
Il venait juste de gagner la guerre en Crimée ; il participait à la seconde guerre de l’opium en Chine ; il prenait les armes pour imposer à l’Autriche l’unité italienne ; il s’apprêtait à intervenir contre les Druzes au Liban ; et enfin, à lancer une expédition pour tenter de donner au Mexique un empereur Habsbourg. Pour l’Extrême-Orient, il fut poussé par sa volonté de satisfaire son électorat catholique. Les milieux catholiques s’indignaient des persécutions dont les missionnaires étaient les victimes de la part d’un pouvoir annamite (2). À l’époque, l’Annam comptait 600 000 chrétiens.
L’aventure indochinoise, ne répondant à aucune nécessité économique, suscitait d’emblée la réticence des milieux d’affaires. Le ministre des Affaires étrangères de l’empereur devait déclarer que le projet ne paraissait admissible « ni au point de vue du droit et des traités, ni au point de vue de l’utilité et encore moins de la nécessité ». Mais l’enjeu véritable était de ne pas laisser l’Angleterre – « la perfide Albion » – seule maîtresse du commerce avec l’Extrême-Orient. L’empereur avait obtenu l’adhésion enthousiaste de l’état-major de la marine. Après la victoire des Anglais lors de la première guerre de l’opium (1840-1842), ils avaient reçu la concession du territoire de Hong-Kong. Fortement implantés en Birmanie, ils poussaient leurs feux au Siam. Et la guerre qu’ils venaient de reprendre contre la Chine, avec l’appui des Français, ne pouvait manquer d’y renforcer leurs positions, étendant depuis l’Inde leur influence sur tout le sud-est de l’Asie. En assortissant sa participation aux côtés de l’Angleterre à la guerre de l’opium (3) d’une intervention en Indochine, la France espérait obtenir une base (ou un comptoir) en Cochinchine pour ne pas laisser à ses rivaux le bénéfice de disposer seuls d’une base navale et d’une place de commerce à proximité de Canton.
Les succès de l’armée française débouchèrent, avec l’annexion de la Cochinchine, sur une implantation territoriale beaucoup plus étendue que prévu (1862) dans un contexte où, confrontée en Chine à la révolte des Taiping (1851-1864), et réduite à quémander l’aide de l’Angleterre et de la France pour y mettre fin, la cour de Pékin n’avait pas pu intervenir dans le conflit.
C’est à l’initiative de l’amiral de La Grandière, gouverneur sur place, que fut signé le traité par lequel le roi du Cambodge plaça son pays sous le protectorat de la France (1863). C’est par la volonté de quelques jeunes officiers que fut explorée la vallée du Mékong. On découvrit à cette occasion la possibilité de relier, via le Fleuve Rouge, le port de Saïgon au sud de la Chine ; le Yunnan et ses mines de cuivre et d’argent. Et c’est à l’amiral Dupré que l’on doit, dès 1873, une première occupation de Hanoï et l’institution d’un protectorat de fait sur l’Annam. Cette première implantation en Indochine s’était faite sans véritable plan concerté, par la seule supériorité des forces françaises en Extrême-Orient, l’autonomie totale laissée à leurs chefs, l’impuissance du gouvernement de Hué, et l’atonie de celui de Pékin. Mais tout allait changer avec l’avènement de la IIIe République, surnommée par les historiens « la République des francs-maçons ». Après l’humiliante défaite de 1870, la droite française rêvait de reprendre l’Alsace et la Lorraine, mais la gauche voyait les choses autrement.
Elle entendait faire profiter le monde entier des idéaux hérités des Lumières.
Il est vrai que les pères fondateurs de la République avaient ouvert la voie. En 1871, Renan écrivait : « Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, autant la régénération des races inférieures ou abâtardies par les races supérieures est dans l’ordre providentiel de l’humanité ».
En 1879, c’est Victor Hugo qui déclarait dans un discours vibrant : « Allez, peuples ! Emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui ? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes, Dieu offre l’Afrique à l’Europe… Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires… ». Notons, au passage, que c’est toujours au nom des idéaux des Lumières qu’on nous reproche aujourd’hui la colonisation.
« La République des francs-maçons » avait répondu à l’appel en Tunisie, en Afrique noire et à Madagascar, mais aussi en menant la conquête du Tonkin et l’assujettissement de tout le royaume d’Annam. Léon Gambetta avait prophétisé : « La civilisation européenne aura à lutter un jour contre la subversion de la race chinoise… Il faut donc que la France s’établisse au Tonkin… afin de mettre la main sur l’Annam, sur le royaume de Siam et sur la Birmanie et d’avoir ainsi barre sur les Indes ; et d’aider la civilisation européenne contre la race jaune. » Et Jules Ferry, le père de l’école laïque et obligatoire, cette belle conscience humaniste, déclarait :
« Il faut dire ouvertement qu’en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures… Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures… ». Personne aujourd’hui n’oserait accuser Léon Gambetta et Jules Ferry de racisme, de discrimination, de suprématisme blanc, et tout le monde ou presque – surtout à gauche ! – continue à les encenser et à les porter aux nues.
Cette conquête, du Tonkin en 1884, complétée en 1893 par un protectorat sur le Laos, allait permettre à l’œuvre coloniale de réaliser de très grandes et très belles choses : des infrastructures, des routes, des institutions sociales, des hôpitaux et dispensaires, des écoles, la mise en valeur des terres et des productions agricoles comme le riz et l’hévéa, etc.
Beaucoup de colons, de fonctionnaires coloniaux, de soldats, ont attrapé « le mal jaune » en Indochine : l’amour de ce pays et de ses habitants. J’ai ressenti ça il y a quelques années, quand, avant d’écrire mon livre « Au capitaine de Diên-Biên-Phu » (4) j’ai sillonné notre ex-Indochine, du sud au nord, pendant trois semaines. Ce pays est magnifique et ses ethnies sont attachantes.
Et puis, et puis… la Chine va se venger. Elle va nourrir le nationalisme vietnamien au début du XXe siècle. Plus tard, lors de la pris de pouvoir par Mao-Zédong en 1949, elle nous mènera une guerre inexpiable par l’intermédiaire du Viêtminh qu’elle armera massivement. En Indochine, notre Corps Expéditionnaire d’Extrême-Orient mènera une guerre de pauvres, une guerre de gueux. Il fera preuve d’abnégation, de courage, d’héroïsme, de générosité et écrira quelques-unes des plus belles pages de notre histoire. Tout ceci se terminera tragiquement, après des combats à un contre trois, puis à un contre dix, dans la sinistre cuvette de Diên-Biên-Phu, le 7 mai 1954.
Le 11 juillet 1951, le général de Lattre, le « roi Jean », avait déclaré : « D’entreprise aussi désintéressée que cette guerre, il n’y en avait pas eu, pour la France, depuis les croisades ». Quelques semaines plus tôt, il avait perdu son fils unique, le lieutenant Bernard de Lattre, tué le 30 mai 1951, à Ninh Binh, au Tonkin. Cette guerre était perdue depuis le désastre de Cao-Bang en octobre 1950.
Dans les milieux militaires le « devoir de mémoire » a encore un sens, mais je voudrais que, chez les civils, on veuille bien se souvenir que de 1946 à 1954, à plus de 10 000 km de la mère-patrie, des Français, des Légionnaires, des troupes indigènes et des supplétifs, se sont battus, seuls (5), contre l’expansion de la « peste rouge », le communisme, qui a tué des millions de personnes dans le monde. Nos anciens d’Indo sont de moins en moins nombreux ; la camarde éclaircit leurs rangs tous les jours. Je voudrais qu’on n’oublie pas leur sacrifice et surtout, qu’on ne salisse pas leur mémoire.
1)- « Le Dieu Blanc est mort à Diên Biên Phu » : de Jean-Luc Ancely ; éditions Mols ; 2019
2)- De nos jours, le sort des chrétiens persécutés par l’islam n’émeut pas grand monde, même au sommet de la hiérarchie catholique.
3)- La seconde guerre de l’Opium, de 1856 à 1860
4)- « Au Capitaine de Diên-Biên-Phu » publié chez SRE-éditions ; 2011
5)- Bien que très modérément soutenus par un « allié » américain qui, en réalité, œuvrait pour nous chasser d’Indochine.
|
|
L’ŒUVRE SANITAIRE
Par VERITAS N° 69 et 71 JANVIER/MARS 2003
|
|
DE LA FRANCE EN ALGERIE
En arrivant à Alger en 1830, la France avait trouvé des populations non seulement végétant... « dans un océan de misère » mais, aussi, un pays livré à une anarchie permanente résultant du conflit entre l'Odjak (corporation des janissaires) et de la Taïta des Raïs (corporation des pirates esclavagistes dits barbaresques). Elle avait trouvé aussi un état sanitaire lamentable de la population, une hygiène médiévale, des ruelles encombrées d'immondices voisinant avec des palais somptueux où vivaient, dans une opulence orientale, pachas et seigneurs turcs, les maîtres du pays depuis plus de quatre cents ans...
Maladies de carence et de sous-alimentation, fièvres, dysenteries, mortalité infantile très lourde achevait de faire de la Berbérie un vrai musée pathologique, (Professeur Pierre Goinard « I'Algérie œuvre française, Laffont.1984).
Plus misérable encore, si possible, croupissait toute une population d'esclaves car ce territoire qui ne s'appelait pas encore Algérie (nom que lui donnera la France) était la colonie d'un Etat esclavagiste, l'Empire Ottoman de Constantinople.
Le premier geste de la France, en libérant une centaine d'esclaves chrétiens à Alger, sera d'y interdire la pratique de l'esclavage dans tous les lieux qu'elle allait contrôler.
Au point de vue sanitaire, on partait donc à zéro. Le seul établissement de soins rudimentaire établi par Saint Vincent de Paul et les Lazaristes au XVllème siècle avait disparu. Il existait seulement quelques « Moristan » annexés à certaines mosquées comme celui de la rue Bâb Azoun, sorte de mouroir...
Simple asile, sans autre mobilier que des nattes d'une saleté repoussante, il accueillait, dans une dangereuse promiscuité, infirmes, aveugles incurables, vivant de la charité des fidèles (Dr Raymond Fery « l’œuvre médicale française en Algérie, Editions Gandini 1994).
La caste des riches dignitaires turcs avait recours aux médecins maures appelé « tobba » savants surtout en aphorisme moyenâgeux et en superstitions. Bref, on était dans le haut Moyen-âge.
Les médecins militaires français furent les premiers et pendant longtemps les seuls à prendre en charge les problèmes sanitaires de la population. Ils durent d'abord enseigner des rudiments d'hygiène, notion totalement inconnue, et commencer par les eaux polluées, sources de terribles dysenteries entraînant une énorme mortalité infantile. Ils durent faire preuve de dévouement, d'ingéniosité, dans un pays aussi démuni de tout, sans même une seule route carrossable, la plupart des autochtones vivant dans des gourbis où aucun soin n'était possible, on dut ouvrir des lits dans les hôpitaux militaires de campagne, eux-même rudimentaires, sous la tente.
En 1853, lors de la création du corps des médecins de la colonisation, qui vont, peu à peu, prendre le relais des médecins militaires, ces derniers, qui sont au nombre de 420 à se consacrer aux populations civiles, ont déjà fait œuvre utile : les enfants meurent moins en bas âge et l'on voit beaucoup moins d'agonisants le long des chemins ou abandonnés sur des paillasses dans les arrière-cours.
Ces premiers médecins civils de la colonisation, bientôt formés à l'école des médecins d'Alger fondée en 1857, vont rayonner dans le bled. Le territoire algérien va être divisé en une soixantaine de circonscriptions médicales et chacune sera dotée, peu à peu, d'un hôpital auxiliaire. Leur mission est de soigner les patients musulmans des douars : tout est gratuit, tout est aux frais de l'administration française. Ces médecins, pendant plus d'un siècle, vont faire œuvre de civilisation dans ce pays qu'ils ont trouvé démuni de tout. Ils seront l'honneur de la colonisation française. Ils seront aidés par le corps des auxiliaires médicaux indigènes, recrute souvent parmi les diplômés des medersas qui, après deux ans d'études, vont apporter une compétence remarquable dans les tâches qui leur sont assignées : visites des malades les plus éloignés dans cet immense territoire, vaccination antivariolique que l’administration française sera la première au monde à généraliser. Les musulmans, enfin libérés de toutes les croyances superstitieuses, affluent avec confiance dans les centres de soins et hôpitaux auxiliaires.
Dans les petits centres urbains, un service d'assistance aux mères et aux nourrissons est assuré par des auxiliaires médicales féminines formées à I'Ecole des infirmières et visiteuses coloniales de l'hôpital PARNET d'Hussein Dey. Ce maillage sanitaire s'étend et se densifie à mesure que la population musulmane augmente, grâce aux progrès sanitaires qui réduisent de plus eh plus la mortalité infantile et prolongent la durée de la vie. Lorsque sera célébré le centenaire de la Médecine de Colonisation, le 5 janvier 1955 à Alger, le professeur Sergent et le doyen Sarrouy évoqueront la grandeur de l'œuvre accomplie par tous ces médecins, parfois au prix de leur vie, pour faire aimer la France jusqu'aux bleds les plus reculés et une plaque commémorative sera apposée sur le seuil de cet Institut d’Hygiène et de Médecine d'Outre mer qui transforma, en un siècle, la vie de tous les habitants de l'Algérie.
Dans les villes qui se bâtissaient, un immense chantier de constructions d'établissements hospitaliers s'ouvrait dont allait profiter principalement la population musulmane. L'hôpital Caratine, construit rue Bâb Azoun sur I'emplacement d'un ancien bagne d’esclaves illustrait bien l'œuvre de civilisation de la France : une œuvre caritative hautement humanitaire sur un lieu de la plus ancienne des barbaries qu'ait connue I'humanité !
En 1854, ce fut le premier chantier de l'hôpital de Mustapha, mais sa forme moderne et originale de 14 pavillons, en avance de près de soixante ans sur ceux de I’hôpital Edouard Herriot de Lyon, ne sera inaugurée qu'en 1878. Plus tard, il sera, à nouveau, modernisé selon les techniques hospitalières les plus avancées à partir de 1945. Il devint alors le centre hospitalo-universitaire modèle, le plus bel hôpital de toute l'Afrique avec ses salles d'opération plus perfectionnées que celles de la majorité des hôpitaux métropolitains et les patients traités étaient, à 90%, musulmans.
L'hôpital d'El Kettar, inauguré en 1896 pour les maladies contagieuses comprenait six pavillons totalisant 86 lits. L'hôpital Parnet, ouvert en 1912 à Hussein Dey, offrait 257 lits en médecine et chirurgie, il avait une annexe abritant une école d'infirmières. Un service de chirurgie infantile fut installé, sur l'initiative du professeur Curtillet, à l'hôpital de Douéra, fonctionnant comme une annexe de la clinique chirurgicale universitaire de Mustapha.
En dehors d'Alger, l'hôpital civil de Constantine, installé provisoirement dans les bâtiments du Collège arabe-français en 1876 fut bientôt transféré hors les murs, sur un plateau de 650 mètres d'altitude. En 1930, il disposait de 800 lits. A Bône, Philippeville, Bougie, Souk-Ahras, des hôpitaux secondaires surgissaient, peu à peu, du néant, dans des régions que la France faisait sortir du Moyen-âge, il en était de même en Oranie, vaste bâtiment pavillonnaire comprenant 800 lits à Oran. Hôpitaux secondaires à Ain Temouchent, Relizane, Orléanville, Saint Denis du Sig. Ce denier offrait 353 lits.
On ne peut omettre dans ce bilan, les nombreuses structures privées. Les hôpitaux indigènes crées par le Cardinal Lavigerie, avec comme infirmières, les sœurs missionnaires de Notre Dame d'Afrique ; les cliniques indigènes réservées aux femmes et aux enfants, où tout le personnel, médecins et infirmières, étaient exclusivement féminin pour respecter certains principes de la religion musulmane. Enfin les nombreuses cliniques privées, la clinique Laverhne à Alger, la clinique Oulié à Constantine, la clinique Abadie à Oran. Toutes étonnaient souvent les médecins métropolitains en visite par leurs capacités d'accueil, leur confort et leur modernisme.
Les dépenses considérables engagées par la France, sous quelque forme que ce soit, pour construire et entretenir d'aussi nombreux établissements de soins, toujours à l'avant-garde du progrès, donnent la mesure des préoccupations sociales et humaines de notre pays en Algérie et la mesure aussi de L'IGNORANCE A PEINE IMAGINABLE DE LA GRANDE MAJORITE DES ENSEIGNANTS METROPOLITAINS, AGREGES OU NON, QUI REPETENT PLUS QUE JAMAIS A LA JEUNESSE QUE LA FRANCE N'A APPORTE A L'ALGERIE QUE « LA NUIT COLONIALE » ! Ce slogan prend la forme d'un délire qui n'est pas seulement une dénaturation de la vérité, mais devient une offense à I'intelligence..
Ainsi dotée d'un équipement extrêmement complet et toujours d'avant-garde, la médecine en Algérie, allait connaître un brillant essor sur le plan de I'enseignement. De I'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie de 1857, encore bien modeste, allait naître par le décret du 30 novembre 1909, la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie d'Alger qui, avec ses 35 chaires d'enseignement, ses 1150 étudiants en médecine, ses 325 étudiants en pharmacie et ses 280 étudiants en chirurgie, ainsi que par la qualité exceptionnelle de ses professeurs, se classa, en 1959, comme une des toutes premières parmi les Facultés de médecine métropolitaines. Déjà, en 1943, l'organisation, le niveau scientifique, les réalisations originales de cette Faculté dans le domaine des maladies tropicales, en symbiose avec l'Institut Pasteur d'Alger, avaient fait l'admiration des médecins du service de santé des armées alliées opérant en Méditerranée de 1942 à 1945.
L'histoire de I'Institut Pasteur d'Alger mérite une mention à part. D'origine très modeste, établi dans un pavillon au sein des jardins de l'Université où travaillaient depuis 1894 les Professeurs Soulié et Trolard, I'Institut Pasteur, sur I'initiative du Gouverneur Général Jonnard, fut ensuite transféré dans un bâtiment neuf sur les hauteurs du HAMMA et confié au Professeur Edmond Sergent, disciple de Pasteur en 1909 et dont la mission capitale pour l'étude des maladies tropicales fut fixée par décret de janvier 1910.
En une cinquantaine d'années, il va attirer les chercheurs, non seulement de Métropole, mais aussi du monde entier. Il est impossible d'énumérer, même brièvement, l'étendue des recherches de cet Institut modèle en matière de pathologies infectieuses tropicales. Il va devenir le premier Institut de recherche pour l'étude et le traitement du paludisme dans le monde.
L’importance de l'activité de I'Institut Pasteur d'Alger justifie quelques chiffres tirés du livre du Docteur Raymond Féry (o.c.) dans une période où son action fut décisive pour la santé, du fait de la guerre de 1942 à 1945, trois millions de doses de vaccins contre le typhus, cent vingt mille, doses de vaccins contre la peste, près de dix millions de doses de vaccins antivarioliques (cette terrible maladie, presque toujours mortelle n'était pas encore éradiquée à cette époque) et beaucoup d'autres sérums furent livrés aux troupes alliées opérant alors en Méditerranée et, aussi, envoyés, clandestinement, à la résistance française par des parachutages dans le midi de la France.
Lorsque parurent en 1964, sous la signature du Professeur Sergent. Les travaux scientifiques de I'Institut Pasteur d'Alger de 1900 à 1962, cette publication comportait 2.276 titres et comptes-rendus, et elle fut accueillie dans le monde médical comme une des plus belles contributions de la France dans cette première moitié du XXème siècle.
Le bilan sanitaire de la médecine française en Algérie paraÎt considérable. Il est bien rare de voir les conditions de vie d'une population donnée, transformées de fond en comble en moins d'un siècle. Le paludisme endémique atteignait près de 50 % de la population musulmane dans certaines régions. Il recula dans d'énormes proportions et la mortalité des sujets atteints (adultes et enfants) tomba de 25 à 5 % grâce aux travaux et recherches du médecin-colonel Laveran (prix Nobel de médecine) et du médecin commandant Maillot. Le nom de ce dernier fut donné à l'hôpital militaire d'Alger, mais le F.L.N. débaptisa ce dernier, la révolution algérienne n'ayant sans doute pas besoin de ce grand savant français.
Le trachome était une conjonctivite granuleuse et ulcérante redoutable dont un grand nombre de nouveau-nés et de nourrissons étaient atteints en Afrique du Nord. Les trois quarts d'entre eux restaient aveugles définitivement. Les premiers médecins militaires en Algérie avaient été frappés par le grand nombre d'aveugles qui peuplaient les rues d'Alger. Mendiants assis au pied d'un palmier, le visage tourné vers un ciel invisible, psalmodiant des versets du Coran en sollicitant la charité publique. On les prenait parfois pour des prophètes ou des marabouts.
La médecine coloniale française entreprit une campagne d'éradication qui dura quarante ans :
1') Création de centres de dépistage précoce ( les fameux Biout el Ainin : Maisons des yeux) jusque dans les plus petites communes.
2') Equipes itinérantes visitant les familles jusqu'au fond des bleds les plus reculés et des mechtas les plus dispersées sur deux millions de kilomètres carrés.
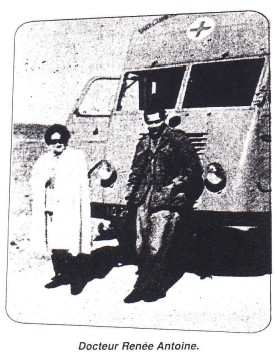 Une femme médecin se distingua particulièrement dans cette œuvre qu'elle considérait comme un apostolat, le Docteur Renée Antoine y consacra plus de vingt ans de sa vie. Elle était extrêmement populaire dans les territoires du Sud auprès des Touaregs. Avec Emilie de Vialar, elle devrait être considérée comme une apôtre de la civilisation française en Afrique. Le trachome devait disparaÎtre à peu près complètement et les aveugles du même coup, avec plus de cinquante ans d'avance sur les autres pays arabes du Moyen Orient, l'éradication du trachome en Algérie fut une des plus belles victoires de la médecine coloniale. Une femme médecin se distingua particulièrement dans cette œuvre qu'elle considérait comme un apostolat, le Docteur Renée Antoine y consacra plus de vingt ans de sa vie. Elle était extrêmement populaire dans les territoires du Sud auprès des Touaregs. Avec Emilie de Vialar, elle devrait être considérée comme une apôtre de la civilisation française en Afrique. Le trachome devait disparaÎtre à peu près complètement et les aveugles du même coup, avec plus de cinquante ans d'avance sur les autres pays arabes du Moyen Orient, l'éradication du trachome en Algérie fut une des plus belles victoires de la médecine coloniale.
La syphilis faisait des ravages en Afrique du Nord et se traduisait par ces nez rongés, parfois jusqu'à la racine tandis que les enfants hérédosyphilitiques mouraient en très bas âge. L'organisation de dispensaires, I'emploi de médicaments efficaces déjà avant la Première Guerre Mondiale, la formation des sages femmes à l'européenne, la surveillance sévère des maisons de tolérance, placèrent I'Algérie au premier rang de la lutte anti-syphilitique dans tout le monde arabe. La surveillance et le traitement des femmes enceintes syphilitiques furent très efficaces sur la prévention de la mortalité infantile.
Le typhus exanthématique affection grave, mortelle le plus souvent, avant les antibiotiques, régnait en petits foyers endémiques avant 1830 : la lutte fut très longue mais I'efficacité en fut déterminée par l'amélioration du niveau de vie, avec des rechutes dans les périodes de sécheresse qui entraînaient des famines. Le médecin-colonel Charles Nicolle (prix Nobel de médecine 1928) découvrit les germes, les rickettsies, intermédiaires entre les bactéries et les virus ainsi que la transmission par les poux. La vaccination entreprise sous l'égide de l'Institut Pasteur d'Alger, en 1942-1943, dont quatre millions de personnes furent bénéficiaires en Afrique du Nord, évita l’extension de la maladie, comme ce fut malheureusement le cas à Naples où une terrible épidémie survint dans la population civile au début de I'hiver 1943-1944, après le débarquement des troupes alliées.
La peste bubonique ravageait périodiquement les pays riverains de la Méditerranée au moment des guerres et des déplacements de populations. Cette maladie, que Camus a popularisée dans un roman célèbre, est due au bacille de Yersin (encore un médecin militaire français) et était transmise par les rats. La peste bubonique n'a jamais ravagé l'Afrique du Nord comme elle I'a fait au Moyen Orient, ceci grâce aux mesures prophylactiques, la dératisation, la vaccination par virus atténué et I'hygiène générale des populations. La peste s'observait souvent, par contre, dans les pays orientaux soumis à la domination turque, par suite de la misère et de I'incurie qui régnaient dans ces populations. Il est utile de rappeler que, peu d'années avant 1830, dans le cloaque où vivait la population d'Alger, une terrible épidémie avait emporté le tiers des habitants !
La tuberculose : son dépistage fut entrepris aussi sur une très grande échelle avec de très nombreux dispensaires, cinq sanatoriums dont celui très moderne de Tizi-Ouzou, en pleine Kabylie, construit en 1936, trois préventoriums et quatre aériums. Entre 1949 et 1955, un million cinq cent mille enfants algériens reçurent le vaccin du B.C.G. fourni par l'Institut Pasteur d'Alger.
Dans aucun pays musulman au monde, à cette époque, un tel effort de prophylaxie de la tuberculose ne fut comparable... Dans "Le Monde, de septembre 1998, le journaliste algérien Djillali Hadjadj écrivait en La couverture vaccinale des enfants a régressé, le taux de mortalité infantile connaît une courbe ascendante représentant dix fois celui de la France. Le fléau de la tuberculose connaît un retour inquiétant,.
Un très grand nombre de maladies parasitaires traitées en Algérie, souvent de façon originale (kyste hydatique) est à mettre au palmarès des nombreuses conquêtes de la médecine française dans ce pays, comme dans les territoires de I'Afrique occidentale et équatoriale administrés par la France. On peut les énumérer ici :
En 1962, la France laissait à I'Algérie indépendante le plus moderne des équipements hospitaliers avec 48.000 lits, équipement supérieur en nombre et en qualité à celui de la Métropole ! Grand a été notre étonnement, lorsqu'en 1962, nous avons, au cours de l'exode, découvert les établissements hospitaliers de Métropole dont le niveau était loin d'atteindre celui de notre « Mustapha », écrit le Professeur Félix Lagrot, membre de I'Académie de Médecine dans la préface du livre du Docteur Raymond Féry. Que sont devenus ces hôpitaux sous le règne du F.L.N. ? (voir LA LETTRE DE VERITAS de novembre 2002)
En conclusion, il faut rendre un vibrant hommage, aussi, à la conduite des médecins et infirmiers de toute I'Afrique du Nord pendant la deuxième guerre mondiale. Sur le plan technique d'abord, le Professeur Benhamou créa de remarquables équipes de transfuseurs réanimateurs qui, dans les combats de Tunisie, d'Italie et lors de la libération de la Métropole, recueillirent et sauvèrent plus de trente huit mille blessés de 1942 à 1945. Père de la transfusion sanguine moderne, le Professeur Benhamou fut secondé très efficacement par la générosité de M. Henri Borgeaud qui finança, dans son domaine de Staouéli, une usine et un laboratoire pour la lyophilisation du plasma sanguin, laquelle servira, plus tard, de modèle, en Métropole.
Le corps médical mobilisé d'Afrique du Nord comptera dans ses rangs soixante, quinze morts et près de deux cents blessés graves invalides pour la libération d'une ingrate patrie... Pourcentage bien supérieur à celui des pertes du service de santé pendant la Première Guerre Mondiale.
Nous laisserons au Professeur Pierre Goinard la conclusion de cet article :
" Le nombre des musulmans ne dépassait guère les deux millions en 1872. Il allait quadrupler en moins d'un siècle. Sans l'œuvre sanitaire de la France, trois musulmans sur quatre n'auraient pas existé. La médecine française n'avait pas seulement refoulé les épidémies, éradiqué les endémies diffuses, réduit la mortalité infantile, sauvé des vies condamnées. Les médecins français avaient conquis le cœur des populations. ,.
Que reste-t-il de tout cela ? Le bilan sanitaire de l'Algérie d'aujourd'hui est désastreux. Tous les témoignages sont concordants : ce désastre symbolise bien le degré de régression humaine et sociale qu'a entraîné la brutale séparation de l'Algérie et de la France. La révolution algérienne, entre autres méfaits, a détruit l'œuvre sanitaire de la France.
Dr Pierre CATTIN
Médecin métropolitain
|
|
Le plaidoyer de Goldnadel
De M. Gilles william Goldnadel
Le 13 mai 2014
|
Pourquoi l'esclavage n'était pas
l'apanage de l'occident
Le plaidoyer de Goldnadel
Gilles-William Goldnadel est avocat et écrivain. Il est secrétaire national à l'UMP chargé des médias. Il préside par ailleurs l'Association France-Israël. Toutes les semaines, il décrypte l'actualité pour FigaroVox.
Je n'aurais certainement pas rédigé le «twitte» de Thierry Mariani dans les termes utilisés par l'ancien ministre des transports. D'ailleurs, je ne «twitte» pas. Je n'aurais pas non plus évoqué le thème fondamental de la déculpabilisation occidentale à la défaveur d'un drame en train de se dérouler en terre africaine.
Ayant posé cela fermement, personne ne m'empêchera de m'interroger sur le fond d'une question esclavagiste posée trop lapidairement par le lapidé et sur les causes profondes de sa lapidation.
Qui a dit: «Donnez-moi dix lignes et je vous ferai pendre?» Il en a suffi d'une seule pour que Dominique Sopo, expédie (Le Monde du 9 mai «le bréviaire de la haine») M. Mariani «esclave de sa haine» dans les limbes de l'enfer.
À ce vilain jeu de l'excommunication, pour lequel je ne pourrais évidemment jamais lutter avec un ancien président de SOS-Racisme, il y aurait pourtant beaucoup à écrire.
À en croire en effet M. Sopo, refuser l'auto culpabilisation occidentale au motif que l'Occident n'aurait pas eu le monopole de l'esclavage serait une démonstration de mépris «à l'endroit des immigrés d'origine maghrébine, africaine et subsaharienne».
Tiens donc. À cette aune, et si par hypothèse absurde, il fallait peser systématiquement le mépris des hommes au trébuchet de leurs écrits d'un jour, le mépris de M. Sopo pour les populations visées serait, on va le voir, assez lourd.
Mais si on veut bien revenir à une réflexion plus pondérée, on pourrait poser comme postulat que l'incontestable et unilatérale culpabilisation de l'Occident dans la question esclavagiste provient de ce que seul le légitime devoir de mémoire à l'égard de la traite transatlantique est respecté, tandis que la mémoire de la traite arabique des chrétiens européens et des Noirs africains est systématiquement et délibérément occultée.
C'est bien dans ce trou de mémoire, qui n'est pas oubli mais déni, qui fait de l'occidental l'unique esclavagiste, que se niche la culpabilisation avidement recherchée.
Et l'on peut effectivement parler d'auto culpabilisation lorsque l'on constate que la mémoire chrétienne et occidentale moderne a été littéralement effacée.(1)
Le spécialiste incontesté de la période, Robert C. Davis (« Christians slaves, Muslim masters » Palgrave Macmillan editor 2003) observe que si les historiens ont étudié minutieusement l'esclavage des Noirs africains par les blancs, ils ont ignoré superbement l'esclavage des blancs par les Arabes nord-africains.
Mémoire gommée d'abord, et de stupéfiante manière, de l'esclavage des blancs, essentiellement chrétiens, réduits à la servitude par les Arabes à partir du XVIe siècle et jusqu'au XIXe.
La question centrale pour la présente réflexion étant de tenter de comprendre pourquoi les occidentaux ont oublié ce dont les Noirs se souviennent si bien.
Le spécialiste incontesté de la période, Robert C. Davis («Christians slaves, Muslim masters» Palgrave Macmillan editor 2003) observe que si les historiens ont étudié minutieusement l'esclavage des Noirs africains par les blancs, ils ont ignoré superbement l'esclavage des blancs par les Arabes nord-africains.
Le professeur Davis, qui enseigne l'histoire sociale à l'université d'Etat de l'Ohio, rappelle que la côte barbaresque qui s'étend du Maroc à la Lybie fut le lieu d'une industrie prospère de rapt d'êtres humains de 1500 jusqu'à 1800.
Les capitales esclavagistes étaient Tunis, Alger, Tripoli et Sale.
Alors que la traite occidentale était cyniquement mercantile, pour les Arabes, la traite des chrétiens participait d'un esprit de revanche lié aux croisades et à la reconquista espagnole.
Quand ils débarquaient, les pirates musulmans détruisaient systématiquement les lieux de culte chrétiens.
Dès l'arrivée en Afrique du Nord, on faisait défiler chrétiens et chrétiennes dans les rues pour les humilier.
Selon sa méthode d'estimation, entre 1530 et 1780, environ 1 250 000 chrétiens européens blancs auraient été déportés en les couvrant d'immondices. On rasait les nouveaux esclaves pour les soumettre davantage, y compris sexuellement. On a peine à imaginer aujourd'hui ce que fut la vie de ces hommes qui, en majorité, passèrent le reste de leur existence sur les galères où ils étaient fouettés au moyen de pénis de bœufs (le fameux «nerf de bœuf»). Le professeur Davis indique que ces Infidèles, au contraire du Code Noir, ne bénéficiaient d'aucune protection contre l'arbitraire ou la cruauté de leur maître. On a également peine à imaginer aujourd'hui l'impuissance des nations européennes, en raison de la faiblesse de leurs marines, et à l'inverse de l'habileté manœuvrière des corsaires, à empêcher les razzias. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que les Italiens purent prévenir les raids terrestres dévastateurs. Avant cela, le sud de l'Italie et la Sicile, si proches des rivages tunisiens, vécurent littéralement dans la terreur. Quand les pirates débarquaient, la population fuyait vers l'intérieur des terres, ce qui n'empêchait pas les barbaresques d'aller les chercher.
Combien furent-ils? Le professeur Davis insiste sur le fait que des recherches gigantesques ont été menées pour évaluer aussi finement que possible le nombre de Noirs enlevés, mais qu'à l'inverse peu d'efforts ont été accomplis pour évaluer l'ampleur de l'esclavage des chrétiens entrepris par les Arabes. Ces derniers, au demeurant, ne conservaient pas d'archives.
Selon sa méthode d'estimation, entre 1530 et 1780, environ 1 250 000 chrétiens européens blancs auraient été déportés.
Quand les Français s'emparèrent d'Alger en 1830, précisément pour lutter contre cette piraterie, il y avait encore 120 esclaves blancs retenus en captivité dans le bagne de la ville.
À nouveau: pourquoi si peu d'intérêt, sans même évoquer de compassion, pour l'esclavage en Méditerranée alors que la traite négrière n'a plus de secret pour personne, fait l'objet, à juste raison, de commémorations assorties de lieux de pèlerinage, comme à Gorée?
Pour conclure Jacques Heers déplore : « l'histoire de l'Afrique est écrite sans que l'on veuille vraiment porter attention à cette traite, la première pourtant et la plus importante de toutes. ».
Ainsi que l'explique le professeur Davis: «des esclaves blancs avec des maîtres non blancs ne cadrent pas avec le récit maître de l'impérialisme européen. Les schémas de victimisation si chère aux intellectuels requièrent de la méchanceté blanche, pas des souffrances blanches.»
D'autre part, qui peut nier sérieusement qu'alors que la traite négrière dite transatlantique, organisée par les Européens, est connue universellement, au point de passer pour unique, et a fait l'objet d'innombrables documentaires écrits ou audiovisuels basés sur la réalité ou la fiction, un silence de plomb continue de peser sur la traite orientale des esclaves noirs ?
Pourtant la première est quantitativement moins importante que la seconde, a duré moins longtemps et s'est achevée moins récemment : 11 millions d'esclaves sont partis d'Afrique vers les Amériques ou les îles de l'Atlantique entre 1450 et 1860. En revanche, 17 millions d'Africains noirs ont été déportés par les négriers d'Orient de 650 jusqu'à 1920.
Citons le professeur Lugan: «le XIXe siècle nous a laissé de nombreux témoignages se rapportant à ce commerce et aux razzias qui l'alimentaient. (…) En général les hommes étaient décapités et, les femmes et les enfants enlevés en esclavage à travers les pistes sahariennes.»
L'article «Esclavage, esclavage» publié par Éric Chaumont (Robert Laffont 2007), chargé de recherche au CNRS, spécialiste du droit musulman, rappelle que ce n'est que «sous pression extérieure que les derniers pays esclavagistes qui étaient musulmans ont aboli l'esclavagisme ; de quasi droit, celui-ci existe encore dans certains pays sahariens et, de fait, dans la péninsule arabique».
L'ouvrage de Jacques Heers, directeur du département médiéval de la Sorbonne, «Les négriers en terre d'islam, la première traite des Noirs» (Perrin 2003) est tristement illustratif de la condition d'esclave noir en terre d'islam. Dans le chapitre «l'homme de couleur mal-aimé, le mépris», cet historien considérable écrit dans un chapitre intitulé «Les Noirs, heureux de leur sort?»: «Aucun noir, esclave en Égypte, au Maroc ou en Orient, n'a écrit le récit de sa vie ; si certains ont eu l'occasion de le faire, il n'en reste pas même un vague souvenir. Aucun, surtout, n'a eu le loisir d'en parler aux siens, à ceux de sa race, de retourner chez lui, libéré de ses liens et de cet opprobre social. De plus, et cela paraît une grave lacune pour la connaissance matérielle et sociale de l'esclavage, ces captifs arrachés d'Afrique noire pour être mis sur les marchés du Caire ou d'Arabie, n'ont certainement pas, comme les noirs de la traite européenne Atlantique, bénéficié à une certaine époque d'un fort mouvement d'opinion pour éveiller et tenir en alerte les bonnes consciences par toutes sortes de livres, pamphlets, manifestations et conférences. Silence total, silence complice?» Et l'historien d'observer qu'il n'y a pas eu de «Case de l'oncle Tom» édifiée en terre d'islam.
Pour conclure Jacques Heers déplore: «l'histoire de l'Afrique est écrite sans que l'on veuille vraiment porter attention à cette traite, la première pourtant et la plus importante de toutes.».
La cabale organisée à l'encontre de l'historien Olivier Pétré-Grenouilleau, coupable lui aussi d'avoir rappelé la vérité historique, aura été instructive en ce qu'elle a montré que ce ne sont pas des personnalités Arabo-islamiques qui s'effarouchent le plus de la mise en perspective des traites esclavagistes, mais plutôt certains militants extrémistes antillais ou guyanais, davantage friands de culpabiliser l'occidental français.
A preuve, lorsqu'on demandait à Mme Christiane Taubira, jadis indépendantiste guyanaise, et mère de la loi mémorielle qui proscrit toute négation de la traite esclavagiste, pourquoi seule la transatlantique était visée, à l'exclusion des autres ; celle-ci répondait ingénument qu'il convenait de ne pas désespérer les jeunes des cités…
C'est bien dans ce cadre «ressentimental» agressif et ciblé qu'il est permis d'interpréter psychologiquement le refus de la ministre de chanter à l'unisson l'hymne français vécu comme un «karaoké», dans les circonstances de la commémoration de l'abolition de l'esclavage.
Pour terminer, retour sur Thierry Mariani et son sévère contempteur de SOS-Racisme. À aucun moment, dans son article, ce dernier, en dépit de son souci claironné pour le sort des victimes, ne fait la moindre allusion à la traite négrière arabique. Et je n'ose évoquer la traite barbaresque des chrétiens blancs.
Mais il y a bien plus grave, et qui ne concerne pas seulement M. Sopo et ses amis à la sélective mémoire. Il ne s'agit plus d'Histoire douloureuse. Il s'agit de souffrances au présent.
Ce qui compte, c'est de pouvoir maintenir l'occidental, et lui seul, tête basse, vide des mémoires de ses propres souffrances, en position de génuflexion.
Qui ose évoquer le fait que l'esclavage n'a toujours pas disparu en terre d'Orient?
Je ne parle pas seulement d'esclavage moderne à l'égard des Philippins, des Indiens ou des Pakistanais que les émirats richissimes pratiquent aussi allègrement qu'impunément.
Je parle de l'esclavage de toujours. De celui que l'on trouve encore, par exemple, dans un pays comme la Mauritanie.
Je renvoie les esprits forts à la lecture édifiante de l'article de Christophe Chatelot (Le Monde du 25 mai 2012) et dans lequel sont évoqués les déboires de M. Ould Abeid, coupable d'avoir pris la tête d'un mouvement appelé «initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste» pour lutter contre la survivance de pratiques esclavagistes dont certains maures blancs se rendent coupables à l'égard de Noirs de Mauritanie.
Il est des silences éloquents. Ce silence là devrait être entendu. Il montre cruellement que pour les pseudos antiracistes de nos contrées idéologiques, le sort des victimes noires leur est complètement indifférent.
Ce qui compte, c'est de pouvoir maintenir l'occidental, et lui seul, tête basse, vide des mémoires de ses propres souffrances, en position de génuflexion.
C'est dans ce sens qu'il fallait lire la lecture d'un twitte.
(1) le lecteur pourra, pour davantage de précisions sur le sujet, se reporter à mes «Réflexions sur la question blanche» (Jean-Claude Gawsewitch éditions 2011).
|
|
JARDIN DES ETOILES 2025
Fleurissement cimetière de Bône
Par Mounir Hanéche et Eric Wagner
|
Mesdames, messieurs, chères et chers compatriotes bônois(es), bonjour.
Les années s'écoulent et nous sommes toujours là, au rendez-vous de la mémoire des nôtres laissés en leur terre algérienne.
Bien que tout soit complexe et difficile, cette année encore nous renouvelons le fleurissement de notre cimetière pour la Fête des Défunts.
Des travaux sont en cours d'éclairage, de rehaussement de murs, de fermeture de tombes, et autres par l'APC et le Consulat de France.
Difficile d'avoir toutes les informations utiles, ni photos, mais les précisions que je reçois convergent en ce sens.
Il nous faut marquer de notre présence.
Soyons plus nombreux qu'en 2024!
Faites savoir, svp autour de vous... Si le coeur leur (vous) en dit.
Je vous mets en pièce jointe le bon de commande de l'année dernière, en raison de l'augmentation des coûts, une hausse de 2€ a été ajoutée.
Je fais au mieux tant que je le peux, à vos côtés en relais de toutes celles et de tous ceux qui les années précédentes se sont démenées. Merci.
Merci à Mounir d'être toujours à nos côtés pour cette marque de respect et du souvenir envers nos anciens.
Solidairement, piednoirement, bônoisement vôtre.
Eric Wagner (Bône décembre 1961)
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône et la Province du Constantinois méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il a continué jusqu'à son dernier souffle. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous, des pages qui pourraient être complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir. Jean Claude est décédé, et comme promis j'ai continué son oeuvre à mon rythme.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Guelma, Philippeville, etc. a été fait pour d'autres communes de la région de Bône et de Constantine.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et du Constantinois
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
|
|
| Redoutable Intelligence Artificielle
Envoyé Par Eliane
|
Un père de famille rentre de son labo électronique avec un nouveau robot détecteur de mensonges.
Son fils de 12 ans rentre avec 2 heures de retard de l'école.
« Où étais-tu tout ce temps ? demande le père
« J'étais à la bibliothèque pour préparer un devoir » !
Le robot se dirige vers le fils et lui assène une claque...
Le père explique : « Mon fils, ce robot est un détecteur de mensonges, tu ferais mieux de dire la vérité »
« OK... J'étais chez un copain et nous avons regardé un film »
« Quel film ? demande le père.
« Les 10 Commandements » répond le fils.
Et paf ! Le robot assène de nouveau une claque au fils...
« Aïe ! Bah oui ! En fait, c'était un film porno... »
Le père : « J'ai honte de toi ! À ton âge, je ne mentais jamais à mes parents »
Et paf ! Le robot assène une baffe au père...
La mère se marre : « Décidément, c'est bien ton fils… »
Et paf ! Une baffe à la mère !
|
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d'informer est grandement menacée, et c'est pourquoi je suis obligé de suivre l'exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d'information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d'expression, tel qu'il est reconnu par la Résolution 59 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d'expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|
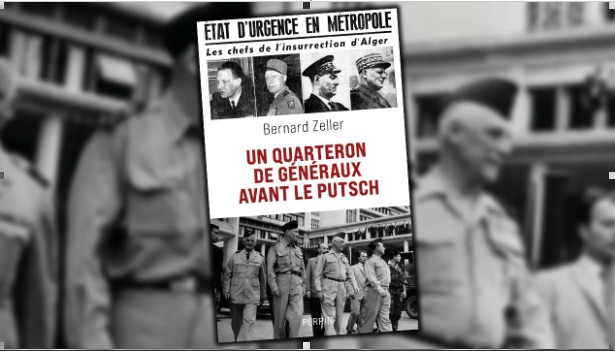


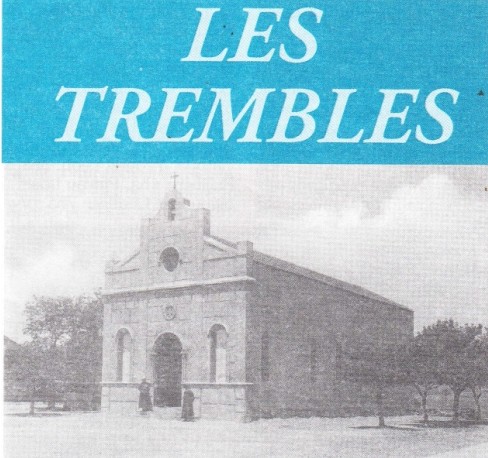 La commune des Trembles, dont le nom ancien était Sidi-Hamadouche est située à 491m d'altitude, entre les centres de Oued Imbert et Prudon, à 15 Km de Sidi-Bel Abbès. Elle a été érigée en commune de plein exercice par arrêté préfectoral en date du 25 juin 1874. Antérieurement rattachée à la circonscription militaire de Sidi-Bel-Abbès, elle comprenait les communes de Oued Imbert et Lauriers Roses qui ont été extraites entre 1880 et 1885.
La commune des Trembles, dont le nom ancien était Sidi-Hamadouche est située à 491m d'altitude, entre les centres de Oued Imbert et Prudon, à 15 Km de Sidi-Bel Abbès. Elle a été érigée en commune de plein exercice par arrêté préfectoral en date du 25 juin 1874. Antérieurement rattachée à la circonscription militaire de Sidi-Bel-Abbès, elle comprenait les communes de Oued Imbert et Lauriers Roses qui ont été extraites entre 1880 et 1885.
 Lors du "Grand Retour", le mardi 29 mars 1949. le village accueillit Notre-Dame de Santa-Cruz au cours d'une très belle cérémonie. Les pauvres et les "bons riches" s'unirent pour construire un clocher et acheter un carillon qui fut inauguré le 27 mars 1955, par le curé, le R.P. Straesslé. Le maire. M. René Schweitzer offrit la plus grosse cloche, un fa de 900Kg. Les noms des donateurs sont : Sibioude, Mariano, Sénac, Maigre, Serrano, Gabriel Lopez, Albert Miller et les marraines des 4 plus grosses cloches : Mmes Maigre, Vincent. Liberato. Rebolle. Marin, Cerdan. Ce fut une bien belle fête : "Entouré de nombreux prêtres, chanoines, R.P.. directeurs du centre professionnel de Misserghin, avec leurs élèves, leur fanfare et leur clique de tambours et clairons, les pères de Sonis, les missionnaires du St-Esprit, les curés des environs, et même le curé doyen de Tlemcen, Mgr Lacaste. Evêque d'Oran assisté du vicaire général Lecat et du chanoine Collet bénit les nouvelles cloches ornées des plus belles dentelles qu'on puisse réunir pour un tel jour. "En 1956 et 1959. Le village reçut les visites pastorales de Mgr Lacaste en tournée de confirmation. Le bon père qui le reçoit pour la 3ème fois est âgé de 75 ans et tous les gens de la commune ont bénéficié de son dévouement : Il est unanimement aimé et respecté.
Lors du "Grand Retour", le mardi 29 mars 1949. le village accueillit Notre-Dame de Santa-Cruz au cours d'une très belle cérémonie. Les pauvres et les "bons riches" s'unirent pour construire un clocher et acheter un carillon qui fut inauguré le 27 mars 1955, par le curé, le R.P. Straesslé. Le maire. M. René Schweitzer offrit la plus grosse cloche, un fa de 900Kg. Les noms des donateurs sont : Sibioude, Mariano, Sénac, Maigre, Serrano, Gabriel Lopez, Albert Miller et les marraines des 4 plus grosses cloches : Mmes Maigre, Vincent. Liberato. Rebolle. Marin, Cerdan. Ce fut une bien belle fête : "Entouré de nombreux prêtres, chanoines, R.P.. directeurs du centre professionnel de Misserghin, avec leurs élèves, leur fanfare et leur clique de tambours et clairons, les pères de Sonis, les missionnaires du St-Esprit, les curés des environs, et même le curé doyen de Tlemcen, Mgr Lacaste. Evêque d'Oran assisté du vicaire général Lecat et du chanoine Collet bénit les nouvelles cloches ornées des plus belles dentelles qu'on puisse réunir pour un tel jour. "En 1956 et 1959. Le village reçut les visites pastorales de Mgr Lacaste en tournée de confirmation. Le bon père qui le reçoit pour la 3ème fois est âgé de 75 ans et tous les gens de la commune ont bénéficié de son dévouement : Il est unanimement aimé et respecté.
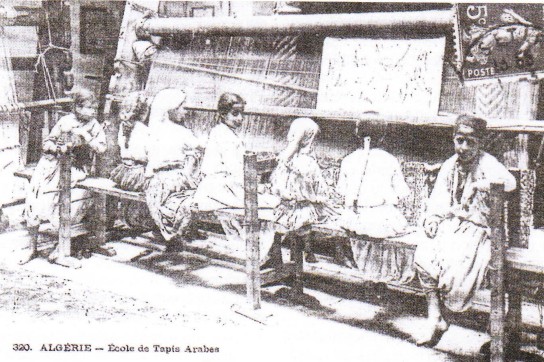
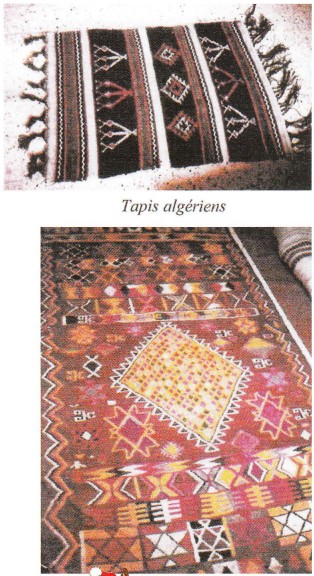 Les nattes d'alfa au décor géométrique simple, à base de losanges et de triangles, et à la gamme sobre : rouge, brun, noir, bistre, est une industrie féminine au Bou-Thaleb ( Ampère). Quatre mille nattes se vendent chaque année sur les marchés locaux. Leurs réputations justifiée permettent une exportation jusqu'aux territoires sahariens (Touggourt).
Les nattes d'alfa au décor géométrique simple, à base de losanges et de triangles, et à la gamme sobre : rouge, brun, noir, bistre, est une industrie féminine au Bou-Thaleb ( Ampère). Quatre mille nattes se vendent chaque année sur les marchés locaux. Leurs réputations justifiée permettent une exportation jusqu'aux territoires sahariens (Touggourt).
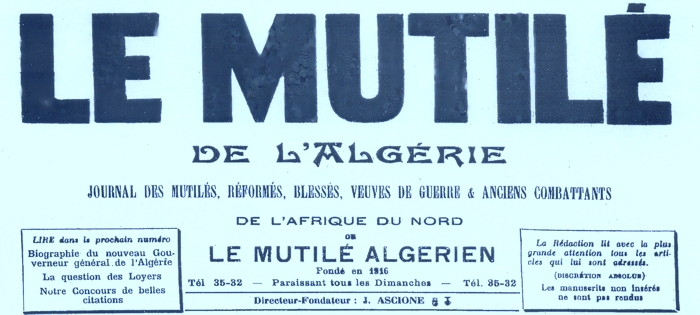
 Né à Huires, dans le quartier Saint-Esprit, qui fait aujourd'hui partie de Bayonne, le 31 octobre 1825, de Léon-Philippe Allemand-Lavigerie, jeune contrôleur des douanes, et de Laure-Louise Latrilhe, Charles Martial fut baptisé dans l'Eglise de Saint-Esprit ; nous avons vu, non sans une vive émotion, le baptistère où il devint enfant de Dieu. Vers l'âge de dix ans, il fut envoyé au Petit Séminaire de Larressore. A Mgr Lacroix, l'évêque du diocèse, qui l'interrogeait : « Vous avez donc la vocation d'être prêtre ? »
Né à Huires, dans le quartier Saint-Esprit, qui fait aujourd'hui partie de Bayonne, le 31 octobre 1825, de Léon-Philippe Allemand-Lavigerie, jeune contrôleur des douanes, et de Laure-Louise Latrilhe, Charles Martial fut baptisé dans l'Eglise de Saint-Esprit ; nous avons vu, non sans une vive émotion, le baptistère où il devint enfant de Dieu. Vers l'âge de dix ans, il fut envoyé au Petit Séminaire de Larressore. A Mgr Lacroix, l'évêque du diocèse, qui l'interrogeait : « Vous avez donc la vocation d'être prêtre ? »
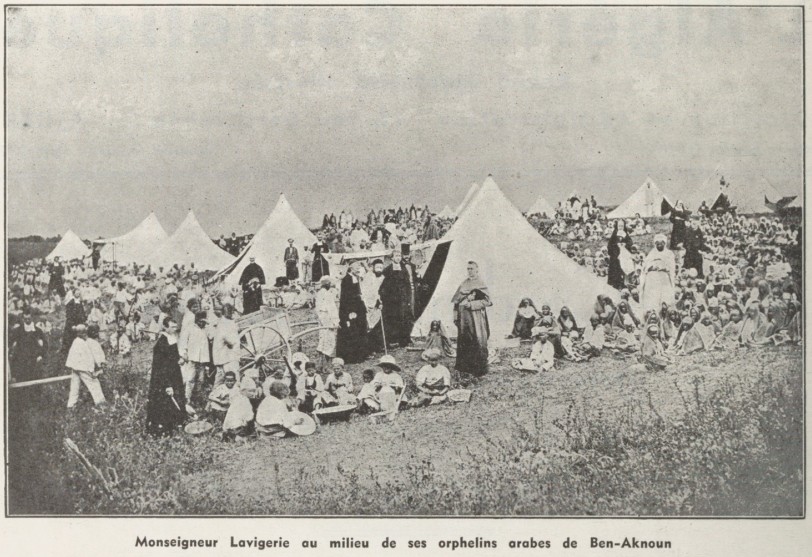
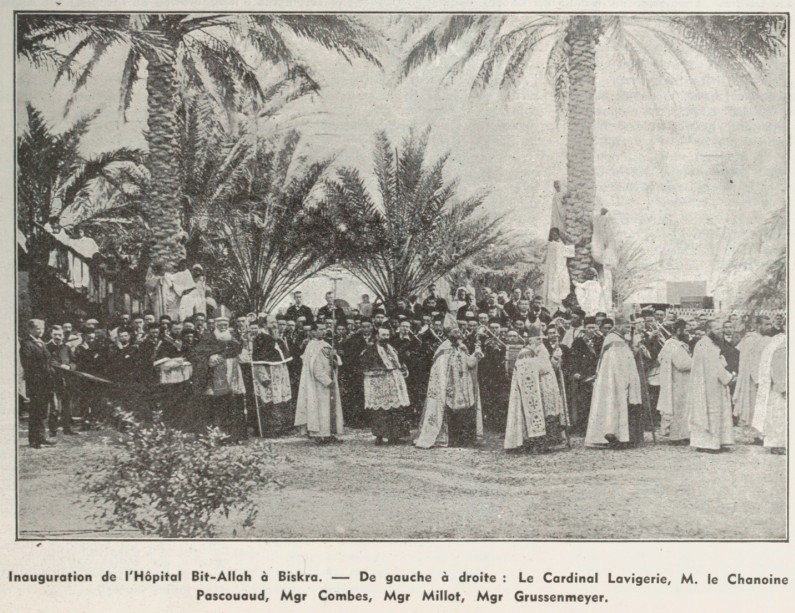
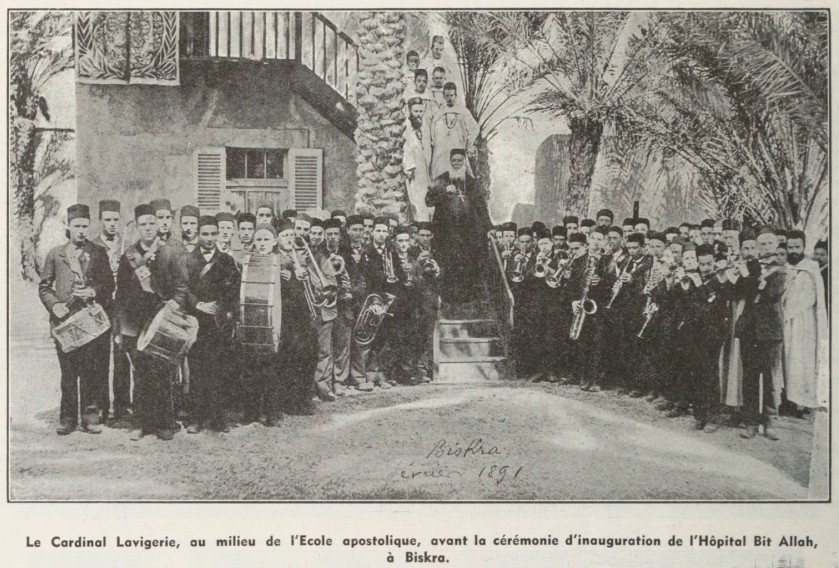
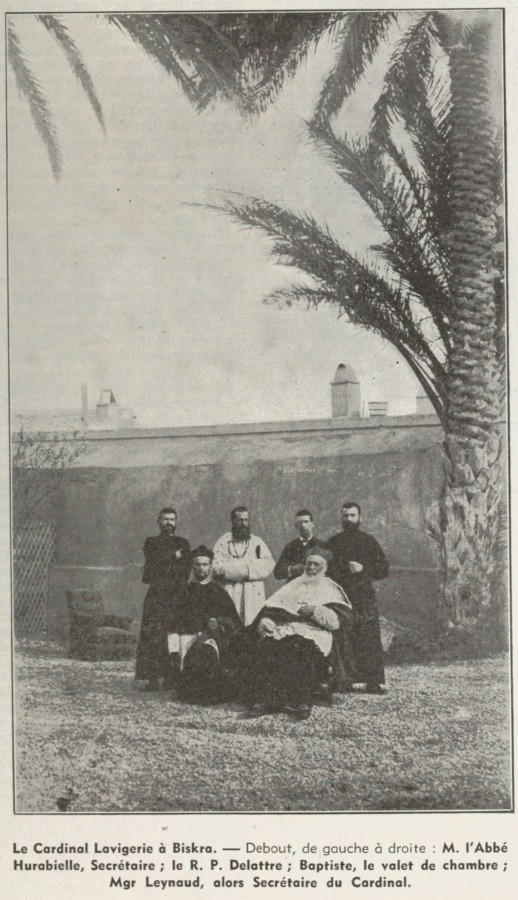 Une telle initiative n'était certes point faite pour lui gagner la sympathie du Gouvernement d'alors ; mais il ne s'en inquiète pas et, pour encourager encore les colons dans leur tâche difficile et les fixer au sol, il voulut leur donner les moyens possibles de pratiquer notre sainte religion, en poursuivant très activement la construction de nouvelles églises.
Une telle initiative n'était certes point faite pour lui gagner la sympathie du Gouvernement d'alors ; mais il ne s'en inquiète pas et, pour encourager encore les colons dans leur tâche difficile et les fixer au sol, il voulut leur donner les moyens possibles de pratiquer notre sainte religion, en poursuivant très activement la construction de nouvelles églises.

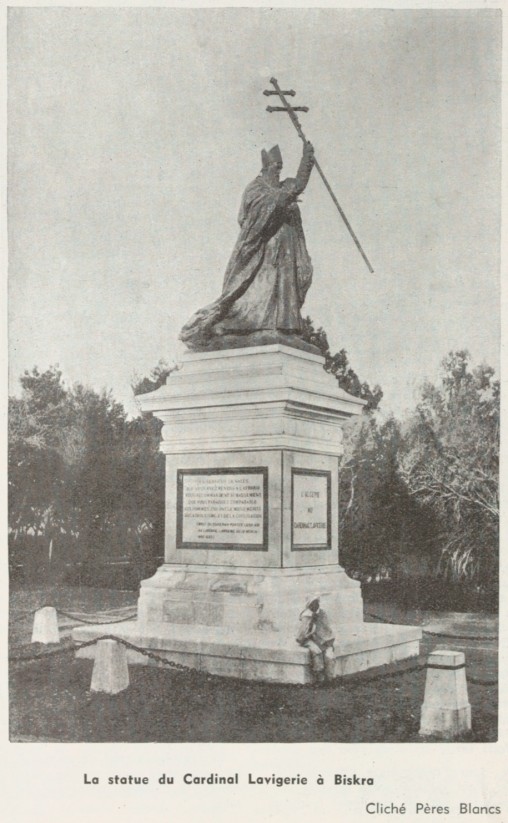 Nous connaissons tous cette gandoura blanche, ce burnous blanc, cette chéchia, ce rosaire que nous sommes heureux de saluer, dans nos villes, dans nos campagnes, dans la plaine du Cheliff et jusque sur les montagnes de la Kabylie.
Nous connaissons tous cette gandoura blanche, ce burnous blanc, cette chéchia, ce rosaire que nous sommes heureux de saluer, dans nos villes, dans nos campagnes, dans la plaine du Cheliff et jusque sur les montagnes de la Kabylie.
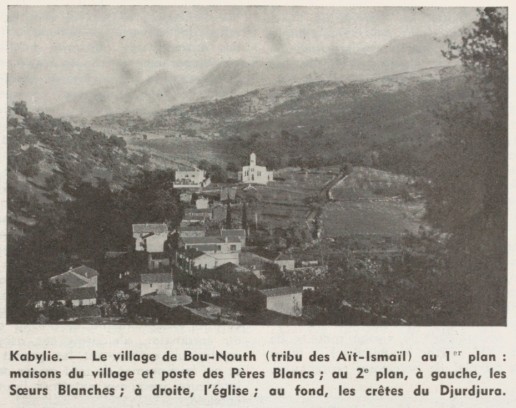
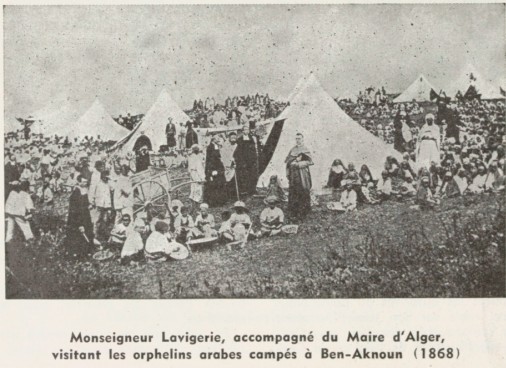
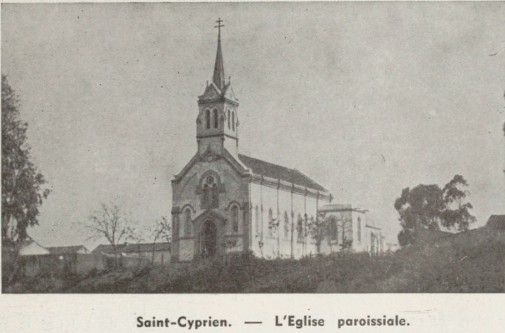
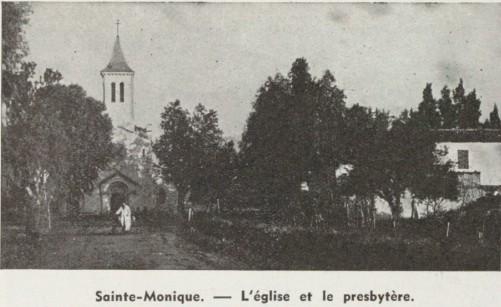
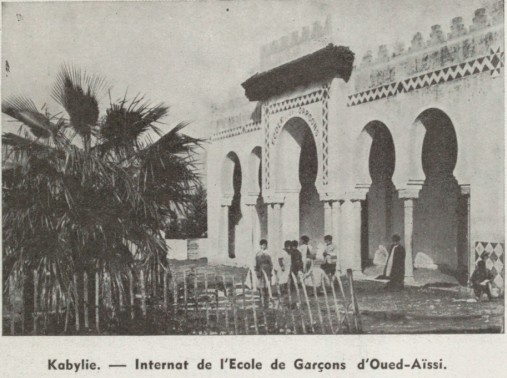

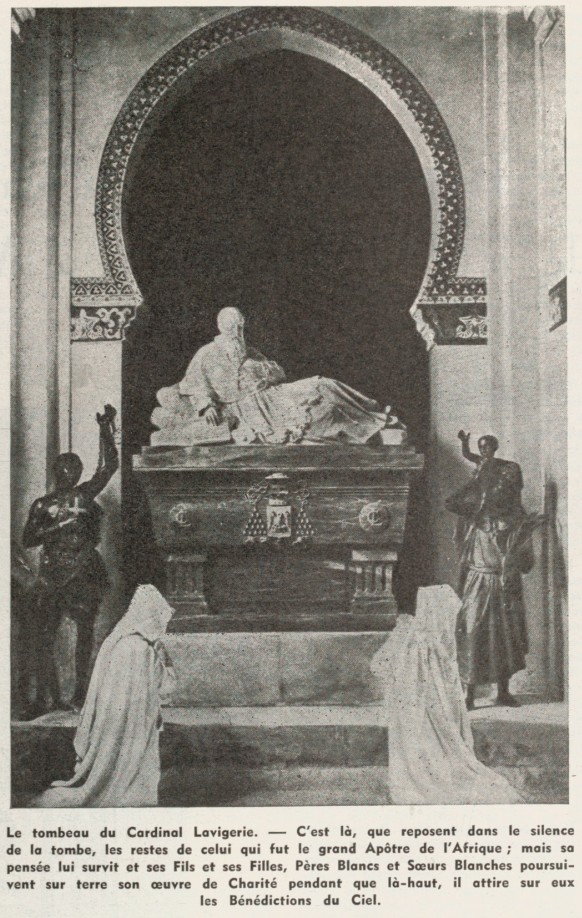
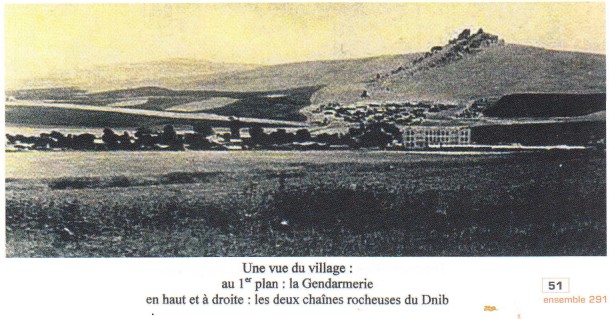
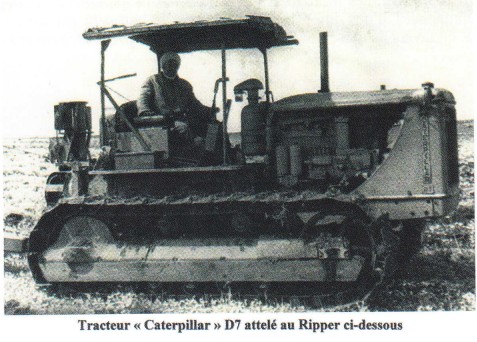
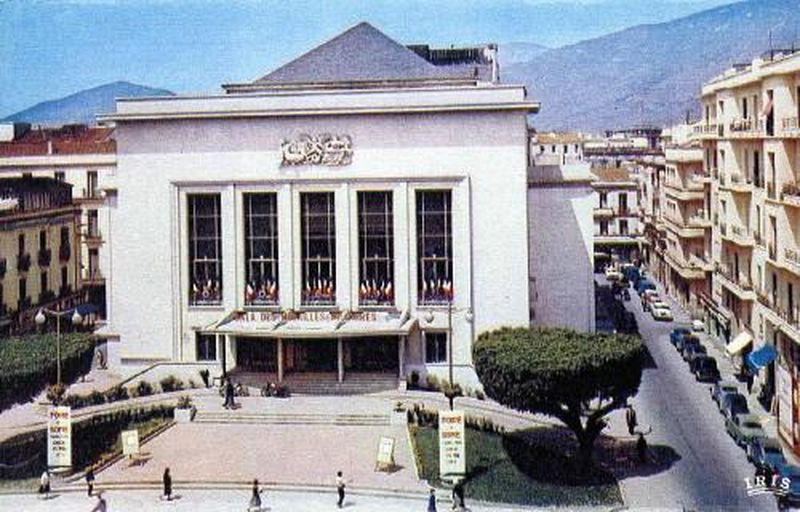

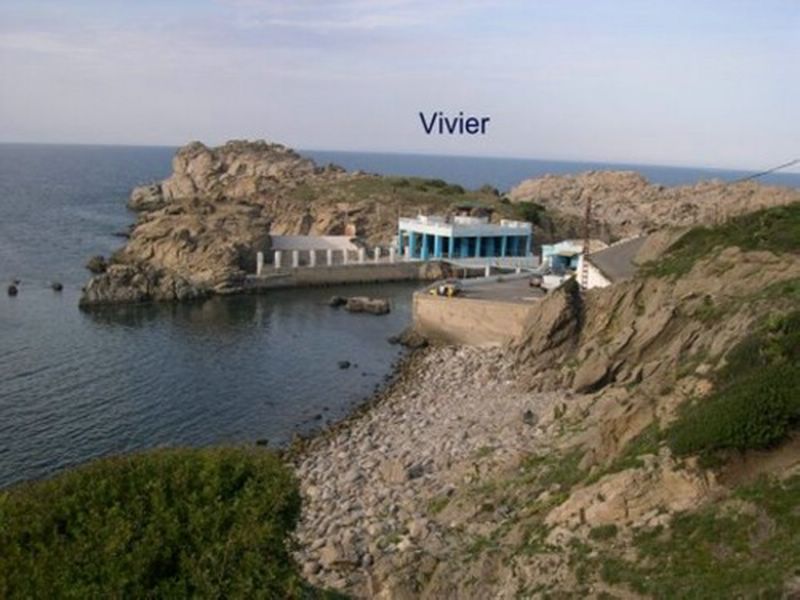
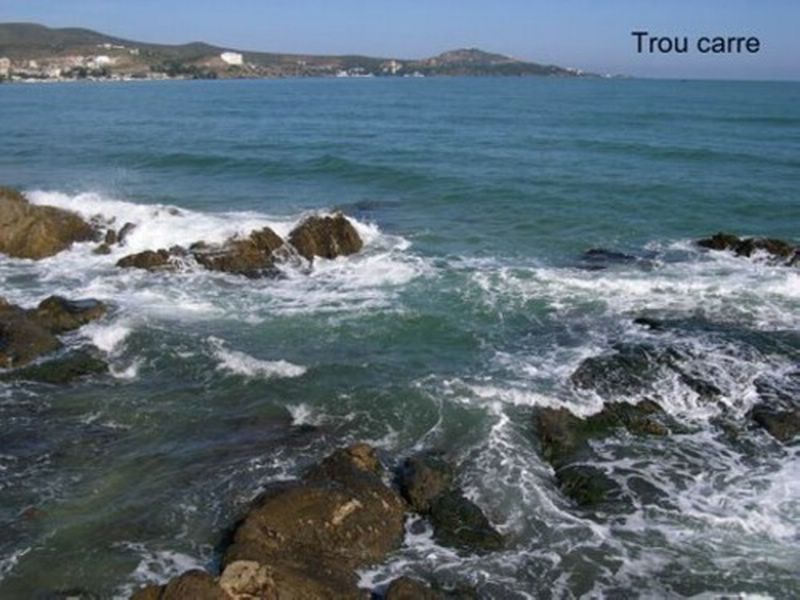


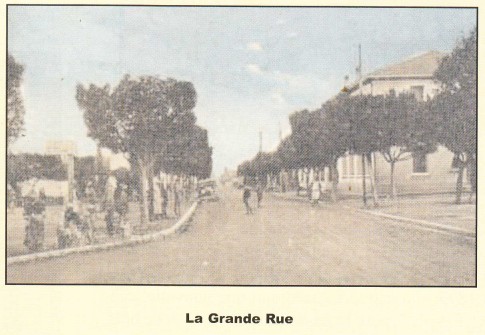 Ce village destiné à quarante-trois familles comprenait un territoire de cinq cent quatre-vingt-dix hectares formés de terres fertiles et égayés par quelques belles plantations d'orangers. Les lots de jardin étaient irrigables. Les nouveaux colons furent choisis surtout parmi les Mahonnais et ne comptèrent que quelques familles françaises installées depuis un certain temps en Algérie : Camps, Coll, Gomila, Sintes, Moll, Pons, Lapalud, Piris etc.
Ce village destiné à quarante-trois familles comprenait un territoire de cinq cent quatre-vingt-dix hectares formés de terres fertiles et égayés par quelques belles plantations d'orangers. Les lots de jardin étaient irrigables. Les nouveaux colons furent choisis surtout parmi les Mahonnais et ne comptèrent que quelques familles françaises installées depuis un certain temps en Algérie : Camps, Coll, Gomila, Sintes, Moll, Pons, Lapalud, Piris etc.
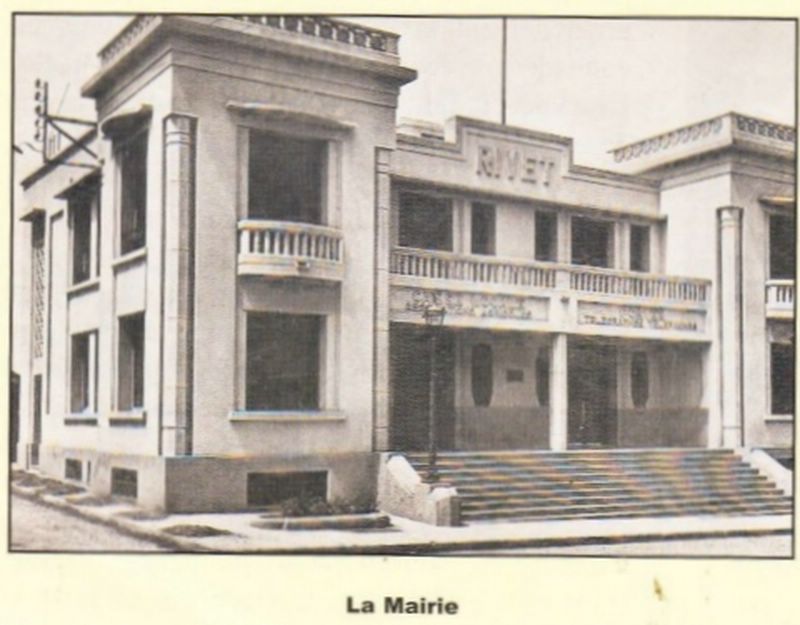 L'année suivante, presque toutes les maisons du village étaient construites, cent trois hectares étaient cultivés et, à la fin de 1859, la population s'élevait à cent quatre-vingts personnes et trois cents hectares étaient en culture.
L'année suivante, presque toutes les maisons du village étaient construites, cent trois hectares étaient cultivés et, à la fin de 1859, la population s'élevait à cent quatre-vingts personnes et trois cents hectares étaient en culture.
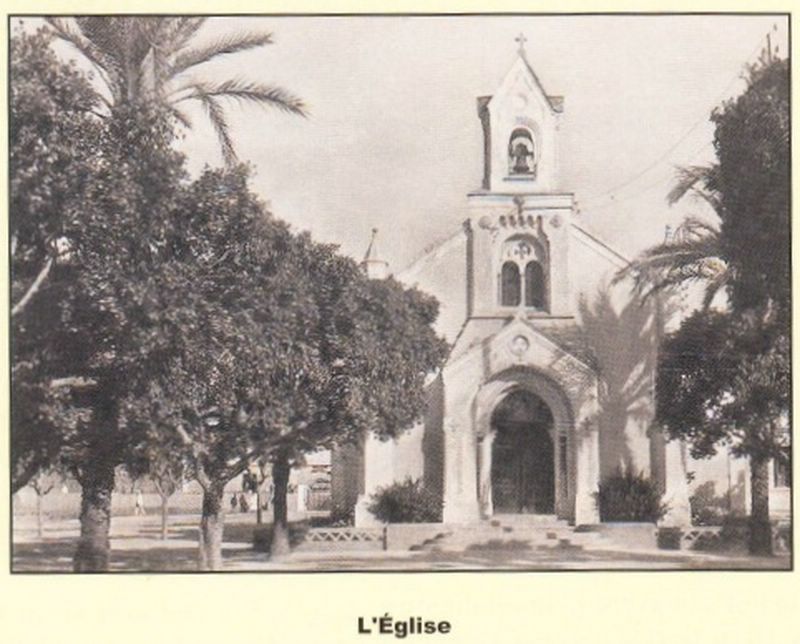 Un vignoble de 129 hectares, composé de cépages Carignan, Cinsaut, Alicante, Bouschet, donne un bon vin de coteaux.
Un vignoble de 129 hectares, composé de cépages Carignan, Cinsaut, Alicante, Bouschet, donne un bon vin de coteaux.
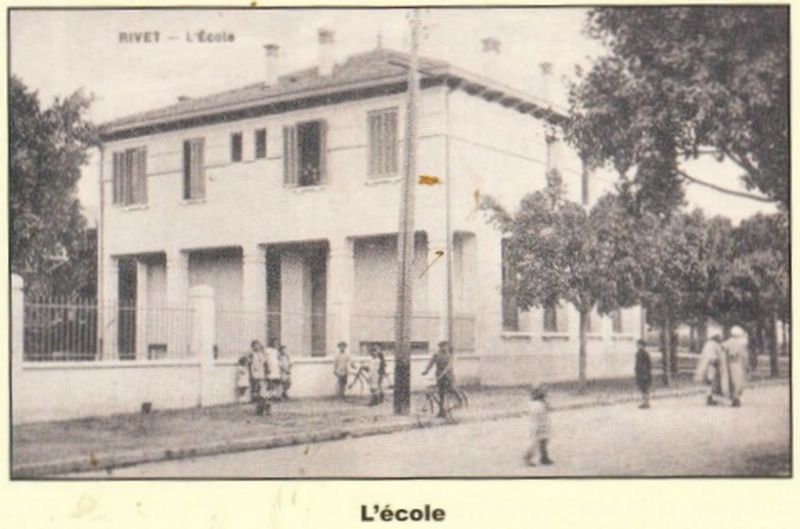 "L'Afrique du Nord Illustrée" publie par la suite l'article du Professeur Georges Aubry expliquant la cause principale de ce fléau qui fait d'inquiétants progrès.
"L'Afrique du Nord Illustrée" publie par la suite l'article du Professeur Georges Aubry expliquant la cause principale de ce fléau qui fait d'inquiétants progrès.
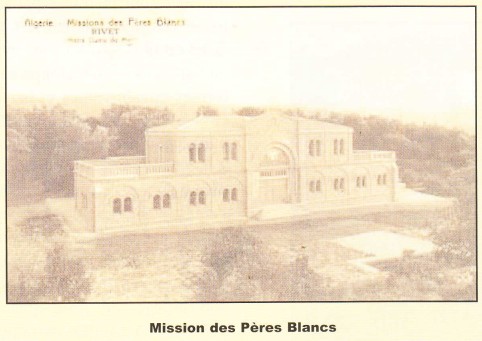 Or I'armement antituberculeux est inexistant. Pourquoi ? La première raison et la plus tristement valable est que I'effort financier à envisager est considérable. Le prétexte avancé par tous ceux qui veulent écarter ou seulement ajourner I'importante question de l'organisation de la lutte contre la tuberculose est qu' on ne peut pas la traiter en Algérie.
Or I'armement antituberculeux est inexistant. Pourquoi ? La première raison et la plus tristement valable est que I'effort financier à envisager est considérable. Le prétexte avancé par tous ceux qui veulent écarter ou seulement ajourner I'importante question de l'organisation de la lutte contre la tuberculose est qu' on ne peut pas la traiter en Algérie.
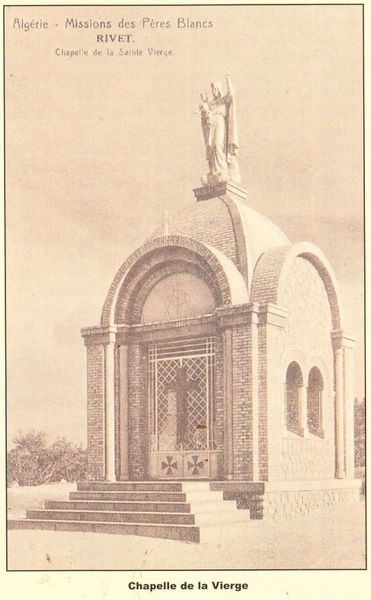 L'établissement sera un hôpital sanatorium. organisme infiniment plus large, ce que le Professeur LEBON appellerait un hôpital auxiliaire spécialisé. Dans cette formation, une moitié des lits sera réservée aux tuberculeux de guerre, ainsi qu'aux veuves de guerre et aux pupilles de la Nation. Le choix du site, effectué par une commission technique se porte sur la forêt de St-Ferdinand. Un avant-plan est dressé et en 1930 le Gouverneur Général Bordes pose la première pierre de l'établissement. Mais I'Association ne possède pas à cette époque I'argent nécessaire à la construction.
L'établissement sera un hôpital sanatorium. organisme infiniment plus large, ce que le Professeur LEBON appellerait un hôpital auxiliaire spécialisé. Dans cette formation, une moitié des lits sera réservée aux tuberculeux de guerre, ainsi qu'aux veuves de guerre et aux pupilles de la Nation. Le choix du site, effectué par une commission technique se porte sur la forêt de St-Ferdinand. Un avant-plan est dressé et en 1930 le Gouverneur Général Bordes pose la première pierre de l'établissement. Mais I'Association ne possède pas à cette époque I'argent nécessaire à la construction.
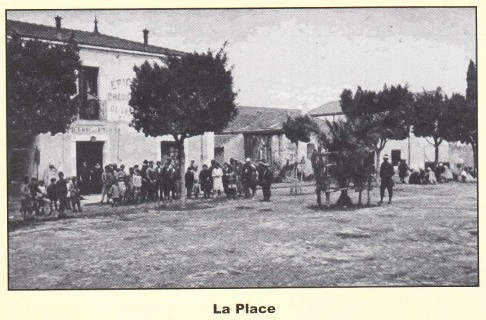 Monsieur Bienvenu, architecte diplômé est choisi par le Gouverneur Général pour réaliser les travaux, et il présente tout d'abord une maquette. Le bâtiment central se prolonge de chaque côté par deux ailes en alignement rectiligne. Il comporte 180 lits, 100 pour les hommes dans I'aile ouest, 80 pour les femmes dans I'aile est. La séparation entre les sexes étant réalisée par la partie médiane réservée aux services généraux. Dans chaque aile sont disposées les chambres des malades avec leur galerie de cure orientée au sud.
Monsieur Bienvenu, architecte diplômé est choisi par le Gouverneur Général pour réaliser les travaux, et il présente tout d'abord une maquette. Le bâtiment central se prolonge de chaque côté par deux ailes en alignement rectiligne. Il comporte 180 lits, 100 pour les hommes dans I'aile ouest, 80 pour les femmes dans I'aile est. La séparation entre les sexes étant réalisée par la partie médiane réservée aux services généraux. Dans chaque aile sont disposées les chambres des malades avec leur galerie de cure orientée au sud.
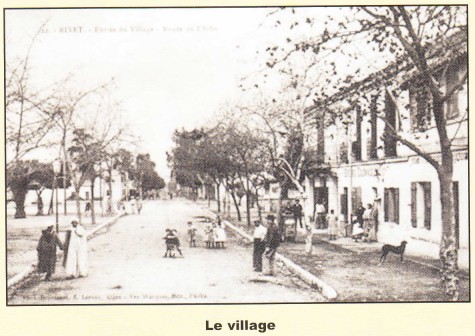 Toutes les chambres sont dotées du confort moderne, elles comportent 3 lits (80%) 2lits ou 1 lit. Les lavabos s'intercalent entre les chambres. Ces chambres ouvrent directement sur la galerie de cure par des portes pivotantes qui font de cette galerie un prolongement de la chambre.
Toutes les chambres sont dotées du confort moderne, elles comportent 3 lits (80%) 2lits ou 1 lit. Les lavabos s'intercalent entre les chambres. Ces chambres ouvrent directement sur la galerie de cure par des portes pivotantes qui font de cette galerie un prolongement de la chambre.
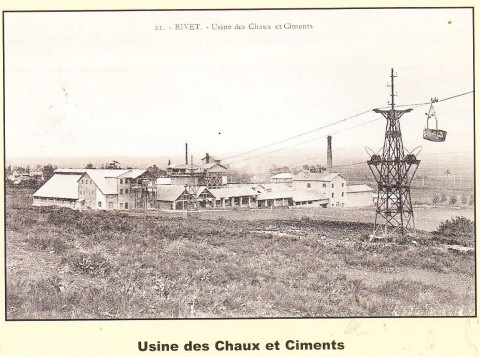 Les services généraux sont au-dessous : consultations, radiographie, pharmacie dans les sous-sols sont les cuisines, chauffage, buanderie, ateliers... Tout est prévu au mieux et la construction, réglée par un cahier des charges minutieux, durera environ 2 ans et reviendra à 7.000.000 de francs. Une somme de 500.000 francs est réservée pour la première année de fonctionnement. De nouveaux donateurs s'ajoutent aux précédents et le SYNDICAT PROFESSIONNEL des JOURNALISTES fait un don de 2.000.000 de francs.
Les services généraux sont au-dessous : consultations, radiographie, pharmacie dans les sous-sols sont les cuisines, chauffage, buanderie, ateliers... Tout est prévu au mieux et la construction, réglée par un cahier des charges minutieux, durera environ 2 ans et reviendra à 7.000.000 de francs. Une somme de 500.000 francs est réservée pour la première année de fonctionnement. De nouveaux donateurs s'ajoutent aux précédents et le SYNDICAT PROFESSIONNEL des JOURNALISTES fait un don de 2.000.000 de francs.
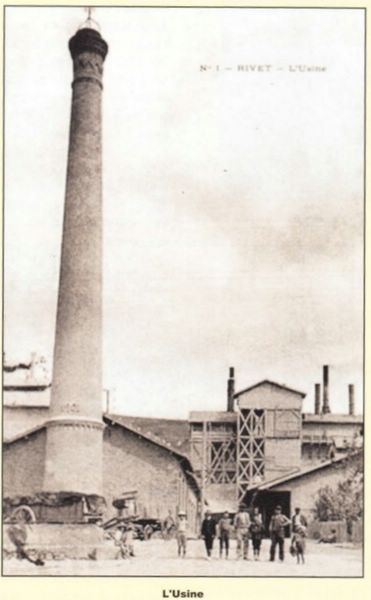 En 1940, l'édifice est inauguré par le Gouverneur Général Lebeau en présence du Maire de Rivet, M. Vanoni, d'un rePrésentant de la Préfecture et du Conseil d'Administration, mais la guerre ne permet pas de donner à la cérémonie tout l'éclat qu'auraient mérité tant d'efforts et de détermination.
En 1940, l'édifice est inauguré par le Gouverneur Général Lebeau en présence du Maire de Rivet, M. Vanoni, d'un rePrésentant de la Préfecture et du Conseil d'Administration, mais la guerre ne permet pas de donner à la cérémonie tout l'éclat qu'auraient mérité tant d'efforts et de détermination.
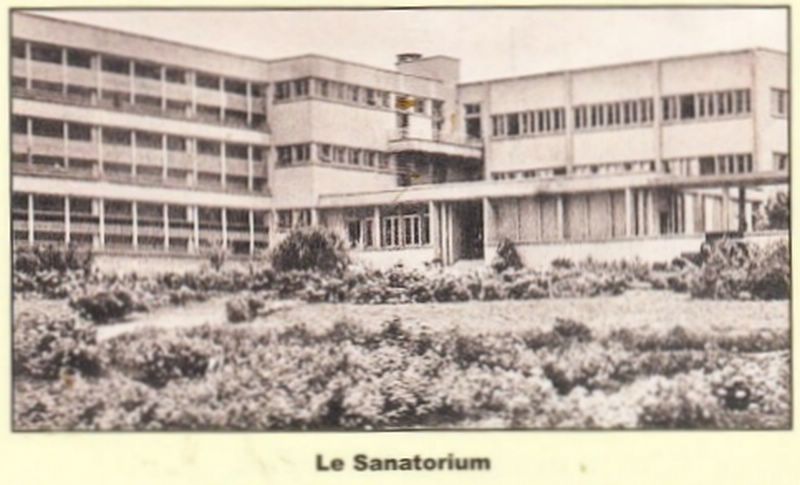
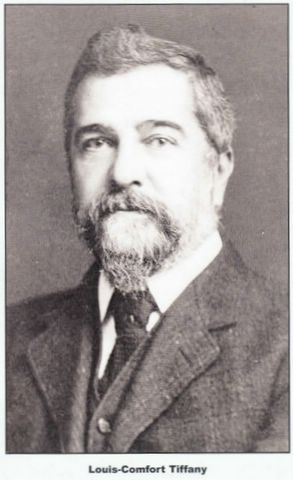 La maison Tiffany
La maison Tiffany
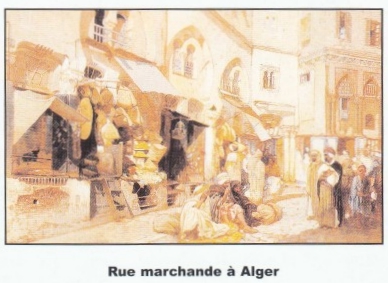 Il étudia en 1866 à la National Academy of Design. Sa première réalisation est une peinture réalisée alors qu'il est élève de George Inness en 1867. A 24 ans, il s'intéresse au travail du verre. C'est à cette période qu'il rencontre Mary Woodbridge Goddard, qu'il épousera le 15 mai 1872.
Il étudia en 1866 à la National Academy of Design. Sa première réalisation est une peinture réalisée alors qu'il est élève de George Inness en 1867. A 24 ans, il s'intéresse au travail du verre. C'est à cette période qu'il rencontre Mary Woodbridge Goddard, qu'il épousera le 15 mai 1872.
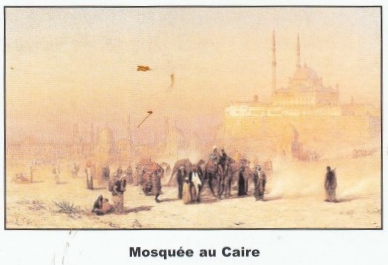 En 1893, son entreprise introduit une nouvelle technique, " Favrile ", pour la fabrication de vases et de bols. Ce nom est dérivé du latin fabrilis, voulant dire " fait à la main ". Il réalise par ailleurs des vitraux (notamment à l'église Church of the Incamation, Madison Avenue, à New York), tandis que son entreprise crée une gamme complète de décorations intérieures. Il use de tout son talent pour la conception de sa propre maison, Laurelton Hall, à Oyster Bay, Long Island, terminée en 1904.
En 1893, son entreprise introduit une nouvelle technique, " Favrile ", pour la fabrication de vases et de bols. Ce nom est dérivé du latin fabrilis, voulant dire " fait à la main ". Il réalise par ailleurs des vitraux (notamment à l'église Church of the Incamation, Madison Avenue, à New York), tandis que son entreprise crée une gamme complète de décorations intérieures. Il use de tout son talent pour la conception de sa propre maison, Laurelton Hall, à Oyster Bay, Long Island, terminée en 1904.
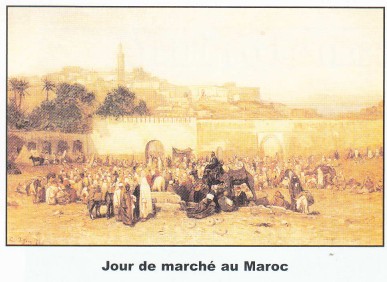 Il se retire progressivement des affaires à la fin des années 1920. Sa firme Tiffany studios fait faillite en 1932, un an avant son décès.
Il se retire progressivement des affaires à la fin des années 1920. Sa firme Tiffany studios fait faillite en 1932, un an avant son décès.
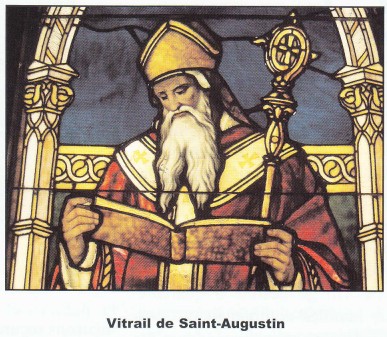 La création de vitraux a été une activité importante pour Tiffany qui a produit plusieurs milliers d'exemplaires dans son atelier. Concevant le dessin, il a été aidé pour cela par son équipe, dont les membres les plus connus furent Agnès Northrop et Frederick Wilson. Les thèmes prédominants étaient la religion et les paysages.
La création de vitraux a été une activité importante pour Tiffany qui a produit plusieurs milliers d'exemplaires dans son atelier. Concevant le dessin, il a été aidé pour cela par son équipe, dont les membres les plus connus furent Agnès Northrop et Frederick Wilson. Les thèmes prédominants étaient la religion et les paysages.
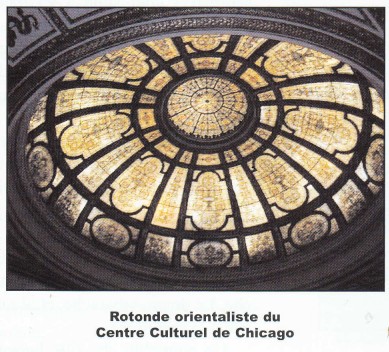 L'architecture intérieure
L'architecture intérieure
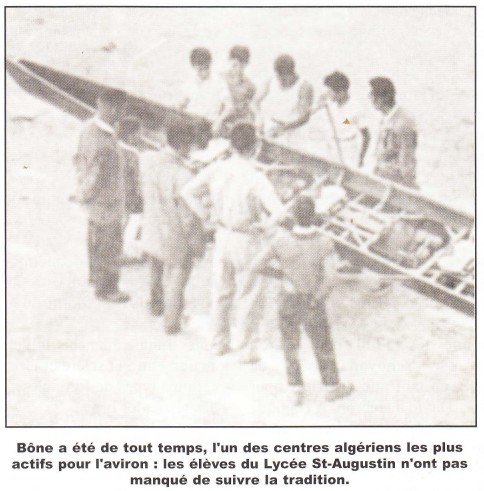 En Algérie, dès avant 1910 une section du sport nautique d'Alger réunissait des fervents de la rame. Mais le premier club algérien exclusivement voué à l'aviron, le Rowing Club d'Alger, ne fut fondé qu'en 1922. Peu après un autre Rowing était créé à Bône et les premières régates à être courues dans les eaux algéroises se disputaient le 22 juillet 1923. L'année suivante voyait de nouveaux clubs naître à Oran, Arzew, Philippeville, Bougie et Mostaganem.
En Algérie, dès avant 1910 une section du sport nautique d'Alger réunissait des fervents de la rame. Mais le premier club algérien exclusivement voué à l'aviron, le Rowing Club d'Alger, ne fut fondé qu'en 1922. Peu après un autre Rowing était créé à Bône et les premières régates à être courues dans les eaux algéroises se disputaient le 22 juillet 1923. L'année suivante voyait de nouveaux clubs naître à Oran, Arzew, Philippeville, Bougie et Mostaganem.
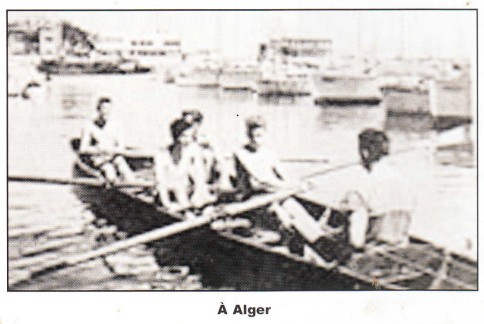 Ils s'appelaient " Tapie et Fourcade " et leurs noms dans les esprits ne peuvent être dissociés car ils ne faisaient qu'un, une "équipe" dont les exploits restent gravés dans les mémoires et demeurent un exemple que chacun s'efforce de suivre et d'imiter. Georges Tapie, en canoë simple, réussissait en outre I'exploit d'être champion de France en 1928, 1929,1930 et 1933, tandis que son club, le Rowing Club de Bône, enlevait le titre national en " quatre " et en " huit " en 1928 et 1930, et le " quatre " en 1929 et 1933, en yole de mer. Le même Rowing Club de Bône fut encore un brillant champion de France en 1938 en "quatre barré" et en "huit", performance unique pour un club en championnat de France " outriggers ".
Ils s'appelaient " Tapie et Fourcade " et leurs noms dans les esprits ne peuvent être dissociés car ils ne faisaient qu'un, une "équipe" dont les exploits restent gravés dans les mémoires et demeurent un exemple que chacun s'efforce de suivre et d'imiter. Georges Tapie, en canoë simple, réussissait en outre I'exploit d'être champion de France en 1928, 1929,1930 et 1933, tandis que son club, le Rowing Club de Bône, enlevait le titre national en " quatre " et en " huit " en 1928 et 1930, et le " quatre " en 1929 et 1933, en yole de mer. Le même Rowing Club de Bône fut encore un brillant champion de France en 1938 en "quatre barré" et en "huit", performance unique pour un club en championnat de France " outriggers ".
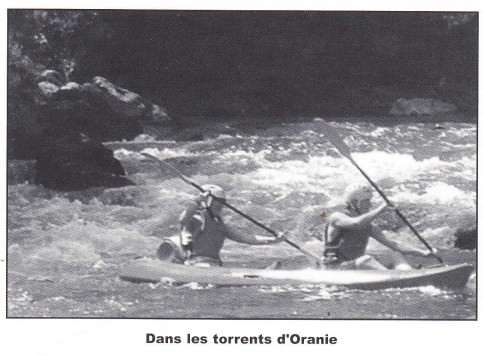 Depuis 1956 l'aviron n'a cessé de progresser aussi bien du point de vue des effectifs que de la qualité sportive. Le 26 novembre 1957 a eu lieu le premier Championnat Nationale avec vingt six équipages du Rowing Club d'Alger, du Sport Nautique d'Alger, de I'Aviron Oranais et du Rowing Club Bônois qui se sont affrontées.
Depuis 1956 l'aviron n'a cessé de progresser aussi bien du point de vue des effectifs que de la qualité sportive. Le 26 novembre 1957 a eu lieu le premier Championnat Nationale avec vingt six équipages du Rowing Club d'Alger, du Sport Nautique d'Alger, de I'Aviron Oranais et du Rowing Club Bônois qui se sont affrontées.

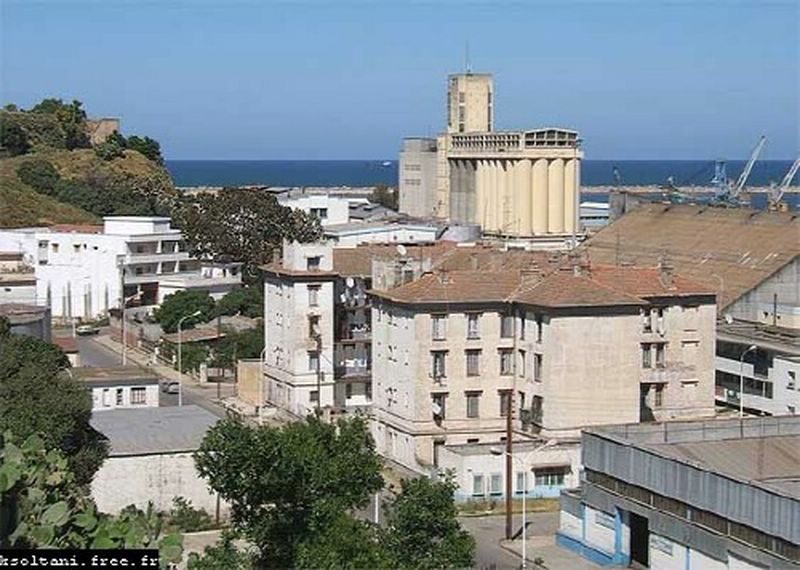

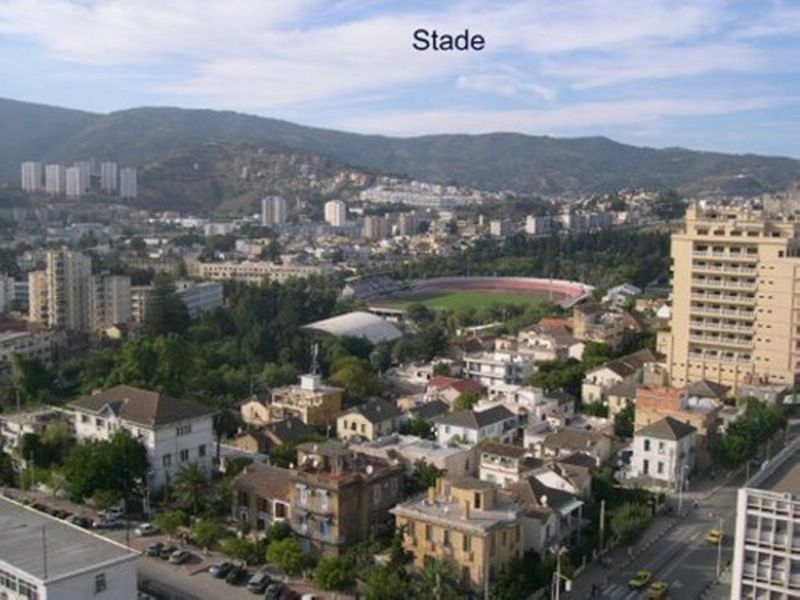
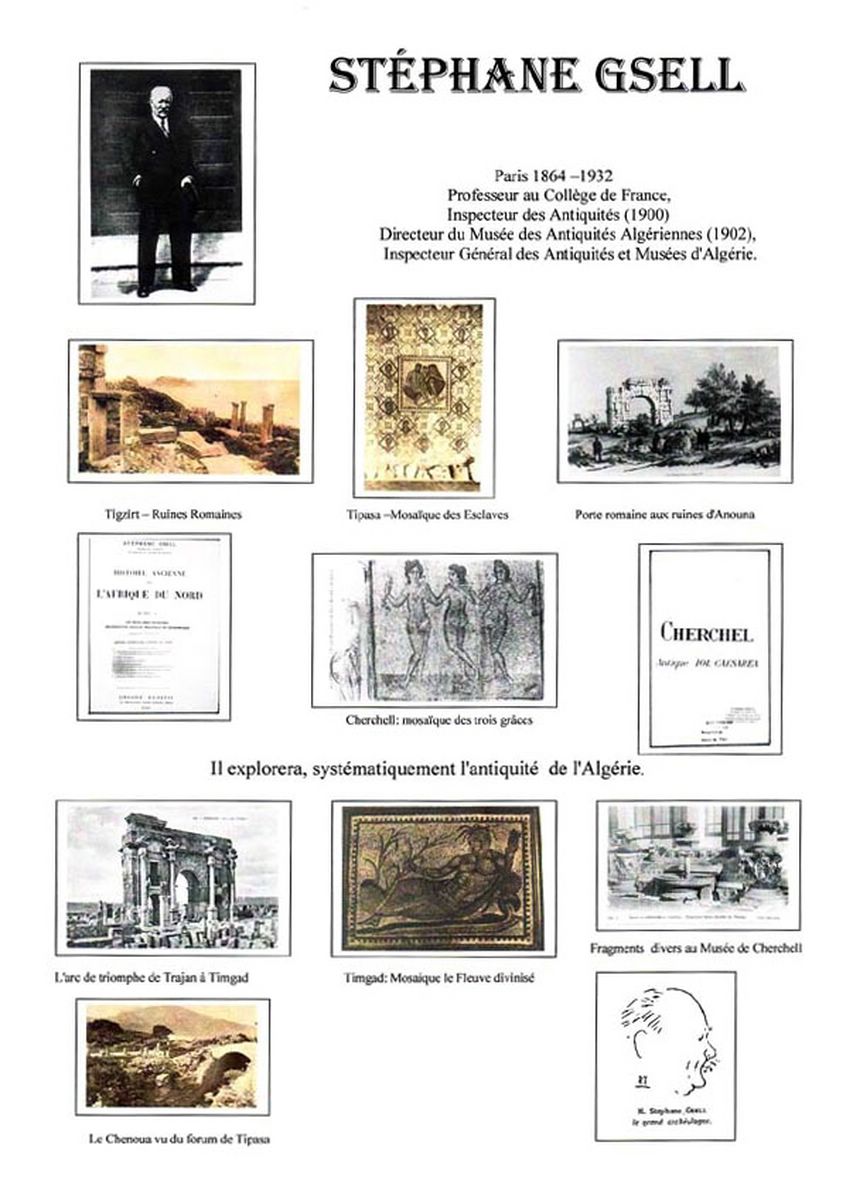



 .
.


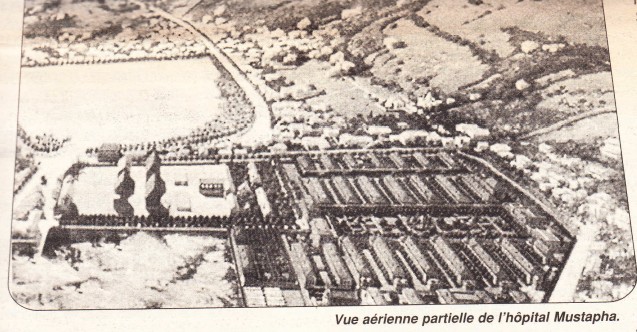
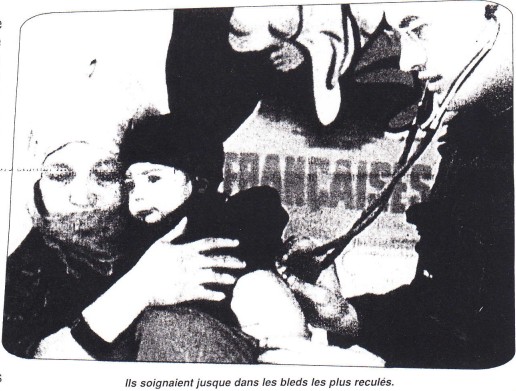
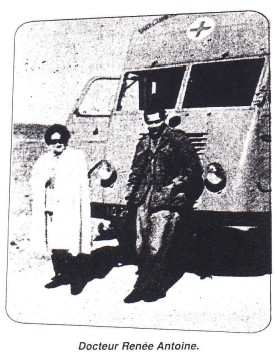 Une femme médecin se distingua particulièrement dans cette œuvre qu'elle considérait comme un apostolat, le Docteur Renée Antoine y consacra plus de vingt ans de sa vie. Elle était extrêmement populaire dans les territoires du Sud auprès des Touaregs. Avec Emilie de Vialar, elle devrait être considérée comme une apôtre de la civilisation française en Afrique. Le trachome devait disparaÎtre à peu près complètement et les aveugles du même coup, avec plus de cinquante ans d'avance sur les autres pays arabes du Moyen Orient, l'éradication du trachome en Algérie fut une des plus belles victoires de la médecine coloniale.
Une femme médecin se distingua particulièrement dans cette œuvre qu'elle considérait comme un apostolat, le Docteur Renée Antoine y consacra plus de vingt ans de sa vie. Elle était extrêmement populaire dans les territoires du Sud auprès des Touaregs. Avec Emilie de Vialar, elle devrait être considérée comme une apôtre de la civilisation française en Afrique. Le trachome devait disparaÎtre à peu près complètement et les aveugles du même coup, avec plus de cinquante ans d'avance sur les autres pays arabes du Moyen Orient, l'éradication du trachome en Algérie fut une des plus belles victoires de la médecine coloniale.