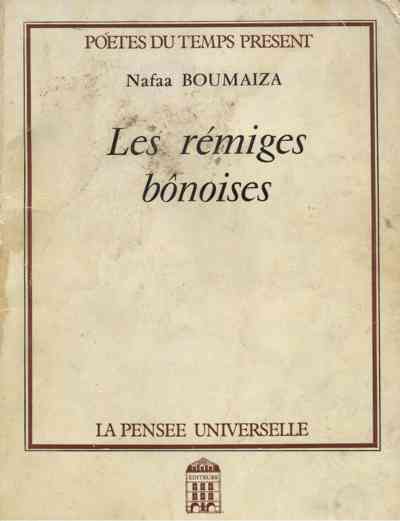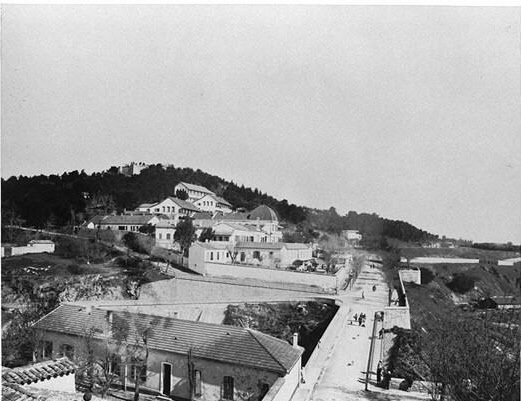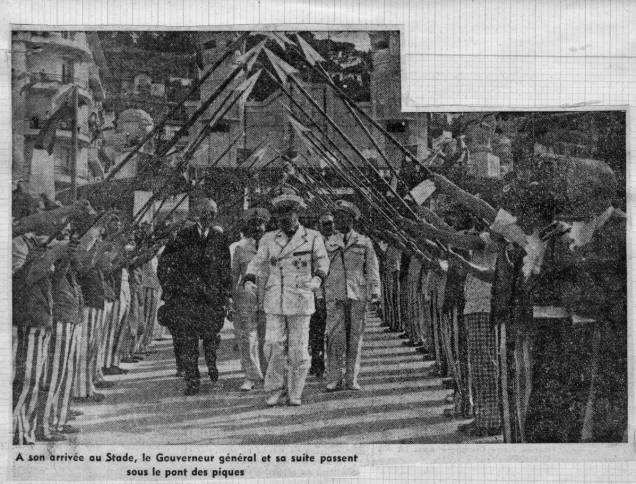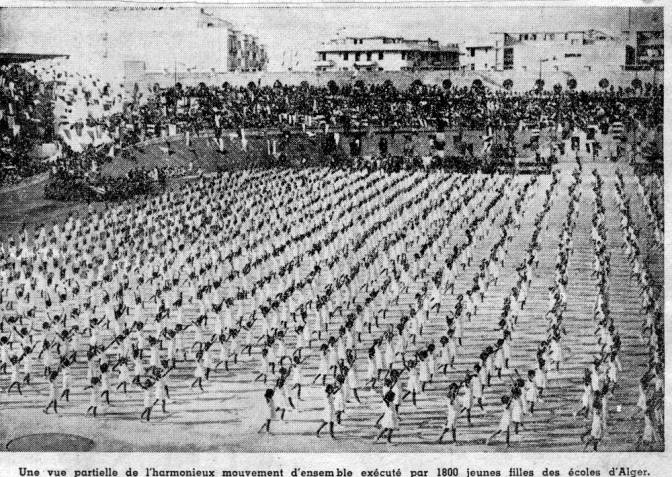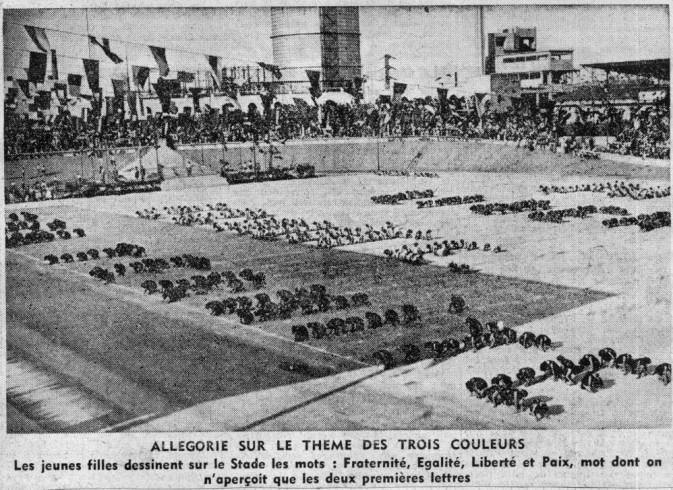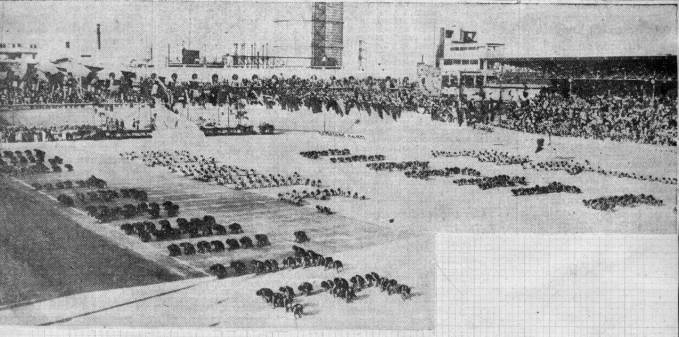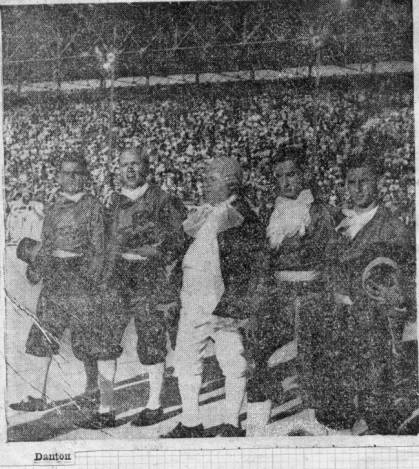|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site. |
|
|
|
EDITO
Les Braises du Ravin Rouge
Revenant des obsèques d’un Ami, d’un frère, j’ai appris par quelques messages que je serais un menteur ; que je n’ai pas de preuves, que je suis un mauvais contradicteur ;ou moralisateur ; que j’ai décerné les bons et mauvais points aux clans ; que j’ai trop d’amitié pour M. Barisain ; et patati et patata…
J’ai même reçu le scénario catastrophe d’un chef d’entreprise qui n’a encore rien compris et qui mélange souscription pour lancer le scénario d’un film avec un montant total de souscription fixé à l’avance (35000 €) et un produit fini, c’est à dire un film (environ 5 millions d’euros). Il confond client et souscripteur. Le fait-il sciemment ? Si c’est le cas c’est grave, si ce n’est pas le cas, c’est complètement idiot de mettre encore de l’huile sur le feu.
Comme je n’ai plus envie de répondre individuellement car ces messages ne m’apportent aucun élément de vérité, ce n’est que du réchauffé, que de l’élucubration, que de la désinformation grossièrement diligentée, je peux répondre publiquement à tout cela sur deux points :
A) Sur le point personnel :
Pourquoi parler du Moi ?
- Parce que je ne rentre pas dans le moule où l’on voudrait m’enfermer ;
- Parce que je ne suis pas enfermé dans une religion, un parti politique ou une association ;
- Parce que cet écrit ne s’inscrit pas dans un règlement de compte personnel mais comme une fin de non recevoir à l’incompréhension volontaire.
- Parce que seules la vérité et la défense de la mémoire m’intéressent.
- Parce que les non dits et les écrivailleurs de cette mauvaise «presse P.N.» dite «cachée, peu connue, pas responsable, etc..», continue de m’interpeller sur le ton et avec les mêmes discours mensongers, haineux, de caniveau, parfois même crasseux ou mielleux ;
Certains diront «on n’y peut rien», sauf à passer son temps à démentir et à remettre les points sur les I. Cela devient lassant.
Si je ne veux pas entrer dans «LE système» je deviens la bête noire; si je réponds avec des explications, je deviens un salaud en étant obligé d’étaler des preuves que l’on me demande de garder secrètes car elles serviront pour la justice.
Donc dois-je me battre à la manière de Don Quichotte contre les moulins à vent de la mauvaise foi ; contre les menaces à peine voilées parce que j’exprime ma libre façon de penser et d’agir ; contre la politique de démolition que pratique certains de nos compatriotes ; contre l’idiotie et la décervellation ?
Je suis conscient des enjeux de ce film et de l’actuelle période trouble où tout mouvement contraire à un certain courant de pensée est considéré comme ennemi à la communauté Pieds-noirs. Et où un groupe de « patibulaires nerveux» cherche des boucs émissaires à LEURS propres échecs.
Ils feraient mieux de s’occuper par exemple d’un livre «Le Boucher de Guelma» écrit par un Pieds-Noirs où il y aurait beaucoup à dire. On n’est jamais mieux trahis que par les siens.
B) Sur ma conscience publique :
Les vaillants «réactionnaires ou activistes» sont là, dirigeant la désinformation et la calomnie, à demi visible et se croyant influents. Je le dis surtout pour les gens dont la mémoire, pourrie par la propagande malsaine, pourrait faillir et nourrir la «guerre» entre les Pieds-Noirs par leur courte vue.
S’agissant enfin de ma liberté, elle peut interpeller les gens manquant de toute jugeote ou pour certains s’écrasant derrière les avantages, les prébendes et les envies. Depuis un bon moment, je vis loin des associations uniquement parce que j’ai tenté de faire mon devoir dans la communauté et que ce devoir a déplu ou contrarié certains dans leurs «histoires ou chikayas» ou dans leur «confort associatif». S’ils le pensent utile pour leur conscience, c’est en toute objectivité aux gens de juger de ce que j’ai fait publiquement et individuellement et de juger ce qu’ont fait les autres. Les plateaux de la balance sont fait pour cela.
Je suis conscient de tout cela et je réponds encore une fois tout simplement aux fausses accusations car je me sens moralement rassuré auprès des miens; auprès de mes Amis ; auprès de la quasi-totalité des lecteurs de la Seybouse; auprès de la très grande majorité des souscripteurs de ce film dont le flou continu à nous envelopper dans un nuage de communiqués indignes, faussement moralisateurs sous couvert de la religion, contradictoires et mensongers à la limite du diffamatoire à l’encontre de M. Barisain. Le dernier communiqué intitulé :
COMME NOUS PARDONNONS A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES», est un modèle du genre qui passe des pleurs, à la prière, aux leçons de morale et fini par des menaces. C’est pathétique à en faire pleurer un certain Judas qui n’aurait pu faire mieux en son temps. L’auteur dépasse les bornes, j’en découvre des facettes qui me font regretter le profond respect qui m’en reliait. C’est ainsi que l’on fait des guerres inutiles. La vie est faite de leçons continues et il faut savoir en tirer le bénéfice.
1) Des souscripteurs ont fait confiance à la souscription de ce film lors de mon engagement personnel sur la Seybouse 104 où je faisais :
- Le pari du cri de Vérité face à la rouspétance inutile
- Le pari de la réussite face à celui de l'échec.
- Le pari de la mémoire face à celui de l'oubli.
- Le pari de l'Action face à celui de l'inaction et de l'attentisme.
- Le pari de l'enseignement de la connaissance face à celui de la désinformation.
Comme M. Pierre Barisain, ces paris je les ai perdus
car les dés étaient pipés depuis le début.
2) Pour répondre aux questions de ces souscripteurs, j’ai fait mon travail d’information lorsque j’ai appris les difficultés internes pour la réalisation de ce film et après avoir demandé aux deux parties de me fournir toute la documentation afférente à leurs arguments. Seul le «clan» de M. Barisain l’a fait en toute objectivité. L’autre «clan», RIEN.
3) J’ai pris position pour un remboursement de la souscription et j’en ai fait officiellement la demande avec mon argumentation (Voir ma lettre ci-jointe).
4) J’ai refusé de publier des communiqués incitant à la haine contre un homme avec des propos mensongers qui pourraient me faire condamner si une plainte était déposée sûrement à juste raison. Ces communiqués donnaient une triste image de notre communauté.
5) J’ai fait confiance à M. Barisain et jusqu’à preuve formelle du contraire, je continuerai dans cette même voie car il n’y a aucune malversation de sa part. Il s’est fait simplement rouler pour avoir fait confiance et plus on avance, plus on est enclin à pencher pour une machination pernicieuse d’origine P.N. Je ne suis pas en droit de désigner tel ou tel coupable comme le font certaines personnes dans leurs communiqués car même dans le clan «anti-Barisain», il y aurait des emberlificotés. Seule la justice pourrait établir les vraies responsabilités. Je dis merci à M. Barisain d’avoir sauvegarder 60% de la collecte dont le remboursement a déjà commencé grâce à son esprit lucide qui a gardé le droit chemin.Moi-même j'ai reçu le remboursement (Ci-joint, preuve que les remboursements ont commencés et que ceux-ci sont contestés par 3 mousquetaires, on ne sait pas où sont le cardinal et le couple royal.)
6) J’ai été chef d’entreprise pendant 35 ans, (j’en connais un bout sur la question contrairement aux donneurs de leçons) et en tant que souscripteur, j’ai approuvé ce remboursement de 60% car après avoir déduit de nôtre souscription :
- les 33% versés à Mme Ruellé qui avait repris la suite de ACAP-ONE comme productrice, il s’est avéré qu’elle ne le pouvait pas.
- Les 7% représentant les frais de gestion (timbres, lettre recommandées, etc..) plus des frais judiciaires pour tenter de se faire rembourser auprès de Mme Ruellé qui a rendu sa mission caduc. C’est elle qui le dit.
Que chacun après avoir récupéré le restant de sa participation le reverse s’il le veut à une autre entité à lses risques. J’ai déjà dit et je le redis haut et fort que je ne reverserai plus jamais aucune souscription ou le moindre sou car j’ai perdu toute confiance en tout projet. C’est malheureux mais c’est la faute à ceux qui ont entamé sérieusement notre confiance et notre espoir et qui continuent à entretenir une guerre larvée au sein de la communauté alors qu’ils auraient pu s’asseoir à une table de discussion.
7) Depuis des années, j’ai suffisamment apporté de gages dans la défense de notre communauté que je peux laisser les pisses vinaigre dans leur jus qui ne les aide pas à grandir. Leur répondre encore individuellement serait leur accorder l’importance qu’ils n’ont pas. J’ai tenté tout ce que je pouvais pour apaiser certains esprits mais j’ai du baisser les bras car après l’incompréhension et la bêtise j’ai vu la haine.
Je vis dans le bonheur de ma liberté et mes modestes écrits illustrent bien à quel point je suis fondamentalement opposé à la pensée unique et séparé de toute association même s’il y en a de très bien. Certes je ne serai jamais un écrivain (je n’en ai même pas la prétention de le devenir) car je n’ai pas eu la chance de faire des études, mais ce que j’écris, je le fais avec le cœur et comme je le pense.
Des hommes seuls sont arrivés avec des petits moyens à produire des films, ce sont Jean Pierre Lledo, Charly Cassan ou les frères Pérez. Pourquoi ne fait-on pas appel à leur savoir ? Sont-ils des pestiférés parce qu’ils n’ont pas fait appel au courant de pensée imposé par certains ? Pourquoi chercher à jouer dans la cour des grands alors que ceux-ci ont toujours refusé de regarder objectivement la mémoire des exilés que nous sommes ?
A l’heure où l’on parle encore d’union, de film, de mémoire ou de commémoration de notre exil, des discours, communiqués ou scénario catastrophe expriment l’exclusion et la calomnie. La haine revient à chaque fois pour mettre une couche de doute sur les réfractaires à la pensée unique. Lorsque des campagnes et appels à la vindicte populaire sont lancés contre ces réfractaires qui s’opposent à la ligne tracée par ceux qui se prétendent les représentants officiels de la communauté et de son pouvoir, il y a de quoi être inquiet sur le devenir de cette communauté. Avec une haine entre ce que je crois être des compatriotes, jamais la communauté Pieds-Noirs ne connaîtra la paix et la sérénité pour faire aboutir un grand projet. Les valeurs de nos pionniers, celles que nos anciens nous ont inculquées sont en train de foutre le camp.
Pour ce film sur lequel je fondais des grands espoirs, à l’heure actuelle certains protagonistes m’ont même dégoûté au point où s’il sortait miraculeusement d’une caméra, je ne pense même plus que j’irai le voir. Les braises allumées et entretenues dans ce ravin resteront chaudes et rouges encore longtemps.
Le vrai grand film de l’épopée complète de nos anciens de 1830 à 1962 reste à écrire à la manière d’une saga. Peut-être que nos petits enfants pourront un jour en voir les images.
Mektoub
Diobône
P.S. : Bien entendu, je m’attends à recevoir encore des messages haineux mais maintenant je dis comme les copains : «les chiens aboient et la caravane passe.» Je dis aussi à P. Barisan : «Bien faire et laisser dire, ton travail honnête sera un jour reconnu. En attendant sors-toi de ce merdier dans lequel tu es tombé.»
Jean Pierre Bartolini
|
|
LA CULTURE DU TABAC DANS LA REGION DE BÔNE
La plaine de Bône donnait d’excellents tabacs, variés comme couleur, souvent jaune clair ou orange, aromatiques, désignés sous les noms de Zina, Choucha, Arfi Safi, H’Sfeur, Namra, Cabot et dont quelques-uns uns pouvaient être employés avantageusement en mélange avec certains tabacs étrangers.


Plan de cabot Jeunes plants de cabot
Cette culture revêt un caractère essentiellement familial et elle intéresse au premier chef la population musulmane qui, soit directement, soit en métayage, exploite presque en totalité les superficies cultivées en tabac.
Cette production était bien souvent pour eux l’unique ressource, ressource bien aléatoire lorsqu’elle était laissée aux seuls moyens dont pouvaient disposer les pauvres familles de fellah.
Le tabac était pourtant avec la vigne la culture qui convenait le mieux à la région Bônoise.
Ne pas s’intéresser au développement d’une telle culture, c’eût été vouloir maintenir dans la pauvreté une population laborieuse.
Les innombrables petits planteurs de tabac de la plaine n’avaient aucun moyen d’abriter leur récolte au moment de la mauvaise saison pour attendre les acheteurs.
Ils étaient obligés de vendre le plus rapidement possible. Et les spéculateurs n’attendaient que ce moment là pour venir offrir d’acheter la récolte menacée de pourrir sous la pluie et l’humidité.
Alors les infortunés planteurs étaient obligés de vendre, le plus souvent à vil prix, une récolte qui représentait le labeur de toute une année et dans laquelle ils avaient placé tout leur argent.
Cette situation se renouvelait chaque année.
C’est ainsi que les planteurs de tabac (Français et Français Musulmans) furent conduits à s’unir pour créer le 17 février 1921 « la Société coopérative des planteurs de tabac de la région de Bône » ou TABACOOP par la fusion des docks coopératifs et la société des planteurs. Elle fut la base, la pierre angulaire de tout l’édifice de la mutualité agricole dans l’est Algérien.
Ils eurent la possibilité de se procurer des avances en espèces, en cours de campagne, ce qui les empêchait d’être pressés par le besoin et de risquer d’être victimes des prêteurs qui en profitaient pour accaparer leur récolte à des prix plus rémunérateurs
Avec ces objectifs économiques, allaient de pair des réalisations sociales : fixation à la terre du planteur par une culture familiale, élévation de son standard de vie.
La TABACOOP qui a été la première des coopératives et qui a été la plus puissante et a essaimé toutes les coopératives filiales, groupées au pied de l’antique Hippone.
On peut dire que la période 1920-1929 demeura dans les annales de l’Est Algérien, comme celle de la prospérité par l’agriculture.

Vue d’ensemble des Coopératives installées dans le quartier d’Hippone

La sortie du personnel des Docks d’Hippone

Le personnel des Docks d’Hippône de la Tabacoop

Elle fut provoquée par l’initiative privée qui s’exerça par la création et le développement des syndicats, coopératives et caisses de Crédit Agricole qui assurèrent aux moyens et petits propriétaires français et Français-Musulmans la stabilité des prix par la certitude de l’écoulement de la production et pour tous, la consolidation de la propriété.

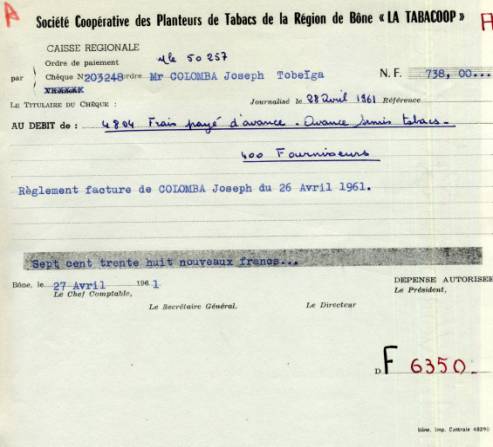
C’est la terre qui a déterminé l’expansion de la cité Bônoise
de 1920 à 1949, 70 000 habitants en 1926, 83 000 en 1936
et près de 120 000 en 1954

Vue intérieure de l’un des docks de la Tabacoop, à Hippone

Maison de l’Agriculture

Tabacoop : Intérieur des docks d’Hippone
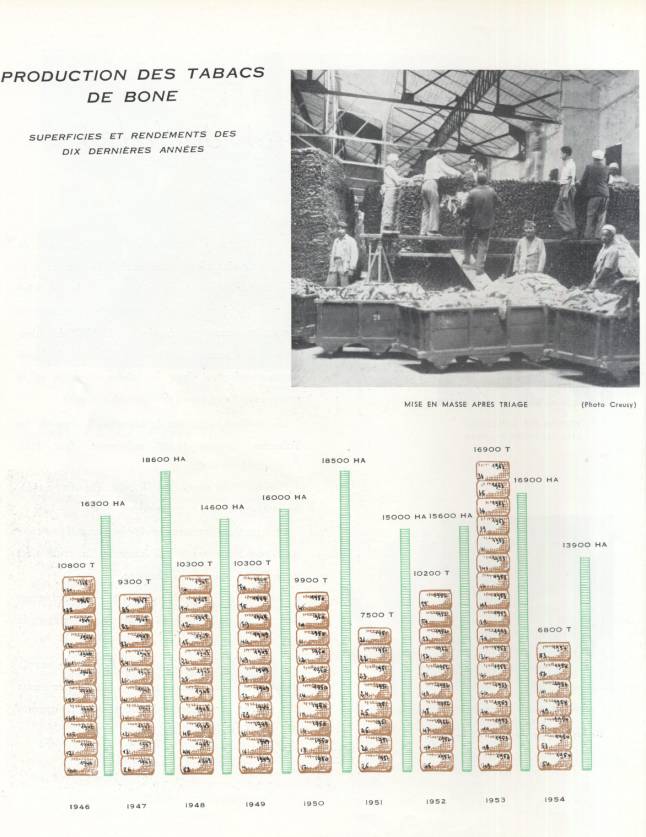
Fin 2ème partie: ciantar.charles@wanadoo.fr
|
|
| Pour nos chers Amis Disparus
Nos Sincères condoléances à leur Familles et Amis
|
Par Mme Andrée Pernice
Décès de M. Marcel Pernice
 Marcel est né le 02/09/1949 à Herbillon dans la maison de ses grands-parents Martin. Marcel est né le 02/09/1949 à Herbillon dans la maison de ses grands-parents Martin.
Il y a ensuite passé toutes ses vacances scolaires, ses parents travaillant à Djidjelli, (sa mère au bureau de poste et son père, après avoir été marin comme tous les Pernice, est entré à la gendarmerie). Après avoir profité des joies du soleil, de la mer et de l'insouciance de l'enfance il a rejoint la métropole en octobre 1962.
Rapatriés à Arras, la famille se regroupe à Dijon où il rencontre Andrée puis tous les deux s'installent à Orléans en 1973.
Ses années passées en tant que moniteur d'auto école puis d'agent à la poste ont été ensoleillées par la naissance de ses 2 enfants Loïc et Sandrine.
Il aimait aménager sa maison de Grayan en Gironde, son coin de paradis, où il aimait se ressourcer, il souhaitait que ses cendres y soient déposées au pied de son rosier préféré.
Il avait pratiqué l'escrime lors de ses années passées à Dijon mais il avait pris goût à l'inactivité sportive. Puis le sport a fini par le rattraper et il s'est pleinement investi dans le club de tir sportif de St Denis en Val d'abord simple licencié puis membre du comité directeur puis secrétaire et arbitre.
Il aimait jouer de la guitare. Ecouter Brassens, Brel, Polnareff mais aussi Fausto Papetti ou de la musique irlandaise. Il avait la passion des livres et avait toujours des mots croisés dans ses poches.
Mais depuis quelques années son loisir préféré consistait à s'occuper de ses 3 petits enfants: Océane, Cassie, Arthur, jouer avec eux, leur apprendre la vie des lutins de la forêt en construisant des cabanes ou bien en inventant des contes du soir.
L'an dernier il a eu le grand bonheur de retourner sur sa terre d'enfance retrouver cette chaleur qui l'a vu grandir et qu'il a su redistribuer autour de lui. Ce retour a été intense en émotions. S'asseoir sur les bancs de l'école avec un copain de classe ou revoir la maison natale ont été les points forts. Il était tout simplement heureux.
Son seul regret : trop court; son grand souhait: y retourner plusieurs jours.
Depuis le voyage il en parlait quasiment tous les jours et début juin il avait émis le vœu de coucher sur papier ses souvenirs. Il savait tellement bien parler de son pays et surtout d'Herbillon.
Marcel avait encore beaucoup de projets, personne n'est maître de son destin, ainsi va la vie.
Andrée Pernice
Mon Adresse pour me joindre : Andrée Pernice
================
Bonjour à tous,
Herbillon 1949 – Orléans 2011
C'est avec beaucoup de peine que je vous annonce que Marcel Pernice nous a quitté le 16 juillet 2011.
La cérémonie religieuse et la crémation ont eu lieu à Orléans.
Marcel avait intégré le groupe des voyages en Algérie en 2010. Il avait revu Herbillon sa ville natale et Djidjelli où il a passé sa prime jeunesse. Longtemps il avait rêvé de ce voyage qui fut un des grands moments de sa vie, riche en émotion en découverte et en retrouvailles. Marcel est le 2ème du groupe à rejoindre le Jardin des Etoiles.
Il était prêt à retourner pour un séjour encore plus long car il sentait qu'il en avait besoin.
Pour nous aussi, cela a été un grand moment d'émotion que d'avoir été présents à ses cotés et de le voir si heureux.
Les lecteurs de la Seybouse se joignent à nous pour présenter nos sincères et fraternelles condoléances afin d'accompagner la famille dans cette terrible douleur.
Au revoir Marcel
J.P.B.
©§©§©§©§©§©§©
Par M. Xavier Sarail
Décès de Mme Josette Sarail
Jean Pierre
Triste nouvelle, après 2 ans d'espoir Josette nous a quitté le 22 juillet 2011
Très dur ....................mais sans souffrances.
Xavier
Mon Adresse pour me joindre : Xavier Sarail
Née à Bône, Josette Sarail était une lectrice assidue de la Seybouse. Je l'ai connue au cours d'une exposition de peinture où j'avais pu admirer ses magnifiques oeuvres sur le Sahara. L'hommage que lui rend un ami Saharien est à la hauteur de la modestie qu'elle affichait.
Au revoir Josette. J.P. B.
©§©§©§©§©§©§©
Par M. Nicolas Duchenne
Décès de M. Gérard Mayer
 Gérard Pierre Edouard MAYER fils de René MAYER, ancien maire de
PENTHIEVRE s’en est allé le 12 septembre 2011 à l’âge de 73 ans. Gérard Pierre Edouard MAYER fils de René MAYER, ancien maire de
PENTHIEVRE s’en est allé le 12 septembre 2011 à l’âge de 73 ans.
Après l'exode, la famille s'est posée dans le Poitou dans un petit village, Haims, à 45 km de Poitiers.
Là avec son frère Didier (décédé en 1994), et leur père, ils firent de leur propriété " la Rangeardière " un havre de paix mais surtout de labeur avec l'âme de pionnier qui a toujours animé les pieds noirs.
De son mariage avec Yvette en 1963, il eut trois enfants, Frédérique, Corinne et Stéphane.
La maman, aujourd'hui âgée de 97 ans, ses sœurs, Pierrette et Andrée ont complété une famille unie et solidaire.
Gérard a décidé de partir, épuisé par les traitements ; Conscient jusqu'au bout, il a eu le temps de parler avec les siens pour laisser quelques directives.
Il s'en est allé mais les dernières années (2006 à 2009), déjà atteint d'un cancer furent malgré tout les plus belles. En effet il retrouva sa terre natale, rencontra des gens qu'il connaissait ou leurs descendants.
La traversée du village, se fit en 4 heures lors de sa première visite, il aura eu le plaisir d'aller à l'école d'Agriculture de Guelma, et parcourir les sentiers où il avait grandi. Il parlait l'arabe couramment, et ce fut très utile pour nous qui l'accompagnons dans son périple.
Un plaisir immense qui lui remplissait ses jours et ses nuits, une fois revenu en France.
Il avait demandé à Jean Pierre, lors de la rencontre du groupe de ces voyages, les 23 et 24 juillet 2011 d'organiser encore un voyage mais y croyait-il vraiment…le mercredi suivant la maladie accélérait son processus de destruction. Il a fermé les yeux en présence de sa femme, 2 de ses enfants, et ses deux sœurs qui le veillèrent jour et nuit à l'hôpital pendant les derniers douze jours.
Ce n'est pas une page qui se tourne mais un livre qui se ferme. Une mémoire de l'Algérie s'est éteinte.
Nicolas Duchenne
Epoux de Pierrette Mayer
Mon Adresse pour me joindre : Nicolas Duchene
================
Le 12 septembre nous avons appris la terrible nouvelle du départ de Gérard Mayer, bien que nous savions et que nous attendions ce moment, nous avons du mal à l'accepter. C'est avec tristesse qu'une âme s'envole, elle laisse des pleurs et un abîme pour ces proches. La délivrance de la douleur viendra avec le temps pour ne garder que les moments merveilleux.
Comme le dit Nicolas (plus haut), Gérard était un véritable pionnier. Avec son père et son frère ils avaient acheté un domaine de 150 Ha où rien ne poussait, ce n'était que du " marécage ". Les locaux les prenaient pour des fous quand ils disaient qu'ils allaient ensemencer et faire pousser des céréales sur cette terre. Tous ces gens moqueurs attendaient qu'ils se cassent la figure. Ces pionniers reproduirent le travail fait par leurs ancêtres dans la plaine de Bône. Ils firent venir des USA une vieille machine agricole abandonnée, ils la démontèrent et la remirent en fonction avec des modifications. Ils en firent une machine qui creusait des tranchées, posaient des tuyaux (drains) et rebouchèrent tout cela. Ils drainèrent ainsi 130 Hectares. Ils gardèrent 20 hectares pour en faire 5 étangs de récupération des eaux où ils élevaient du poisson. Bien entendu les 130 hectares donnaient les résultats escomptés ce qui leur permettait d'avoir des bovins et des ovins. Ils se suffisaient à eux même.
Voilà un savoir-faire qui a fait ses preuves en Algérie et qui a été reproduit en France. De quoi faire bien des jaloux et un exemple à citer sans modération.
Il est parti en paix et nous garderons de lui un merveilleux souvenir de nos voyages en Algérie. Nous pensons beaucoup à toute sa famille et surtout à sa Maman (97 ans) qui voit partir un autre fils après son époux.
Comme dit, notre groupe de voyage, nous venons de perdre encore un de nos frères................... Gérard est le troisième du groupe.
Gérard a été inhumé dans le petit cimetière de Haims
où il a rejoint son père et son frère.

Tous ceux qui ont eu la joie de le revoir en juillet lors de nos retrouvailles autour d'un méchoui à la maison et de voir la force qui émanée de lui pour combattre ce maudit crabe, ont été émerveillés et remplis de bonheur. Ils se sont sentis plus forts par ce qu'il nous donnait. Même fatigué, il avait tenu à être parmi nous et pour rien au monde il n'aurait défailli, pas un instant il a fait montre de souffrance. Il avait marqué nos voyages par sa présence, son calme et la connaissance de sa terre où notre chantre Bônois Rachid Habbachi l'avait surnommé l'Orfèvre de Penthièvre. Il était apprécié de nous tous, quelqu'un de très souriant, de discret, de chaleureux. Nous le pleurons et regretterons tous.
Nous nous associons tous aux lecteurs de la Seybouse pour présenter nos condoléances à toute sa famille. La petite communauté Bônoise affectée par sa disparition, qui pleure sa perte.
Un départ est toujours triste mais ce n'est qu'un Au revoir et comme nos amis aiment citer Saint-Augustin :
" Essuies tes larmes,
ne pleures plus si tu m'aimes ".
" Il n'est plus là où il était,
mais il est maintenant partout où nous sommes ".
J.P.B.
Texte réalisé avec les extraits des témoignages du Groupe des Amis des Voyages en Algérie.
©§©§©§©§©§©§©
|
|
|
|
|
CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS
DE BARBARIE (1857)
PAR M. L'ABBE LÉON GODARD
ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE
AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES
Dominare in medio inimicorum tuorum.
Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.
SOIREES ALGERIENNES
NEUVIÈME SOIRÉE
Le rachat.
Fatma, chargée de préparer les sièges sur la terrasse, redescendit en annonçant que le sirocco soufflait. Ce n'était pas encore un vent dur et brûlant, mais seulement une haleine chaude, lui enveloppait le visage aussitôt qu'on s'exposait à l'air extérieur.
" Alors, dit Mme Morelli, on prendra le thé sous la galerie. "
Toutes les maisons mauresques ont la même disposition. Une cour carrée en forme le centre. Elle est ordinairement pavée de marbre blanc, et souvent une fontaine, jaillissant au milieu, versait ses eaux limpides dans une vasque de marbre, riche de sculpture et au galbe élégant.
Cette cour est entourée d'une galerie à jour. Le plafond en est soutenu par des poutrelles de cèdre ; des carreaux de brique peinte et vernissée dessinent, sur le pavé et sur les murs latéraux, des figures géométriques et des fleurons variés comme ceux du kaléidoscope. La même galerie se reproduit à l'étage supérieur, et c'est là qu'il convenait de passer la soirée pour s'abriter un peu contre le vent du désert.
Le père trinitaire et MM. Morelli, n'en ressentant que le souffle précurseur, montèrent sur la terrasse pour y passer quelques minutes. L'horizon présentait de toutes parts une beauté effrayante et grandiose. La mer était comme une nappe de bitume, et ses teintes noirâtres se confondaient, vers le nord, avec un ciel de plomb. Au couchant et au sud, d'immenses lueurs rouges, sanglantes, se projetaient au-dessus des montagnes ; et à l'est, vers le cap Matifou, un vaste incendie, allumé dans les forêts par les Arabes ou par la foudre, éclairait les profondeurs lointaines et silencieuses de la nuit.
Le vent souffle à peine et par intermittence; on dirait des soupirs émanant du sein de la nature oppressée, dévorée par des feux intérieurs, et menacée d'une convulsion.
Quand le vent s'arrête, les feuilles inquiètes, détachées des arbres, tournoient encore et dansent en bruissant, sur le béton de la terrasse, comme si elles se mouvaient d'elles-mêmes. Nul autre bruit. Des peurs et des chimères vagues traversent l'espace.
" Que Dieu est grand ! dit le vieux moine.
- Oui, reprit Alfred, Dieu est grand... "
Ils restèrent quelque temps dans une contemplation muette, et leurs pensées ne rencontrèrent le sujet habituel de la conversation qu'au moment où ils abaissèrent leurs regards vers la ville, assoupie dans une atmosphère pesante.
" Voyez donc, révérend père, le minaret de la mosquée El-Djedid, il s'allonge dans l'ombre comme un spectre. Jamais cette mosquée ne m'a paru aussi monumentale que ce soir ; ces jeux d'une lumière fantastique, où se noient sa coupole et ses créneaux, lui donnent un aspect grave et religieux.
- C'est réellement la plus belle mosquée d'Alger, dit M. Morelli; tout homme de bon sens en est encore à se demander pourquoi le gouvernement français n'en a pas fait une église. Elle est bâtie en forme de croix, et il n'y aurait presque rien à faire pour l'approprier au service divin. Placez un autel sous le dôme, des cloches dans la tour large et carrée du minaret ; vous avez un temple spacieux et empreint, par sa disposition et son style, des caractères de l'architecture chrétienne.
- Il serait d'autant plus convenable d'affecter cette mosquée au culte catholique, ajouta le moine, qu'elle est l'ouvrage d'un architecte génois, puni de mort pour prix de son travail, Les imams comprirent que ce plan cruciforme était un signe de dédain pour le mahométisme. Si l'on en croit la tradition, l'esclave chrétien aurait prononcé ces prophétiques paroles
" Lorsque les chrétiens viendront s'établir à Alger, ils auront une église. "
- Léon l'Africain, reprit M. Morelli, avait sans doute en vue la mosquée de la Pêcherie au XVIème siècle, lorsqu'il disait ;
" Entre les temples d'une élégante structure que renferme Alger, il en est un plus beau et plus vaste situé au bord de la mer. Du côté qui regarde le port, il est ceint d'une très-agréable galerie ouverte (deambulacrum), bâtie sur le rempart de la ville que le flot vient mouiller. "
- Quoi qu'il en soit, dit le père Gervais, les villes de Barbarie doivent aux esclaves beaucoup d'ouvrages d'art et d'utilité publique. Les fortifications d'Alger, les travaux importants de l'ancien port, les fontaines, autrefois si bien entretenues, sont en grande partie le fruit de leur travail. Je ne foule qu'avec respect cette terre de la Boudjaréa, de Mustapha, de Saint-Eugène, de Hussein-Dey. J'y vois ruisseler partout la sueur de nos frères.
- Sauf quelques vieilles industries, empruntées pour la plupart aux peuples conquis, les Arabes et les Maures d'Espagne n'ont rien qui leur appartienne en propre, dit M. Morelli. Je voudrais bien qu'un savant eût la patience de reprendre cette matière traitée de nos jours, avec une érudition si fausse et si dépourvue de critique, par des littérateurs. Alger musulmane n'eut jamais rien de grand que ses crimes. Sa marine même est l'ouvrage des chrétiens, esclaves ou renégats. "
En ce moment, Carlotta vint prier ces messieurs de rentrer à la galerie , où l'on avait servi le thé. Ils le firent d'autant plus volontiers que l'air s'embrasait graduellement.
" Ces vitres de couleur, ces barreaux de bronze taillé, ces colonnettes torses de marbre blanc, aux chapiteaux délicatement fouillés, continua M. Morelli en indiquant ces divers ornements de la galerie, ces briques vernissées mêmes, croyez-vous que ce soit une efflorescence de la civilisation sarrasine ?
- Mais je ne l'ai jamais pensé, interrompit Mme Morelli; tout cela est italien. Je l'attribue aux esclaves, et surtout à ceux de mou pays, qui ont toujours été nombreux en Afrique. Malheureux italiens ! continua-t-elle, combien sont morts sur cette terre où nous vivons libres et heureux! L'Italie au reste a dû, elle aussi, faire de grands sacrifices pour le rachat de ses enfants ; car sa foi vive lui montrait l'étendue des maux de l'esclavage au milieu de l'infidélité.
- Notre saint-père le pape s'est sans doute occupé beaucoup du sort et de la rançon des captifs ? demanda Carlotta en interrogeant le trinitaire.
- Oh ! certainement, dit le religieux. Les papes ont encouragé partout l'œuvre de la rédemption, comme ils ont excité toujours les nations d'Europe à s'armer pour la répression des corsaires. Ils ont sévèrement interdit aux chrétiens le commerce qui fournissait des armes aux Maures et aux Turcs. Ce crime faisait encourir l'excommunication ipso facto ; et l'impie qui en était frappé ne recevait l'absolution, même à l'article de la mort, qu'à la condition de consacrer à la terre sainte l'équivalent de ce qu'il avait fourni aux infidèles, en armes offensives et défensives, en métal, en bois de marine, en cordages, en denrées alimentaires. Il était ordonné de lire publiquement les noms de ces traîtres, les dimanches et les fêtes, dans les églises des grandes villes maritimes. Il était cependant permis aux esclaves de ramer sur les galères en course contre les chrétiens, de travailler aux chantiers de marine des corsaires, mais seulement s'ils y étaient contraints par les Turcs. Les papes ont toujours veillé aux moindres intérêts de la grande famille chrétienne ; ils ont aussi racheté directement une foule de captifs.
Pour ne citer qu'un petit nombre d'exemples, en 1585, Grégoire XIII chargea d'une rédemption en Algérie les pères capucins Pietro de Plaisance, célèbre prédicateur, et Philippe de la Rocca Contrada, accompagnés de deux laïques, Giovanni Sanna et Luigi Giumius. Le père Pietro resta à Alger, où il mourut de la peste, en assistant les esclaves dans les maisons des Maures et sur les galères.
En 1586, d'autres capucins venus à Alger dans le même but, y trouvèrent beaucoup d'esclaves des deux sexes en péril d'apostasie, à cause des tourments qu'ils enduraient ; plusieurs de ces infortunés portaient la chaîne depuis quarante ans. Les pères, au nom de Sixte-Quint, promirent au pacha quinze mille écus romains pour leur délivrance. Le pacha rendit les prisonniers sur la confiance que lui inspirait le nom du pape, Sixte-Quint se hâta d'envoyer la somme promise, et il eut la consolation de recevoir à Rome les deux cents captifs, au milieu du peuple ému d'un si touchant spectacle.
Les aumônes des souverains pontifes à la congrégation de la Propagande eurent souvent pour objet la rançon ou l'adoucissement du sort des esclaves, dans les missions que cette congrégation secourait.
- Je vois que le rachat des esclaves se faisait de diverses manières, dit Alfred, et les deux ordres des trinitaires et de la Merci n'ont pas seuls accomplis cette œuvre de miséricorde.
- Non assurément, répondit le père Gervais. Voici les principales voies par lesquelles les esclaves arrivaient à la liberté ; ils se rachetaient eux-mêmes, soit au moyen du pécule qu'ils avaient amassé au service de leurs maîtres, soit au moyen de la rançon que leur famille envoyait par l'intermédiaire du consul. Ou bien, ils étaient délivrés par les religieux des deux ordres rédempteurs, qui appliquaient à cette fin une portion des revenus de leurs couvents et les aumônes des fidèles. Les autres ordres ont été chargés d'ailleurs de bien des rachats, soit par de riches particuliers, soit par des associations de charité. Les franciscains, les lazaristes ont largement partagé nos travaux.
- On dit, père, que saint Vincent de Paul a été esclave à Tunis, interrompit Alfred.
- C'est vrai ; et l'Afrique a été le théâtre de sa charité et de celle de ses disciples. Ajournons à demain, si vous le voulez, ce qui les regarde.
Enfin, continua le vieillard, les négociations de rachats ont été confiées aussi à des laïques honorés de cette mission par leurs souverains.
- Certes, dit Alfred, ces laïques devaient être des hommes d'une remarquable vertu.
- Je puis vous faire connaître un de leurs modèles, mon ami, reprit le vieillard. C'était un homme simple, pieux et dévoué ; ce qui ne l'empêchait pas d'être encore un vrai gentil homme et un homme d'esprit : don Diego de Torrès.
- J'ai entendu prononcer son nom quelquefois.
- Eh bien ! je vais le laisser raconter lui-même une partie de son histoire. Elle fera ressortir les épreuves que traversaient souvent ceux qui remplissaient les mêmes fonctions.
" J'étais, dit-il, dans la maison de François de Torrès, mon père, au pays de Campos, et n'avais que dix-huit ans, quand je fus tenté de voyager. Je découvris mon dessein à mon père, je lui demandai la permission de l'exécuter, et, ayant reçu sa bénédiction, je me rendis à Séville, en 1544, dans la pensée, de partir d'Espagne à la première occasion. Là, je contractai des relations amicales avec Nicolas Nunez, qui avait son gendre Fernand Gomez en Barbarie. Fernand, en qualité de racheteur de prisonniers, servait dans ce pays le sérénissime roi don Juan, qui, pour récompense, lui donna la décoration de l'ordre du Christ. Nunez me persuada d'aller au Maroc pour aider son gendre en ses affaires. Encore que je fusse jeune, je pouvais lui succéder un jour, en me rendant capable de remplir sa charge.
" Je suivis ce conseil, qui ne m'a pas beaucoup enrichi ; car il est impossible qu'un homme qui va pour payer des rançons devienne riche, voyant devant ses yeux tant de misères auxquelles il faut remédier. En effet, mon prédécesseur était fort à l'aise quand il partit pour la Barbarie; il est revenu avec une dette de sept mille ducats ; il en devait deux mille à Moulê-Arrani, fils du chérif, et cinq mille à Ibrahim et Isaac Cabeça, qui sont deux frères juifs. Toutefois je ne me repentirai jamais d'avoir marché sur les pas de cet honnête homme, parce que je pense avoir servi Dieu dans ma charge et expié une partie de mes péchés.
" Je m'embarquai à Cadix dans une caravelle, et avec un vent favorable nous arrivâmes à Mazagran. Le gouverneur Louis de Lorero me fit bon accueil, et au bout de trois jours nous suivîmes la côte jusqu'à Saffie, où je débarquai. Puis je me dirigeai vers Maroc avec les marchandises que j'apportais, Mais les chaleurs étaient alors si grandes en Barbarie, que nous bûmes toute l'eau que nous avions, et fûmes forcés de creuser un puits dans le sable, afin de ne pas mourir de soif durant le chemin. J'entrai à Maroc le jour de la Fête-Dieu, et j'allai loger à l'Alhondiga, au quartier des chrétiens, où je fus bien reçu par Fernand Gomez. "
Ils s'occupèrent ensemble du sort des prisonniers, qu'une guerre perpétuelle entre le chérif et les présides espagnols amenait à Maroc. Le chérif avait alors à cœur de châtier Louis de Lorero, gouverneur de Mazagran. Dans une rencontre, celui-ci eut vingt-cinq hommes faits prisonniers, entre autres Lazare Martin, auquel il dut la vie. Le capitaine du chérif, fier d'avoir remporté cette victoire, se hâta d'envoyer à Maroc les têtes des chrétiens morts sur le champ de bataille. On les exposa sur la place du palais. " Je m'y trouvai ce jour-là avec plusieurs autres, pour savoir la cause de ce bruit, continue don Diego ; lorsque je la sus et que je vis le petit peuple qui accourait en foule à ce spectacle, je n'osai me hasarder à passer outre, et, prenant des rues détournées, je me retirai vers la douane. Mais, quelque diligence que je fisse, je ne pus y être sitôt qu'il n'y eût déjà de petits barbares occupés à rouler cinq têtes à la porte. Ils s'amusaient à les casser à grands coups de pierre, déshonorant les chrétiens par de piquantes injures. A cette vue, je me retirai dans la boutique d'un Maure qui était mon ami.
Alors il sortit avec moi, nous ouvrit un passage, un bâton à la main, et me mena jusqu'à la porte de la Douane, où j'entrai par la poterne, et je mis avec moi les têtes qui étaient sur le seuil; ensuite nous les enterrâmes avec beaucoup de tristesse. "
Fernand et Diego essayèrent de racheter Lazare Martin; mais ce fut impossible : le chérif exigeait dix mille ducats.
Un an après, Lazare réussissait à fuir et à gagner Mazagran. Il s'était évadé de la basse-fosse où on le tenait enfermé, par une ouverture qu'un des captifs avait mis un an à pratiquer, au moyen d'un crochet de fer. Huit de ses compagnons arrivèrent avec lui au préside ; mais, pour ceux qui furent repris, on les fouetta et on leur brûla le ventre et le menton avec des torches ardentes, de sorte qu'ils n'avaient plus aucune figure d'homme. " On les eût fait mourir à force de coups, dit don Diego, si Fernand Gomez et moi n'eussions couru au lieu où l'on tourmentait ces pauvres chrétiens. Aussitôt que Fernand fut arrivé, comme il était aimé de ceux qui étaient chargés de les faire punir, il les pria d'avoir pitié de ces malheureux esclaves. On cessa de les maltraiter, et nous, nous ne songeâmes plus qu'à les faire panser. "
Diego succède à Gomez; celui-ci rentre en Portugal avec des gentilshommes qui, depuis vingt-cinq ans, portaient des fers du poids de quarante livres. Un des premiers actes de Diego fut de prévenir le gouverneur de Mazagran, au moyen d'une dépêche écrite à l'encre sympathique, que le chérif méditait d'enlever la place par surprise. C'était jouer sa tête; mais cet homme généreux n'hésitait point à le faire, pour le service de Dieu et de sa patrie. Il ne craint pas de reprocher au chérif, qui retient des prisonniers contre le droit des gens, la lâcheté d'un manque de parole. On le jette en prison contre toute justice. Mais son caractère énergique et franc lui concilie l'estime des princes maures eux-mêmes.
Animé d'une piété sincère, il tâchait de suppléer autant que possible au manque d'église et de prêtre à Maroc, il fit tapisser une salle de sa demeure, y exposa des images apportées d'Espagne, alluma des lampes et des cierges, et établit la coutume de chanter le Salve Regina le samedi et les jours de fête en cet oratoire. Il fonda une confrérie de la Miséricorde, Les marchands qui en étaient membres tâchaient de soulager les esclaves.
" Quelque temps après vint le carême, dit-il; et quand nous fûmes en la semaine sainte, je fis un petit autel en mémoire de notre rédemption. Je le fis de soie de diverses couleurs, avec douze degrés qui étaient couverts de satin blanc. Au milieu il y avait une pièce de velours noir avec force découpures de papier, vingt-quatre cierges de cire blanche et plusieurs bouquets de roses et d'œillets, Au pied des degrés il y avait, sur un oreiller, un crucifix couvert d'un voile noir, avec quatre cierges de la même cire. "
- Savez-vous, mon révérend père, interrompit Alfred, que les soi-disant esprits forts auraient mauvaise grâce à se moquer de ce sacristain-là?
- Souvenez-vous, Alfred, que le courage s'accorde bien avec l'énergie de la foi religieuse, et la lâcheté avec l'impiété.
Diego de Torrès, dénoncé au chérif, défendit le droit qu'il avait de se conduire en bon chrétien, et on le laissa libre. A quelque temps de là, il passe de Maroc à Tarudant, où on le jette sans motif dans la fosse des esclaves. Elle était profonde de plus de douze toises; on y descendait par une échelle de corde, et l'on n'y recevait qu'un faible rayon du jour. Ses souffrances y furent extrêmes ; mais il obtenait la patience en invoquant avec ses compagnons la Vierge Marie. Ils récitaient toutes les nuits le Salve Regina devant ses images. Diego resta là plus d'un an et demi. Il exerça ensuite son zèle à Maroc et à Fez, où il racheta plus de sept cents esclaves. Enfin, observant de près les ressources du pays et des chérifs qui venaient de s'y établir, il rédigea des mémoires secrets pour indiquer au roi son maître la manière de conquérir ces royaumes, où l'on ne comptait pas moins de soixante mille cavaliers.
- Nous aurions grand besoin, dit Alfred, des mémoires de don Diego de Torrès. L'intérieur du Maroc, n'est guère mieux connu du gouvernement français que l'Afrique centrale ; et pourtant, d'un jour à l'autre...
- Voilà ce que c'était qu'un racheteur d'esclaves au service du roi, dit en terminant le vieux trinitaire.
- Il faudrait maintenant, mon révérend père, reprit Mme Morelli, nous expliquer comment vous procédiez vous-même au rachat, quel était le prix d'un esclave, enfin passer en revue toutes les formalités de ces intéressantes négociations.
- Lorsque nos pères disposaient d'une somme suffisante, ils nous en donnaient avis à Alger. Nous obtenions du dey un passeport pour eux, et bientôt l'étendard de notre ordre apparaissait en vue du rivage. La nouvelle circulait dans la ville, ranimait l'espérance au cœur des esclaves, et, il faut le dire, la cupidité dans celui des Turcs. Les pères se rendaient près duc dey, baisaient le pan de sa robe, et offraient des présents en argent monnayé ou en objets d'orfèvrerie. Ils lui annonçaient la valeur du chargement du navire eu argent et en marchandises, et l'on faisait tout transporter au palais du dey. Celui-ci percevait trois et demi pour cent sur les valeurs, et douze et demi sur les marchandises. Ensuite les pères se retiraient dans une demeure qu'on leur assignait, et ils traitaient au moyen d'un drogman, souvent renégat.
Les esclaves, les Turcs, les Maures assiégeaient les religieux, mais ceux-ci devaient agir avec discernement, pour n'être pas trompés. Tout d'abord ils payaient la rançon d'un certain nombre d'esclaves que le bey les obligeait à racheter; ils choisissaient ensuite ceux de leur nation, et, s'il leur restait des aumônes, ils délivraient encore d'autres captifs. Ces affaires étaient fort épineuses : un esclave menace d'apostasier, un autre se dit atteint d'un mal qui le tuera dans les fers; celui-ci s'appuie sur les longues années de sa captivité ; celui-là sur les malheurs d'une famille qui l'attend. Les religieux, désolés d'être si pauvres, empruntaient alors à des juifs ou restaient en otage.
La rançon payée au propriétaire, il y avait encore d'autres droits à régler : dix pour cent à la douane, tant de piastres aux khodjas, tant au capitaine du port, tant pour étrennes aux soldats d'escorte qui avaient protégé les acheteurs depuis leur arrivée. On acquittait ces droits en boudjous (pièces de un franc quatre-vingts centimes), en rial?draham-segher (de soixante centimes) et autres monnaies du pays.
Il n'est pas facile de marquer le prix de rançon ; car il a varié selon les temps, la valeur présumée des esclaves et la cupidité des propriétaires. Les pères trinitaires Mathurin, Jean de la Faye, ministre de la maison de Verberie, Henry le Roy, de celle de Bourmont, disent, dans leur relation de voyage au Maroc, en l'année 1723 et suivantes :
" Les chrétiens captifs au royaume de Maroc appartenaient tous au roi, qui n'accorde presque jamais leur liberté que quand ils sont invalides; encore exige-t-il des sommes exorbitantes. On a pu voir dans la relation précédente de l'un de nos pères, de l'an 1704, que pour des présents de la valeur de plus de quatre mille piastres, il ne leur accorda que douze captifs : on verra dans celle-ci que pour la valeur de six mille nous n'en avons pu retirer que quinze. "
La rançon des prisonniers vulgaires du beylik d'Alger, sans les droits, était de cinq à six cents rials, c'est-à-dire de trois cents à trois cent soixante francs. Si l'esclave n'était pas chétif, si son industrie était fructueuse pour le maître, ou si on le soupçonnait d'être d'une famille riche, la rançon montait à mille livres, et quelquefois bien plus haut. A la fin du XVIIIe siècle, le bey de Tunis ne rendait guère un homme pour moins de trois cents sequins de Venise, ou trois mille six cents francs ; une femme valait; jusqu'à sept cents sequins, ou sept mille deux cents francs.
Et il fallait voir les vieux juifs, de grosses lunettes sur le nez, peser les écus avec plus de soin qu'un lapidaire en Europe ne pèse un diamant
Encore s'il y avait eu constamment bonne foi de la part des musulmans dans ces marchés ! Mais on n'imagine pas quelles injustices, quelles odieuses chicanes venaient suspendre le départ et peut-être même rompre la convention.
- Cela n'étonne pas ceux qui ont fait des affaires avec les Arabes, dit M. Morelli ; ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'une parole donnée. Vous achetez un cheval à un Arabe cent douros ; l'affaire est conclue; vous ne quittez pas votre Arabe ; vous arrivez avec lui devant la tente où est son cheval entravé ; vous croyez qu'il va vous livrer l'animal; vous lui tendez le sac de douros :
" Voilà les cent douros, " dites-vous. Mais notre homme s'est ravisé :
" Cent douros ! s'écrie-t-il. Sidi-Abd-er-Rhaman ! y pensez vous ? une pareille jument pour cent douros ! Makâch ! "
Vous êtes stupéfait; mais il en faut prendre son parti. En vain sous représenterez qu'on était contenu de cent douros ; l'Arabe en veut maintenant cent vingt. Il ne reste plus qu'à vous retirer; à moins que vous ne préfériez entendre un éloge enflammé des liants faits et des brillantes qualités de la cavale. Écoutez; il s'en faut peu qu'elle ne descende en droite ligne de la jument du Prophète; d'El-Borak, à la crinière d'or et à la queue de pierreries.
C'est la même scène s'il s'agit d'un télis d'orge ou d'un œuf l'Arabe est convents de dix francs, il en veut douze ; de cinq centimes, il en veut dix. Il nie devant le juge ce qui est écrit par le notaire.
- Combien de fois, reprit le trinitaire, n'avons-nous pas été déçus, après ces négociations toujours lentes comme le sont toutes négociations avec les Orientaux ! Que de tracasseries, que d'extorsions n'avons-nous pas subies ! Lorsque enfin il ne restait plus un nuage pour obscurcir le regard de la justice, pas un fi l pour tendre un piège, nous et nos esclaves nous nous rendions en procession au palais du dey, Les captifs étaient dépouillés des haillons de la servitude, délivrés de l'anneau de fer qu'ils portaient au pied, si c'étaient des esclaves du beylik, et revêtus d'un manteau blanc, symbole d'innocence et de joie. Ils recevaient du divan le jeskeret ou certificat d'affranchissement, et nous prenions place à bord de notre navire, qui mettait aussitôt à la voile.
Oh ! sans doute, les esclaves que nous n'avions pas pu délivrer avaient le cœur bien serré en voyant le vaisseau cingler vers les rives de leur patrie. Mais les rachetés, ivres de joie, croyaient rêver, lorsqu'à leurs yeux s'éloignait la terre maudite, lorsque les contours de ces rivages, où ils avaient tant souffert, s'évanouissaient pour toujours dans la brume.
Et nous, le cœur partagé entre ces sentiments divers, nous nous prenions à sourire dans les pleurs.
- O mon père, quelles émotions ! dit Carlotta.
- Au débarquement, les scènes devenaient encore plus attendrissantes, lorsqu'une famille éplorée reconnaissait parmi nos captifs un père, un fils, un frère, un époux qui semblait revenir du tombeau. Après une séparation si cruelle, le bonheur de se revoir, quelquefois inattendu, allait jusqu'à l'ivresse et se traduisait par des démonstrations qu'on aurait prises pour de la folie, si la cause n'en avait pas été connue.
- Révérend père, je vais commettre une indiscrétion : Carlotta me récitait ce matin un sonnet de notre poète Giuseppe Parini sur le retour des esclaves ; Alfred l'a traduit en français. Il ne vous sera pas désagréable d'entendre cette poésie.
- J'en serai charmé, Madame, répondit le vieux trinitaire, bien que je sois un pauvre juge en littérature.
- Pendant un séjour de cinquante ans en Afrique, dit M. Morelli, vous avez eu le temps, mon père, de devenir polyglotte, comme le deviennent nécessairement grand nombre de nos prêtres d'Algérie. Alger, c'est, pour la confusion des langues, une tour de Babel. "
Carlotta dit ces vers d'une voix harmonieuse : elle justifiait le goût de Charles-Quint, qui voulait parler français à son ami, italien à sa dame :
Queste incallite man, queste Garni arse
D'Afrim al sol, questi piè rosi e stanchi
Di servil ferro, questi ignudi fi anchi
Donde sangue e sudor largo si sparse,
Toccano alfi n la patria terra ; apparse
Sovr' essi un raggio di pietade, e fianchi
Mostransi ai fi gli, alle consorti, ai blanchi
Padri che ogni lor duol senton calmarse.
O cara patria ! o tare leggi ! o sacri
Riti ! noi vi piangemmo alle meschite
Empie d'intorno, e ai barbari lavacri.
Salvate vol queste cadenti vite,
E questi spirti estenuati e marri
Col sangue del divino Agno nodrite.
Et Alfred reprit :
Enfin, ils .ont touché les bords de la patrie,
Ces esclaves brûlés du soleil d'Algérie.
Voyez ces pieds meurtris que les fers ont brisés,
Ces flancs nus, de sueur et de sang arrosés.
La charité sourit, et les chaînes affreuses
Par miracle aussitôt quittent ces mains calleuses.
Pères aux cheveux blancs, fils, épouses en pleurs,
Par de tendres baisers apaisent leurs douleurs.
O patrie adorée ! ô religion sainte !
Lois chères ! loin de vous nous jetions notre plainte
A la mosquée impie, au bagne ténébreux.
Leur vie en durs travaux s'est longtemps consumée ;
Secourez-les, chrétiens ! A leur âme affamée,
Prêtres, distribuez l'Agneau mystérieux !
- Oh ! oui, mon ami, reprit le trinitaire, la charité répondait à l'appel de ce poète chrétien ; elle n'abandonnait pas l'esclave sans ressources et encore éloigné des siens, lorsqu'il abordait au port désiré. La religion et la charité lui faisaient cortège jusqu'au seuil de la maison paternelle.
En Espagne, les pieuses cérémonies qui accompagnaient le retour des esclaves étaient très-pompeuses ; mais je préfère vous rappeler les usages propres à votre pays. Dans un de ses voyages à Tunis, en 1635, le père Dan racheta quarante-deux Français, entre lesquels un vieillard de Rouen, Noël Dubois, qui avait passé trente et un ans dans les bagnes. Il se rendit avec ces esclaves à Paris, traversant en procession Marseille et les grandes villes situées sur sa route. Les confrères et pénitents de la Trinité qui se trouvaient dans ces villes marchaient devant les esclaves ; ceux-ci s'avançaient deux à deux, revêtus du scapulaire de notre ordre et tenant dans leurs mains des chaînes brisées. Pour la plupart, sans doute, elles étaient plus qu'un symbole : en était-il un seul qui ne les eût jamais portées.
" Nous entrâmes à Paris par la porte Saint Antoine, dit le père Dan, et nous fûmes solennellement reçus par les religieux de notre couvent des Mathurins, qui vinrent à notre rencontre avec les cierges allumés.
" Deux archers de la ville, ayant hoquetons et hallebardes, et deux bedeaux avec eux marchaient à la tête de la procession. Quatre-vingts confrères de Notre-Dame de Bonne-Délivrance les suivaient pieds nus, deux à deux et revêtus de leurs aubes. Ils avaient chacun une couronne de laurier sur la tète, et en main un gros cierge de cire blanche, où, dans un ovale qu'on y avait attaché, se voyait peinte une croix rouge et bleue entre deux branches de palmier. Les religieux marchaient ensuite, séparés en deux chœurs et suivis d'un assez bon nombre d'archers de la ville en même équipage que les premiers.
" A cette dévote troupe en fut jointe une autre de quarante jeunes enfants, qu'on faisait attendre devant l'église des religieuses de Sainte-Marie. Ils avaient de petits rochets de fine toile, avec une branche de laurier en main et une guirlande sur la tête. Près d'eux était un corps de musique composé de plusieurs excellents chantres de Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle. Comme ils eurent pris leur ordre tous ensemble, ils furent droit à la porte Saint-Antoine pour nous y recevoir, nous et les captifs rachetés.
" Cependant il n'est pas à croire combien se trouva grande la foule de peuple qui accourut de toutes paris pour voir cette procession, dont les rangs se déroulaient depuis la porte Saint-Antoine jusqu'à notre église des Mathurins, dans l'ordre suivant :
" Les exempts de la ville marchaient les premiers, suivis de quatre archers et de deux trompettes.
" Un archer portant le grand guidon de camelot blanc, où étant peinte une croix rouge et bleue, avec les armes de notre saint-père le pape et celles du roi.
" Deux autres trompettes, ayant, comme les premiers, des banderoles de camelot blanc, avec une grande croix rouge et bleue, bordées de frangettes rouges, blanches et bleues, et les cordons de même, selon l'ordinaire des guidons et des bannières de l'ordre.
" Deux bedeaux, qui devançaient la croix, après laquelle venaient les confrères de Notre-Dame de Bonne?Délivrance, habillés comme nous l'avons dit et suivis du premier chœur des religieux.
" Les quarante jeunes enfants dont nous venons de parler. L'un d'eux portait un guidon de taffetas blanc, où étaient peints à genoux deux anges tenant une croix rouge et bleue, avec tes mots pour devise : REDEMPTIONEM MISIT POPVLO SVO ; et à ses côtés il y avait deux autres enfants tenant le grand cordon du même-guidon, auprès duquel étaient aussi deux archers.
Le chœur des musiciens, suivi du dernier chœur des religieux.
" Les quarante-deux captifs rachetés. Le premier, accompagné de deux frères convers de notre ordre, portait une bannière de clamas blanc, où étaient peints d'un côté un ange revêtu de l'habit de l'ordre, tenant avec les bras croisés les chaînes de deux esclaves qui étaient à ses genoux ; de l'autre, des religieux qui rachetaient ces esclaves d'entre les mains des Turcs.
" Un autre captif, au milieu de ses compagnons, se faisait remarquer par un guidon qu'il soutenait, et où étaient peintes les armes de l'ordre : une croix rouge et bleue, ornée de huit fleurs de lis en champ d'azur et timbrée d'une couronne royale.
" Les révérends pères députés pour la rédemption des captifs et leurs associés, suivis de plusieurs archevêques.
" Voilà quel fut à peu près l'ordre de cette procession triomphante. Elle se rendit en notre église, où le saint sacrement était exposé. A son entrée les trompettes et les orgues se firent entendre à l'envi. Alors notre révérend père général, revêtu de son habit ordinaire, avec l'étole par-dessus, ayant reçu les captifs, qu'il embrassa l'un après l'autre et qui furent rangés près de l'autel, fi t les prières accoutumées en cette cérémonie. "
Cependant les bannières et les guidons furent exposés autour du grand autel, et le Te Deum solennellement chanté en musique. Un éloquent sermon fut ensuite prononcé en présence de hauts personnages de l'Église et de l'État, et de plusieurs dames de condition.
Le lendemain, la même procession se rendit du couvent des Mathurins à Notre-Dame et à Saint-Nicolas-des?Champs. Les esclaves, rentrés au monastère, y reçurent les sacrements de la Pénitence et de l'Eucharistie. On les pourvut d'habits, d'argent et d'un certificat de rachat pour les aider à regagner leurs pays.
Sur la route ces voyageurs étaient assistés par les confrères de la Sainte-Trinité.
Après la mort de saint Jean de Matha, la confrérie des trinitaires, réalisant l'idée de notre fondateur, s'était établie dans le monde catholique pour recueillir des aumônes qu'elle versait entre les mains des rédempteurs, et pour conduire les captifs après leur délivrance jusqu'au dernier terme de leur voyage.
La plupart des esclaves témoignaient à Dieu leur reconnaissance pour la liberté qu'il leur avait rendue, par des actes publics de religion ou de charité. Ils allaient en pèlerinage à quelque sanctuaire de la Vierge, et y suspendaient les chaînes ou les vêtements de la servitude. Les églises d'Espagne conservent encore les ex-voto de ce genre.
- Il en est de même de plusieurs églises en Italie, interrompit Mme Morelli ; je me souviens particulièrement d'avoir vu, dans la sacristie du pieux sanctuaire de Monténégro près de Livourne, les vêtements de la servitude offerts à la sainte Vierge par une jeune fille rachetée de l'esclavage. C'est une touchante histoire du commencement de notre siècle.
Cette jeune fille, enlevée par des corsaires barbaresques aux environs de Livourne, fut vendue à un riche musulman. Il l'enferma dans son harem, et la remit aux mains des femmes impures qui en avaient le gouvernement. Le chagrin et les angoisses de la pauvre Livournaise n'avaient de comparables que la foi vive et l'amour de la chasteté qui l'animaient. Par bonheur elle ne perdit point courage; elle leva les yeux et soupira vers Celle dont le nom béni ne fut jamais invoqué en vain ; elle s'abandonna sans aucune réserve à la protection de la Reine des vierges. La paix et la confiance descendirent dans son âme et lui communiquèrent une force invincible. Prosternée devant Dieu, elle le priait ardemment, et sans cesse elle invoquait la Mère de Jésus :
" O bonne Vierge ! obtenez-moi la grâce de Dieu; gardez moi pure, chaste, fidèle à ma foi ; je vous promets en retour mort amour et ma reconnaissance. "
Des vœux si conformes à la sainteté et à la volonté de Dieu devaient être exaucés. Trois fois la jeune esclave, protégée par le Ciel, se vit en danger de subir l'ignominie qu'elle redoutait plus que la mort ; trois fois elle en fut préservée comme par miracle. Elle continuait cette vie de prière, quand elle apprit d'un esclave qu'un chrétien venait d'arriver pour racheter des victimes de la piraterie. Elle réussit à faire passer à ce libérateur, par-dessus les murs du jardin, un billet où elle disait son nom, son pays et son long martyre. C'était le moyen dont notre Seigneur voulait se servir pour l'arracher à son malheur. Elle fut aussitôt rachetée et ramenée à Livourne.
Les transports de reconnaissance dont elle fut saisie en découvrant de la mer le sanctuaire de Monténégro sont inexprimables. Dès le commencement de son esclavage la généreuse enfant de Marie avait fait vœu, si elle recouvrait la liberté en gardant le trésor de son honneur, d'accomplir à ce saint lieu un pèlerinage d'actions de grâces.
A peine débarquée, elle ne cherche point ses parents les plus chers, mais s'achemine vers ce temple célèbre, bâti sur la colline et dédié au Seigneur sous l'invocation de la sainte Vierge. Elle monte à genoux la pente escarpée; elle arrive toute ensanglantée, mais tellement transportée par les sentiments de foi, d'amour et de reconnaissance, qu'elle est insensible aux douleurs du corps. Après une longue oraison, où elle remerciait avec tendresse une si douce mère, un Dieu si bon, elle suspendit à l'autel ses vêtements de Mauresque, comme un trophée de la grande victoire de Marie et de la grâce divine. Vous pourriez les voir encore à la chapelle de Montenegro. "
La fin de ce récit fut troublée par l'orage, qui commençait à éclater sur la ville. Un livide éclair déchira la nuée ; Carlotta et Mme Morelli se signèrent.
" Et toi aussi, Fatma ? dit Alfred. Je vois bien que le zèle de ma sœur porte ses fruits. De catéchumène tu deviendras bientôt néophyte. "
La négresse répondit par un sourire, bien qu'elle n'eût pas compris sans doute les derniers mots d'Alfred. Le jeune marin, accoutumé aux ouragans des tropiques, monta sur la terrasse comme il eût fait sur le tillac de son navire, pour regarder le ciel et la mer. Les ténèbres étaient profondes, le vent courbait la tète des palmiers de Sidi-Abd-er-Rhaman, et les lames déferlaient avec furie sur la grève.
Alfred aimait la mer quand elle est douce ; mais il l'admirait surtout dans ses terribles colères. Le regard perdu à l'horizon, il murmurait en ce moment les paroles de David : " Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus ! Les élancements de la mer sont admirables ; Dieu, dans les hauteurs des cieux, est plus admirable encore... " On ne se retira qu'après une prière pour les navires exposés à la tempête.
A SUIVRE
|
CONTE EN SABIR
Par Kaddour
|
|
LI BOURRIQUOT AFIC SI BATRONS
FABLE IMITEE DE LA FONTAINE!
On jor li borriquot d'on kabyle jardinier
Y fir à li mon Diou, on bran réclamation
Qui ji va vos spliquer :
" Li coq ti po chanter tojor di bon matin
(Qui dire cit borriquot à mosio li mon Dion)
" Moi ji chante avant lui, y ji fir du potin,
Por ji vian al marchi, bor portir dis ognon,
Di spirges, di crisson ! !
" Qu'il bonhor mon zami, y ji soui bian content
Qui mi lisse à dormir
Tot li jor bor blisir "
Li mon Diou y pensi, " pit-itre cit borriquot
Y viendra blous content
Afic on zarbicot.
Ou biann on mozabite.
Ji va loui fir sanger, y ji li mit to d'souite
Afic l'entroponor di saloperi poublique. "
Qui son porti la sable, borvar di la Poublique.
Ma la sable y son lord, y la mir y son loann
Y ji marche la rote, afic matrac to l'tann.
Li borriquot y dire : comme ji soui coillou,
Quand ji barle à mon Diou, bor sangi mon batron !
Afic loui to li jor, quand ji viann al marchi
Ji trove por mangi, to c'qui fo, sans sarchi !
A présent son fini, li zagnon dans li sac ! !
J'en a barda blous lord, y tojor la matrac.
Li mon Diou bor cit fois, encor y loui sanger ;
Y loui donne on batron, qui cit one charbonnier,
To li jour y bromène dans la rue Bab-Azoun
Afic son batron qui son crié : " Charboun ! ! "
Li borricot encore y ni son pas contann
Li mon Diou y loui dit : " - Toi ti réclame to l'tann
Jami ti soui contan, y tojor ti m'embite
Vos ites blous d'one million, qui ti mi casse la tite !
Ti crois qui rian qui toi, ji pense to li jours
Qui ji souis bian contann, quand ,ji voir ton figour ? "
MORALE
Qui ti souis gininar, brisidann ou brifi
Janri vos ites contann
Tojor vos ites barli : Li autre sont tout bouffi
Y moi ji mange riann "
Po li jor ti bloré, por misiou li mon Diou
Barc' qui, ça qui vos ites
Tir dis ji souis pas bon
Li mon Diou son fini, y barli : " Ti m'embite
Barka fot moi la pi, ti cassi mon la tite. "
|
|
| ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Envoyé par Sauveur
| |
C'est un couple qui va fêter ses 25 ans de mariage et l'épouse demande à son mari :
- Mon amour, que vas-tu m'offrir pour nos noces d'argent ?
Le mari répond :
- Un voyage en Chine.
La femme, très surprise par ce cadeau magnifique, lui demande :
- Mais mon amour, si pour nos 25 ans tu m'offres ça, que feras-tu pour nos 50 ans ???
- Bah ! J'irais te rechercher.
|
|
|
| HISTOIRE DES VILLES DE LA
PROVINCE DE CONSTANTINE N°7
PAR CHARLES FÉRAUD
Interprète principal de l'Armée auprès du Gouverneur général
de l'Algérie.
|
|
LA CALLE
ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE
DES ANCIENNES CONCESSIONS
FRANÇAISES D'AFRIQUE.
Au GÉNÉRAL FORGEMOL
Ancien Capitaine Commandant supérieur,
du Cercle de La Calle
M. de l'Isle d'Antry en mission au Bastion
Au mois d'avril 1632, M. de L'Isle-Antry, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy et Commissaire de S. M. pour les Affaires de Barbarie, se rendit en Afrique sous prétexte de s'enquérir de tout ce qui regardait le service du Roy, mais principalement pour notifier à Sanson Napollon une Ordonnance aux termes de laquelle il fut bien établi que S. M, entendait qu'il (Sanson), tint les Places de Barbarie immédiatement d'Elle et qu'Elle voulait qu'il prit la charge de la pêche du Corail et du Commerce de Barbarie.
Le 11 avril 1632, M. de L'Isle-Antry, reconnût solennellement Sanson Napollon Commandant, pour le Roy, du Bastion de France et des Forteresses du Cap Rose et de La Calle.
Voici les Documents relatifs à cette Mission :
Lettre du Roi Louis XIII à Sanson Napollon.
" Fontainebleau, le 9 octobre 1631.
" Monsieur Sanson Napollon, en conséquence des dernières résolutions que j'ai prises, en mon Conseil, sur les Affaires de Barbarie, j'y envoie présentement le Sieur de L'Isle, Gentilhomme de ma Chambre, pour réparer les contraventions faites par ceux dudit pays aux Articles de paix qu'ils ont arrêtés avec vous, pour me les présenter, aucuns desquels Articles je désire être changés; ainsi que vous dira particulièrement le Sieur de L'Isle, lequel j'envoie aussi pour voir et visiter, de ma part, le Bastion de France et autres Forteresses construites en mon nom ; sur quoi je vous ai bien voulu faire cette lettre, qui vous sera rendue par ale Sieur de L'Isle, pour vous dire que vous ayez à le recevoir dans le dit Bastion et l'assister par de là de tout ce qui pourra dépendre de vous, le considérant comme un Gentilhomme en qui j'ai toute confiance, à quoi m'assurant que vous satisferez. Je ne vous ferai celle-ci plus longue, que pour prier Dieu, Monsieur Sanson Napollon, qu'il vous ait en sa sainte garde.
" Louis. "
Du Cardinal de Richelieu.
" Fontainebleau, le 9 Octobre 1631.
" Monsieur Sanson Napollon, le Roy envoyant le Sieur de L'Isle-Antry au Bastion et en Alger, pour Affaires concernant son Service et le bien de ses Sujets, j'ai bien voulu faire cette lettre pour vous assurer de la continuation de mon affection en votre endroit et vous prie, par même moyen, de vouloir assister le Sieur de L'Isle aux lieux où vous êtes, en ce quoi il pourra avoir besoin de vous, comme une personne que j'affectionne particulièrement. Je me promets cela de vous, qui m'empêchera de vous en dire davantage, sinon que je suis votre affectionné ami à vous servir.
" LE CARDINAL DE RICHELIEU. "
Lettre écrite au Roy par Sanson de Napollon, le 26 Avril 1632 .
" SIRE,
" J'ay reçeu des mains de M de L'Isle la lettre que Votre Majesté m'a fait écrire, le Onzième Octobre dernier, et, satisfait au contenu d'icelle et à tout ce que le Sieur de L'Isle m'a demandé et commandé de votre part. Je remercieray toujours le Ciel des faveurs que j'ay reçues, d'être, à Votre Majesté, très humble et très fidèle sujet et serviteur, et ne tiens rien si cher dans ce monde que cet honneur, espérant que mes services vous seront toujours agréables, me remettant au Rapport que le dit Sieur de L'Isle fera, à Votre Majesté, de tout ce qu'elle désirera savoir de ce Païs.
" Quant aux Affaires d'Alger, il me semble qu'elles sont aisées à accommoder et de retirer cent cinquante Français qui sont détenus, si Votre Majesté commande que les Turcs du dit Alger, qui sont en vos Galères, soient restitués, ainsi que Votre Majesté aura vu par les dépêches, qu'il y a trois mois que le Bacha et Milice ont écrites à Votre Majesté, tellement qu'il y a deux choses à faire sur ce sujet :
" La première est un Commandement, de Votre Majesté, à M. le Général de vos Galères, de rendre les dits Turcs ; - le second, les deniers que le dit Sieur Général prétend de retirer à raison de cent écus pour chacun. Il ferait difficulté de rendre les Reniés, desquels les Turcs font plus de cas, pour être dans leur Loy et leur protection, et lesquels ont beaucoup de crédit par toute la Turquie et exercent les plus grandes charges. Il me semble que ce n'est pas un sujet qui mérite qu'on s'y arrête, et que, pour cinq ou six Reniés qui sont déjà perdus, laisser périr cent cinquante Français qui sont en danger et beaucoup d'autres qui peuvent tomber en leurs mains ; le pire est que les Corsaires ne laissent pas de faire mal jusqu'à ce que la dite restitution soit faite, et le plus tost qui se pourra ne sera que le meilleur pour le bénéfice des Sujets de Votre Majesté, à qui je prie Dieu, etc.
" SANSON NAPOLLON. "
Lettre écrite à M. le Cardinal Duc de Richelieu,
par Sanson Napollon, le 26 Avril 1632
" Éminentissime Seigneur,
" J'ay reçeu des mains de M. de L'Isle, la lettre qu'il a pleu à Votre Grandeur me faire écrire du 21 Octobre dernier. Je rends grâces à Dieu de me veoir si glorieux que d'estre au nombre de vos serviteurs et vous asseure qu'en toutes les occasions où je pourray donner les preuves de ma fidélité et de mes services, Votre Éminence en verra les effets.
" J'ai reçeu avec un contentement le Commandement que M. de Lisle m'a fait de la part de Sa Majesté, lequel je conserveray toujours et perdray plutost la vie que d'y manquer. Tous le contentement que j'ay est d'estre dans l'impuissance de n'avoir peu servir mon dit sieur de L'Isle ainsi qu'il mérite, veu le lieu qu'il possède dans la grâce de Votre Éminence ; à tout moins il aura reconnu ce qui est de mes bonnes volontés ; sa vertu et son bel esprit lui auront fait connoistre et comprendre tout ce qui est du Bastion et de ses dépendances, de quoi il en fera un Rapport à Votre Eminence et de tout le reste des affaires de Barbarie ; et parce que Votre Éminence recouvra plus de satisfaction de son Rapport que je ne lui en pourrai donner par une lettre, je m'en remets à lui ; seulement supplierai-je Votre Éminence d'être assurée de mon fidèle service, n'ayant aucun désir que de servir le Roy, à cette fin qu'il se parle de son nom en ce pays de Barbarie et que cela apporte, à ses Sujets, du bénéfice ; et si j'ai le commandement de poursuivre le dessein que je jugeray pouvoir réussir pour le bien de son service, je le feray, espérant qu'il aura bon sujet à la satisfaction de sa Majesté. Les affaires d'Alger sont en désordre entre eux ; néanmoins ils ne laissent pas de faire du ravage.
" Le sujet de la contravention arrivée depuis le Traité de paix a été causé par les Turcs que Monsieur le Général des galères a retenus, qui est la cause qu'on a retenu en Alger cent cinquante Français, sans les déprédations que feront à l'avenir les Corsaires.
" (Il répète ici ce qu'il dit dans sa lettre au Roy, ci-dessus).
" Pour moi Éminentissime Seigneur, je n'y ay autre intérest que les œuvres de pitié que chacun doit avoir pour les pauvres âmes qui souffrent en Barbarie, pour la liberté desquelles il y a longues années que j'emploie tous mes travaux, mes soins et mon bien et continueray toujours avec plus d'affection, me voyant serviteur de votre Éminence, à laquelle je prie Dieu.
" SANSON NAPOLLON. "
Déclaration faite par M. De L'Isle à M. Sanson Napollon.
" Ayant mis pied à terre dans les Costes d'Afrique, le onzième d'Avril 1632, visité, par le Commandement du Roy, le Bastion de France, le Fort du Cap Rose et celui de La Calle, pris connaissance et tiré instruction bien particulière de l'état des dites Places et du Négoce de Barbarie, et entièrement satisfait sur tout ce qui peut regarder le Service du Roy, par le sieur Sanson Napollon, pourvu pour y Commander, d'une Commission scellée du grand Sceau, en date de Monceaux, du 29 Août 1631, en vertu de l'ordre et pouvoir exprès à nous donné, du Roy, à Fontainebleau, le huitième Octobre 1631.
" Avons déclaré et déclarons au dit Sanson Napollon que Sa Majesté entend qu'il tienne les dites Places immédiatement d'Elle et lui en réponde de sa vie.
" Qu'Elle veut qu'il prenne la Charge de la Pêche du Corail et Négoce de Barbarie, qui, par les profits et revenus qui en pourront provenir, il prenne le fond nécessaire pour la dépense de l'entretienement de lui et des dites Places, et que, du surplus, il en rende bon et fidèle compte à qui Sa Majesté commandera, le tout jusqu'à ce qu'autrement il en soit ordonné par Sa dite Majesté..
" Fait au Bastion de France, le 29 Avril 1632.
" PHILIPPE D'ESTAMPES. "
" L'An mil six cent trente-deux, le onzième jour d'Avril, nous Charles Gatien, écrivain du Bastion de France, en Barbarie, faisons savoir à tous ceux qui ces lettres verront, que le dit jour est arrivé en cette Place du Bastion, M. Philippe d'Estampes, Seigneur de L'Isle-Autry Lamotte Vouzeron Orsay, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, Lieutenant de Monseigneur le Cardinal, dans le Vaisseau Amiral, lequel a dit qu'il a esté député Commissaire du Roy, pour venir visiter le dit Bastion et autres Places construites en cette coste, au nom de Sa Majesté:
" Aussitôt que le Capitaine Sanson Napollon, Commandant pour le Boy, en la dite Place, a vu débarquer le dit sieur de L'Isle, il est allé à sa rencontre et avec grande joie et contentement l'a reçu, a fait ouvrir toutes les portes du Bastion dans lequel le dit sieur de L'Isle a pris un logement.
" Le 18 du dit mois, le dit sieur de L'Isle est allé à Cap de Rose, visiter le Fort et l'Équipage qui est dedans : le 22 du même mois, il est allé visiter le Port et le Fort qu'on appelle La Calle, l'ayant le Capitaine Sanson de Napollon, accompagné partout pendant le séjour que le dit sieur de L'Isle a fait au Bastion. Il a vu et visité toutes les Places et habitations, et aussi vu tout ce qui est en dedans, ayant requis le dit Capitaine Sanson de lui donner l'Estat de toutes les affaires du Bastion, le nombre des personnes qui y habitent, tant en la garnison que les équipages pour la Pêche du Corail, maistrances, personnes de la marine et autres, qui servent dans les dites Places, ensemble de tous les salaires qui se payent. La quantité de vivres et munitions de toute l'année, comme aussi du rôle de la dépense qui fut faite en Alger, pour obtenir la permission de construire les dites Places, lequel Estat a été payé par le Capitaine Sanson Napollon, lequel il a signé de sa main, confine aussi a fait Pierre Duserre, Intendant des affaires du Bastion et qui tient la Caisse des deniers, lequel Estat est donné au dit sieur de L'Isle qui a tout vu et lu le contenu d'iceluy, le 29 du même mois.
" Le dit sieur de L'Isle a commandé au dit sieur Sanson Napollon de faire venir tous les principaux Officiers et Soldats, tous lesquels furent assemblés au même instant et s'allèrent présenter à luy, lequel sieur de L'Isle a dit qu'en vertu de l'ordre et pouvoir qu'il a du Roy, a déclaré et déclare au dit sieur Capitaine Sanson que Sa Majesté entend qu'il tienne les dites Places immédiatement d'Elle et lui en responde de sa vie, et qu'Elle veut qu'il prenne la Charge de la Pêche du Corail et du Négoce de Barbarie, et que sur les profits et revenus qui pourront provenir, il prenne le fonds nécessaire pour la dépense et entretènement de luy et de ses Places, et du surplus en rendre bon et fidèle compte à qui Sa Majesté le commandera ; le tout jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné par Sa dite Majesté ; l'ayant fait prêter le serment de fidélité, lui ayant donné par escrit la dite Déclaration signée de sa main, après le dit sieur de L'Isle a fait prêter le serment de fidélité à tous les Chefs et Soldats, tant de ceux qui sont de la garnison du Bastion et du dehors que des Forts de La Calle, de Cap de Rose, et a commandé que la dite Déclaration et Procédure en soit escrite dans le Registre des affaires du Bastion ; ce qui a été fait, le 26 du dit mois d'Avril, en présence de M. Jean Henry, Docteur en Médecine, habitant à Paris, et de M. François Armand, Escuyer de la ville de Marseille, témoins à ce requis et appelés, qui ont signé à l'original des présentes avec les dits sieurs de L'Isle et le Capitaine Sanson Napollon.
" Extrait collationné à son original par moi Escrivain soussigné.
" GATIEN ESCRIVAIN. "
Collection manuscrite de Brienne, formée par ordre de Colbert. Vol. LXXVIII de la Bibliothèque Nationale.
Sanson fit augmenter les fortifications du Bastion et en compléta la garnison et les Officiers. Le profit qu'il tirait du commerce des blés et de la Pêche du Corail lui donna le moyen de munir le Bastion et La Calle de tout ce qui était nécessaire pour la subsistance de quantité de gens de toute sorte d'arts et de professions pour pouvoir se passer des secours d'Europe.
" François d'Arvieux, un de mes oncles, qui a commandé une Galère du Roy, raconte le Chevalier d'Arvieux dans ses Mémoires, fut fait son Lieutenant au Gouvernement du Bastion. Il commandait sous les ordres du sieur Sanson, et il le faisait avec tant de conduite que si le Gouverneur avait suivi son conseil, il ne serait pas péri comme il lui arriva dans une entreprise qu'il fit sur le Fort de Tabarque.
Les Génois étaient maîtres de ce Fort et de l'Ile sur laquelle il était situé. Leur commerce incommodait celui du Bastion; le Gouverneur voulait le détruire en s'emparant de Tabarque. "
Il y avait encore une raison qui poussait Sanson contre les Génois, c'est qu'il leur conservait rancune de tous les embarras qu'ils lui avaient causé à Alger, en offrant de fortes sommes d'argent pour pécher le redressement du Bastion par les Français. Depuis 1543, les Génois occupaient déjà Tabarque. Jennetin Doria, neveu du célèbre Amiral André Doria, avait pris, trois ans avant sur les côtes de la Corse, le fameux Dragut, Lieutenant de Barberousse. La République de Gênes, à laquelle ce Corsaire s'était rendu redoutable, refusa longtemps toute rançon pour sa délivrance ; elle consentit enfin à lui rendre sa liberté par l'entremise d'un marchand noble du nom de Lomellini qui, pour prix de son intervention, obtint, de Barberousse, la petite île de Tabarque en toute propriété.
Une Colonie Génoise vint s'y établir et prospéra rapidement. D'Avity parle de cet Établissement dans sa Description de l'Afrique. Les Génois, dit-il, ont à Tabarque une bonne Forteresse munie d'artillerie avec une garnison de deux cents soldats. Pour entretenir la liberté du commerce, ils paient six mille écus aux Pachas de Tunis et d'Alger qui, outre cela, tirent encore trente mille roubles de la Pêche du Corail autour de l'île; mais les Génois sont obligés de souffrir vis-à-vis d'eux, en terre ferme, une Garde de Janissaires pour éclairer leurs mouvements. Cette Garde était soudoyée aux dépens des Génois.
Or donc, Sanson voulant se venger des Tabarquins, s'entendit avec un Génois qui était boulanger du Fort et qui devait l'y introduire, mais celui-ci le trahit. En effet, y étant allé une nuit avec des bateaux armés et tout autant d'hommes qu'il put prendre au Bastion et a La Calle, il trouva la garnison de Tabarque sous les armes qui l'attendait et qui fit feu sur lui et sur ses gens, si vigoureusement qu'il y fut tué avec une partie de ses compagnons (le 11 Mai 1633).
Les autres furent la plupart blessés et eurent bien de la peine à regagner leurs bateaux, en désordre, et revenir au Bastion où d'Arvieux était resté pour commander.
Sanson Lepage, Gouverneur du Bastion
Un sieur Sanson Lepage, Premier Héraut d'Armes de France, du titre de Bourgogne, fut nommé pour remplacer le Capitaine Napollon.
Au mois de Septembre 1634, le nouveau Gouverneur partit pour se rendre à son poste, mais Richelieu le chargea d'aller, d'abord auprès du Divan d'Alger, pour obtenir des modifications au Traité de Napollon que lui, Richelieu, qualifiait d'Acte diplomatique indigne du Roi de France.
Il s'agissait de réclamer plusieurs navires Français que les Corsaires Algériens retenaient injustement et dont les équipages, en violation du dernier Traité, avaient été faits Esclaves. " Le sieur Lepage fut bien accueilli de ceux d'Alger, dit Pierre Dan qui accompagnait dans ce voyage le Commandant du Bastion : toutefois, lorsqu'il se présenta au Port, il fut proposé en plein Divan de faire ôter la bannière de France, de dessus le vaisseau, au plus haut duquel elle avait été arborée. Les Turcs alléguaient pour raison que cette bannière ainsi déployée dans leur havre était une marque de souveraineté ; mais toutes leurs raisons ne furent pas assez fortes pour celles du sieur Lepage qui les sut si bien persuader, que, durant tout le temps que nous fûmes à Alger, la bannière y demeura. Il est vrai qu'il nous fallut ôter du navire le gouvernail et les voiles et les mettre à terre, au magasin de celui qui gardait le Port. " Les Algériens désarmaient ainsi tout bâtiment étranger pendant le séjour qu'il faisait dans leur Port, afin qu'il ne put reprendre la mer sans leur assentiment.
Quant à l'objet de sa mission, le sieur Lepage fut moins heureux. Il demanda, d'abord, que tous les Français qui avaient été faits Esclaves, contre les articles de la dernière Paix, lui fussent restitués on refusa d'y consentir. Il proposa de rendre soixante Turcs qui étaient détenus à Marseille en échange des Français prisonniers ; il offrit même de racheter une partie de ces derniers, mais on rejeta toutes ses propositions. Il fut obligé de partir pour le Bastion de France sans avoir rien obtenu.
Description du Bastion de France
Pierre Dan, l'auteur de l'Histoire de la Barbarie, suivit le Gouverneur Lepage et assista à son installation. Voici la description qu'il nous donne de cet Établissement, (Septembre 1634).
" Ce Bastion est au bord de la mer Méditerranée, en cette côte que l'on appelle communément la petite Afrique et l'ancienne Numidie. Il regarde directement le Nord, du côté duquel il a pour borne ta mer qui bat ses murailles et une petite plage où abordent d'ordinaire les barques de ceux qui vont pêcher le Corail...
" Il y a deux grandes cours en ce Bastion, la première desquelles est vers le Nord, où sont les magasins à mettre le blé et les autres marchandises, avec plusieurs autres chambres basses, où logent quelques Officiers du Bastion ; et cette cour est assez grande.
" L'autre qui est beaucoup plus spacieuse, se joint à la plage dont nous avons parlé ci-dessus, où l'on retire les bateaux et les frégates. Au bout de celle-ci, se voit une belle et grande Chapelle toute voûtée que l'on nomme Sainte Catherine, au-dessus de laquelle il y a plusieurs chambres où logent les Chapelains et les Prêtres du Bastion. Le cimetière est au devant; et un peu à côté, entre la Chapelle et le Jardin, se remarque l'Hôpital, où l'on traite les Soldats, les Officiers et les autres personnes malades. Entre ces deux cours, du côté du. Midi, il y a un grand bâtiment tout de pierre et de figure quarrée : c'est la Forteresse qui est couverte en plate-forme, munie de deux pierriers et de trois moyennes pièces de canon de fonte. Là, même, est le Corps de Garde et le Logement des Soldats de la garnison, divisé en plusieurs chambres.
" A dix pas hors de la porte du Bastion qui regarde la terre ferme, il y a quelques vingt familles d'Arabes qui se tiennent lit pour le service de la Forteresse. Ils demeurent sous des tentes avec tout leur ménage, poules, chevaux, bœufs et autre bétail, ce qu'ils appellent, en leur langue, une baraque, et toutes ces tentes jointes ensemble font un Douar, comme qui dirait un hameau ou un village.
" Durant le séjour que nous y fîmes, je prenais un extrême plaisir à visiter ces Arabes dans leurs baraques, par le moyen d'un des leurs qui parlait Franc et me rendait raison de tout ce que je lui demandais.
" Pendant que nous fûmes là, je remarquai qu'il y avait bien quatre cents hommes tant soldats et Officiers que gens de travail. Ils sont d'ordinaire tous entretenus aux dépens du Bastion, hormis les Corailleurs auxquels la Compagnie paye le Corail par livre, à raison du prix dont ils ont convenu, à condition toutefois que ceux qui en font la pêche n'en oseraient vendre ni donner tant soit peu, sous peine de perdre leurs gages. Ceux qui font là leur demeure, sont Français dont il yen avait jusqu'à sept ou huit cents, au temps que le sieur Sanson Napollon en était Gouverneur. On y fait ordinairement un trafic avantageux et riche qui est de quantité de Corail, de Blé, de Cire, de Cuirs et de Chevaux barbes, que les Mâtes et les Arabes voisins y viennent vendre à très bas prix et que l'on transporte après en Provence. "
Les Algériens, comme les autres Barbaresques, n'observaient guère les Traités avec les Nations Chrétiennes : et l'encre de ces sortes d'Actes n'était pas encore séchée tout à fait qu'ils avaient déjà trouvé moyen d'en violer quelque stipulation. Ainsi, dans le courant de l'année 1637, les Turcs d'Alger et de Tunis, en dépit des Traités récents, capturaient nos bâtiments de commerce sous les plus frivoles prétextes, ou même sans se donner la peine de mettre en avant, un prétexte quelconque. - Il ressort de l'inspection de nos Côtes de la Méditerranée, faite, en 1633, par Henri de Séguran, Seigneur de Bouc, que presque chaque jour, les Barbaresques débarquaient en Provence où ils enlevaient hommes, femmes et navires. La population, livrée sans défense à ces Corsaires, avait dû chercher un refuge dans l'intérieur des terres. Tout le long des côtes de Provence on avait dû élever des postes-vigies sur les promontoires qui, à raide de feux, signalaient l'approche des corsaires barbaresques et donnaient ainsi l'alarme aux populations. Ces incessantes piqûres de moustiques sur la peau du lion faisaient plus souffrir la France par l'humiliation que par la douleur. On s'en aperçoit dans la Correspondance politique et administrative de l'époque. Aussi le Cardinal de Richelieu, poussé à bout par l'insolence des Pirates, écrit en ces termes, le 28 Mai 1637, à Monseigneur de Bordeaux, Chef de l'Armée Navale :
" Si en revenant de la croisière contre les Saletins, vous pouvez faire quelque chose pour ravoir nos Esclaves de Tunis et d'Alger, vous le pourrez faire ; j'estime ainsi que vous l'avez écrit plusieurs fois, que le meilleur moyen pour cela, est d'essayer de leur faire peur et de prendre autant de leurs vaisseaux qu'on pourra ; après quoi on viendra à restitution de part et d'autre."
Conformément à ce programme, M. de Chastellux, Commandant le vaisseau le Coq, s'empara de deux Corsaires d'Alger, qui avaient eu la mauvaise chance de se rencontrer sur sa route.
Voulant en outre profiter de la présence de l'Armée navale du Roi, dans la Méditerranée, Richelieu donna, le 7 Août 1637, les instructions suivantes :
" Le Roi, avant pitié de plusieurs de ses pauvres Sujets détenus Esclaves par ceux d'Alger, veut obliger les dits d'Alger à rendre et restituer les dits Esclaves en échange des Turcs et Maures qui sont sur ses Galères, comme aussi à faire un Traité de paix avec les Sujets trafiquant sur les dites mers, en sorte que le commerce soit libre.
" Pour cet effet, Sa Majesté juge à propos qu'il soit choisi trois ou quatre vaisseaux de Sa dite Armée navale bien armés et équipés...,sur lesquels vaisseaux il faudra mettre tous les dits Turcs et Maures d'Alger qui se trouveront dans les dites Galères pour être menés à la vue d'Alger, étant ainsi nécessaire afin que leurs femmes, enfants et parents soient mus et excités à procurer leur liberté par l'échange des dits Sujets du Roi.
" Le Capitaine Sanson Lepage, qui a connaissance de la langue Turquesque et des manières d'agir de ceux d'Alger, accompagnera celui qui commandera les dits vaisseaux et négociera le dit Échange et le Traité de paix selon les instructions qui lui ont été données ci-devant et le pouvoir qui lu a été expédié et donnera compte de tout ce qui se fera en cette affaire au Commandant des dits vaisseaux pour s'y conduire selon ses avis. "
L'Avant-garde de la Division navale commandée par Féraud, Capitaine du vaisseau l'Intendant, arrivait, à Alger, le 24 Novembre 1637. Lepage qui était à bord essaya immédiatement d'entamer des négociations. On voulait procéder pacifiquement, mais on s'y prit assez mal. Le Cardinal de Sourdis avait ordonné au Chevalier de Manty, Commandant de l'Escadre, d'arrêter tous les navires qu'il rencontrerait, de les faire mouiller auprès de lui et de bien veiller à ce qu'aucun d'eux ne s'échappât pour aller donner avis de lui au dehors.
" Il lui avait aussi enjoint, lorsque le temps fixé pour les négociations serait fini, si Lepage n'apportait pas la satisfaction que le Roi désirait, d'emmener tous les vaisseaux en France et de mettre à la chaîne tous les Turcs. "
De Manty exécutant à la lettre les ordres qu'il avait reçus, captura tous les navires qu'il rencontra, en pénétrant dans le Port d'Alger sous Pavillon parlementaire.
Comme, on devait s'y attendre, le négociateur Lepage fut très mal accueilli par le Divan qui trouvait que c'était méchamment faire, après avoir pris leurs barques d'arborer en leur rade, une bannière blanche, sous feintise de traiter de la Paix.
Il fut renvoyé sans réponse. Après avoir attendu jusqu'au lendemain, de Manty, voyant bien qu'on ne pourrait rien obtenir, ordonna de lever l'ancre et de déployer à l'arrière du navire un Étendard rouge, comme signal de guerre.
" Il avait bonne volonté de fane lâcher contre la ville tous les canons de son vaisseau, où il y en avait plus de soixante, mais il s'abstint de peur que l'on en fit porter la peine aux esclaves Français. "
Dès lors, il n'y avait déjà plus moyen de s'entendre. Le Divan fit arrêter le sieur Pion, Vice-consul de France, à Alger, et un nommé Mussey dit Saut, qui faisait, à Alger, les affaires de la Compagnie du Bastion.
Pion raconte, en ces termes, l'affaire du Bastion à M. Vian, son Consul alors en congé à Marseille :
" ... Après un gros conflit, les Membres du Divan me demandèrent si, quand ils avaient donné le Bastion aux Français, c'était pour sortir le Blé ou Corail. Je me défendis là-dessus que je n'étais pas ici, pour le Bastion et qu'il y avait un homme particulier pour cela (Mussey dit Saut) qui, jusqu'à présent, leur avait payé la taxe et qui donnerait raison de cela. Et l'ayant fait venir, lui firent la même proposition ; mais ne sachant que répondre, la rumeur fut grande et courûmes fortune, lui et moi d'être brûlés, car cette maudite parole passa plusieurs fois parmi les 1,000 ou 1,200 Barbares pour lors assemblés dans ce Divan. Enfin, par la grâce de Dieu et l'assistance de mes bons amis, nous évitâmes le péril, et, après nous avoir envoyés en prison, où nous avons demeuré deux jours, ils ont passé leur colère sur le Bastion ; car en même temps ils envoyèrent quérir le sieur Cheleby (Ali Bitchinin), Général de leurs Galères et lui commandèrent d'armer et obligèrent six Galères y aller là-bas pour raser le dit Bastion, ruiner tout ce qui se trouvait dedans et emmener les personnes ici esclaves. Et ont de plus, arrêté entre eux, que jamais le dit Bastion ne se redresserait, ni par prière du Roi de France, ni par Commandement du Grand Seigneur ; que le premier qui en parlerait perdrait la vie.
" Les Galères sont parties depuis hier pour aller faire cette belle expédition et voilà en quoi sont aujourd'hui les affaires en ce pays, que s'il n'y avait que le Bastion qui en pâtisse, ce serait peu de chose ; car leur Agent qui est ici (Mussey) a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher que Sanson, au nom du Roi, ne fi t point de paix avec cette Milice. Il a cru de bien faire, mais tout le mal leur tombe dessus, bien que nous autres, qui sommes ici, nous ne pouvons manquer d'être de la fête ; car s'il est véritable que, M. de Manty vienne canonner la ville, ainsi qu'il leur. a fait entendre, nous sommes assurés de finir tous nos jours misérablement, ayant été arrêté dans le Divan qu'au premier coup de canon on coupe la tête à tous les Français, ... ".
A SUIVRE
ALGER, TYP. DE L'ASSOCIATION OUVRIÈRE V. AILLAUD ET Cie
Rue des Trois-Couleurs, 1877
Livre numérisé en mode texte par M. Alain Spenatto.
| |
MON LYCEE
Par M. Nafaa Boumaiza
Envoyé par Mme Boumaiza (sa fille)
|
ONC je n'oublierai, mon entrée un matin
Dans l'imposant lycée qui porte comme en reliques,
Le nom du vénérable enfant de Sainte MONIQUE
L'ancien évêque d'HIPPONE le grand Saint-AUGUSTIN.
J'avais déjà souffert dans ma première enfance
De la séparation de mon pays natal.
Une fois encore le Sort invincible et fatal
Frappait cette fois le seuil de mon adolescence.
Que de larmes et chagrins dans le triste internat
J'ai dû encore subir devant mes camarades
Eux qui étaient tous fiers et prêts pour la parade
Lycéens volontaires pour tout un septennat.
Le hasard cependant qui arrange les choses
D'amis qui flambaient neuf me fit la connaissance
Et les jours après jours je reprenais conscience
Et perdais du même coup mon air triste et morose.
Maintenant que le TEMPS avec son sablier
M'a montré le chemin que j'aurais dû choisir
Ma mémoire infaillible me fait bien souvenir
De cette période heureuse où j'étais écolier.
Le soir dans les ténèbres j'imagine BRACHET
Proviseur souriant tout frêle mais volubile
Je revois CAZABAN METHAIS et COSTABILE
Et l'heureux débrouillard, sympathique BOUCHET.
Le vertueux COHEN disciple de Socrate
Enseignait la sagesse et l'aimable CAMOIN
Professant dans les Sciences préparait avec soin
Les meilleurs des élèves au serment d'Hippocrate.
LAWRANCE en agrégé des lois mathématiques
Conduisait nos études au baccalauréat
Monsieur ROUILLON doté d'un grand certificat
Nous enseignait alors la sublime Rhétorique.
Je dresse ma mention au beau couple BLANCHARD
Ils étaient elle sévère et lui si magnanime
SECCHI nous prodiguait ses plus chères maximes
Le plus " gentil " de tous était pépé AGARD.
GRATTELOUP enseignait la Dive Philosophie
MERLE nous fatiguait par ses grands mouvements
Et le pauvre LHERMITE par nos comportements
Punissait Faraday des malheurs de Sophie.
Dans les flots du passé et j'en rends grâce à Dieu
J'ai présent à l'esprit le surveillant suprême
Qui au fil des années était resté le même
On l'appelait le dur : il s'appelait BOURDIEU.
Quand il nous regardait, dévisageant nos âmes
On sentait le bon cœur et son regard oblique
Au-dessus des lunettes, très franc et sans mimiques
Scrutait dans nos pensées la chaleur de nos flammes.
Nous étions garçonnets piaffant et trépignant
Et ne comprenions guère ce guide sévère et sage
Mais le Temps nous oblige à semer nos hommages
A celui qui repose en terre de Perpignan.
Le vieux MEZALTARIM, auguste dans sa loge
Sermonnait bien souvent le grand veilleur de nuit
Ce même TENNERONI qui sans le moindre ennui
Réparait pour des sous les montres et les horloges .
Le compère Jeannot A.N.S. Titulaire
Ne parlait qu'à DJENDI son seul ami d'enfance
Le maître les avait et pour la circonstance
Placés à la même table, à l'école primaire.
Ils devaient occuper tous deux la même classe
Djendi le souriant était le professeur
Et Jeannot le courtois en était balayeur
C'est ainsi que le Sort décida à leur place.
Te rappelles-tu ami cette courte adolescence
Qui a nanti nos cœurs de si tendres moments ?
Nos maîtres avaient juré que par nos sentiments
Nous écririons un jour notre reconnaissance.
Souvent je le revois ; Alors je me rappelle
L'ambiance qui y régnait dans ma folle jeunesse
Je me plie humblement devant toute sa noblesse
En donnant mon respect à cette citadelle.
Je pourrais cher lecteur sans la moindre des ruses
Enumérer les faits d'une enfance joyeuse
Mais craignant de trouver leur liste fastidieuse
Je préfère présenter toutes mes sincères excuses.
BOUMAIZA NAFAA.
Ecole An-nasr
Lever de l'aurore
- ANNABA -
|
|
| LE BAC...
Envoyé Par Henri
| |
Une jeune fille très belle et vêtue de façon assez provocante entre dans une salle d’examen pour passer l'oral du baccalauréat.
L’examinateur semble ému. Il bégaye un peu en lui proposant un sujet et la fille lui répond avec force œillades et trémoussements :
- Je sais pas, j’ai pas appris ma leçon...
Le professeur, un peu gêné, lui demande :
- Je vous propose un autre sujet, ou un rendez-vous ?
- Oh ! Monsieur je préfèrerais un rendez-vous ( en rougissant quand même un petit peu )
- Très bien ...
Alors, à l’année prochaine ...
|
|
|
PHOTOS D'ECOLE
Envoyé par M. Joachim Sardella
|
|
LYCEE SAINT AUGUSTIN
Année 1945/1946
Une classe du lycée Saint Augustin en 8ème ou 9ème
 1 Camillieri - 2 Laporte - 3 Genisson - 4 ? - 5 Brun - 6 ? - 7 Belkessa Rédouane - 8 ? - 9 ? - 10 ? -
1 Camillieri - 2 Laporte - 3 Genisson - 4 ? - 5 Brun - 6 ? - 7 Belkessa Rédouane - 8 ? - 9 ? - 10 ? -
11 Zamit - 12 Albou - 13 ? - 14Nancy? - 15 ? - 16 ? - 17 ? - 18 Scarnelli - 19 ? -20 Monnier - 21 ? -
22 ? - 23 ? -24 Gamba - 25 ? - 26 ? - 27 ? - 28 ? - 29 Hocine - 30 Djendi Najib - 31 ? - 32 ? -
33 Daguet - 34 Calamia - 35 Moussa - 36 Rezzutto - 37 Lecouffe Alain - 38 Merle - 39 ? - 40 Bellagamba - 41 ? - 42 Joachim Sardella -
43 Khann - 44 ? - 45 Gommis - 46 ? - 47 Bonifaci - 48 Pili -
___________________
Est-ce que d'autres amis se reconnaîtront-ils et apporteront-ils d'autres informations ?
Merci M. Sardella |
|
|
23 SEPTEMBRE 1940…
L’AGRESSION BRITANNIQUE SUR DAKAR
« L’empire, sans la France ce n’est rien. La France sans l’empire, ce n’est rien »
(Amiral Darlan – Novembre 1942)
« Nous avions reçu un empire ; nous laissons un hexagone »
(Colonel Charles Lacheroy)
Après avoir été donné à la France par le traité de Paris, le 30 mai 1814, Dakar devint, en 1904, la capitale de l’Afrique Occidentale Française (AOF). Située à l’extrémité occidentale de l’Afrique, elle occupait, en 1940, une position stratégique considérable qui faisait bien des envieux. Au point de séparation de l’Atlantique Nord et Sud, en avancée face à l’Amérique Latine, sur le chemin entre l’Afrique du Sud et l’Europe, Dakar intéressait tout le monde et en premier lieu les Britanniques qui, sur le chemin traditionnel de l’Afrique australe et de l’Asie par le Cap, retrouvaient là l’un des enjeux de leurs rivalités coloniales avec la France et voulaient profiter de son écrasement.
En septembre 1940, le Maréchal Pétain avait confié au général Weygand la délégation générale du gouvernement en Afrique et le commandement en chef des troupes. Ainsi se trouvait affirmée la volonté de défendre l’Afrique mais aussi de préparer les moyens de la revanche.
Le 31 Août 1940, soit près de deux mois après la lâche agression commise par ces mêmes britanniques sur la flotte française au mouillage et désarmée, dans le port de Mers El-Kébir (Algérie) et près d’un mois après l’entretien Churchill – De Gaulle (6 août 1940) sur les modalités d’une éventuelle attaque contre les forces françaises stationnées au Sénégal et demeurées fidèles au Maréchal Pétain, la force navale M (M comme « Menace ») britannique où se trouvait de Gaulle quitta les ports britanniques pour Freetown en Sierra Leone qu’elle atteignit le 16 Septembre.
Cette expédition reposait sur deux principes et deux ambitions :
- Churchill espérait mettre la main sur l’or de la Banque de France et des banques nationales belges et polonaises, représentant plus de 1000 tonnes d’or… et sur le cuirassé Richelieu, redoutable par sa puissance de feu (bien que son armement ne fût pas terminé), fleuron de la flotte française.
- De Gaulle désirait s’imposer comme le chef suprême de l’empire français en guerre… empire d’importance que le gouvernement de Vichy tenait, par ailleurs, à défendre ardemment.
Partie de Freetown le 21 septembre, la force M se présenta devant Dakar le 23 à l’aube. A 6 heures, un message de de Gaulle était adressé à la garnison en lui demandant de se rendre… sans effet. Sa seule présence qu’il espérait suffisante, ne provoqua pas à son grand dam les ralliements escomptés… le traumatisme de Mers El-Kébir était trop vif. Le gouverneur général de l'A.O.F., Pierre Boisson, commandant la Place, résolument rangé derrière Pétain, refusa catégoriquement de se rallier, affirmant sa volonté de défendre Dakar « jusqu'au bout » La décision de De Gaulle ne se fit pas attendre : Il fallait débarquer ! Une première tentative de débarquement se solda par un fiasco suivie de deux autres qui subirent le même sort. Une tentative de persuasion politique échoua et Thierry d’Argenlieu, arrivé par mer pour parlementer avec un drapeau blanc, fut accueilli par un tir de mitrailleuse qui le blessa mais son embarcation parvint à s'échapper. Il en résultait que de l’avis de De Gaulle et de l’amiral Cunningham, le patron de la flotte anglaise, la résistance allait être farouche…
En effet, face à l’armada britannique qui se préparait au combat, la France disposait, cette fois, de solides moyens navals ainsi qu’une sérieuse défense côtière. On en n’était plus aux conditions dramatiques de Mers El-Kébir où la flotte désarmée avait été littéralement assassinée ; cette fois, les marins français étaient prêts au combat et animés, de surcroît, d’un esprit de revanche parfaitement perceptible… et compréhensible. Avant la tragédie de Mers El-Kébir, la flotte française était la 4ème plus puissante flotte du monde ; elle était décidée à le prouver et cela d’autant plus qu’elle n’avait jamais été vaincue…
Sur cette résistance, de Gaulle écrira dans ses mémoires : « Décidément, l’affaire était manquée ! Non seulement le débarquement n’était pas possible, mais encore il suffirait de quelques coups de canons, tirés par les croiseurs de Vichy, pour envoyer par le fond toute l’expédition française libre. Je décidai de regagner le large, ce qui se fit sans nouvel incident. »
Ainsi se passa la première journée, celle du 23 septembre.
Dans la nuit du 23 au 24 septembre, plusieurs télégrammes furent échangés entre l’amiral Cunningham et Churchill, décidé à poursuivre l’affaire jusqu’à son terme : « Que rien ne vous arrête ! » Dans cette même nuit, un ultimatum anglais fut adressé aux autorités françaises de Dakar leur enjoignant de livrer la place au général de Gaulle. Le texte était fort maladroit et accusait les forces de Dakar de vouloir livrer leurs moyens aux Allemands. Il ne pouvait que provoquer l’indignation des défenseurs et ne recevoir d’autres réponses que le refus. Le gouverneur général Boisson, répondit : « La France m’a confié Dakar. Je défendrai Dakar jusqu’au bout !»
Depuis la tragédie de Mers El-Kébir, Vichy avait décidé de défendre fermement cette position stratégique française et avait envoyé à cet effet, de Casablanca, des bombardiers, des chasseurs et des croiseurs. Il y avait là : Un cuirassé (Richelieu), deux croiseurs légers, quatre contre torpilleur, trois destroyers, six avisos, cinq croiseurs auxiliaires, trois cargos et trois sous-marins. Par ailleurs, la force de frappe aérienne n’était pas négligeable… et elle allait le prouver.
Du côté anglais, la flotte était tout aussi
impressionnante : Un porte avions (Ark Royal qui avait déjà opéré à Mers El-Kébir), deux cuirassés, trois croiseurs lourds, deux croiseurs légers, dix destroyers, deux dragueurs de mines et une dizaine de navires transports de troupes portant 4200 soldats –dont la fameuse 101ème brigade des Royal Marines… à laquelle s’ajoutait l’armée gaulliste composée de trois avisos, un patrouilleur, quatre cargos et 2700 soldats français.
Toute la journée du 24 se passa en échanges de coups d’artillerie de marine entre les deux flottes qui firent de nombreuses victimes parmi les marins des deux camps et la population civile qui subit également ce pilonnage. Des obus anglais de gros calibre (380m/m) tombèrent sur la ville, touchant, entre autres, l’hôpital et la caserne du 6° RAC, faisant 27 morts et 45 blessés. En soirée, la situation n’avait guère évolué…
Le lendemain, 25 septembre, la ténacité britannique continua. Les navires de la force M voulurent de nouveau s’approcher afin de poursuivre leur œuvre de destruction, mais, comme précédemment, ils durent se frotter aux bâtiments français (Vichystes, diront les gaullistes !) qui leur infligèrent de sérieux dégâts et cela d’autant plus que l’aviation française était maîtresse du ciel.
C’en était trop ! De Gaulle écrira : « L’amiral Cunningham décida d’arrêter les frais. Je ne pouvais que m’en accommoder. Nous mîmes le cap sur Freetown. »
L’armée française sortait vainqueur de la bataille en dépit de ses 203 morts et 393 blessés. Les 1927 morts de Mers-El-Kébir étaient en partie vengés.
Cette opération constitua un tournant idéologique pour les gouvernements, bien plus qu'un affrontement important du point de vue des forces en présence, du nombre des victimes ou des pièces militaires détruites ou endommagées. L’aventure anglo-gaulliste se solda ainsi par un cuisant échec et eut des conséquences considérables.
- D’un côté, le régime de Vichy sortait renforcé de l’épreuve et la cohésion des troupes de la marine –toujours invaincue- autour de la personne du Maréchal Pétain, revigorée.
- De l’autre, le crédit du général de Gaulle dégringolait en chute libre. L’homme se retrouvait isolé. Soudainement mis à l’écart, il fut politiquement menacé par l'amiral Muselier accusé à tort d'avoir été à l'origine des fuites qui empêchèrent le débarquement. Il ne s’en cacha pas dans ses mémoires : « A Londres, une tempête de colères, à Washington, un ouragan de sarcasmes, se déchaînèrent contre moi. Pour la presse américaine et beaucoup de journaux anglais, il fut aussitôt entendu que l’échec de la tentative était imputable à de Gaulle. » … « C’est lui, répétaient les échos, qui avait inventé cette absurde aventure, trompé les Britanniques par des renseignements fantaisistes sur la situation à Dakar, exigé par donquichottisme, que la place fût attaquée alors que les renforts envoyés par Darlan rendaient tout succès impossible… »
De son côté, Churchill, lui aussi, sortait de l’aventure en fâcheuse posture. Il dut subir les sarcasmes de la Chambre des Communes et fut à deux doigts d’être démissionné. S’il lui avait été facile de détruire, à Mers El-Kébir, une flotte désarmée (et pourtant alliée) causant la mort de 1927 marins, manifestement, avec Dakar ce fut tout autre et son désir de s’emparer de l’excellente et cohérente flotte française ou de la détruire se solda par un échec retentissant.
José CASTANO
e-mail : joseph.castano0508@orange.fr
N.B : Les alliés ayant débarqué le 8 Novembre 1942 en Afrique du Nord (opération « Torch »), les autorités Vichystes d’AOF, convaincues par l’amiral Darlan, signèrent le 7 décembre 1942, un accord avec les alliés, qui remit l’empire colonial français dans la guerre en formant « l’Armée d’Afrique » dans laquelle firent merveille les « tirailleurs sénégalais ». Lors de la constitution du Comité Français de la Libération nationale (CFLN), le gouverneur général Boisson démissionnera et sera remplacé le 1er juillet 1943 par le gaulliste Pierre Cournarie.
Le Richelieu appareilla pour les Etat-Unis où son armement fut modernisé. Il participa au côté des Alliés à la guerre contre l’Allemagne puis, dans le Pacifique, à celle contre les Japonais. Il fut présent à la capitulation japonaise en rade de Singapour.
Le 1er Octobre 1945, il fut de retour à Toulon après 52 mois passés loin de la Métropole. Il participa à la guerre d’Indochine puis fut mis en réserve en août 1959, désarmé en 1967 et démoli en 1968.
-o-o-o-o-o-o-o-
« L'âme de nos marins plane sur l'Océan,
je l'ai vue ce matin, sous l'aile d'un goéland » (Freddie Breizirland)
« La France n’est pas à vendre, même à ses amis.
Nous l’avons reçue indépendante, indépendante nous la laisserons »
(Georges CLEMENCEAU, dans une lettre de mise en garde au président américain COOLIDGE, le 9 août 1926)
« J'ai prouvé que l'on pouvait être résistant sans être gaulliste ! »
(Antoine de Saint-Exupéry)
-o-o-o-o-o-o-o-
- Pour revoir l’article : - 3 JUILLET 1940… L’AGRESSION BRITANNIQUE SUR MERS-EL-KEBIR – Cliquez sur : 3 juillet 1940 : l’agression britannique sur Mers-el-Kebir – par José CASTANO
-o-o-o-o-o-o-o-
-Marins, qu’a-t-on fait de vos sépultures ? Et vous, Français d’Algérie quels crimes avez-vous commis pour engendrer tant de haine ? Cliquez sur : http://www.unite-francaise.org/article-Images.php3?id_article=68.
|
|
| L'impromptu de Berlin, un régal..
en Alexandrins
Envoyé Par Marc
| |
La scène se passe dans les jardins du Château Bellevue, à Berlin.
Angelica von Mecklemburg et Nicoletto de Neuillycity se sont discrètement éclipsés de la réception offerte par le roi de Prusse.
On entend, au loin, les accents du quatuor de Joseph Haydn.
Nicoletto :
Madame, l'heure est grave : alors que Berlin danse
Athènes est en émoi et Lisbonne est en transes.
Voyez la verte Erin, voyez l'Estrémadoure
Entendez les Romains : ils appellent au secours !
Ils scrutent l'horizon, et implorent les Dieux.
Tous les coffres sont vides, et les peuples anxieux
Attendent de vous, madame, le geste généreux !
De leur accablement ils m'ont fait l'interprète :
Leur destin est scellé, à moins qu'on ne leur prête
Cet argent des Allemands sur lesquels vous régnez.
Cette cause est bien rude, mais laissez moi plaider...
Angelica :
Taisez-vous Nicolas ! Je crois qu'il y a méprise
Folle étais-je de croire à une douce surprise
En vous suivant ici seule et sans équipage
Je m'attendais, c'est sûr, à bien d'autres hommages !
Mais je dois déchanter, et comme c'est humiliant
De n'être courtisée que pour son seul argent !
Nicoletto :
Madame, les temps sont durs, et votre cœur est grand
Vos attraits sont troublants, mais il n'est point décent
D'entrer en badinage quand notre maison brûle !
Le monde nous regarde, craignons le ridicule !
Notre Europe est malade, et vous seule pouvez
La soigner, la guérir et, qui sait ? La sauver !
Nous sommes aujourd'hui tout au bord de l'abîme
Vous n'y êtes pour rien, mais soyez magnanime !
Les Grecs ont trop triché ? Alors la belle affaire !
Qu'on les châtie un peu, mais votre main de fer
Est cruelle aux Hellènes, et nous frappe d'effroi !
Angelica :
J'entends partout gronder, en Saxe, Bade ou Bavière
L'ouvrier mécontent, le patron en colère.
Ma richesse est la leur, ils ont bien travaillé.
L'or du Rhin, c'est leur sueur et leur habileté.
Et vous me demandez, avec fougue et passion
De jeter cette fortune au pied du Parthénon ?
Ce serait trop facile et ma réponse est non !
Nicoletto :
On ne se grandit pas en affamant la Grèce
En oubliant Platon, Sophocle et Périclès !
Nos anciens nous regardent, et nous font le grief
D'être des épiciers et non pas de vrais chefs !
Helmut Kohl est furieux et Giscard désespère.
Un seul geste suffit, et demain à Bruxelles
Desserrez, je vous prie, le nœud de l'escarcelle !
Angelica :
Brisons là, je vous prie, la nuit est encore belle
Votre éloquence est grande et mon âme chancelle...
> Mais si je disais oui à toutes vos demandes
Je comblerais la femme, et trahirais l'Allemande !
(Ils s'éloignent, chacun de leur côté)
|
|
|
LES ANNALES ALGERIENNES
De E. Pellissier de Reynaud (octobre 1854)
Envoyé par Robert
|
|
LIVRE VII
Administration du général Berthezène. - M. Bondurand intendant en chef. - Aperçu des actes de l'administration militaire. - Administration civile. - Acquisitions des Européens. - Essais de culture. - Analyse de divers actes administratifs.
Administration du général Berthezène
Le corps d'occupation dont le général Berthezène vint prendre le commandement était formé des 16e, 20e, 21e, 28e et 50e régiments de ligne, des zouaves, des chasseurs algériens, de deux escadrons du 12e régiment de chasseurs, plus un certain nombre de batteries d'artillerie et de compagnies du génie. Il y avait, en outre, une masse assez informe de volontaires parisiens, qui s'accroissait chaque jour. Elle se composait d'hommes dont plusieurs avaient pris une part active à la révolution de juillet, et dont le nouveau Gouvernement s'était hâté de se débarrasser en les envoyant en Afrique aussitôt qu'ils n'en avaient plus eu besoin. On travaillait alors à les organiser plus régulièrement; ils formèrent plus tard le 67e de ligne. La plupart n'étaient liés au service par aucun engagement légal, et s'étaient laissés conduire à Alger, trompés par les promesses de ceux qui avaient intérêt à les éloigner de Paris. On s'est plu à dire beaucoup de mal de ces hommes, qui cependant, dans toutes circonstances, se conduisirent avec bravoure et dont plusieurs rendirent de vrais services au pays comme ouvriers d'art. En général, les officiers étaient ce qu'il y avait de pire dans cette foule presque tous avaient usurpé ce titre; ou du moins pris des grades plus élevés que ceux qu'ils avaient réellement; mais on fit bientôt les épurations convenables.
Toutes ces troupes étaient divisées en trois brigades, commandées par les maréchaux de camp Buchet, Feuchère et Brossard ; le général Danlion commandait la place d'Alger. Le général Berthezène avait pour chef d'état-major le colonel Leroy Duverger. M. Bondurand avait été nommé intendant du corps d'occupation, en remplacement de M. Voilant, qui était rentré en France.
Dès son début à Alger, le général Berthezène se montra homme d'intérieur et de calculs personnels. Il parut ne voir dans sa position qu'une occasion de faire des économies sur un traitement assez considérable, qu'il était du reste incapable d'augmenter par de coupables moyens.
M. Bondurand intendant en chef.
M. Bondurand, le nouvel intendant, et, par son importance administrative, le second personnage du corps d'occupation et de l'Algérie, était un fonctionnaire recommandable à bien des égards, mais ce n'était point un homme d'une grande portée. L'administration militaire, qu'il dirigea pendant longtemps avec un certain ordre matériel, ne donna jamais sous lui, et, osons le dire, longtemps encore après lui (ce qui du reste l'excuse peut-être), que de tristes preuves de son impuissance.
L'armée recevait les vivres de campagne, c'est-à-dire le pain, la viande, les légumes, le sel et le vin. Les marchés pour toutes ces denrées se passaient en France, excepté pour la viande, et quelquefois pour les grains. L'administration de l'armée d'Afrique n'y était donc pour rien : elle recevait seulement les envois et en constatait la qualité. Mais les troupes eurent souvent à se plaindre de la facilité de ces réceptions : des denrées évidemment avariées et quelquefois malsaines furent mises en distribution, sans qu'il y eût urgence, c'est-à-dire impossibilité de faire autrement. La correspondance de l'état-major constate qu'à diverses époques, surtout à celles du renouvellement des généraux, des réclamations, je pourrais même dire des reproches très graves, furent adressés à l'intendance à cet égard. Les soldats, accoutumés à juger trop légèrement peut-être ceux qui sont chargés de les nourrir, ont pu, d'après cela, accuser certains membres de l'administration d'une complaisance intéressée envers les fournisseurs.
Quant à la viande, le mode de fourniture a souvent varié : tantôt le service s'est fait par entreprise, et tantôt par régie ; enfin on s'arrêta à la fourniture faite par les comptables eux-mêmes, moyennant un abonnement réglé sur les mercuriales. Avec plus d'activité et de zèle pour la chose publique, on aurait pu avoir un troupeau qui, bien conduit et se multipliant tant par son croit que par des achats faits en temps opportun, aurait procuré à l'armée de bonne viande, moins conteuse que celle qu'on lui a presque toujours distribuée. Au lieu de cela, chaque comptable eut auprès de lui quelques bêtes étiques, qu'il ne nourrissait pas et qu'il faisait abattre quelques heures avant le moment où elles devaient nécessairement mourir d'inanition. Mais ce n'était encore rien : nos boucheries militaires étaient si mal approvisionnées, même de mauvaise viande, par les moyens employés par l'administration, qu'à la moindre baisse dans les arrivages des Arabes on était obligé de diminuer la ration, et qu'il arriva même quelquefois que la viande manqua complètement.
Les comptables, qui avaient un intérêt personnel à acheter bon marché, ne se pourvoyaient que de mauvaises bêtes souvent malades, ou de bêtes volées, qu'ils avaient par cela même à bon compte; de sorte que notre administration militaire, non contente de mal nourrir nos soldats, donnait des primes d'encouragement pour le vol aux Arabes eux-mêmes. Le chef du bureau arabe, pour avoir soutenu avec chaleur les droits de propriétaires indigènes et européens, qui avaient reconnu du bétail à eux appartenant dans le troupeau d'un comptable, se vit, en 1835, accusé par l'administration de nuire à l'approvisionnement de l'armée, parce qu'il voulait que ce bétail fût rendu. Voilà donc une administration qui avouait que le recèlement était mis par elle au nombre des moyens employés pour nourrir l'armée dans un pays où nous avions la prétention d'introduire la civilisation et de faire cesser le brigandage !
Aperçu des actes de l'administration militaire.
Dans tout cela, l'administration militaire n'était pas seule coupable : les généraux en chef auraient dû sans doute s'occuper eux-mêmes des besoins de l'armée et des moyens de les satisfaire ; il est même évident que, sans leur participation, l'établissement d'un troupeau général, d'un véritable troupeau, avec croît et produit, comme en avait le gouvernement du Dey, était impossible; mais, enfin, il était du devoir de l'intendant en chef de prendre l'initiative de la proposition, et je répugne à croire que les secours militaires eussent manqué à un établissement utile.
Parmi les actes de M. Bondurand, il en est un qui ne mérite que des éloges : ce fut l'établissement d'un hôpital d'instruction à Alger. Les cours en étaient faits par les officiers de santé de l'armée, parmi lesquels se trouvaient des hommes très distingués. Je citerai, entre autres, l'habile opérateur Baudens, dont la réputation est devenue depuis européenne.
Administration civile.
M. le général Berthezène était hors d'état de donner à l'administration militaire l'impulsion qu'elle ne pouvait recevoir de son chef direct. Il en fut de même dans l'administration civile, et ici la mollesse du général en chef, résultat naturel de son indifférence pour tout ce qui ne se rapportait pas exclusivement à lui, était augmentée de ce qu'une extrême méfiance de lui-même avait mis dans son âme de circonspection et d'incertitude. Quoique son esprit ne fût point empiétement dépourvu de lumières acquises, il était peu en état de traiter des questions administratives d'un ordre élevé. Il devait donc être facilement réduit au silence par ceux que leur position avait familiarisés avec la phraséologie administrative, et prendre enfin l'habitude de leur céder sans discussion, mais non sans rancune, car l'homme élevé en dignité pardonne difficilement à ceux qui le mettent trop souvent dans la dure nécessité de s'avouer son impuissance.
Au reste, presque tous nos généraux de cette époque étaient, à cet égard, dans la même position que le général Berthezène. Quel que fût l'éclat de leur vie passée, quel pie fût le mérite de leurs services, bien peu d'entre eux avaient la généralité de connaissances et l'amour du travail nécessaire pour donner à l'administration d'un pays quelconque une impulsion ferme et régulière. L'expérience a prouvé que de tels hommes sont disposés, ou à ne tenir aucun compte des observations et des avis de leurs chefs de service, et par conséquent à agir avec ignorance et brutalité, ou à les laisser opérer sans contrôle, chacun dans sa sphère, ce qui détruit l'harmonie des actes administratifs. Chaque chef de service ne voit et ne doit voir que sa spécialité : Ies considérations prises en dehors du cercle dans lequel il se meut n'en sont pas pour lui: de sorte que, s'il n'existe pas au sommet de la hiérarchie administrative un homme capable de tenir dans ses mains tous les fils sans les confondre, il n'y a ni direction ni but commun. L'administration des finances ne prend à tâche que d'augmenter les recettes, sans considérer si des mesures trop fiscales ne nuisent pas à la prospérité du pays; celle des travaux publics ne voit que les constructions qui peuvent flatter l'amour-propre de ses membres sous le rapport de l'art, et ne s'enquiert pas si des constructions moins coûteuses et plus faciles ne conviendraient pas mieux à l'actualité, et ainsi du reste.
Depuis 1851, l'état-major général s'est renouvelé; mais, à cette époque, la composition en était telle qu'un gouverneur de l'Algérie ne pouvait être pris que parmi des hommes dont les uns étaient usés par l'âge, et dont les autres appartenaient à une génération à laquelle les bienfaits de la haute instruction ont complètement manqué. Or, il est bien rare qu'un homme soit assez heureusement constitué pour que sa conduite dans les affaires publiques ne se ressente pas plus ou moins de ce qui manque à la culture de son esprit.
M. Berthezène était arrivé à Alger avec des préventions fâcheuses contre la plupart des fonctionnaires qu'avait employés son prédécesseur : c'est ce qui s'est vu à chaque changement de gouverneur. Le dernier venu s'est toujours imaginé que les fautes qui lui avaient été signalés ou qu'il avait découvertes lui-même tenaient exclusivement au personnel administratif, et qu'en changeant quelques employés, tout serait dit. Cependant, si un fonctionnaire s'égare, il vaut mieux le remettre dans la bonne voie que de le remplacer par un homme nouveau, qui, dans un pays d'étude et d'essai comme l'Algérie, aura son éducation de localité à faire, ce qui n'est pas peu de chose. II est vrai que, pour mettre un homme sur la voie, il faudrait savoir soi-même où l'on veut aller.
Parmi ceux à qui le général Berthezène en voulait le plus était M. Fougeroux, inspecteur des finances, avec lequel il eut d'assez vives altercations. Ce fonctionnaire était un personnage trop pénétré de son importance, et qui mit plusieurs fois à l'épreuve la patience du général en chef. Celui-ci obtint son rappel. M. Williaume le remplaça comme inspecteur des finances et comme membre du comité du Gouvernement, qui prit le 1er juin la qualification de commission administrative; M. le sous-intendant militaire de Guirroie en était le secrétaire depuis quelques mois. Il avait remplacé M. Caze.
M. Girardin, directeur du domaine, étant rentré en France par congé, M. le contrôleur Bernadet prit le service par intérim.
M. Rolland de Bussy quitta les fonctions de commissaire général de police. Elles furent données au grand prévôt Mandiri, déjà agha des Arabes.
Tous ces arrangements terminés, chaque chef de service se mit à faire de l'administration pour son compte, sans trop s'embarrasser de l'ensemble. Les projets d'arrêtés étaient soumis pour la forme au général en chef, et la machine allait comme elle pouvait.
Le général Berthezène était arrivé au gouvernement de d'Algérie avec des dispositions d'esprit assez favorables aux indigènes ; malheureusement, les effets de sa bienveillance pour eux se concentrèrent sur quelques Maures intrigants, tels que Bouderbah et sa coterie. Cet homme adroit et insinuant se fit adjuger, à lui ou aux siens, la ferme du marché au blé (la Racheba), celle de presque tous les autres marchés où se perçoivent des droits, et tous les fondouks. Il commença alors à jouer un rôle important parmi les Musulmans, qui jusqu'alors l'avaient méprisé, comme un homme sans moralité, dont le nom avait plus d'une fois retenti devant les tribunaux. Il paraîtrait que ce fut à cette époque que les notabilités maures d'Alger se mirent à rêver une restauration musulmane faite à leur profit. Il y a même lieu de croire que des communications semi-officielles, venues de très haut, leur firent penser que la chose était possible, et que la France elle-même, fatiguée de sa conquête, y donnerait les mains.
Le 24 mai, M. le général Berthezène décréta qu'une première indemnité, équivalente à six mois de loyer, serait payée aux propriétaires dépossédés pour cause d'utilité publique. Ce fut tout ce que reçurent les malheureux indigènes dépouillés par l'administration française. Comme la masse s'en accroissait chaque jour, on put bientôt évaluer à 190.000 francs de rente les indemnités qui leur étaient dues. On conçoit tout ce qu'une pareille somme, enlevée annuellement à quelques centaines de familles, peu aisées pour la plupart, dut y laisser en échange de misère et de désespoir. Cependant personne ne voulut pénétrer dans le secret de tant de douleurs : de pauvres enfants tendaient la main au coin des rues aux humiliants secours de l'aumône; de malheureuses jeunes filles, destinées naguère à la chasteté du nœud conjugal, étaient livrées par la faim à la prostitution ; et nul ne s'enquérait de la cause de ces souffrances. Des commissaires que le Gouvernement envoya en Algérie en 1855 pour examiner la situation du pays s'aperçurent cependant qu'il y avait des injustices à réparer : l'un d'eux nomma à la tribune nationale une victime de notre administration. Mais quelle était cette victime ? Un Européen qui, après avoir acheté pour 800 francs de rente une vaste ferme (Ben-Achsoun) dans les environs d'Alger, se vit dépouiller des bâtiments de cette ferme que l'on fut forcé de lui prendre pour loger une partie de notre cavalerie, mais dont on lui paya 2,000 francs de loyer. Voilà l'horrible infortune qui émut la philanthropie de l'orateur en question ! Cependant, en allant dans les bals et les soirées où il puisait ses observations, cet orateur avait pu voir, à la porte des hôtels où il entrait, des douzaines d'enfants à qui notre civilisation n'avait donné, en échange de la boutique ou de l'atelier de leurs pères, que la sellette du décrotteur.
C'est au Gouvernement lui-même, à la France, représentée par ses Chambres, que doit s'adresser le reproche de dureté et de mauvaise foi envers les indigènes dépossédés. Nous avons vu que le général Clauzel avait décrété que les immeubles du domaine serviraient de gage à leurs créances; mais quelques commis du ministre de la guerre trouvèrent que cette manière de procéder sortait des règles communes, ce qui était vrai, et qu'il n'y avait aucun rapport entre les propriétés du domaine et les créances sur l'Etat, ce qui, dans l'espèce, était faux. Car voici la question réduite à sa plus simple expression : le Gouvernement français s'impatronise à Alger, mais il ne connaît encore que vaguement ce qui lui appartient comme propriétaire : or, dans cet état de choses, des motifs plus ou moins fondés d'utilité publique exigent la démolition d'une maison : cette maison se trouve appartenir au domaine ; c'est bien, voilà une maison de moins pour le domaine, et il n'en est plus question. Un peu plus loin existe une seconde maison dont la démolition est également rendue nécessaire ; mais celle-ci appartient à un particulier qui réclame, et vous dit : Peu loin de ma maison, dans telle rue, le beylick en possède une de même valeur que la mienne : donnez-la-moi, et je vous tiens quitte. M. Clauzel prévint cette demande, et y répondit d'avance par l'arrêté du 26 octobre dont le ministre de la guerre arrêta l'exécution. Ce ministre assuma donc la responsabilité des injustices commises envers les propriétaires dépossédés. Si l'on eût laissé faire l'autorité algérienne, les indemnités auraient été payées. Jusqu'à l'arrivée de M. Pichon, le budget des dépenses civiles fut réglé sur les recettes locales, et il est indubitable que l'indemnité aurait continué à y figurer. Lorsque le ministre voulut faire rentrer Alger dans le droit commun financier, il aurait dû ne pas avoir deux poids et deux mesures, et ne pas laisser les indigènes dans l'exception, lorsqu'elle leur était désavantageuse, en même temps qu'il les en faisait sortir en ce qu'elle avait de profitable pour eux. C'est cependant ce qui a eu lieu : car si, d'un côté, la législation financière ne permettait pas, en s'appliquant à la rigueur, de laisser subsister les dispositions de l'arrêté du 26 octobre
1850, de l'autre, notre loi fondamentale défendait de dépouiller un propriétaire sans une juste et préalable indemnité. Malgré cette violation des lois de l'équité et de la logique, il ne faut pas croire que l'on fût, dans les bureaux, ennemi systématique des Maures : bien au contraire; par une inexplicable contradiction, les mêmes hommes qui causaient la ruine de tant de familles musulmanes accueillaient avec empressement tous les intrigants qui leur arrivaient d'Alger. Ils les comblaient de faveurs, de décorations et de pensions; heureux quand ils ne s'en servaient pas peur créer des embarras à l'administration locale !
La question de l'indemnité touche de près à celle du séquestre. Nous avons dit que M. le général Clauzel avait ordonné la réunion au domaine de tous les biens des Turcs déportés. Cette confiscation fut convertie en séquestre par un arrêté du 10 juin 1851, rendu d'après une décision ministérielle du 27 mai. Les dispositions de cet arrêté ayant été souvent appliquées, soit par erreur, soit par fausse interprétation, à des Turcs non déportés, il y eut quelques levées de séquestre parti elles. Elles furent d'abord prononcées par la commission administrative, mais le ministre se les réserva ensuite. Ainsi, des Turcs de la garnison de Mostaganem, qui étaient à notre service, ne purent rentrer dans leurs biens qu'en vertu d'une décision ministérielle, quoique le séquestre qui les avait atteints fût évidemment le résultat d'une erreur non susceptible de discussion. Cette obligation de recourir à Paris, pour des choses aussi simples, diminuait aux yeux des indigènes l'importance de celui qui commandait à Alger, ce qui était un grand mal ; le pouvoir a besoin d'y être fort et d'y jouir d'une indépendance au moins apparente.
Acquisitions des Européens.
Cependant les Européens que l'espérance avait conduits en Afrique y faisaient chaque jour des acquisitions. Le 21 juin, un arrêté soumit à l'obligation de l'enregistrement tous les actes translatifs de propriété et de jouissance. Le 21 juillet suivant, le droit d'enregistrement fut fixé à 9. pour 100 pour les actes d'aliénation définitive ou de cession de jouissance pour cinquante ans et au-dessus. Il fut réduit d'un centième par chaque année pour les cessions de jouissance de moins de cinquante ans.
Il y a des choses fort curieuses à dire sur les acquisitions des Européens en Afrique, et cette matière mérite que nous nous y arrêtions quelques instants.
Plusieurs familles musulmanes chez lesquelles les préjugés religieux étaient fortement enracinés, ne voulant pas vivre sous la domination chrétienne, prirent le parti, dans les premiers mois qui suivirent la conquête, de s'éloigner d'Alger, et d'aller s'établir, soit dans le Levant, soit dans les villes de l'intérieur de la Régence. Elles cherchèrent, avant de partir, à réaliser leurs fortunes ; mais les Musulmans qui restaient à Alger n'étaient pas dans des circonstances à faire des achats d'immeubles, et les Européens qui étaient venus s'y établir avaient plus de désirs que de moyens de devenir propriétaires. La plupart ne pouvaient disposer que de faibles capitaux ; et ensuite, quand même ils en auraient eu de plus considérables, l'avenir du pays n'était pas assez assuré pour que des acquisitions pussent se faire par les moyens ordinaires, c'est-à-dire par l'échange d'un immeuble contre une somme quelconque d'écus, car nous pouvions, d'un moment à l'autre, évacuer Alger, et les nouveaux acquéreurs se seraient vus forcés d'abandonner leurs immeubles, sans la moindre lueur d'espérance de rentrer dans leurs capitaux. Cependant, comme, d'un côté, il y avait désir d'acheter et de l'autre besoin de vendre, on finit par s'entendre ; les aliénations furent faites au moyen de rentes perpétuelles. Ce mode de transaction garantissait à l'acheteur, qu'en cas d'évacuation, il ne perdrait jamais que quelques annuités, et laissait entrevoir au vendeur la possibilité de rentrer dans sa propriété.
Les rentes furent en général calculées au plus bas, relativement à la valeur que nous sommes habitués à donner aux propriétés foncières, de sorte que les Européens furent éblouis de la facilité avec laquelle on pouvait devenir propriétaire à Alger.
Une fois que cette manière assez commode d'acquérir fut établie, ce fut à qui deviendrait propriétaire. On avait commencé par acheter aux émigrants, mais bientôt on acheta de toutes mains. L'occupation militaire s'étendait sur un grand nombre de maisons dans l'intérieur de la ville; à l'extérieur, les dévastations et les maraudes de nos soldats, tristes fruits d'une discipline extrêmement relâchée, rendaient presque impossible l'exploitation des propriétés rurales de la banlieue d'Alger. Les indigènes, voyant donc qu'ils ne pouvaient tirer aucun profit de leurs propriétés, soit rurales, soit urbaines, se mirent à les vendre aux Européens à des conditions qui se ressentaient du discrédit dans lequel elles étaient tombées; ceux-ci les achetèrent, parce qu'elles étaient à vil prix, et qu'ils espéraient qu'une fois dans leurs mains ils parviendraient à les faire respecter. Mais il en fut presque toujours autrement : à l'exception de quelques sommités coloniales, qui obtinrent des indemnités pour le mal qu'on leur avait fait, et des garanties pour l'avenir, précisément parce qu'elles étaient plus en position que d'autres de supporter des pertes, à l'exception, dis-je, de ces sommités, les propriétaires européens ne furent pas mieux traités que les indigènes. On peut même dire que la dévastation et la maraude s'attachèrent plus particulièrement à leurs possessions; car, comme il était de notoriété qu'ils avaient fait valoir ces éventualités de pertes, pour acheter à bon compte et profiter des malheurs des indigènes, les soldats semblaient prendre à tâche de tourner la chance contre eux. Les chefs eux-mêmes mirent plus de négligence à faire respecter la propriété, lorsqu'ils surent que les pertes ne devaient plus tomber que sur des hommes qui les avaient fait entrer en ligne de compte dans leurs transactions avec les naturels. Les militaires disaient ouvertement qu'ils ne prétendaient pas avoir conquis le pays pour enrichir des spéculateurs. Ceux-ci, tout fiers de leur nouvelle qualité de propriétaires, poussaient souvent leurs prétentions jusqu`à l'injustice, et auraient voulu chasser l'armée de toutes les maisons qu'elle occupait. De là, des récriminations passionnées de part et d'autre, et les épithètes injurieuses de banqueroutiers et de Vandales qu'échangeaient deux classes d'hommes destinés à concourir au même but.
Mais il est bon de remarquer que plus d'un militaire se mit dans la catégorie de ce qu'on appelait les banqueroutiers, et plus d'un spéculateur dans celle des Vandales. En effet, plusieurs officiers achetèrent des maisons et des terres, et ne déployèrent pas dans leurs transactions plus de scrupules que les spéculateurs de profession: tandis qu'un grand nombre de ceux-ci se mirent à dévaster leurs propres possessions, coupant les arbres, enlevant les boiseries, les marbres et les ferrements des maisons, enfin tout ce qui était enlevable; après avoir réalisé, de cette manière, quelques milliers de francs, ils se laissaient exproprier par leurs vendeurs maures pour faute de paiement de la rente qu'ils avaient consentie.
A ces moyens peu délicats d'acquérir de l'argent et des immeubles, quelques Européens en ajoutèrent d'autres tout à fait criminels : des manœuvres frauduleuses eurent lieu, pour faire croire à des propriétaires indigènes qu'ils allaient être expropriés par l'administration, et qu'ils n'avaient d'autres moyens de ne pas tout perdre que de se hâter de vendre à quelque prix que ce fût.
Les indigènes, à qui nous donnions l'exemple de la déloyauté dans les transactions, ne tardèrent pas à nous imiter. Lorsque toutes les propriétés du Fhas eurent été à peu près vendues, Ies achats firent irruption dans la plaine : on commença d'abord par traiter avec des Maures, propriétaires de fermes dans la Métidja ; puis les Arabes se mirent aussi à vendre leurs terres, trouvant qu'il était très avantageux de se faire payer une rente d'un immeuble dont rien n'empêchait l'ancien propriétaire de continuer à jouir paisiblement; car toutes ces acquisitions s'étendant bien au-delà de nos lignes, les Européens ne pouvaient pour le moment songer à en prendre possession; mais on travaillait pour l'avenir, et dans l'espérance de voir arriver le jour où l'on cesserait de n'être propriétaire que de nom. Une fois parvenues sur ce terrain, les ventes ne furent souvent plus que des fictions où la cupide crédulité de l'acheteur était la dupe de la friponnerie du vendeur. Les Européens étaient tellement possédés du désir d'acquérir une parcelle du sol africain qu'ils achetaient tout ce qu'on venait leur offrir, non seulement sans voir l'immeuble, ce qui, du reste, était presque toujours impossible, mais en outre sur des titres faux ou altérés, et souvent sur un simple certificat de notoriété établi d'après la déclaration de sept témoins inconnus eux-mêmes.
C'est de celte manière que les mêmes propriétés ont été vendues en même temps à diverses personnes, que les Européens ont tellement été trompés sur les contenances, que si celles qui figurent dans leurs contrats de vente étaient exactes, ils se trouveraient avoir déjà acheté dix fois la superficie de la Métidja, et qu'enfin on a même acheté des terrains qui n'ont jamais existé. Les Arabes se sont fait un jeu de tromper la cupidité des Européens, et ceux-ci s'y sont prêtés avec la plus étrange crédulité. On a vu, à Alger, des hommes qui se sont imaginés avoir acheté, pour quelques centaines de francs de rente, deux à trois mille hectares d'excellente terre, bien complantée et bien arrosée, même des villages entiers. Mais, malgré de nombreuses déceptions, il est incontestable que beaucoup d'Européens acquirent dès les premiers temps de l'occupation, et à des titres sérieux, une partie notable du territoire de la province d'Alger. Cet accaparement de la propriété foncière fut un grand mal et une grande imprévoyance de la part du Gouvernement : car presque tous les Européens de ces premiers temps, n'achetant que pour spéculer, devaient rendre nécessairement la colonisation plus difficile en rendant le prix des terres plus élevé pour les vrais travailleurs et en créant une foule d'embarras à l'administration. On s'est repenti plus tard de cette énorme faute, que j'avais signalée dès 1856, lors de la première publication des Annales algériennes.
Essais de culture.
Il est juste de dire que, même dès le principe, quelques Européens achetèrent pour exploiter, et que, dès le printemps de 1851, ils se mirent à l'œuvre. Le docteur Chevrau, excellent homme, dont la colonie eut trop tût à pleurer la perte, MM. Faugeroux frères, Roche et Colombon se livraient à des essais de culture que le succès paraissait devoir couronner. Ces derniers avaient même établi des travailleurs européens dans une ferme acquise par eux à Beni-Mouça, à une lieue et demie de la Ferme-Modèle. Ces exemples étaient imités dans les environs d'Alger ; mais lorsque l'on vit qu'en dehors de nos lignes la guerre venait détruire ce que le travail tendait à créer, et qu'à l'intérieur les produits agricoles étaient souvent la proie de ceux qui devaient les défendre, les exploitations languirent, et on se livra, en attendant des temps meilleurs, au brocantage des terres, exemple fatal, bientôt suivi par une foule de gens qui en firent un métier, sans avoir jamais eu la moindre velléité, de culture.
Le Gouvernement, cause première de cette déviation de l'activité coloniale, ne fit rien pour en arrêter les conséquences. Il établit un droit d'enregistrement, et s'applaudit sans doute d'avoir ainsi augmenté ses recettes de quelques milliers de francs. Cependant les achats des Européens avaient, sous le point de vue politique, des inconvénients pour le moins aussi graves que pour la colonisation : les Arabes qui nous vendaient des propriétés éloignées le faisaient presque toujours avec l'espérance, assez ouvertement avouée, que nous ne viendrions jamais les occuper, et qu'ils continueraient à en jouir; de sorte que chaque achat d'immeubles fait par les Européens, sur !es points où nous n'avions pas encore d'établissements, créait à l'occupation future une famille d'ennemis de plus. Ainsi, de toute manière, il aurait été à désirer que tout achat d'immeubles eût été interdit aux Européens en dehors de nos lignes. Je crois même qu'il aurait été sage et prudent de rendre, dans le principe, cette prohibition absolue, et d'attendre de savoir ce qu'on ferait de l'Algérie pour permettre aux Européens d'y devenir propriétaires.
Analyse de divers actes administratifs.
Cent quinze arrêtés furent signés par le général Berthezène, dont quarante-cinq formaient législation, cinquante sur des objets transitoires, et vingt portant nomination à des emplois. Dans ce nombre, les dispositions fiscales jouent un très grand rôle.
Le 20 mars, un droit d'octroi, pour les objets de consommation apportés de l'intérieur, fut établi : le tarif réglé à cette époque fut modifié par arrêté du 50 juillet.
Le 21 mars, un droit de 80 boudjous par mois (148 fr. 80 cent.) fut mis sur la boucherie juive, pour tenir lieu du droit de patente.
Le 11 juillet, ainsi que nous l'avons vu plus haut, les actes translatifs de propriété ou de jouissance furent assujettis à un droit d'enregistrement. Le même jour, le commerce du sel fut déclaré libre ; mais les introductions, par terre et par mer, furent frappées d'un droit de 3 francs par quintal métrique pour les sels français, et de 4 francs pour les sels étrangers. Les sels ne furent point admis à l'entrepôt accordé pour d'autres marchandises par l'arrêté du 51 décembre 1830; mais le receveur des douanes fut autorisé à recevoir en paiement, sous sa responsabilité personnelle et moyennant caution, des traites à trois mois de date, pour une moitié, et à six mois pour l'autre moitié des droits acquis au trésor.
Le 28 juillet, un arrêté modifia quelques dispositions du tarif des douanes. Il fixa à 10 francs par tête le droit d'exportation des bœufs et vaches; à 12 francs par quintal métrique le droit sur la cire exportée sous pavillon étranger, et à 8 francs celui de la cire exportée sous pavillon français.
Il existe quelques autres dispositions financières de l'administration de M. Berthezène, mais elles ne sont que d'un intérêt secondaire.
Pour ce qui est des domaines, le général Berthezène introduisit dans cette administration un principe dont l'expérience a démontré l'opportunité : ce fut la séparation du domaine militaire d'avec le domaine civil. Par arrêté du 26 novembre 1811, tous les immeubles appartenant au domaine, et affectés soit au casernement des troupes et au logement des officiers, soit aux magasins de l'artillerie, à ceux du génie et à ceux de l'administration militaire, furent concédés au génie militaire qui fut chargé de leur réparation et de leur entretien. Cette mesure prévint la ruine totale des immeubles occupés par les troupes, qui étaient encore debout à l'époque où elle fut prise. Il est difficile de se faire une idée du désordre qui avait existé jusqu'alors dans l'occupation militaire. A l'extérieur, les troupes s'étaient établies dans les maisons de campagne qui étaient à leur convenance, sans remise régulière, sans état des lieux ; en un mot, sans aucune des formalités qui devaient en assurer la conservation. A l'intérieur de la ville, lorsqu'on devait y établir des troupes et des officiers, on s'adressait au commissaire du roi près de la municipalité, qui, sans étudier les localités, donnait mission à un de ses agents de livrer les maisons. Celui-ci parcourait la ville, frappait à la première maison venue, et si on ne lui répondait pas, parce que la maison était abandonnée, soit par suite des émigrations, soit par l'absence momentanée des propriétaires, il faisait enfoncer la porte, et livrait ce local à l'occupation militaire, sans autre formalité. On conçoit que cette manière de procéder devait conduire immanquablement à la perte de tous les immeubles affectés au casernement, puisque personne n'était responsable de leurs dégradations, ni chargé de leur entretien. L'arrêté du 26 novembre mit un terme à ces abus.
Le général Berthezène avait déjà diminué en partie les inconvénients de l'occupation militaire par la construction des casernes de Mustapha-Pacha, situées hors la ville, au-delà du faubourg Bab-Azoun. Cet édifice, dont le plan avait été fait sous le maréchal Clauzel, est une agglomération de bâtiments en pisé, à un seul étage, à toiture à terrasse à la manière du pays, et disposés parallèlement comme les baraques d'un camp. Il peut contenir 2,000 hommes. Les travaux commencèrent au mois de mars et furent terminés au mois d'octobre. Cet édifice, peu brillant, mais extrêmement utile, fait honneur à l'administration du général Berthezène.
D'autres travaux non moins utiles furent exécutés à cette époque. La jetée qui joint le rocher de la Marine au continent et forme le port d'Alger, était tellement endommagée du côté de la darse de l'ouest, que l'existence des vastes magasins qui y sont situés était menacée. Elle fut réparée, avec autant d'habileté que de promptitude, par M. Noël, ingénieur, chargé spécialement de cette mission. Un abattoir fut construit hors de la porte Bab-Azoun, par entreprise et sous la direction de la municipalité. M. Melchior, maître maçon, qui en fut tout à la fois l'entrepreneur et l'architecte, y déploya des talents et surtout une louable probité, qui le recommandèrent à la confiance publique et lui valurent plus tard des avantages réels honorablement acquis.
Avant notre arrivée à Alger, il n'existait pas dans cette ville de place, de forum proprement dit. Les marchés se tenaient sous des portiques, ce qui certainement était beaucoup plus commode, vu la chaleur du climat. Cependant, comme nos habitudes exigent une place, et qu'ensuite on désirait avoir un lieu de ralliement pour la garnison, on commença, sous l'administration de M. de Bourmont, à agrandir, parla démolition des maisons voisines, le petit espace quadrangulaire qui se trouvait au centre de la ville, en face de l'entrée principale du vieux palais de la Djenina. Ce fut l'origine de la place du Gouvernement. M. le général Berthezène alloua au génie militaire (il n'était pas encore question à cette époque des ponts et chaussées) une somme de 20,000 fr. pour les premiers travaux de cette place; elle fut employée à la consolidation et aux réparations des beaux magasins voûtés qui sont en dessous.
Il nous reste, pour terminer ce que nous avions à dire de l'administration civile de M. Berthezène, à parler de ses actes relatifs à la municipalité, à l'agriculture, au commerce et à la police.
M. Cadet Devaux avait fait entrer dans ses prévisions la nécessité d'une forte réserve en grains. Il en acheta 10,000 mesures, qu'il laissa tellement avarier par faute de soins, qu'il fallut les jeter ou les vendre à vil prix. Cette réserve fut alors fixée à 4,000 mesures, et ce fut le fermier de la Racheba (C'est le fermier du marché aux grains : il avait le privilège d'interdire la vente des grains ailleurs que dans les marchés, et recevait un droit pour chaque mesure vendue. Il payait au Gouvernement une redevance de 25,000 fr. pour ce privilège.) qui dut la fournir; mais il ne l'eut jamais.
Le 21 juin, un arrêté fixa à un an la durée des fonctions du chef de la nation juive, et régla qu'il serait nommé par le général en chef, sur une liste de trois candidats présentés par les notables Hébreux. Ce même arrêté mit auprès du chef de la nation juive un conseil composé de trois membres également nommés par le général en chef, sur une liste triple de candidats.
Le 4 septembre, un arrêté, prenant en considération les dévastations qui se commettaient dans les environs d'Alger, et qui devaient détruire toute végétation, défendit la coupe des arbres et mit en vigueur les dispositions forestières des lois françaises.
Le 15 juillet, l'introduction des céréales fut affranchie de tout droit. Lorsque cet arrêté fut promulgué, nous étions bloqués dans nos lignes par les Arabes ; c'était après la funeste retraite de Médéa, dont nous parlerons dans le livre suivant, et l'on ne recevait plus rien de l'intérieur.
Le 24 mars, le port d'armes fut interdit à tous les Arabes de l'arrondissement d'Alger, sous peine de mort, sauf à ceux qui auraient une autorisation des kaïds ou des cheiks. Les délinquants durent être traduits devant l'autorité prévôtale. Cet arrêté est un non-sens continuel, car M. Berthezène n'avait aucun moyen de le mettre à exécution. Ensuite, qu'était-ce que l'autorité prévôtale pour l'administration de la justice, après l'arrêté constitutif du 22 octobre qui n'en parlait pas ?
Le 9 juin, parut un arrêté qui soumit à des formalités très gênantes le commerce des métaux, et autres matières propres à la confection des armes, et prescrivit de nouvelles dispositions pour les débits de poudre qui, comme nous le savons déjà, n'existaient pas.
Le 1er août, un arrêté, rendu sous l'impression de la retraite de Médéa, prononça la peine de mort contre tout indigène qui ne ferait pas la déclaration des armes et des munitions qu'il aurait chez lui.
Le commerce des fers et aciers fut rendu à la liberté le 7 septembre.
M. le général Berthezène prit encore sur l'administration de la justice quelques dispositions que nous allons faire connaître.
L'arrêté du 22 octobre 1830 ne disait pas devant qui seraient portés les appels des jugements correctionnels. Il était évident que, dans l'esprit du législateur, ce devait être devant la cour de justice; mais enfin, il fallait l'exprimer, c'est ce que fit un arrêté du 9 juin.
Le 20 juin, une commission fut créée pour la révision des arrêtés rendus sur la justice, mais cette mesure n'eut aucun résultat.
M. le général Berthezène, dans le cours de son administration, rendit quelques arrêtés confirmatifs ou infirmatifs de jugements prononcés par le cadi, ce qui prouve qu'il était établi alors que le général en chef pouvait recevoir les appels en révision. Je signale ce fait, parce que, plus tard, une question de cette nature amena un conflit fâcheux entre les deux premières autorités de l'Algérie.
A SUIVRE
|
|
PHOTOS
Anciennes de BÔNE
Envoyé par M. Norbert
|
Vu générale de l'hopital civil de Bône
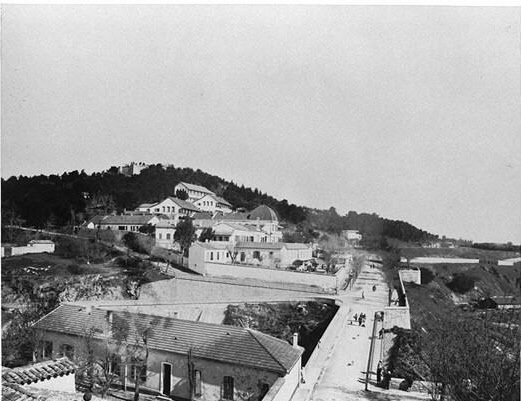
Le draguage du port de Bône

Un Torpilleur à quai

La grue au travail

Le pont sur la Seybouse

|
|
Cent Cinquantième Anniversaire
de la Révolution Française
14 juillet 1939, avant la mobilisation de septembre
envoyé par M. Charles Ciantar
|
Coupures de Presse : Dossier réalisé par NADAL Adolphe
Directeur d’école natif d’AUMALE
Remis par son fils NADAL Francis Ophtalmologue à Toulouse
(A la retraite actuellement)
ciantar.charles@wanadoo.fr
|
|
| HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DU COMMERCE FRANÇAIS
DANS L'AFRIQUE BARBARESQUE
(1560-1793) (N°11)
|
|
(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)
PAR Paul MASSON (1903)
Professeur d'Histoire et de Géographie économique
à l'université D'Aix-Marseille.
TROISIÈME PARTIE
LA PAIX AVEC LES BARBARESQUES
ET SES PREMIERS RÉSULTATS (1690-1740)
CHAPITRE IX
LES DERNIÈRES COMPAGNIES DU BASTION
ET DU CAP NÈGRE
(1690-1706)
En 1690, le règne de Louis XIV touchait à son déclin ; les nécessités des dernières guerres, l'épuisement de plus en plus grand du trésor, l'insuffisance de la marine, trop faible déjà pour lutter contre celle des Anglais et des Hollandais et pour défendre nos colonies, firent abandonner définitivement les projets, chers à Colbert et à Seignelay, de destruction des Barbaresques. Il ne pouvait plus être question de croisades ; la France avait trop d'ennemis; aussi, tandis que l'alliance avec les Turcs était resserrée, les Pontchartrain ne cherchèrent qu'à maintenir la paix avec les Barbaresques. Il fallut, pour cela, changer de dispositions et d'attitude ; se montrer conciliant et patient, fermer les yeux souvent sur les infractions multiples que les reïs faisaient toujours aux traités, ou bien demander satisfaction sans aigreur et se contenter de demi-réparations. Enfin, il était nécessaire de distribuer fréquemment des présents pour se ménager l'amitié des puissances. Il faut dire que, malgré les difficultés de la situation politique, la France garda toujours sa dignité mieux que les autres puissances. Les lamentations continuelles de nos consuls, qui se plaignaient qu'on les laissait désarmés contre les intrigues de leurs collègues Anglais et Hollandais, maures de distribuer l'argent à pleines mains pour ruiner notre influence et tourner les Barbaresques contre nous, montrent que notre gouvernement ne croyait pas devoir acheter trop cher la neutralité de ceux-ci.
En effet, malgré les revers de la France, malgré cette parcimonie aussi nécessaire que voulue, nos ennemis ne parvinrent jamais à décider les Barbaresques à rompre avec nous. C'est que les bombardements de Duquesne et de d'Estrées n'avaient pas été complètement inutiles; les Puissances n'oubliaient pas, à Alger et à Tunis, qu'en quelques jours les vaisseaux du roi pouvaient paraître dans la rade pour demander réparation d'une injure. On ne négligea rien, d'ailleurs, pour leur rappeler souvent ce voisinage et, , à la fin du règne de Louis XIV, il ne se passait presque pas d'année sans que des officiers du roi vinssent montrer leur pavillon. D'un autre côté, les Barbaresques étaient sortis très affaiblis de leurs luttes du XVIIe siècle. Alger, seule, restait puissante ; cependant " les grands corsaires étaient tombés tour à tour sous le canon des croisières et sous les coups des chevaliers de Malte ; les armateurs s'étaient dégoûtés d'une spéculation devenue trop hasardeuse " ; les deys durent se charger eux-s de créer une marine de guerre. Tout ce qui faisait la force d'Alger diminuait : l'armée et la marine, la milice et les reïs ; les renégats, qui se distinguaient par leur esprit d'aventure et leur énergie, avaient à peu près disparu au début du XVIIIe siècle. "
Ainsi, pour la première fois depuis bien longtemps, la paix dura entre les Français et les Barbaresques. C'était une paix peu honorable pour eux, une paix bien fragile, mais elle devait être très profitable au développement de leurs établissements et de leur commerce. Les derniers ministres de Louis XIV l'avaient maintenue par nécessité ; plus tard, on en apprécia les bienfaits et la politique pacifique, inaugurée par Pontchartrain en 1690, reconnue définitivement la plus utile, fut poursuivie par tous ses successeurs, jusqu'à la Révolution.
Grâce au maintien des relations pacifiques avec Alger, les Concessions d'Afrique changèrent de caractère. Jusqu'ici, on avait vu la plupart des gouverneurs du Bastion devoir leur situation à la faveur du dey et du divan. Sanson Napollon, Cocquiel, Picquel, Arnaud, Dusault, s'étaient fait d'abord reconnaître, par les Algériens, concessionnaires du Bastion, puis avaient obtenu une commission du roi et constitué une compagnie. Ainsi, les Concessions ne semblaient pas avoir été données à la France, mais paraissaient une faveur personnelle, faite à des Français qui avaient rendu des services, notamment dans la négociation des traités de paix. Les gouverneurs semblaient dépendre plus des Puissances d'Alger que des ministres du roi, et s'inquiétaient plus de ménager leur faveur auprès du divan qu'à la cour ; on avait vu Arnaud se maintenir un Bastion avec l'appui du dey, malgré toutes les réclamations de Colbert.
Le gouvernement français avait, d'ailleurs, su profiter souvent de l'influence personnelle dont jouissaient à Alger les gouverneurs du Bastion ; il les avait chargés parfois de missions diplomatiques, d'aider ou de suppléer nos consuls et nos négociateurs; Dusault s'était distingué dans ce rôle. Guillaume Marcel, le négociateur du traité de 1689, reçut encore du dey la concession du Bastion, mais c'était déjà un officier du roi; il n'avait sans doute agi que d'après les instructions du ministre. Après lui, les directeurs de la Calle, nouveau centre de nos établissements, furent toujours désignés uniquement par le gouvernement royal ou par les compagnies; le divan d'Alger ne prit aucune part à leur désignation et ne s'intéressa guère à leur personne. Dès lors, les Concessions furent bien françaises et ne dépendirent plus que du roi. En même temps, les directeurs de la Calle, n'ayant pas d'influence particulière à Alger, ne furent plus investis de missions diplomatiques. Ils restèrent de simples marchands, étrangers à la politique. La Primaudaie avait déjà, en partie, remarqué ce changement : " Si cette seconde phase de l'existence des Concessions, dit-il avec raison, ne fut pas la plus brillante, elle fut du moins la plus heureuse. "
Guillaume Marcel, après avoir obtenu la concession du Bastion, était venu en France former une compagnie. Il fit, en 1690, un nouveau voyage à Alger et signa, le 5 mai, la convention ordinaire qui fixait les conditions accordées à toute compagnie nouvelle. On y voit que les établissements français étaient fort délabrés et presque abandonnés ; mais c'était une formule employée déjà, en 1679, et répétée plus tard, en 1694. Les Algériens autorisaient toutes les constructions et réparations nécessaires et, en considération de ces dépenses, déchargeaient la compagnie de toutes redevances ou lismes pendant deux ans. Dans l'ensemble, cette convention reproduisait les précédentes et se référait souvent aux usages du temps de Sanson Napollon.
Marcel était alors au mieux avec les Algériens ; le dey l'appelait son bon et son tendre ami. Le divan écrivait à Louis XIV que Marcel, par son habileté à négocier, avait ouvert la porte de la paix qui était fermée. " Nous pouvons vous assurer, ajoutait-il, que si vous eussiez envoyé tout autre de vos serviteurs, même avec cérémonie, fut-ce un de vos premiers ministres, il n'aurait jamais pu parvenir à faire la paix avec nous. " Mais le jeune protégé de l'intendant de la marine, de Vauvré, qui l'avait désigné à Seignelay pour remplir sa mission, ne jouit pas longtemps de sa faveur. L'ambassadeur envoyé par les Algériens à Paris, à la suite de la paix, ne fut pas satisfait de l'accueil qu'il reçut en France et s'en prit à Marcel qui l'avait accompagné. Marcel n'était plus le tendre ami du dey qui écrivait à Pontchartrain, à la fin de 1691 : " Nous savons de bonne part que le nommé Marcel a été cause que toutes nos affaires sont demeurées et qu'il a trompé le ministre, M. de Seignelay(1). "
Heureusement que Dusault avait alors reconquis la faveur des Puissances(2) ; on l'envoya à Alger pour consolider la paix, régler les échanges d'esclaves, et en même temps pour s'occuper du rétablissement du Bastion(3). Marcel ne put donc former la nouvelle Compagnie du Bastion et Pontchartrain dut se résoudre à reconstituer l'ancienne, toujours en liquidation. Un arrêt du 17 mars 1691 ordonna que, dans la huitaine de sa signification pour tout délai, " Hugues Mathé de Vitry-la-Ville ou ayans cause, les héritiers et créanciers de feu Jacques Durand, Jacques Rebuty, Dusault et de Gumery, à présent seuls intéressés au commerce du Bastion, " s'assembleraient pour convenir des sommes qui étaient .à fournir. " Et n'y ayant entre lesdits intéressés que ledit du Sault et Ferdinand de Gumery qui se fussent trouvés en état de se transporter, tant au Bastion qu'à Marseille, et qui fussent capables de faire ledit rétablissement et régir ledit commerce pour l'avantage d'icelui, " tous deux furent chargés de la direction.
Les circonstances paraissaient alors très favorables pour la Compagnie. Les débuts de la guerre de la Ligue d'Augsbourg avaient causé une hausse considérable des blés en Provence. On commençait à sentir les effets des longues guerres et de la lourdeur des impôts. Bien avant l'enquête des intendants de 1697, la culture des céréales était abandonnée et beaucoup de terres laissées en friche. Aussi, l'approvisionnement de la France en blé devint l'une des plus grandes préoccupations de l'administration royale, à la fin du règne de Louis XIV.
En 1692, la Compagnie traita avec le ministre pour la fourniture des grains nécessaires à l'armée de Catinat, qui opérait sur la frontière des Alpes, avec un bénéfice de 40 sols par charge. Pour la première fois, le gouvernement était intéressé directement aux opérations de la Compagnie du Bastion. Aussi, Pontchartrain s'inquiétait beaucoup de leur succès et écrivait à la Chambre de Commerce de Marseille, pour qu'elle aida le directeur, de Gumery, à les faire réussir ; c'était là un rôle tout nouveau pour elle .
Cependant, la situation de la Compagnie était peu brillante en 1693, telle que l'expose le préambule de l'arrêt du Conseil du 17 août :
" Le roi, étant informé que la Compagnie des intéressés au commerce du Bastion de France a négligé, depuis très longtemps, de faire les fonds nécessaires pour la continuation de ce commerce, soit à cause de la mort de quelques-uns d'entre eux ou de l'impuissance et de la mésintelligence des autres, et que les bâtiments et établissements dans les places qui en dépendent, dans le royaume d'Alger, sont entièrement détruits et la traite des blés absolument abandonnée... ordonne que, dans quinzaine du jour de la signification du présent arrêt... lesdits intéressés... seront tenus, chacun a proportion de leur intérêt, de faire les fonds nécessaires pour le rétablissement du commerce jusqu'à la concurrence de la somme de 300.000 livres. "
Il est vrai que cet arrêt était le résultat des manoeuvres de Dusault, pour amener la fusion de la Compagnie du Bastion avec celle du cap Nègre qui, mieux que sa rivale, avait su profiter de la disette des blés en France. Celle-ci même, grâce à la faveur du gouvernement et surtout à l'appui de M. de Vauvré, intendant de la marine à Toulon, très écouté de Seignelay, avait fait nommer consul à Tunis, a la fin de 1689, le directeur de son comptoir, Sorhainde. C'était sacrifier aux intérêts de la Compagnie ceux des marchands français établis à Tunis, mais cette mesure était bien conforme à la politique générale de Seignelay, tout à fait prévenu en faveur des compagnies les consuls du Levant n'étaient, en effet, au thème moment, que des agents de sa compagnie de la Méditerranée.
D'un autre côté, les dispositions du dey étaient alors excellentes : à diverses reprises, il s'était adressé au roi pour obtenir l'assistance de nos vaisseaux : en 1686, il avait besoin d'assurer son autorité : en 1692, il craignait une descente des Tripolitains sur ses côtes : en 1693, il fut menacé par les Algériens. En retour des secours qu'il sollicitait, le bey parlait de concéder de nouveaux avantages au cap Nègre et de nous abandonner Tabarque.
Jusqu'en 1691, cependant, la Compagnie Gautier n'avait fait que des pertes, par suite de circonstances défavorables. Ce n'est qu'au début de cette année là qu'elle avait pu reprendre l'exploitation régulière du cap Nègre, abandonné à cause de la guerre d'Alger. Elle avait subi une grande déception, par suite de l'insuccès complet de la pêche du corail, qu'elle avait dû abandonner, et elle avait été obligée de s'attacher exclusivement à la traite des blés. Puis, au moment où le commerce reprenait, la peste força la Compagnie d'abandonner de nouveau le comptoir pendant quelque temps, dans l'été de 1691, et lui causa pour 50.000 livres de frais imprévus(4).
Mais, à partir de l'automne de 1691, l'exploitation du comptoir devint active et fructueuse. Pontchartrain ne cessait de presser la Compagnie d'acheter le plus de blés qu'elle pourrait et celle-ci même s'empressait de le satisfaire, car elle réalisait des bénéfices considérables. Dans le seul mois de septembre 1691, elle expédia, sur six bâtiments, plus de 20.000 charges de blé. Pour assurer son trafic, le ministre ordonnait au commissaire de la marine de lui laisser le nombre de matelots dont elle aurait besoin pour faire naviguer ses bâtiments, tandis que les simples armateurs en étaient privés par suite des besoins de la marine royale; cette même faveur lui fut renouvelée, en 1692 et en 1693(5).
Un document, publié par Plantet, nous donne une idée des bénéfices que la traite des blés pouvait donner à la compagnie. Elle pourrait expédier à Marseille 150.000 charges(6) de blé, estimées 1.200.000 livres(7). Sur quoi il fallait déduire 450.000 livres pour l'achat, 162.000 livres pour le transport, à 3 livres par charge de nolis et pour les frais, et 34.000 livres pour les redevances et cadeaux aux Puissances et aux indigènes du cap Nègre, au total 646.000 livres. Par suite, la compagnie pouvait espérer un bénéfice annuel sur les blés de 554.000 livres. La bonne situation de la Compagnie nous est confirmée par une lettre du consul Sorhainde que Pontchartrain, à la suite de la réforme des consulats de 1690, mit en demeure d'opter entre ses fonctions de consul et ses intérêts dans la compagnie, car les consuls ne devaient faire dorénavant aucun commerce.
" J'espère, répondait-il au ministre, le 26 janvier 1692, que vous aurez la bonté de me permettre d'opter et que... Il vous plaira agréer que je subsiste intéressé dans l'affaire du cap Nègre, dont ayant essuyé les fatigues et ma part des contretemps dont elle a été traversée, pendant les quatre premières années de son établissement, il serait doublement rude pour moi d'être obligé à m'en arracher, dans un temps que la Compagnie travaille avec quelque succès, et que le petit intérêt que j'y ai peut produire de quoi me consoler de mes pertes et peines passées. "
En cette occasion, la Compagnie éprouva encore une fois, d'une façon signalée, la protection du gouvernement car, malgré les plaintes des marchands français de Tunis contre Sorhainde, qui l'accusaient d'avoir fait un traité secret avec le bey, pour accaparer tous les blés de la régence, celui-ci resta consul et reçut la permission de " continuer l'intérêt qu'il avait dans la Compagnie ", en étant averti qu'on aurait une attention toute particulière à sa conduite. Ce fut là une dérogation unique au principe qui avait présidé à la réorganisation des consulats du Levant et de Barbarie.
Il est vrai que les attaches avec le gouvernement étaient souvent gênantes : la Compagnie n'était pas libre dans son négoce. Le ministre la requérait parfois de vendre tous ses blés au roi, à des conditions qu'il fixait lui-même.
L'intention de S. M., écrivait Pontchartrain aux intéressés, le 15 octobre 1692, est que vous lui donniez par préférence tous les blés qui vous viendront du cap Nègre et d'Italie, en vous les pavant au prix dont vous conviendrez, ou au moins sur le pied de 10 sols, par charge, de meilleur marché que le prix-courant. Les secours que vous lui donnerez, et ceux que j'attends de vous pour la Provence, sont des moyens sûrs de vous attirer la protection du roi. " Le 23 avril 1693, le ministre écrivait encore : " L'intention de S. M. est que vous continuiez de faire venir en Provence tous les blés que vous pourrez tirer du cap Nègre, tant pour la fourniture que vous êtes obligés de livrer au munitionnaire, que pour la consommation du peuple, jusqu'à ce qu'elle vous permette d'en vendre pour les pays étrangers. "
En 1693, la Compagnie du cap Nègre consolida sa situation, en faisant négocier à Tunis le renouvellement de sa concession, aux conditions stipulées dans le traité de 1685. En vain, les Génois " dans le chagrin d'avoir les Français pour voisins tirent des mouvements extraordinaires pour tâcher de réunir le cap Nègre à Tabarque, comme il était ci-devant. " Les Anglais essayèrent aussi d'empêcher la réussite de la négociation et d'obtenir le cap Nègre pour eux ; ils offrirent jusqu'à 10.000 piastres par an, tandis que, par le traité de 1685, les Français n'étaient obligés qu'au paiement de 8.333 piastres. Sorhainde triompha de leurs intrigues, mais il dut promettre 1.700 piastres d'augmentation sur les redevances annuelles. En cette occasion, les résidents français de Tunis avaient uni leurs efforts à ceux des Anglais et des Génois, dans l'espoir d'être débarrassés du monopole et de la concurrence de la Compagnie. " Nos marchands français, écrivait Sorhainde, qui sont tous des Provençaux et des Languedociens, n'ont pas hésité un moment à prendre publiquement le parti de nos ennemis. "
C'est dans ces circonstances que Dusault crut habile de réunir, en une seule, les deux compagnies et de persuader à Pontchartrain d'approuver sa combinaison. Les deux compagnies tireraient meilleur parti des conjonctures favorables et la concurrence, qui profitait alors à celle du cap Nègre, serait supprimée. De plus, Dusault espérait sans doute avoir la haute main sur toutes les concessions d'Afrique ; c'était précisément le moment où il cherchait à mettre ses parents dans les consulats d'Alger et de Tripoli : tout le commerce de la Barbarie allait être sous sa dépendance. L'union des deux compagnies rencontra de l'opposition. Le Bartz, munitionnaire général, envoya au contrôleur général, Pontchartrain, des observations fort justes :
Les deux cents mille charges de blé que les deux compagnies pouvaient tirer d'Afrique, sans compter ce qu'elles achetaient à Ancône et qu'elles mélangeaient aux blés durs, formaient un commerce annuel de 3.000.000 livres, à l'aide duquel elles étaient sûres de dominer tout le marché, d'exclure les autres négociants, en sacrifiant au besoin 15 ou 20.000 livres, pour produire une baisse et, enfin, d'accaparer sous main tous les blés, ou de n'en faire venir qu'une quantité suffisante pour maintenir les prix. C'est ainsi que les blés, achetés ailleurs pour Lyon, n'avaient coûté que 15 livres, tandis que les deux Compagnies, depuis leur union, avaient mis les leurs à 18 et les poussaient jusqu'à 20 livres.
" Vous pouvez aisément, ajoutait-il, faire deux ou trois compagnies de celle du Bastion... Chacun défrichera son terrain et il est certain qu'on retirera de cette côte, une fois plus de marchandises que l'on n'a fait par le passé. Ainsi, les blés se trouveront séparés en différentes mains ; les uns se trouveront plus pressés de vendre que les autres et le public en sera mieux et les blés ne manqueront pas ici et n'y seront jamais chers...(8). "
Ces objections ne furent pas écoutées ; une série d'arrêts du conseil, en août et septembre 1693, transférèrent à la Compagnie du cap Nègre la propriété du Bastion. Un certain nombre d'anciens intéressés dans la Compagnie du Bastion entrèrent dans la nouvelle. D'après l'arrêt du conseil du 18 septembre, ils devaient fournir 120.000 livres, sur un capital total de 300.000 livres(9).
Mais, cette fusion de 1693 reste très obscure à expliquer. Il se forma, à la fin de 1693, une Compagnie pour l'exploitation du Bastion, ayant à sa tête Pierre Hély, dont la forme était curieuse elle comprenait 9 intéressés principaux, 3 de Paris, 3 de Bayonne, le pays de Dusault, et 3 de Marseille. Son fonds, de 300.000 livres aussi, était constitué par 120.000 livres d'apport de l'ancienne Compagnie du Bastion et, pour remplacer les 180.000 fournis, lors de la fusion, par les intéressés du cap Nègre, Pierre Dusault, bourgeois de Paris, devait donner 105.000 livres, Jacquier frères et Denis Dusault 75.000(10).
Peut-être y eut-il successivement deux combinaisons, l'une dont on avait cherché à écarter Dusault, à la tête de laquelle auraient été Ferdinand de Gumery et Jacques Rebuty, ses anciens associés, l'autre dans laquelle il entra avec Pierre Hély et ses nouveaux associés. L'union des deux compagnies ne semble donc avoir été faite qu'à la suite d'intrigues compliquées. D'un autre côté, il parait certain qu'elle ne fut pas complète. Tout en ayant des intérêts communs et surtout un accord complet pour la vente des blés à Marseille, il semble qu'elles continuèrent séparément l'exploitation du Bastion et du cap Nègre(11). Enfin, la concorde fut loin de régner entre les nouveaux associés, si l'un en juge par le conflit qui éclata, en 1695, entre Dusault et les anciens associés du cap Nègre Charpentier, Michel, Robineau et Simon. Ceux-ci portèrent contre lui des accusations très graves et le traitèrent catégoriquement de scélérat(12).
L'un des premiers actes de la nouvelle Compagnie fut de signer, suivant l'usage, une convention avec le dey, divan et milice d'Alger, pour l'exploitation du Bastion. Ce contrat, du 1er janvier 1694, a une importance toute particulière, car il fut le dernier, négocié et conclu, entre une Compagnie et les Algériens. Dans la suite, on se contenta toujours de le renouveler à l'avènement de chaque dey, généralement sans aucune modification jusqu'en 1754, seulement, il n'y eut pas moins de 14 confirmations.
Le divan déclarait Pierre Hély et sa Compagnie, nommés et avoués par l'Empereur de France pour la pêche du corail et autres négoces, propriétaires incommutables desdites places du Bastion de France, la Calle, cap de Rose, Bonne et autres places en dépendant, excluant dès à présent et à toujours, toutes autres personnes d'y prétendre, ni d'y faire aucun commerce, sans aveu ni permission expresse (art. 1).
Et, attendu que ledit Bastion, la Calle et cap de Rose, sont fort délabrés et abandonnés, il lui sera permis de les réparer et remettre en leur premier état et de prendre sur les lieux tout ce qui lui sera nécessaire pour cela ; et, attendu qu'un moulin à vent ne suffit pas pour faire les farines nécessaires à la subsistance des places parce que les vents tic terre manquent souvent, nous permettons à ladite compagnie de faire bâtir un moulin sur chacun des monts dudit Bastion et de la Calle, lesquels elle fera enceindre d'une muraille pour empêcher les insultes que les Maures du pays y pourraient faire (art. 3).
Il est permis audit Hely de faire pécher le corail au Bastion, la Calle, cap de Rose, Bonne, le Collo, Gigeri et Bugie, sans qu'on puisse lui donner aucun empêchement, mais il lui sera donné aide, assistance, et fourni les vivres et autres choses dont il aura besoin, en le payant au prix courant (art. 7).
Il est permis audit Hely d'envoyer, tous les deux ans, deux barques en cette ville pour y faire négoce, lesquelles il pourra ensuite envoyer charger au Bastion et à la Calle ou autres lieux de la côte, sans qu'on puisse le contraindre de prendre des cuirs, ni des cires des fondouks, ni autres marchandises contre sa volonté (art. 10).
Un article spécial concernait le commerce de Bône, la principale place de commerce des Concessions : Il ne sera payé audit Bonne aucun droit d'entrée, ni de sortie. Défendons à tous les habitants de vendre à d'autres qu'audit Hely, cires, cuirs, laines, suifs, ni autres marchandises, non plus que les cuirs des agas, des zouavy, qu'il paiera comme du temps de Sanson, ni les cuirs tannés qui resteront après la provision de ladite ville à peine de confiscation, au profit de notre douane; ses bateaux pourront charger des courcoussous et autres provisions pour les habitants des places; pourra y tenir un prêtre pour y dire la sainte messe ainsi qu'au Bastion, la Calle et le cap de Rose, changer ses agents, commis, et généralement faire toute chose comme du temps de Sanson (art. 6).
Le caïd du Collo prendra, pour tout droit, 10 % sur l'argent que ledit Hely enverra audit lieu pour acheter les cires et les cuirs dépendant du bey de Constantine, moyennant quoi est expressément défendu au caïd de prendre aucun autre droit, et à tous les marchands qui apporteront vendre des cires, de les falsifier, ni les vendre, non plus que les cuirs et autres marchandises, à aucun Maure, ni chrétien, mais seulement audit Hely (art. 8).
On retrouvait l'article ordinaire, tant de fois inséré vainement dans les traités: Que si par malheur il arrivait quelque différend qui causât rupture de paix avec l'empereur de France, ce que Dieu ne veuille, ledit Hely ne sera point inquiété, ni recherché dans son établissement, n'entendant point mêler.... les affaires d'état avec le négoce qui s'introduit et s'exerce de bonne foi : mais seront ledit Hely et ses commis, comme nos fermiers et nos bons amis, maintenus en paisible possession et jouissance dudit Bastion et places dépendantes, attendu le grand avantage qu'il en revient à la paie des soldats et à tous les habitants de ce royaume (art. 9).
Les autres articles spécifiaient les redevances et lismes dues par la Compagnie : Moyennant lesdites permissions et privilèges que nous accordons audit Hely, nous défendons à tout autre d'aller dans lesdites places sans son consentement, à la charge qu'il paiera à notre divan 34.000 doubles d'or par chaque année en six paiements égaux qui se feront de 2 mois en 2 mois (art. 11). Ainsi les Algériens, respectueux des traditions, ne songeaient pas à demander des redevances plus élevées que celles qui avaient été stipulées en 1640. C'était aussi d'après les anciens usages qu'étaient fixées les sommes à payer aux chefs indigènes et aux officiers turcs commandant dans les Concessions : Il sera payé à l'aga de Bonne 3000 pataques par an en six paiements égaux ; toutes reconnaissances aux chefs seront payées comme du temps du sieur Sanson, cessantes toutes les introductions faites depuis et ne pourra ledit aga, caïd, ni autre, aller audit Bastion sans l'ordre exprès du divan d'Alger (art. 5).
Un article additionnel, ajouté le 3 janvier, stipulait que les dettes des sieurs Piquet, Arnaud, Latour, Talo Lafontaine, Berthelot, Rebuty, Dusault et ses associés, et généralement toutes celles qui auraient pu être faites depuis que le Bastion et autres places avaient été données aux Français, étaient abolies(13).
Le traité de 1694, qui réglait d'une manière définitive les rapports entre les Algériens et les Français du Bastion, était très avantageux. On y remarque, entre autres, l'insistance des divers articles pour assurer à la compagnie le monopole du commerce dans ses Concessions. Mais, en somme, il ne renfermait pas d'innovation importante et rappelait expressément, à plusieurs reprises, les coutumes du temps de Sanson Napollon. Il faut remarquer que les Français n'y obtenaient pas la libre exportation des grains, accordée par les Tunisiens à la Compagnie du cap Nègre, dès 1685(14). Le dey Chaban montra, par ses actes, qu'il était disposé à faire respecter le traité qu'il venait de signer. La Compagnie ayant eu à se plaindre d'un caïd de Bône, Chaban n'hésita pas à écrire au bey de Constantine de lui envoyer cet officier, pieds et poings liés, pour recevoir son châtiment.
La Compagnie donna toute son attention à la traite des blés, pour suffire aux demandes des munitionnaires de l'armée du roi en Italie et de la marine, en même temps qu'aux besoins de la Provence. Du 2 novembre 1693 au 15 juillet 1695, elle expédia 86 bâtiments au Bastion(15). Cependant, la fusion des deux anciennes compagnies n'eut pas tout le succès qu'en attendait le ministre. La suppression de la concurrence supprima l'émulation et la traite des blés fut plutôt moins active qu'auparavant. Pontchartrain ne cessait de gourmander la compagnie au sujet de l'insuffisance de ses envois.
En 1700, des accusations plus graves furent portées à la cour contre elle ; elle aurait employé des manoeuvres coupables pour faire hausser le prix des blés qu'elle vendait. L'intendant Lebret écrivit à ce sujet, au contrôleur général, une curieuse lettre où il la justifiait.
" Il serait à désirer, disait-il, que le commerce des blés fût sous la direction de deux différentes compagnies et on n'en a permis l'union, sur le pied qu'elle est maintenant, que parce que le soin que je pris pendant plusieurs années d'en former une à Marseille pour se charger du Bastion de France, différente de celle qui était déjà en possession du cap Nègre, fut entièrement inutile. Cependant, je dois vous dire que tous les faits mentionnés dans la lettre anonyme que j'ai l'honneur de vous renvoyer... sont faux ou outrés. Car, quoiqu'on m'ait porté des plaintes en différentes circonstances, et surtout dans le temps de la cherté des blés, de ce que les intéressés à la Compagnie du cap Nègre et du Bastion envoyaient des particuliers dans les marchés de la province, lesquels, sous prétexte de faire des achats, de grosses quantités de blés, les enchérissaient considérablement, tous les soins que j'ai pris pour pénétrer la vérité de ces sortes de plaintes... ne m'ont rien fait découvrir de semblable. En effet, on sera persuadé que les soins des intéressés à cette compagnie ont été très utiles au public, lorsqu'on saura qu'en moins de dix années, et surtout dans les temps de disette, ils ont fait entrer dans le royaume plus de 1,600,000 charges de blés étrangers. Tout ce que l'on pourrait leur reprocher est que, dans les temps qu'ils diminuaient de prix à Marseille, ces intéressés diminuaient à proportion la quantité qu'ils auraient dû y faire, entrer... jusqu'à ce qu'ils fussent remontés ici au prix qu'ils avaient décidé de les vendre ; à quoi il n'était pas possible de remédier que par les deux différentes compagnies, que je n'ai pu jamais former... Ce qu'il y a de vrai, est que les blés sont présentement à si bon marché par toute la province, qu'il n'est pas à désirer qu'ils diminuent beaucoup de prix, ayant remarqué que, quand ils se vendent depuis 15 jusqu'à 18 livres la charge, tout le monde y trouve son compte. "
Chamillard parait avoir été moins favorable à la Compagnie que Pontchartrain et plus accessible aux attaques dirigées contre elle. On fit valoir auprès de lui que l'achat des blés de Barbarie faisait sortir beaucoup d'argent du royaume ; les États du Languedoc se plaignaient, au même moment, de la difficulté de vendre les blés de la province. La Compagnie fut menacée. en 1700, de l'interdiction d'introduire des blés dans le royaume. L'un des directeurs, Charles, alla voir le ministre pour détourner le coup, sans pouvoir le persuader. Il lui écrivait, le 27 août 1700 :
" J'ai réfléchi à ce que V. G. me fit l'honneur de me dire dimanche dernier, au sujet du commerce des blés que fait la Compagnie du cap Nègre et Bastion de France dans le royaume. Premièrement, il n'y a aucun royaume ni État dans le monde qui défende l'entrée des blés ; au contraire, il y en a peu qui accordent la sortie et pas un sans en tirer rétribution ou droits de sortie. Lorsque la Compagnie ne fera point venir des blés, il faut en amène temps qu'on défende ce commerce à tous les négociants, même aux étrangers, d'en pouvoir porter : sans quoi V. G. ruinerait notre Compagnie pour les enchérir et ferait en même temps sortir élu royaume le double de l'argent qui en sort par la Compagnie(16)... Il vient de sortir plus de 80 ou 100 bâtiments des côtes de Provence pour aller acheter des blés... En quelque endroit que ces bâtiments chargent, les blés leur coûtent plus d'argent qu'ils ne coûtent à notre Compagnie et pas un ne fait ce commerce qu'avec de l'argent comptant. Vous me direz peut-être que notre Compagnie gagne beaucoup ; j'ose l'assurer hardiment que, depuis la paix, à peine a-t-elle gagné l'intérêt de ses fonds de 10 %. Nos places nous tiennent lieu de 8 ou 900.000 livres qu'elles nous ont coûté à bâtir, dont il n'est pas sorti un sol du royaume.... Nous avons dans nos colonies plus de 600 Français... Il faut que nous commencions à gagner 400.000 livres par an, pour nous empêcher de perdre, et si nous faisons outre cela quelque bénéfice, le tout reste dans l'État.
Je prendrai encore la liberté de vous représenter que, si notre Compagnie avait eu depuis dix ans la liberté de vendre du blé, soit pour l'Italie, le Portugal ou l'Espagne, elle aurait fait entrer tous les ans quatre fois plus d'argent dans le royaume qu'elle n'en a fait sortir et qu'arrivant une disette en Espagne, on tirera dans un an plus de piastres que nous n'en consommons dans six. Et pourvu qu'on nous laisse la liberté de faire notre commerce dans les lieux qui nous seront le plus avantageux, notre Compagnie, au lieu de faire sortir de l'argent du royaume, y en fera rentrer considérablement... Malheureusement, le royaume n'est pas encore en état qu'on se récrie contre l'abondance des blés et Messieurs des États du Languedoc, qui se plaignent de ne pouvoir pas débiter les leurs, ne s'engageraient pas de fournir du pain bis aux pauvres à 18 deniers la livre. S'il est à ce prix présentement en Languedoc, que ne vaudrait-il pas en Provence sans le secours du cap Nègre, puisque cette province, dans les années les plus abondantes, n'en recueille pas pour se nourrir les deux tiers de l'année. "
Tandis que la Compagnie avait eu à défendre ses privilèges à la cour, nos revers maritimes, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, avaient rendu la situation difficile pour elle à Alger et à Tunis.
Les Anglais avaient essayé de profiter de leurs succès sur mer pour supplanter les Français à Alger. En 1699, l'amiral Almers était venu avec une forte escadre ; il avait distribué quantité d'armes, de munitions de guerre et de présents pour signer un nouveau traité de paix et obtenir de nouveaux avantages commerciaux ; mais le dey Baba Hassan nous était très favorable et le consul Durand avait réussi à faire échouer, en partie, les démarches de nos rivaux. Cependant, Durand se plaignait ensuite qu'on le laissait désarmé devant les brigues de l'ennemi qui prodiguait les présents et cherchait à se faire donner Collo. Si les Anglais ne purent rien entreprendre sur les Concessions françaises, ils réussirent du moins à atteindre le commerce de la Compagnie, dont le monopole n'était pas respecté. , les situations avaient été renversées : moyennant une largesse de 1400 barils de poudre faite au divan, le consul d'Angleterre avait obtenu le monopole de l'achat des blés auprès de certaines tribus.
D'un autre côté, la Compagnie n'avait pu maintenir longtemps son exploitation du cap Nègre dans la situation prospère où elle se trouvait en 1692-94. Elle avait eu à se défendre, en 1695, contre les intrigues des Génois de Tabarque et des Anglais. Les Génois, profitant d'un service rendu au bey, lui avaient surpris une permission de faire des constructions au cap Nègre, et se hâtèrent de faire travailler en diligence à l'achèvement de deux magasins. Ils tenaient beaucoup à pouvoir faire la traite des blés, parce qu'ils avaient fait des propositions aux Anglais pour en fournir leur armée navale et au duc de Savoie pour alimenter ses troupes. Mais le gouverneur de Tabarque eut la mortification de voir tous ses plans détruits par la rétractation du bey et par les ordres qu'y donna aux Tabarcains " de démolir les murailles qui se trouvaient élevées et de se renicher dans leur île avec défense de s'étendre ailleurs et en remettant les choses dans leur premier état. " En vain les Génois essayaient d'éluder l'exécution des ordres du bey.
" Les trémoussements de ces insulaires et leurs faux-fuyants, écrivait Sorhainde, n'ont servi qu'à augmenter leur mortification et leur honte, puisque j'obtins de ce bey qu'il enverrait un agha avec 50 spahis sur le lieu, pour faire démolir en sa présence les bâtiments jusqu'aux fondements, pour faire assembler les cheiks des nations et leur signifier les défenses très sévères de son maître de n'y plus porter leurs denrées et pour aller ensuite dans l'île annoncer au gouverneur qu'il eût à s'y tenir sans prétendre de faire aucun autre établissement sous aucun prétexte. L'officier s'est parfaitement bien acquitté de sa commission. "
Le consul français eut plus de mal à triompher de l'attaque du consul anglais qui offrait au bey pour le cap Nègre des redevances considérables et des conditions tort avantageuses. Mais le bey recula devant la perspective d'une rupture avec la France.
" Ces réflexions, écrivait Sorhainde à Pontchartrain, ont prévalu sur son esprit, en sorte qu'avant renvoyé l'Anglais tout confus, il m'a donné sa parole de ne plus jamais prêter l'oreille à aucune nouvelle proposition, qu'il reconnaissait de bonne foi qu'aucune nation que la française ne pouvait occuper cette place. "
D'ailleurs, le consul anglais ne se tenait pas pour battu et " se vantait qu'il ferait tous ses efforts pour lâcher de rentrer dans la possession du cap Nègre dont les Français l'avaient chassé. "
Cependant, cette année-là, la Compagnie avait fait une traite abondante de blés ; pendant l'été de 1695, elle en fournit pour 263.664 livres au munitionnaire des vivres de la marine. Mais son trafic fut gêné, en 1696 et en 1697, par le peu d'abondance des récoltes et par les croisières ennemies, bien que Pontchartrain fit des efforts pour faire paraître les vaisseaux du roi sur les côtes de Barbarie et éloigner les corsaires. " Voilà deux années de suite, écrivait Sorhainde, qui ne sont pas heureuses pour le cap Nègre, car, si la dernière n'a produit aucun profit à la Compagnie, celle-ci, sans doute, ne lui produira pas de quoi payer les charges de la place.
Avec la paix, la situation redevint meilleure ; grâce aux apparences d'une bonne récolte, en 1698, Sorhainde comptait sur l'achat de 80.000 charges de blé. Cependant les besoins du royaume croissaient, Pontchartrain trouvait que la Compagnie s'occupait plus de vendre à des prix élevés que de fournir au royaume des approvisionnements abondants. Pour la stimuler, le ministre n'hésita pas à lui susciter des concurrents et accepta les offres d'une s compagnie de gens riches et accrédités s qui proposaient d'acheter au bey de Tunis 10.000 kaffis de blé revenant à 25.000 setiers de Paris. La Compagnie du cap Nègre parvint à écarter ces rivaux dangereux, en faisant passer un commis à Tunis qui acheta tous les blés disponibles du bey. Comme ces grains étaient disputés aussi par les Anglais, les prix étaient devenus exorbitants : ils furent achetés 11 piastres le kaffi et devaient revenir à Marseille à 21 livres 15 sols la charge. Au début de 1699, des vaisseaux du roi allèrent chercher à Bizerte et à Porto Farina plus de 10.000 charges de ces blés(17).
Pendant les trois années de paix, la principale préoccupation de la Compagnie fut de renouveler la concession du cap Nègre qui ne leur avait été accordée que pour six ans. Pour couper court aux intrigues des Génois et des Anglais, qui pouvaient se renouveler sans cesse, Pontchartrain donna pour instruction à Sorhainde, en 1697, de demander une concession à perpétuité comme celle du Bastion. Mais la négociation dura trois ans sans aboutir, par suite des scrupules des Turcs : " Ce sens de jouissance perpétuelle, écrivait Sorhainde, qui est une espèce de domination, fut rejeté des notables, soutenus du dey qui était à leur tête, comme contraire à leur religion qui défend aux musulmans d'aliéner leurs terres aux chrétiens. " En vain le consul proposait divers expédients, pour ménager la susceptibilité du Divan : " le muphti, le cadi et autres gens de loi et de justice " faisaient une opposition qu'il ne pouvait pas vaincre. Heureusement une révolution, survenue au début de 1699, donna le pouvoir à un jeune Galipie, 10.000 piastres par homme, Amurath bey, d'humeur impérieuse, qui, sans consulter les autres Puissances, dey et pacha, ni le divan, renouvela le traité du cap Nègre comme le désirait le gouvernement français. Cet acte du 28 juin 1699, conservé aux Archives de la marine, accordait aux Français " la possession et jouissance à toujours du cap Nègre et nous garantissait de tout trouble et de toute inquiétude a de la part de qui que ce fût. "
Dès lors, le cap Nègre appartenait définitivement aux Français au même titre que le Bastion de France. Une forte escadre anglaise était venue mouiller à la Goulette, le mois précédent, et nos rivaux s'étaient donné en vain du mouvement pour demander la restitution d'un établissement que les Français avaient usurpé ; " le bey avait répondu qu'il estimait trop la nation française pour se brouiller avec elle en lui ôtant ce poste. " Mais la Compagnie, qui avait profité d'un coup d'autorité du jeune bey, pouvait avoir tout à redouter de ses caprices. En effet, il s prétendit la forcer à lui prendre ses blés à un prix exorbitant, les faisant pour cet effet voiturer dans la place et loger dans les magasins que le directeur ne put se défendre de lui donner. " Cependant le consul parvint à lui faire promettre, par ses remontrances, de ne plus émettre à l'avenir de semblables prétentions.
Peu après, la Compagnie fut menacée de perdre le cap Nègre, par suite des intrigues de plusieurs marchands français établis à Tunis. A leur tête étaient deux " religionnaires " Jean et Gaspard Bourguet. En leur qualité de protestants, ils ne pouvaient être sous la protection du consul de France, aussi logeaient-ils chez le consul anglais. Dès 1695, le consul Sorhainde avait signalé leurs menées et les avait accusés d'avoir favorisé les efforts des Anglais pour déposséder la Compagnie. Ils étaient en relation avec d'autres huguenots, Jérémie et Claude Baquet et Jacques Roux, logés dans le fondouk français. En 1699, le bey, à leur instigation, défendit aux Maures de porter leurs grains au cap Nègre et les fit transporter à Bizerte et à Tunis, pour les vendre aux résidents français qui les lui avaient achetés, même avant la moisson. En 1700, ils persuadèrent au bey de leur faire donation du cap Nègre et, tandis qu'Amurath écrivait au roi et à Pont-chartrain à ce sujet, ils osèrent eux-s écrire au ministre pour solliciter l'approbation royale. Sorhainde avertissait celui-ci qu'un traité secret, entre les frères Bourguet et le bey, stipulait qu'ils dirigeraient le commerce du cap Nègre pour le compte de ce prince. Le don fait par Amurath dissimulait le projet de déposséder de ce poste la nation française.
En cette occurrence, l'attitude du ministre fut énergique, le marquis de Nesmond, lieutenant général des armées navales, fut envoyé à Tunis avec une escadre pour réclamer l'exécution les traités de 1685 et de 1699. Le résultat fut le renouvellement, par l'intermédiaire de MM. de Gastines et de Ribeyrette, du traité du cap Nègre, le 31 octobre 1700, et la Compagnie fut confirmée dans sa paisible possession. Les frères Bourguet que le consul n'avait oser inquiéter plus tôt, parce qu'ils s'étaient mis sous la protection du bey, furent embarqués pour la France et trois autres marchands, leurs complices, reçurent l'ordre de rentrer dans les trois mois "pour venir rendre compte de leur conduite au conseil de S. M.. "
Cependant les Bourguet, hommes entreprenants, tournèrent leurs vues d'un autre côté. Comme l'agrément de la cour était nécessaire à leurs projets, ils abjurèrent le protestantisme et, en 1702, ils obtinrent du bey une nouvelle concession.
" Le bey et le divan de Tunis, disait le contrat qu'ils conclurent, ont donne à perpétuité aux Bourguet le poste de la Galipie comme échelle franche, avec la permission d'y bâtir des magasins moyennant 7000 piastres de redevance annuelle. Les limites sont tout le cap Bon jusqu'à Sfax. Ils pourront, dans cette étendue, acheter toutes sortes de marchandises et les faire voiturer par terre pour les embarquer. S'il arrivait une guerre entre la France et ce royaume, il ne serait fait aucune insulte aux Bourguet ni à leurs commis qui pourront continuer tranquillement leur commerce à l'exclusion de tous les autres. "
Après avoir refusé si longtemps toute concession a perpétuité aux Français, les Tunisiens en devenaient prodigues. Le traité de la Galipie leur donnait le monopole du commerce de toute la côte orientale de la régence comme celui du cap Nègre les faisait maîtres du trafic de la côte nord. Les frères Bourguet demandèrent l'agrément de la cour en faisant remarquer que les Hollandais avaient offert, pour la Gallipie, 10.000 piastres par an que le bey avait refusées. On ne sait pas ce que devint cette curieuse entreprise, qui montre quelle était, en 1700, l'initiative des Français et l'influence dont ils jouissaient en Tunisie(18).
Au milieu de ces tribulations, la Compagnie du cap Nègre et du Bastion fit de mauvaises affaires. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, à la fin de laquelle les Anglais étaient restés les maîtres de la mer, lui avait causé de graves embarras(19), mais elle avait aussi maintenu très élevé le prix du blé, en France, et procuré des bénéfices. C'était surtout depuis la paix que les conditions d'exploitation étaient devenues défavorables au cap Nègre. La situation troublée de la régence de Tunis, en guerre avec Alger, la médiocrité des récoltes, les exigences du bey qui devait à la Compagnie des sommes considérables(20), la concurrence acharnée des résidents français de Tunis qui avait fait monter d'une façon exagérée le prix des blés, causèrent de grosses pertes. Au milieu de 1701, plusieurs des principaux associés, Millau, Charles, Simon, firent banqueroute et prirent la fuite en Espagne, après s'être concertés pour détruire les papiers les plus compromettants. Pareille conduite semble bien indiquer que les malversations ne furent pas étrangères à cette catastrophe(21).
Cette banqueroute fut suivie d'une longue liquidation dont les conditions furent réglées par les arrêts du Conseil du 30 septembre et du 8 octobre 1701. " S. M. disait l'arrêt du 8 octobre, a nommé et choisi le sieur Begon, grand maître des eaux et forêts de Berry et du Blaisois, de Sorhainde, consul à Tunis, et Michel, négociant de Marseille, pour régir et administrer les affaires et effets de la Compagnie du cap Nègre et pour celle du Bastion de France elle a choisi le sieur Begon, Michel et le sieur Denis du Sault, intéressés en ladite compagnie du Bastion. "
L'exploitation fut, en effet, continuée par les autres intéressés qui avaient offert, bien qu'ils n'y fussent pas obligés, de payer les dettes contractées par la Compagnie(22). Mais, avec la guerre de succession, les circonstances étaient devenues très défavorables. Dès 1702, la Méditerranée fut infestée de corsaires hollandais et anglais, et, en attendant qu'on pût organiser des escortes pour nos navires, la navigation fut complètement suspendue à Marseille en décembre 1702. En 1703, on apprit que 52 vaisseaux de ligne anglo-hollandais avaient passé à Gibraltar et les navires furent encore retenus dans le port de Marseille jusqu'en décembre. La navigation ne put être régulièrement assurée les années suivantes par la marine royale, il fallut la suspendre de nouveau fréquemment et les escortes, organisées surtout par les convois du Levant, étaient loin de donner la sécurité au commerce de la Barbarie.
En quelques années, les pertes s'élevèrent à plus de 400,000 livres(23) ; aussi, quand en 1705, après avoir fixé la distribution à faire à leurs créanciers à 64 %(24) les liquidateurs de la Compagnie du cap Nègre proposèrent de fonder une nouvelle compagnie unique, les négociations traînèrent pendant toute une année, par suite de la répugnance des Marseillais à mettre des fonds dans l'entreprise. La Chambre de Commerce dont on sollicitait le concours pécuniaire, faisait des objections. Pontchartrain, impatienté, parlait d'une combinaison qui permettrait de se passer du concours des négociants de Marseille, dont les tergiversations avaient fait perdre une année entière. On comprend le vif désir du ministre de réorganiser solidement l'exploitation des Concessions, au moment où l'approvisionnement de la France en blé devenait de plus en plus difficile. De plus, nos rivaux étaient toujours à l'affût des occasions. En 1706, les Anglais prodiguaient les présents à Alger et à Tunis pour se faire des alliés des Barbaresques et profiter du désarroi des compagnies françaises. Heureusement que l'exploitation des Concessions n'avait pas été abandonnée et que le paiement des usines avait été fait régulièrement. Mais, en dépit de l'urgente nécessité de prendre une décision, l'hésitation des Marseillais à risquer leurs capitaux était bien naturelle au moment où la guerre prenait décidément pour nous bien mauvaise tournure.
Pour la première fois, depuis l'origine de nos établissements en Barbarie, les Marseillais avaient besoin de subir la pression d'un ministre pour former une compagnie. Jusqu'ici leur hardie initiative avait toujours devancé l'action du gouvernement qui s'était borné à approuver la formation de compagnies, constituées en dehors d'elle, et à donner à leurs chefs des commissions de gouverneurs du Bastion ou du cap Nègre. Désormais, les compagnies d'Afrique allaient devenir de plus en plus des entreprises officielles fortement soutenues et étroitement surveillées. Malgré la double déconfiture des compagnies en 1703, on avait déjà ressenti dans les Concessions les bienfaits de la nouvelle politique inaugurée vis-à-vis des Barbaresques en 1090 ; les Marseillais en avaient joui et les avaient exploitées paisiblement. Une seule compagnie avait occupé le cap Nègre pendant plus de 20 ans et elle avait réalisé un moment des bénéfices considérables. Les deux premières guerres maritimes de la France contre l'Angleterre et la ruine de notre marine avaient tout gâté; la situation paraissait bien compromise en 1706.
(1) Plantet, p. 345. Lettre du 29 octobre 1691. - Cf. les plaintes de l'ambassadeur algérien Mehemet Elemin. p. 247 et suiv. p 217. V. une curieuse lettre de cet ambassadeur au dey p. 303-305, en note.
(2) Lettre du 29 octobre à Pontchartrain : " Vous devez.... lorsque les affaires le requerront, nous envoyer d'honnêtes gens comme M. Dusault, judicieux, parfaits, sincères, désirant l'avantage des deux pays. " - Autre lettre du dey Chaban, à Pontchartrain, 6 octobre 1692. Arch. Nat. marine. B7, 217.
(3) Mémoire pour servir d'instruction au sieur Dusault, allant à Alger pour le rétablissement du Bastion de France, 24 février 1691. Aff. étrang. Alger 1689-92. V. dans ce carton la correspondance de Dusault. - Dusault resta à Alger du 24 mai 1691 jusqu au 16 octobre 1692. - V. aux arch. des colon. (carton. Compagnie d'Afrique 1681-1731), un mémoire rédigé en 1690 par M. de Lagny, sur le rétablissement du commerce du Bastion de France. - Voir aux s archives la proposition faite, les 20 juin et 17 août 1690, la compagnie, par quelques gentilshommes de Gênes, pour participer à la pêche du corail.
(4) Plantet, Tunis, n° 456, 471, 479. - Heureusement le roi n'avait pas exigé d'elle, jusque là, le paiement annuel des 25.000 livres qu'elle devait lui faire pendant 6 ans en vertu du traité du cap Nègre de 1635. Ibid. n° 486.
(5) Plantet. Tunis, n° 486, 508, 534. Pontchartrain marquait encore sa faveur à la Compagnie, en 1692, en lui faisant obtenir l'arrêt du conseil du 9 septembre, qui réduisait à 100.000 livres la somme de 150.000 quelle s'était engagée à payer au roi. Arch. colon. Carton Compagnies de commerce, n° 12.
(6) Ce chiffre parait exagéré, d'après une lettre de Sorhaindc à Pontchartrain, du 14 novembre 1692. Plantet, Tunis, n° 521. - La charge, composée de 4 émines, pesait 300 livres, poids de Marseille, qui faisaient 243 livres, poids de marc ; elle équivalait à 129 kilog. environ.
(7) C'est-à-dire 8 livres la charge. Les prix augmentèrent très vite car Pontchartrain répondait à Sorhainde, le 30 septembre 1693 : " Le prix des blés à Marseille étant de 18 à 20 livres, il n'est point encore cher pour la Compagnie lorsqu'il ne lui revient, rendu élans ce port, qu'à 14 livres et elle peut encore en donner un prix plus avantageux aux Maures, pour les exciter à apporter au Cap Nègre tout ce qu ils en auront. Plantet, Tunis, n° 546.
(8) De Boislisle. Corresp. T. I. no 1221. D'après une lettre de Bouchu, intendant du Dauphiné, du 7 octobre 1693, les blés de Barbarie étaient généralement mal accueillis par le peuple, qui les trouvait de mauvaise qualité et extrêmement difficiles à conserver après le transport par mer (Ibid. note).
(9) V. Mémoire de Dusault sur le rétablissement du Bastion de France, 24 mars 1693. Aff. étrang., Alger. - Arrêt du conseil du 18 septembre 1693. Arch. colon. Carton Cies. de commerce, n° 16. - État général des effets remis par l'ancienne Compagnie du Bastion de France, en exécution de l'arrêt du 9 septembre 1693, à la nouvelle compagnie chargée par ledit arrêt du commerce du Bastion. 4 mai 1695. On y voit que les sieurs de Gumerry, Rebuty, de l'ancienne compagnie, et M. Testu de la Chenaye, de Paris, doivent fournir 120.000 livres pour les huit sols d'intérêt qu'ils ont dans le commerce de la nouvelle. Pierre Charles, Nicolas Simon. Pierre Robineau, Antoine Michel, sont nommés comme intéressés en la Compagnie nouvelle. Parmi les effets remis, évalués 71.759 livres, figurent 10 bateaux corailleurs, valant 65.332 livres. Archives colon. Carton Compagnie du Bastion. 1639-1731. - Arch. nat. marine. B7, 217 : Ordre que les intéressés en la Compagnie du Bastion de France veulent être observé pour la régie générale de leurs affaires, 31 décembre 1694. Signé Charles, Charpentier. Michel, Robineau. Rebutty, Symon. Tous ces signataires, sauf Rebute, étaient d'anciens associés de la Compagnie du cap Nègre. - On lit dans un mémoire de 1719 que la Compagnie du cap Nègre, de 1693, n'était autre que la Compagnie des Indes. (Arch. colon. Cies de commerce, n° 16 : Mémoire pour son Alt. R. Mgr le duc d'Orléans...). Cela veut-il dire que les deux compagnies avaient des actionnaires communs ?
(10) Arch. colon. Carton. Compagnie du Bastion. 1639-1731. - On lit dans le bilan de la Compagnie de 1703 : Dusault soutient que l'ancienne Compagnie représentée par Dusault et les intéressés a 10 sols d'intérêt, que la Compagnie du cap Nègre, représentée par M. Begon, le grand maître, a 10 sols d'intérêts. Ni Dusault, ni Begon, n'ont fourni les fonds qu'ils devaient fournir et dont la Compagnie a besoin pour subsister. Dusault offre de les fournir si Begon les fournit. Aff. étrang. Alger, 1700-1709.
(11) C'est ce qui parait ressortir de la correspondance. - Un mémoire du 25 octobre 1696 (Arch. colon.) " sur la conduite qui doit être observée par MM. les intéressés du cap Nègre et du Bastion, au sujet des ouvriers, corailleurs, frégataires, compagnons et autres gens nécessaires à ce commerce ", est divisé en articles pour la Compagnie du cap Nègre et en articles pour la Compagnie du Bastion.
(12) Arch. colon. Carton Compagnie du Bastion, 1639-1731 : Mémoire de ce que le sieur Dusault a acheté en Alger des fonds qu'il a eus en main pour le rachat des pauvres Français. On mentionne aussi, dans ce dossier, un factum imprimé en 1679 par l'ancien associé de Dusault, Rebuty, " détaillant toutes les perfidies et tromperies que M. Dusault avait faites pour lors à ses anciens associés. " - Cf. Arch. nat. marine. B7, 217 : Mémoire pour le sieur Dusaull et Réponse des intéressés en la Compagnie du cap Nègre, 1695.
(13) Archives de la Chambre de Comm. Compagnie Royale d'Afrique. Recueil des Traités. Ce traité, en 14 articles, avait été négocié par Annet Caissel, délégué par Pierre Hély. En 1698, on retrouve cet Annet Caissel, commis de la Compagnie du cap Nègre, et envoyé par elle v Tunis pour négocier. V. Mémoire instructif sur le voyage que va faire en Barbarie le sieur Caissel, remis à ce dernier par les intéressés du cap Nègre, 8 novembre 1698. Aff. étrang. Tunis. - A ce texte français du traité, il est curieux de comparer le texte turc dont Féraud (p. 278 et suiv.) a publié " la traduction fidèle faite par feu son professeur Bresnier sur l'original que possède la Bibliothèque d'Alger. " Le fond des deux documents est 1er, mais il y a des différences de firme très importantes. Certains articles ont une signification beaucoup plus nette et précise dans le texte algérien. Ainsi l'article 4 renfermait, au sujet des blés, des prescriptions assez élastiques : " Si la disette atteignait les habitants... on ne devra point s'opposer à ce qu'ils se procurent le grain et autres provisions de bouche qui leur sont nécessaires auprès des Arabes de la côte. Personne d'une autre nation ne pourra s'opposer à la vente ou à l'achat des grains et provisions de la ville de Bône et autres lieux en quantité suffisante... aux besoins de la nourriture journalière desdits négociants et des gens de leur suite au Bastion et les autres endroits... Et particulièrement, conformément encore aux anciens usages, on ne s'opposera pas non plus à ce que, chaque année, les négociants, se trouvant au Bastion, chargent deux chahdia (tartanes) de blé, à l'effet de les envoyer comme provisions pour la nourriture de leur famille et des gens de leur suite et les expédient à leurs maisons qui seraient en France. " Les articles 6 et 8 insistaient davantage sur le monopole du commerce accordé aux Francais. à Bône et à Collo. - L'article 10 avait une signification plus claire : " chaque année, suivant l'ancienne coutume, deux chahdia (tartanes) viendront à Alger et, après avoir vendu leur chargement... et pour qu'elles puissent se rendre au Bastion, La Calle et autres échelles, il leur sera délivré au moment de leur départ une permission de notre part, afin qu'ils tirent des marchandises en quantité suffisante pour leurs besoins. Cf. Collect. de doc. Inéd. Mélanges historiques. t. II. p. 681-731, les textes français et turc de la bibliothèque d'Alger et deux autres traductions françaises du texte turc. - La bibliothèque d'Alger possède aussi la notification du traité par le dey à l'agha gouverneur de Bône. - Ou peut consulter un autre texte de ce traité aux Archives des Aff. étrang., Mém. et doc. Alger t. XII, fol. 339-46. Cf. une traduction du texte turc. Ibid., t. X, fol. 8-27, avec les ratifications subséquentes jusqu en 1820. M. Boutin a analysé la convention de 1694. p. 354-62.
(14) Ce traité, dit Bonnassieux, (p. 189. d'après Plantet. Alger. Introduction, p. XXXII) reconnaissait formellement le droit de propriété de la Compagnie sur les côtes de la frontière de Tunis à la rivière de Seybas et ses droits exclusifs sur la pêche, depuis cette rivière jusqu au cap Roux. On ne trouve pas cela dans le texte du traité.
(15) État des bâtiments qui ont été expédiés pour le Bastion depuis le rétablissement du commerce jusqu à ce jourd'huy quinzième juillet 1695. Arch. col. Compagnie du Bastion. 1639-1731. - Féraud (la Calle, p. 294), dit, d'après un document des Arch. de la marine, sur lequel il ne donne pas d'indication, que la Compagnie Hély exporta en moyenne de la Calle, sans Bône et Collo, 90.000 hectolitres de blé. Dans les disettes de 1701 à 1709, la Compagnie Hély aurait expédié en France par Marseille et le Havre jusqu'à 200.000 hectolitres de blé par an. Si ces chiffres élevés étaient exacts, la Compagnie aurait montré beaucoup d'activité. Malheureusement. Féraud a commis deux erreurs qui doivent nous rendre défiants ; il a compté la charge de blé à 153 kilog. Tandis qu'elle n'en valait en réalité que 120 environ ; par conséquent, les quantités d'hectolitres auraient été moins considérables ; d'un autre côté, eu 1709, la Compagnie Hély n'existait plus depuis trois ans. - Plantet. Alger, t. II, p. 65, note 2, reproduit purement et simplement les chiffres de Féraud.
(16) Parce que les Génois achèteraient en Barbarie et vendraient en France, et au lieu de 7 à 8 livres qui sortaient du royaume, pour le prix d'une charge de blé que la Compagnie achetait des Maures, il en sortirait au moins le double par la vente que les Génois feraient en France.
(17) ibid. n° 663, 677, 680, 682, 683, 684, 685. - Un mémoire de 1730 rappelait plus tard qu'en 1699 Paris avait été accouru par les blés du cap Nègre et que le roi avait accordé des frégates pour transporter ces blés au Havre. Ibid., t. II, n° 513.
(18) Ibid, mars 1702, n° 30, 31. La Galipie était une petite forteresse bâtie sur un cap voisin du cap Bon, à l'entrée du Golfe de Hammamet, aujourd'hui Kelbia. Peyssonnel l'appelle la Galipoli.
(19) En 1606, deux vaisseaux du roi furent envoyés sur les côtes de Barbarie pour ramener les bâtiments bloqués par les Anglais.
(20) En 1703. le consul réclamait encore, en vain, au bey le paiement de 25.000 piastres qu il devait à la Compagnie. Plantet, Tunis. t. II, n° 35, 40.
(21) Mémoire concernant les circonstances de ce qui s'est pratiqué dans la banqueroute du cap Nègre. Aff. Étrang. Tunis. - Cette affaire fit grand bruit à Marseille. V. lettre de Dusault à Pontchartrain. 31 août 1701. Aff. étrang. Alger. 1700-1709. Ce carton renferme une correspondance importante de Dusault relatives la liquidation des affaires du cap Nègre et du Bastion.
(22) Arrêt du 3 décembre 1702 qui homologue la transaction des intéressés restants de la Compagnie : Begon, Guillaume Masen, seigneur d'Arquien, Antoine Michel, Nicolas Charpentier et consorts, Arch. colon. Compagnies de commerce, n°12. Ce carton renferme diverses pièces relatives à la liquidation. - Dusault avait vendu sa part de propriété à Begon pour 137.000 liv. V. diverses lettres de son neveu à Pontchartrain, notamment celle du 26 septembre 1704. Aff. étrang. Alger, 1702-1709. Plusieurs lettres des années suivantes montrent que Dusault fit alors le commerce du Levant ; il arma un navire pour la pêche de la baleine à Bayonne en 1705 ; en 1710 il avait un vaisseau à Cayenne, venant de la mer du Sud.
(23) Cependant, d'après un document conservé aux aff. étrang. (Alger 1700-1709 : État da effets de la Compagnie, la situation n'aurait pas été mauvaise jusqu'en 1704.
(24) La liquidation n était pas encore terminée en 1711. V. un très long arrêt du Conseil du 9 mars 1711, relatif à cette opération. Arch. nat. E, 1981, fol. 445-601. - Cf. Mémoire de Begon sur les prétentions de l'ancienne Compagnie du cap Nègre contre le bey de Tunis, remis à M. de Gastine en 1706. Arch. colon. Compagnies de commerce, n° 12. En 1714, Begon et les anciens intéressés adressaient encore des requêtes au duc d'Orléans et au comte de Toulouse pour qu'on leur fit rembourser 322,395 liv. que leur devait le bey de Tunis, sans quoi, ils ne pourraient payer leurs créanciers. Aff. étrang. Alger, 1710-20.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A SUIVRE
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Septembre 2011.
Son adresse: http://www.piednoir.net/guelma
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
Le Guelmois
| |
| L'ane et le cheval
Envoyé par Jean-Claude
Auteur Inconnu
| |
|
Un âne et un cheval broutent de l'herbe dans un pré.
Le cheval dit à l'âne :
- J'en ai marre de brouter, viens chez moi, je t'offre un coup à boire.
L'âne acquiesce et ils se rendent tout les deux chez le cheval. Arrivé chez ce dernier, l'âne remarque une multitude de trophées sur des étagères ainsi qu'un tableau représentant un cheval et un jockey brandissant une coupe.
L'âne demande au cheval :
- C'est toi sur le tableau ?
- Oui, c'est quand j'ai remporté le grand prix d'Amérique il y a quelques années.
Impressionné, l'âne demande :
- Et toutes ces coupes ?
Le cheval répond fièrement :
- Ce sont les nombreux prix que j'ai remporté durant ma carrière.
L'après midi passe, et en partant l'âne propose au cheval de venir chez lui le lendemain, ce que le cheval accepte.
Le lendemain, l'âne cherche dans toutes les brocantes de la ville des coupes ou tableaux, histoire de se faire un peu mousser auprès de son ami le cheval. Mais il ne trouve rien, excepté un tableau de zèbre qu'il achète sur le champs. Une fois chez lui, il accroche le tableau dans l'entrée, bien en vue, pour que le cheval ne puisse pas le rater.
Le cheval tape à la porte. L'âne l’accueille :
- Entre mon ami ! bienvenu chez moi.
Évidemment, le cheval ne peut que remarquer cet immense toile de zèbre qui trône au milieu de l'entrée, et interpelle l'âne :
- Oh l'âne, ne me dit pas que c'est toi sur le tableau !
Et l'âne répond :
- Bien sûr que c'est moi, lorsque je jouais à la Juventus de Turin...
|
|









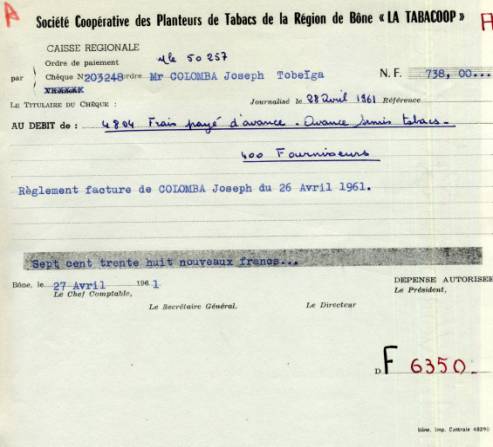



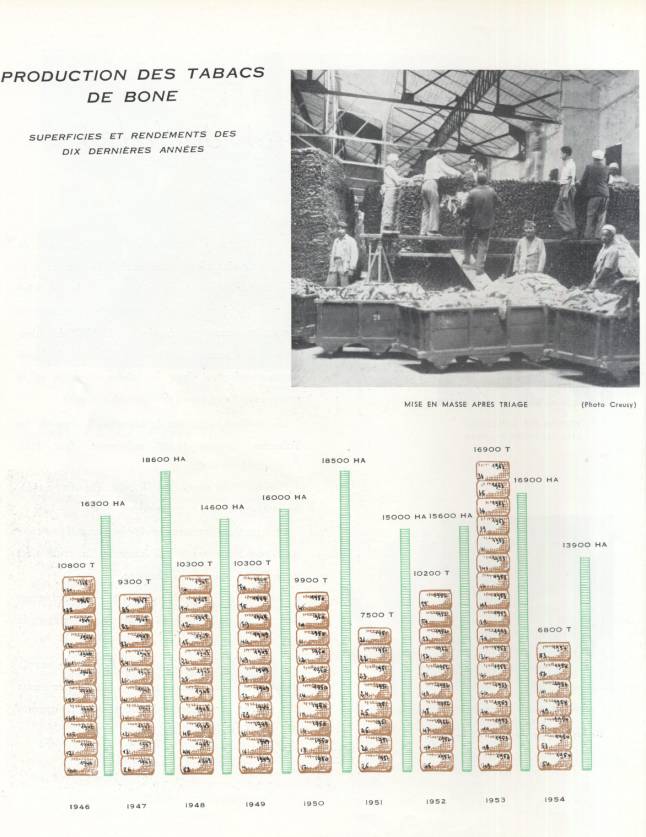
 Marcel est né le 02/09/1949 à Herbillon dans la maison de ses grands-parents Martin.
Marcel est né le 02/09/1949 à Herbillon dans la maison de ses grands-parents Martin.
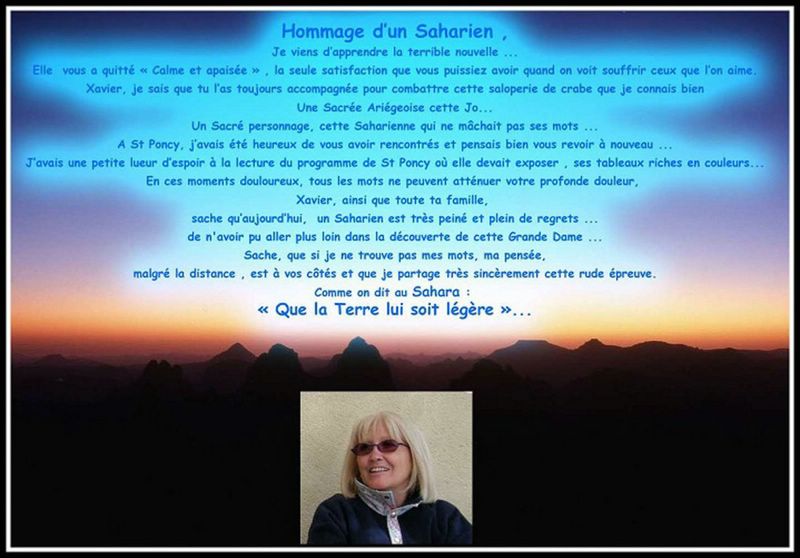
 Gérard Pierre Edouard MAYER fils de René MAYER, ancien maire de
PENTHIEVRE s’en est allé le 12 septembre 2011 à l’âge de 73 ans.
Gérard Pierre Edouard MAYER fils de René MAYER, ancien maire de
PENTHIEVRE s’en est allé le 12 septembre 2011 à l’âge de 73 ans.