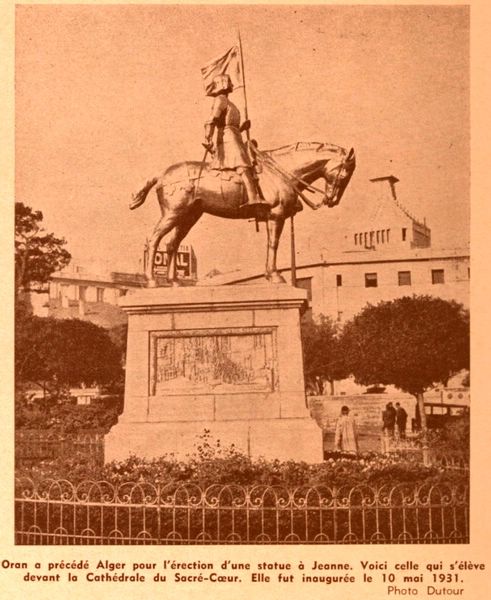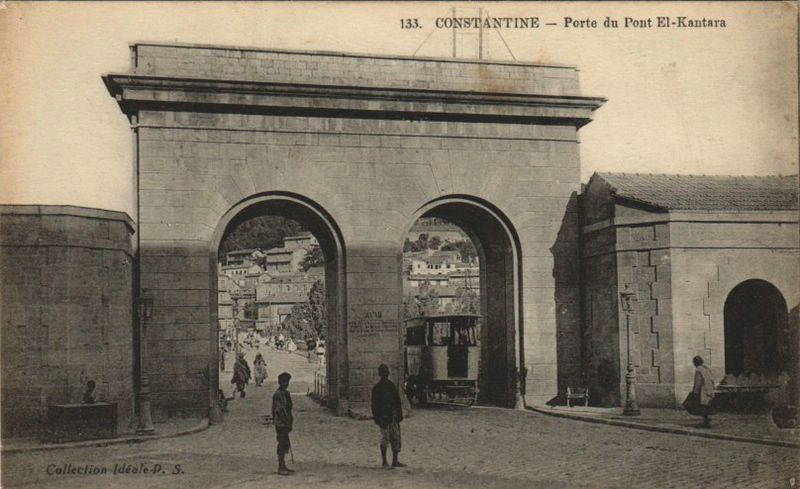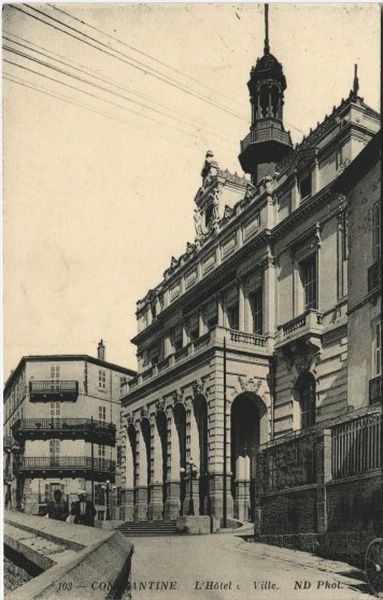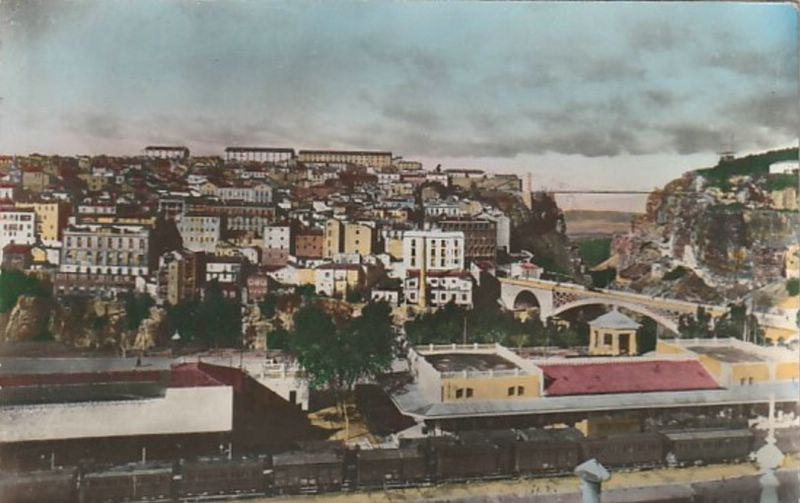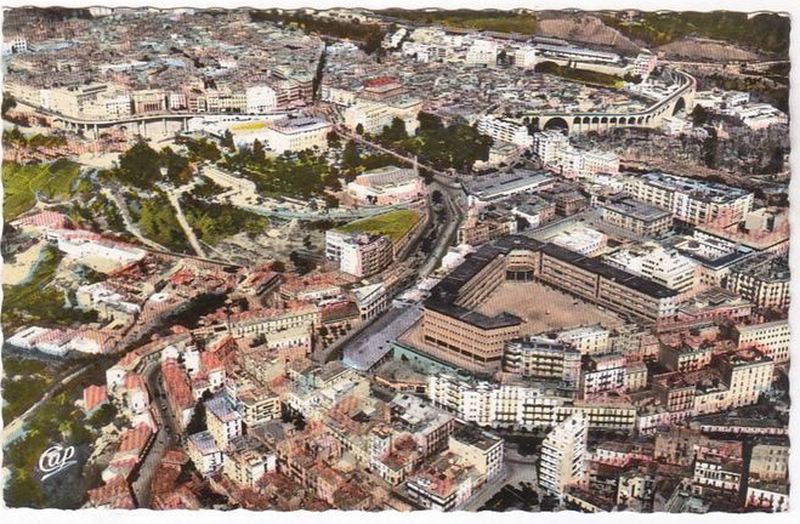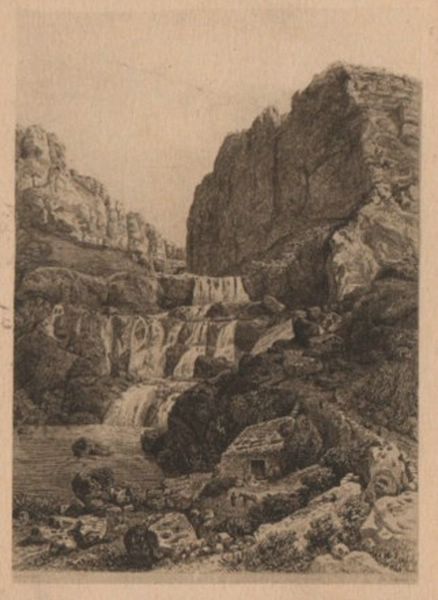|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
217, 218,
219, 220, 221,
222, 223, 224,
225, 226,
| |
La fête des "j'en fou rien"

Aujourd'hui 1er mai, c'est la fête du travail ! Alors pour ne rien changer, je bosse ! Un peu chez moi et beaucoup pour la Seybouse. J'espère que vous aimerez ce Numéro.
La fête du Travail, c'est aussi celle du muguet, donc des fleuristes, et des " bénévoles " qui le vendent au coin d'une rue, après l'avoir ramassé.
Le 1er Mai, est célébrée la fête du travail. Un nom de baptême bizarre car, la très grande majorité des travailleurs du pays, va faire autre chose que travailler. Il va fainéantiser dans la joie. D'après un certain président, habituellement, Il serait même un peu " fainéant " sur les bords.
À l'évidence, ce 1er Mai ne ressemblera à aucun autre. Comment les syndicats pourront-ils rassembler le monde du travail pour crier des revendications alors qu'ils se sont vendus au président ?
Mai 1968, il y a 54 ans. C'était une révolution ou un mouvement social de très grande amplitude à une époque où les manifestations du 1er mai étaient interdites en France depuis 1954. Un mouvement qui avait débuté par les étudiants, puis le monde ouvrier et sans les syndicats qui ont fini par raccrocher les wagons car ils sentaient que cela finirait mal pour eux.
En 2022, la France gronde mais se laisse endormir quand vient la période des élections, mais jusqu'à quand ?
Avec l'obligation vaccinale ; la privation des libertés ; la mort de malades qui auraient pu être soignés sans les ordres criminels qui ont plombé la grande majorité des médecins ; la gabegie des finances publiques ; le grand remplacement voulu par les chefs d'état pour justifier leur incurie ; l'inflation dont on met la cause sur une guerre voulue par des fous, etc...
Tout cela finira très, très mal. Et gageons que nous allons en subir les conséquences. La France a fait un choix, elle sera responsable aux yeux de ses enfants et petits-enfants.
A ce moment là, nul ne se doute encore de l'ampleur que prendront les événements futurs car nous sommes dans une situation pire que 1968 et les insouciants ne veulent pas s'en rendre compte.
Quoi qu'il en soit, ce 1er mai 2022 est celui d'une fin de cycle, celui d'un tournant qui s'annonce, pour le meilleur ou pour le pire. Bonne fête aux travailleurs, aux retraités et aux jeunes qui ont leur avenir entre leurs mains !
Souhaitons que Saint Augustin veille sur nous encore quelques années.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
| La Cuisine du Bastion de France.
|
Il était une fois, La Calle,
au bon temps des Mariages.
Si évoquer aujourd'hui, le temps des mariages à La Calle est pour moi, je vous l'assure, un incontestable plaisir, c'est aussi et à l'évidence, un devoir que je vais m'empresser de remplir de bonne grâce et s'en même me forcer.
En effet et je dois l'avouer franchement, dans ma plus tendre enfance je bénéficiais en la matière d'une confortable position, que je n'hésiterais pas à qualifier de privilégiée : d'une part, par mes fonctions d'enfant de chœur à Saint-Cyprien et d'autre part, par Louise + ma mère, fine cuisinière devant l'éternel.
Dans le premier cas, je fus un temps en qualité d'enfant de chœur en chef, l'assistant direct de Monsieur le Curé Augustin Urbain Decroze, qui, au cours de son ministère Callois, n'aurait jamais pu bénir un seul mariage, sans l'eau du bénitier placée sous ma haute responsabilité.
C'est ainsi que lors des différentes cérémonies et par la force de mes fonctions, j'étais toujours en première ligne pour vivre de très prés la cérémonie nuptiale et par voie de conséquence, absolument indispensable pour que le mariage fut : combien d'unions Calloises bénites par le père Decroze, l'étaient aussi par l'eau de mon bénitier : donc, par moi !
C'est pourquoi aujourd'hui, je peux considérer sans vanité aucune, que j'aie également uni pour le meilleur et pour le pire, un bon nombre d'enfants de La Calle et d'ailleurs, qui doivent encore s'en souvenir.
Dans le deuxième cas, Louise ma mère était souvent demandée, pour préparer le repas des noces et à cette occasion, notre famille régulièrement invitée : ce qui m'autorise aujourd'hui, d'évoquer avec beaucoup de bonheur et nostalgie, les banquets fabuleux de ces beaux mariages d'antan.
Venant toujours à pieds de la mairie, le cortège nuptial était chaleureusement accueilli par le joyeux carillon de Saint-Cyprien et par la belle chorale du Bastion de France, qui entonnait solennellement - le Veni Creator. Puis, tout de blanc vêtue, la mariée rayonnante de bonheur, entrait dans l'église au bras de son père, suivie de près par ses filles d'honneur aux bras de leurs coquets cavaliers. Un parfum d'encens des grands jours et de fleurs, régnait alors dans le vaste chœur de notre belle église. Durant la cérémonie, alors que très tendrement chantait l'harmonium, sous les doigts de Mademoiselle Lucie Borg, la joie et l'émotion s'affichaient sur tous les visages des présents. Puis, c'est après l'échange des bagues, que la bénédiction des époux était saluée de là-haut, par un victorieux cantique lancé à l'unisson, par la chorale du Bastion de France, vers l'infinie profondeur des cieux... Enfin venait le temps du passage à la sacristie et de la signature des registres paroissiaux, puis, les chaleureuses félicitations des époux et les larmes d'émotion...
Nous autres les enfants de chœur, on aimait bien les mariages : il y avait plein de monde bien habillé et surtout, de très jolies et souriantes petites demoiselles toutes endimanchées : c'était la fête dans la maison du bon Dieu et puis, à la fin de la cérémonie, quelques menues monnaies venaient toujours sonnantes et trébuchantes pour nous récompenser.
La sortie de l'église était aussi un moment inoubliable : un arrêt sur le parvis, photographies pour la postérité et pluie de dragées lancées sur la foule massée en face et tout le long du cours Barris...
Finalement, le cortège nuptial, un moment salué par les cloches de Saint-Cyprien, s'en allait lentement à pieds par les rues du village, rejoindre les lieux choisis pour le déroulement du banquet de noces.
La salle des noces de ces mariages d'antan, combien de souvenirs fabuleux n'a-t-elle pas laissés dans ma mémoire : c'était - au Café des Palmiers, cours Barris - Place du marché, chez la famille Patti - en bas la marine, dans les locaux du Racing-club de La Calle - derrière l'église, à l'hôtel Continental - chez André Tarrento - mais aussi ailleurs, parfois même au domicile des familles, ou dans quelque ferme des alentours de La Calle...
Ce ne sont certes pas les lieux qui m'ont le plus marqués, mais surtout la grande table du repas de noces, admirablement disposée, parfois, en un U majuscule élégant ou, toute en longueur.
Couverte de nappes bien blanches joliment brodées, son milieu était parcouru d'un long chemin de table fait de vertes épinettes, lequel, venait séparer les cristaux et porcelaines de la vaisselle et l'argent étincelant des couverts de fête. Sur ce chemin piquant d'Asparagus, se dressaient régulièrement comme des quilles en goguette, de multiples bouteilles cachetées de teinte rouge et rosée, qui arboraient fièrement leurs étiquettes de vins fins. Dans tous les sens accrochées aux murs et suspendues aux plafonds de la salle, de longues guirlandes multicolores apportaient dans les lieux, une note bien sympathique et de profonde gaieté.
Parfois un lunch était offert en premier et puis dans la soirée, un repas somptueux était servi aux invités.
Mais pour rentrer dans le vif du sujet et aborder enfin les choses sérieuses, quel était donc le menu qui était servi au cours de ces noces Calloises ?
A l'évocation des différents plats qui vont suivre, certains d'entre-nous seront peut-être ? tentés d'esquisser un petit sourire amusé. Cependant, il faut le dire, que pour apprécier pleinement et à sa juste valeur ce qui va suivre, il faut impérativement se placer dans le contexte de l'époque : celui où certains produits, ne figuraient sur les tables que dans les grandes occasions - ce qui hélas ! n'est plus aujourd'hui le cas.
Mais que servait-on à La Calle
au bon temps des mariages ?
En fouillant consciencieusement dans mes souvenirs d'enfant, j'ai sans peine retrouvé intact et délicieux, le menu inoubliable que se plaisait à faire Louise ma chère et regrettée maman.
Écoutez bien et appréciez ce qui va suivre, mais surtout, là est l'essentiel, que cette évocation nostalgique puisse vous rappeler, les biens doux souvenirs du bon temps d'autrefois :
Celui des noces Calloises !
C'est très sincèrement ce que je vous souhaite.
Menu d'un mariage Callois :
APERITIFS :
- ANIS Gras.
- Saint RAPHAEL Quinquina.
- CINZANO blanc et rouge.
- CAP Corse.
- SIROPS de Grenadine, Menthe, Orgeat.
REPAS de NOCES :
- POTAGE à la Reine.
- CHARCUTERIES variées - Beurre - Olives noires - Radis - Variantes.
- VOLS au VENT financière.
- POULETS rôtis - HARICOTS verts fins au beurre - POMMES de terre sautées.
- SALADE verte et sa vinaigrette.
- FRUITS de saison.
- BOMBE glacée à la vanille.
- VINS fins, rosés et rouges.
- CAFE - LIQUEURS au choix.
En soirée :
- PATISSERIES diverses.
- PIECES MONTEES : Nougatine, Choux, Génoise.
- MOUSSEUX.
Lorsque parfois cette époque bénie me revient en mémoire, je me dis que les noces Calloises n'avaient rien à envier aux actuels repas de mariages. C'est pourquoi je m'en vais reprendre au hasard de ce menu, quelques-unes des recettes qui étaient chères à Louise ma mère : je suis fermement persuadé que leurs saveurs, vous feront retourner un moment là-bas dans notre cher passé :
à La Calle au bon temps des mariages !
REPAS de NOCES CALLOISES
( Menu préparé par Madame Louise PUGLISI + )
Mariage de Monsieur et Mademoiselle...
( je suis sûr que vous vous reconnaîtrez ! )
Le POTAGE à la Reine.
( Délicieux potage en l'honneur des mariés )
- Faire un bouillon avec les abats de volaille avec : ail, oignon, thym, laurier, clous de girofle, sel et poivre.
- Passez le tout au chinois et tenir bien au chaud.
- Au moment du repas incorporez modérément des pâtes fines dans le bouillon de volaille : langues d'oiseaux ou cheveux d'anges.
- Ajoutez ensuite dans le potage chaud un bon morceau de beurre et des jaunes d'œufs battus.
- Servir immédiatement.
CHARCUTERIES Variées.
( Toujours présentes dans les grandes occasions )
- Jambon blanc, Saucisson, Cervelas.
- Fromage de tête de porc :
Dans un grand récipient mettre à cuire lentement :
- ½ tête de Cochon bien nettoyée avec un court-bouillon : ail, oignon piqué de clous de girofle, carottes, céleri, thym, laurier, sel et poivre.
- Ajoutez deux pieds de Veau.
- Lorsque la tête de Cochon est cuite, retirez, égouttez et laissez refroidir complètement.
- Découpez en dés la partie charnue et répartir dans des moules.
- Couvrir de court bouillon.
- Réservez le reste du court bouillon pour obtenir la gelée.
- Décorez la partie supérieure de la préparation, par des peaux d'oranges découpées en marguerites.
- Laissez au frais au moins 12 heures.
- Servir en tranches avec des cornichons et des variantes, entouré de gelée découpée en menus morceaux.
VOLS au VENT financière
( Bouchées - Reines de la noce )
- Croûtes de Vols au vent, faites maison à la pâte feuilletée.
- Garniture financière : veau, cervelle, ris de veau, quenelles, olives vertes, champignons et sauce au vin blanc liée, ail, oignon, thym, laurier.
- Servir chaud.
POULETS rôtis - HARICOTS verts fins au beurre
Et Pommes de terre sautées :
( Quel travail ! Mais quelle splendeur gustative )
Pour les Poulets ? ! inutile d'indiquer la recette. Mais cependant, il est absolument essentiel de rappeler, le côté infiniment laborieux nécessité par leur longue et patiente préparation : d'abord, il était indispensable, de se procurer quelques belles volailles de campagne - ce n'était pas toujours très facile ! - puis, il fallait hélas les sacrifier, les ébouillanter, les plumer, les vider, les brûler, les trousser...
Mon Dieu ! quel travail…
Ensuite venait la lente cuisson des volailles, dans le plus profond secret des sublimes et antiques cocottes de fonte noire… Que de temps passé pour la cuisinière de service ! Mais je peux sans façon vous assurer, combien, au sortir des cocottes étaient exquises et croustillantes à souhait, toutes ces belles et odorantes volailles infiniment dorées.
C'est ainsi que depuis ce temps-là, j'ai toujours voué un éternel amour à toutes les volailles du monde et cela, en toute humilité au nom de la nostalgie et d'une fidèle gourmandise : le poulet restera toujours pour moi, ce divin privilège des grandes tables de fêtes.
Haricots verts fins et pommes de terre ? !
Que dire, sinon qu'ils étaient frais et de production strictement Calloise.
Préparés tendrement un à un, et délicatement cuisinés avec ail et persil, ils faisaient un couple parfait pour accompagner la noble volaille : c'était là - leur petit secret !
SALADE VERTE :
( Participait de droit au menu des mariages )
Laitues fraîches de nos Jardiniers, avec une sauce sublime de vinaigre de vin et d'huile d'olive pure. Cette toute simple crudité était très appréciée, car, à cette époque, il n'était pas habituel de consommer régulièrement de la salade verte lors des repas. C'est pourquoi la laitue sauce vinaigrette, conservait une place fort estimée dans les festins des grands jours de fêtes.
FRUITS de saison
( Abondance, douceur, et délices du Bastion )
Si les beaux fruits ne manquaient pas à La Calle, ils étaient aussi tout simplement délicieux et gorgés de soleil. Cependant les desserts des repas de noces, offraient parfois des fruits rares et précieux : les bananes par exemple… Mais suivant la saison, oranges et mandarines, raisins, melons et autres fruits, ne faisaient jamais défaut et sur la vaste table et telles des cornes d'abondance les corbeilles d'osier regorgeaient toujours de beaux fruits frais : quelle fête mes amis !
BOMBE glacée à la vanille.
( les délices de Louise )
Pour obtenir cette divine recette, l'opération la plus difficile était l'emprunt d'une sorbetière, dite à main, dont il existait peu de spécimens dans le village : d'où, la réticence bien compréhensive, des rares propriétaires de ces précieuses machines à glacer Mais cet obstacle au demeurant insurmontable, n'était pas opposable à Louise ma mère, qui jouissait de la confiance totale des intéressés : la machine fut toujours rendue à son propriétaire propre comme un sou neuf et intacte de tout délabrement... C'est tout dire !
Ce dessert glacé était pour le palais un bienfait des Dieux et de Louise. Après un bon repas il favorisait la digestion à un point tel, que la fête se poursuivait allègrement et sans aucune difficulté, à coup de gâteaux et de mousseux bien frais.
Alors mes amis, si la Bombe glacée à la vanille venait à vous tenter, faites comme Louise à La Calle au bon temps des mariages !
Préparation de la Bombe glacée
de Mme Louise PUGLISI :
- Faire bouillir : 1 litre de lait frais et entier + 1 gousse de vanille fendue en deux.
- Battre au fouet : 8 à 10 jaunes d'œufs bien frais et introduire lentement 300 g de sucre en poudre.
- Travaillez au fouet et passez au chinois pour éviter les grumeaux.
- Placez à feu doux le lait tiède au bain-marie et retirez la gousse de vanille. ajoutez doucement le mélange, jaunes d'œuf et sucre et travaillez au fouet pour obtenir une préparation bien homogène coulant en ruban.
- Laissez refroidir, puis, versez dans le moule de la sorbetière?
- Répartir autour de la glace pilée salée au gros sel.
- Tournez 20' à 25' environ.
- Dés que la glace est prise, gardez au frais dans le moule, et couvrir d'un torchon.
- Démoulez au moment de servir.
- Il est possible de parfumer la glace, avec du rhum ou toute autre liqueur, voire, d'y introduire des fruits confits, de la crème fraîche…
A quoi bon ! ? Une Bombe glacée vanille, a ce parfum sublime qui lui est propre. Pourquoi ! ? Ne pas le respecter : ainsi parlait autrefois Louise ma mère
EN SOIREE :
( Gâteaux variés, Mousseux et en avant la Musique )
Après le repas, repus, alors que chacun va de sa petite chanson, café et liqueurs circulent librement parmi les convives : mais, c'était du vrai café, broyé au moulin et dans la cafetière passé avec un soupçon de chicorée...
Quant au choix des liqueurs : Rhum Saint-James - Cointreau - Marie Brizard -Vieille Cure - Mandarine - Banane - Prunelle - Cacao...
Et puis des gâteaux de toutes formes et de toutes couleurs, faisaient une entrée très remarquée à la satisfaction quasi-générale, alors que dans la salle de fête, déjà la musique entraînait petits et grands, dans une série de danses endiablées : c'était, la danse du balai et du tapis, la bombe atomique, le Spirou, et même le Quadrille - que les plus anciens dirigeaient avec autorité. Mais il y avait aussi toutes ces danses immortelles, qui bien heureusement aujourd'hui sont toujours à la mode et pour leur faire honneur des danseurs extraordinaires...
Ensuite venait le rite très attendu de la pièce montée : taillée impitoyablement à grands coups de couteaux par les époux et saluée par les salves désordonnées des bouteilles de mousseux, expulsant tous azimuts leurs gros bouchons aux quatre coins de la salle, pour s'en aller ensuite remplir les précieuses coupes d'un jet puissant et de pétillante gaieté...
Pour la pièce montée je me dois de rendre un hommage particulier, à notre cher et regretté Monsieur André Tarento +, qui, par ses Génoises décorées de sucre glace et ses choux à la crème, devait réaliser pour la circonstance de somptueuses pièces montées, dont je me souviens encore aujourd'hui. Mais il serait bien injuste que j'oublie au passage, les divines pièces montées de Nougatine faites par des mains de fées : j'ai nommé mesdames, Marguerite Jacomino + et Clarisse Olivieri + sa complice - nos amies regrettées. Saviez-vous, qu'elles fabriquaient dans les secrets de leurs demeures de la presqu'île de France, une Nougatine incomparable dont elles seules connaissaient la recette ? !
Merci à André, Margot et Clarisse +++, d'avoir apporté par leurs pièces montées et au-delà du temps, un souvenir de plus au bon temps des noces à La Calle.
Hélas mes amis ! la Noce est finie et à présent il me faut rentrer à la maison. Mais je vous l'avoue bien sincèrement, que ce temps des mariages à La Calle, me tourmentait depuis bien longtemps déjà et je voulais absolument vous conter sa belle histoire, comme ça tout simplement et avec tout mon cœur.
Si je n'ai pas évoqué de noms ou même conté certaines anecdotes de ces soirs de noces Calloises, sachez, que le mariage que je viens de raconter, vous le connaissez bien - car c'est peut-être le vôtre !
Avec un peu d'imagination, beaucoup d'entre-nous vont sûrement se reconnaître : avec bonheur peut-être bien ?, mais surtout avec quelques nostalgies !
C'est ce que bien sincèrement je souhaite, même si ce soir là, Louise ma mère n'était pas de service en cuisine !
Jean-Claude PUGLISI
- de La Calle Bastion de France.
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
Fait le 12/O1/1996 à Giens en presque' île
par un jour que m'a semblé un peu moins triste.
$=$=$=$=$=$=$=$=$=
|
|
|
LE MARABOUT DE NEDROMA
ECHO D'ORANIE - N° 280
|
|
Sidi Bénamar : portrait d'un guérisseur
Ce texte a été rédigé en août 1955 et n'était pas à l'époque destiné à la publication. Du moins en l'état. Il s'agissait seulement d'une longue note couchée dans le carnet de route du journaliste stagiaire que j'étais alors. Quelques jours plus tôt, au cours d'une visite de la Zaouia de Nédroma, j'avais été témoin des talents de guérisseur du Cheikh Sidi Bénamar.
Mon enquête sur ses pratiques empiriques (et néanmoins efficaces) devait malheureusement tourner court.
L'Armée en effet ne tardait pas à se rappeler à mon bon souvenir en m'expédiant une feuille de route. La guerre me rattrapait. L'heure n'était plus à l'ethnologie.
Par chance, mes carnets de notes ont survécu au désastre de 1962. Je me suis à nouveau plongé, non sans nostalgie, dans leurs feuillets jaunis quand, dernièrement, le Docteur André Bernard, un ami très cher et de longue date, me précisa qu'il existe une explication scientifique à la thérapeutique du fil de laiton.
C'est pourquoi je tire de l'ombre les lignes qui suivent, sans les amputer ni les étoffer d'un seul mot.
Une sorte d'hospice
Connue à travers tout le Maghreb, la Zaouia des Sidi Bénamar est située au cœur du massif des Trara, à 46 kilomètres de Tlemcen, sur la route de Nédroma, dans une région montagneuse de l'Oranie. C'est en ces lieux d'accès difficile que l'ancêtre Sidi Bénamar était venu chercher, vers la fin du XVIème siècle, la solitude nécessaire " à l'adoration d'Allah et à la contemplation de ses oeuvres". Sur l'étroit éperon rocheux où il avait choisi de s'isoler, ses descendants édifièrent par la suite la Zaouia qui compte aujourd'hui plus de 300 habitants.
Institution typiquement musulmane, la Zaouia est assez complexe à définir. "Ce n'est ni une secte, ni une confrérie. Elle n'a pas d'affilié ni de militant. C'est simplement une sorte d'hospice où tous ceux qui souffrent sont accueillis, soignés, réconfortés. Elle n'impose aucune obligation à celui qui vient solliciter son secours. Aucune pratique religieuse n'est spéciale à la Zaouia. Ni dikr, ni imara* ne sont exigés de ses fidèles si ce n'est les obligations rituelles dues par tous les Musulmans. (1)
De fait, la Zaouia de Sidi Bénamar pratique une politique de la porte largement (et gratuitement) ouverte. Pour héberger ses visiteurs, elle dispose d'un caravansérail pouvant recevoir plusieurs centaines de visiteurs. Trois pièces individuelles sont réservées, contre la mosquée, aux personnes de marque. Mais là n'est pas la véritable originalité de cette institution.
Transmission du secret
A l'époque lointaine ou Sidi Bénamar l'ancêtre vint s'installer dans sa retraite, vivait dans le Trara un vieillard estimé de tous, Sidi El Hadj El Bethioui. Un jour, alors qu'il était sur le point de mourir sans laisser de descendance mâle, celui-ci fit appeler le chef de la nouvelle Zaouia. Il lui confia alors un secret qui se transmettait dans sa famille de père en fils depuis des temps immémoriaux. Il s'agissait d'une technique peu banale mais efficace qui permettait de soigner les sciatiques les plus tenaces. Depuis, le relais a été fidèlement assuré, une génération après l'autre, dans la famille des Sidi Bénamar.
Pour curieux qu'il soit, ce traitement ne relève ni de la magie, ni du miracle. Son efficacité ne dépend pas de la foi en l'Islam. C'est à peine s'il exige la confiance de ceux qui viennent se faire traiter. Bien plus, il n'est pas réservé aux musulmans. Les roumis peuvent également y prétendre.
Fil de laiton
En ce début de matinée du mois d'août 1955, Sidi Moulay Ali Ben Larbi Bénamar est assis à l'ombre d'un mur de pierres sèches, sur une peau de chèvre posée à même le sol. L'air vibre déjà de chaleur. Le saint homme est tout de blanc vêtu. Près de lui, une cruche d'eau, plusieurs boîtes en fer, une bouteille d'encre, des stylets de bois. En partie caché par une barbe poivre et sel, le visage est serein. Presque figé. Légèrement plissés, les yeux bruns se concentrent.
Un homme en djellaba s'approche. Les reins cassés. Le visage marqué par la souffrance. Péniblement, il s'agenouille devant le guérisseur. Celui-ci regarde à peine le nouveau venu. Il lui saisit la tête à deux mains et l'attire vers lui. Dans l'une des boîtes il prend un fil de laiton dont l'une des extrémités est taillée en pointe, tandis que l'autre forme une boucle. Sidi Bénamar porte la pointe de métal à ses lèvres, murmure à voix basse une invocation. Puis, d'un geste précis, il perce l'oreille du patient. Au milieu du tragus. Pas une goutte de sang. Le Cheikh noue les deux bouts du fil de laiton, formant ainsi un anneau qu'il fait jouer entre le pouce et l'index. L'homme à la djellaba glisse sous la peau de chèvre une offrande en monnaie. Lentement il se relève et s'éloigne d'un pas épuisé.
Pendant une minute ou deux Sidi Bénamar paraît perdu dans ses pensées. Un vent léger se met à courir tout au long de la vallée. On entend soudain le froissement des roseaux qui poussent plus bas en touffes épaisses. Quelqu'un apporte un plateau d'argent, des verres. Le thé a un parfum de fleurs sauvages. Sidi Bénamar s'adresse à moi' Tahar, l'interprète, fait son office, prompt et précis comme d'habitude".
Je recommande toujours au malade de tourner l'anneau d'avant en arrière, plusieurs fois par jour, et ensuite de respirer l'odeur qui imprègne alors ses doigts. Le fil tombe de lui-même juste avant la guérison. Ou bien peu après. La peau ne garde aucune trace ".
Je demande des précisions sur la technique. Son histoire, son mode opératoire. Je voudrais savoir s'il s'agit d'une sorte d'acupuncture.
Brève réponse, accompagné d'un sourire :
"Je perce l'oreille de l'homme et Dieu le guérit !"'
Vendetta
Dix heures bientôt. S'approche un montagnard aux gestes lents. Il s'accroupit près du marabout et parle à voix basse. Sidi Bénamar répond. Longuement. D'un ton égal. Ni Tahar ni moi ne percevons un seul mot de ce discret entretien. Nous voulons nous éloigner. Le marabout nous fait signe de ne pas bouger.
Le visiteur s'en va. Le Cheikh m'explique : "Celui-ci a été blessé dans une vendetta. Deux balles dans les reins. Je l'ai soigné ici... Si je les laissais faire, ils poursuivraient la tuerie".
Je sais que les fusils parlent facilement dans ces monts de Nédroma. Une légende illustre le peu d'importance que les Qbails attachent à la vie humaine. L'un d'eux entend un soir un bruit suspect derrière sa maison.
"Un voleur, songe t-il, qui vient piller mes fruits".
Il se lève, chargea son fusil et sort. Les branches d'un figuier s'agitent. Il vise, tandis qu'une voix terrifiée s'écrie:
"Ne tire pas, mon oncle. C'est moi... Ahmed !,,.
"Trop tard, répond l'homme, j'ai déjà mis en joue". Il fait feu. L'enfant s'effondre.
Soins à distance.
Le défilé se poursuit devant le Cheikh. Maintenant c'est une fillette qui porte un plat creux. Timide, elle s'exprime en un murmure. Dans un douar voisin un accouchement s'annonce. Le marabout inscrit une sentence au fond du plat. L'enfant s'échappe aussitôt. Elle versera de l'eau pour délayer l'encre. La parturiente boira la potion. Et souffrira moins, paraît-il.
Fidèle à la tradition, Sidi Bénamar n'hésite pas en effet à délivrer talismans et protections. Au nom de Dieu. Certaines de ses formules ressemblent à des grilles de mots croisés. Il rédige des amulettes qui donnent la fécondité aux épouses stériles, calment les névralgies, apaisent les crises de paludisme et les maladies de coeur. Son écriture au fond d'une assiette est considérée comme un remède radical contre la piqûre du scorpion, la morsure du serpent ou celle du chien enragé.
Peu après onze heures un taxi s'immobilise près de la Zaouia. En descend une femme d'une cinquantaine d'années. Une européenne. Soutenue par son fils, elle se déplace à grand peine. Douloureusement. J'assiste au traitement et j'interroge la patiente. Après avoir pris un peu de repos, celle-ci reprend la route avec un fil de laiton à l'oreille droite. Juste avant de monter en voiture elle me laisse un numéro de téléphone. Celui de son magasin à Tlemcen.
Une fois rentré à Oran j'attends huit jours et j'appelle. La malade m'affirme qu'elle va beaucoup mieux, même si sa guérison n'est pas encore complète.
Michel DESCLAUX
(1) Les informations relatives à l'histoire de la Zaouia, à celle de la famille Bénamar et à la transmission du secret sont extraites d'un document rédigé par Yahia Boutemène et intitulé "La Zaouia des Ouled Sidi Bénamar, près de Nédroma" (Editions "La Koutoubia", 11, rue de l'Alliance, Tlemcen). Imprimé en 1950 chez Heintz Frères à Oran, ce texte m'a été remis par le Cheikh au moment où je prenais congé de lui. Cela se passait dans un autre monde, il y a très longtemps...
N.D.L.R
Le cuivre est connu pour ses vertus curatives, sur certains rhumatismes surtout. L'inspiration "géniale" du marabout est d'avoir placé le fil de cuivre dans le tragus de l'oreille (petit morceau triangulaire situé juste en avant de l'orifice externe).
Le cuivre agit vraisemblablement par électrolyse. Il n'est jamais retrouvé par les malades car il se transforme en poussière.
Qu'est devenu Sidi-Bénamar ? Il aurait été assassiné par le FLN ?
Pieds-Noirs de Tlemcen et des environs, à vos souvenirs !
Dikr: incantation.
lmara: gestuelle
|
|
Je vous passe…
Par M. Marc Donato
|
|
Passez-moi le mot et je vous passerai la chose.
Abbé de Lattaignant - Le mot et la chose.
Lisant récemment le dictionnaire amoureux de Marseille de Paul Lombard, le célèbre avocat, j'ai retenu un passage qui a fait remonter en moi ma jeunesse bônoise. L'auteur appelle cela Le jeu de la datte. Paul Lombard se souvient que lorsqu'il était enfant, il s'amusait avec ses petits copains à attendre le passage d'une dame ou d'une demoiselle dans la rue et lorsque le mistral, ce vent fripon, comme aurait dit Brassens, soulevait les robes, il courait placer son pouce à un endroit précis que rigoureusement ma mère m'interdirait de nommer ici (encore Jojo !). Datte ou olive, sucré ou salé, dessert ou apéro, peu importe !
 Chez nous, le jeu consistait à " passer une datte " non pas avec le pouce, mais avec le majeur qui servait de truchement. Un majeur fièrement dressé en érection au-dessus de la paume, le pouce s'appuyant sur l'index. Et pour nous, pauvres gamins qui n'avions ni tablette, ni smartphone, ni Skype, ni Whatsap, pas de télé, bien sûr (mais comment avons-nous survécu ?), ce jeu en valait bien d'autres. Seul Paris Hollywood, passé sous la pèlerine, froissé par les copains précédents, imprimé dans des nuances d'encre orange nous offrait l'image de stars américaines dévêtues et ressortait taché après des exercices manuels qui seuls nous étaient permis (et encore !). Altra tempora, altra mores ! Nous étions plus ignares que dépravés. Chez nous, le jeu consistait à " passer une datte " non pas avec le pouce, mais avec le majeur qui servait de truchement. Un majeur fièrement dressé en érection au-dessus de la paume, le pouce s'appuyant sur l'index. Et pour nous, pauvres gamins qui n'avions ni tablette, ni smartphone, ni Skype, ni Whatsap, pas de télé, bien sûr (mais comment avons-nous survécu ?), ce jeu en valait bien d'autres. Seul Paris Hollywood, passé sous la pèlerine, froissé par les copains précédents, imprimé dans des nuances d'encre orange nous offrait l'image de stars américaines dévêtues et ressortait taché après des exercices manuels qui seuls nous étaient permis (et encore !). Altra tempora, altra mores ! Nous étions plus ignares que dépravés.
Les victimes de nos érections digitales n'étaient pas des jeunes femmes ou des jeunes filles, nous respections ces dames, créatures encore un peu inaccessibles pour nous, pauvres ados ! Mais plutôt nos petits copains à qui il nous arrivait de faire l'affront d'une datte quand on avait un reproche à formuler. Alors après… C'était ce geste insultant qu'il fallait venger, un affront qu'il fallait laver… Toute la conscience méditerranéenne se soulevait en une vague d'indignation que seule une autre datte pouvait effacer. Jeux d'innocents, j'ose le répéter.
Dans le collège prétendument bien pensant que je fréquentais, la sexualité des élèves n'était pas différente de celle des autres élèves d'autres établissements. Les jeux étaient ceux d'adolescents privés de bien des distractions et dont la libido s'éveillait. Un jeu fit fureur à un moment, c'était celui du Gloupier. Vous ne savez pas ce qu'est un gloup ? Pourtant, je vous sais tous capables de faire des gloups. Ne niez pas. Il vous suffit de prendre une boîte de conserve vide, d'y faire quelques trous et de la plonger dans l'eau. Alors ??? Vous entendez bien : ce sont des gloups, gloups, gloups….
Quand je vous disais que ces jeux étaient innocents ! Mais nous avions corsé l'affaire en créant un ordre du gloupier. Un cordon de coton et un petit tube raccourci à 2 cm de hauteur, le fond percé de petits trous, symbolisait la fabrique de gloups. Alors, celui qui avait eu l'honneur pour un temps d'être décoré de l'ordre du Gloupier, le Grand Chancelier, en quelque sorte, présentait le collier à l'entrée du cours d'un certain professeur chahuté pour sa faiblesse à tous ses camarades de classe qui se prosternaient l'un après l'autre devant l'honorable cordon. Pauvre Bibiche ! Bonjour l'ambiance ! Mais revenons à la datte… car il faut un mais… Le jeu a pris un jour un tour politique inattendu. Je m'en souviens très bien. C'était en 1956. Les événements avaient deux ans et le 5 février, le tout nouveau Président du Conseil, Guy Mollet, venu à Alger, était accueilli par une pluie de tomates. Quelques jours auparavant, nous avions inventé un passe-dattes d'honneur, comme nous avions inventé un gloupier d'honneur ! Qu'il fallait être naïfs !!! Innocents, mais imaginatifs.
Vous pensez bien que le dattier d'honneur pour honorable qu'il fût dans sa désignation, n'en était pas moins porteur d'indignité pour celui qui le recevait. L'opprobre public était marqué du saut de l'indignité, du déshonneur, de l'ignominie. Comme dans une course de relais où on se passe le témoin, il fallait fourguer l'engin à un suivant et, avant tout, éviter d'être le suivant afin de ne pas recevoir l'objet en question, mais surtout, il fallait ensuite le refiler à un autre. Pas la moindre inattention, toujours sur le qui-vive, l'œil… et le reste, aux aguets pour éviter la réception. C'est comme ça que ce 5 février 1956, plusieurs gamins ont passé leurs récréations debout, le derrière bien plaqué contre les murs du préau pour se préserver d'une attaque soudaine de ce scud d'avant l'heure. Je revois la scène, tous alignés, bien protégés et le malheureux " dignitaire " en quête d'un derrière distrait, prêt à se débarrasser d'un encombrant passe-dattes. Nous aurions accepté plus volontiers les tomates algéroises.
Souvenirs, nostalgie quand vous nous tenez !!!
C'était notre jeu de la datte à nous, M. Paul Lombard.
Enfin, pour les amateurs de contrepèteries, je ne vais pas manquer de glisser ce classique du genre, puisque j'avais le choix dans la datte ! Mais pour cela, il aura fallu attendre quelques années encore… Comprenne qui pourra !
Avril 2022 - Marc DONATO
|
|
| DIS LEUR, PETIT !
Michel Mitran
Envoyé Par M. Bernard KUGLER
| |
|
DIS LEUR, PETIT !
J'ai aimé avec passion cette terre où je suis né, j'y ai puisé tout ce que je suis, et je n'ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent, de quelque race qu'ils soient.
Bien que j'aie connu et partagé les misères qui ne lui manquent pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l'énergie et de la création.
Albert Camus, Appel pour une trêve civile en Algérie 22-01-1956
Toi, oui toi ! Le petit "Pied-Noir", qui reste accroché à ton mouchoir et qui, depuis 62, l'agite comme pour dire au revoir !
Ta terre n'est plus en vue. Depuis longtemps ! C'est foutu !
Tu ne reverras plus chez toi, ni les douars, ni Lakhdar. C'est trop tard.
Ton bateau est ancré au milieu de nulle part.
Autour de toi il n'y a qu'horizon. Va falloir te faire une raison.
Les années ont passé, va falloir accoster, et pour toujours tirer un trait.
Tu t'es trop attardé, tes yeux se sont usés sur cette ligne imaginaire qui t'a fait espérer.
Même la Vierge Noire n'a rien pu faire pour toi.
Ni pour eux. Ces "autres" qui sont partis, assommés de chagrin, pour mourir dans un coin.
Il n'en reste pas beaucoup, vous n'êtes plus très nombreux.
Je crois même que tu es un des rares survivants à être né "là-bas".
"Là-bas" c'est ce pays synonyme d'abandon, de départ et d'adieu.
Alors ne reste pas là ! Et viens nous raconter, El-Biar, les Aurès, Cap Falcon et Oran.
On écoutera même cet Alger LA BLANCHE, le pont sur le Rummel, et Bône si t'as le temps !
Les belles orangeraies, les fruits du Père Clément.'
Et le Mascara rouge sur la table le dimanche.
Je te préviens quand même, l'histoire de gens heureux n'intéresse pas grand monde.
Mais quand tu vas parler, on va lire ton regard, embrumé comme Tahat au sommet du Hoggar.
On va enfin comprendre ce qu'est être amoureux.
On sera d'abord deux, toi et moi si tu veux, et puis ils vont venir, les enfants, revenir, les aïeux, attirés par tes yeux brillants de mille feux.
Alors ne reste pas au milieu du néant. Ne laisse pas n'importe qui raconter n'importe quoi ! Jette-le ce mouchoir !
Pour que le monde sache ! Pour tous ceux qui sont morts... Pour ne pas qu'on oublie.
Dis-leur que "là-bas" a un nom !
Celui d'un beau pays qui s'appelle Algérie.
Orphelin d'un autre beau pays, ce foutu pays de France.
Et comme disait Camus : de l'Algérie on ne guérit jamais.
Michel Mitran
|
|
|
|
LE MUTILE N° 134 du 28 mars 1920
|
EDITORIAL
Je me souviens du temps, camarade Russe, où tu défilais en grande pompe sur les grands boulevards, le 14 juillet 1016. Les fleurs pleuvaient sur toi. Tu étais alors l'enfant gâté de tous les bonshommes français, le préféré parmi l'immense cohorte des mercenaires alliés, celui dont on parlait comme, d'un vieux cousin éloigné qu'on se sentait heureux d'avoir enfin auprès de soi. On admirait ton uniforme vert, ton grand corps de géant blond, musclé et souple, ton regard lointain, tes danses cadencées, tes chants mystiques. Les gens bien informés prétendaient que tu ne connaissais que deux choses au monde : ton isba et ton petit père le tsar. Et cette preuve immense de ton intelligence suffisait à les emplir d'orgueil.
Plus tard, quand on connut tes faits d'armes, ton héroïque sacrifice lors de l'attaque de Brimon, le 16 avril 1917, l'enthousiasme ne connut plus de limites. Au fait, ne t'avait-on pas fait sortir par erreur vingt minutes avant l'heure, ce qui permit aux obus français de parfaire l'ouvrage si bien commencé par les mitrailleuses allemandes.
On parlait alors de te faire défiler sous ce fameux arc de triomphe qui vit s'accomplir le miracle équestre de Joffre sur un cheval blanc. On parlait de graver ton nom sur les marbres du Panthéon. On agitait autour de toi ce grand encensoir tricolore qui pue si terriblement le cadavre.
On était fier de tes souffrances, fier de ta mort, ma parole, aussi fier, je t'assure que de celle d'un des nôtres.
Et puis, un jour, tu as eu la mauvaise idée de refuser de te battre pour une cause que tu prétendais ne ressembler que très peu à celle de ta Justice et de la Liberté ! Tu as chassé les officiers incapables et débauchés qui le déshonoraient et qui le trahissaient. Etait-ce possible ! Et tu as eu l'audace de demandé à rentrer chez toi où l'on avait besoin de tes bras, pour mettre à la porte la cohue des profiteurs rapaces, qui pendant ton absence, dévalisaient la maison.
Du coup, tu n'as plus été ni l'ami ni le frère. Comment, en pleine guerre, prétendre qu'il serait temps de songer à la paix ! déposer le fusil et les grenades pour reprendre la bêche et, le marteau. Insensé ?
De combien d'injures n'a-t-on pas couvert ceux qui, plus fortunés que loi, étaient restés en Russie. Mais puisqu'on ne pouvait rien encore contre eux, du moins allait-on se rattraper sur toi. On le tenait, ton compte était bon. On te chargea de chaînes. On t'enferma dans les prisons, on t'envoya dans les bagnes algériens, au Maroc. Tu servis à toutes les besognes, à toutes les domesticités. Pour un peu on t'aurait arraché les yeux et les ongles, flagellé publiquement, déchiré en lambeaux, comme autrefois les Carthaginois firent pour Mathô.
Et depuis trois ans on te fait trimer comme une bête de somme, et si tu n'es pas crevé à la tâche, c'est que tu as la peau dure, malgré la faim qui te mord aux entrailles, et tes joues creusées par la fièvre et les privations.
Mais voilà, au moment où l'on espérait enfin te voir claqué, tu te relèves encore et il se trouve des Français pour te tendre la main, pour te secourir, pour l'embrasser...
Au poteau cette fois-ci et vite, car le temps presse.
LE REVENANT.
|
|
PHOTOS de CONSTANTINE
Envoyé par Diverses personnes
|
BENI RAMASSE

HÖTEL DE VILLE

MANSOURAH

PALAIS DU BEY

PLACE DU PALAIS

PLACE NEGRIER

|
|
| Les Poireaux sauvages
du Campo Santo.
|
C'était à La Calle pendant la guerre 1939/45...
A cette époque troublée, la nourriture était rationnée et bien rare pour la population Calloise, qui, courageusement depuis des années, tentait désespérément de survivre par tous les moyens, y compris ceux offerts par la nature généreuse du Bastion de France.
C'est ce qui devait arriver à un jeune et hardi adolescent : un enfant du pays, qui l'avait bien compris depuis longtemps et qui faisait montre à cet égard, de la meilleure des volontés en essayant autant que faire se peut, d'aider la famille par quelques initiatives d'une rare spontanéité.
C'est dans cet esprit qu'il est parti un jour pêcher sur les rochers en bas du cimetière, en caressant secrètement l'espoir de capturer quelques poissons, pour agrémenter le souper de la familial. A l'évidence, la démarche du garçon était très louable, mais ce jour-là les poissons boudaient dans leurs coins et la pêche fût d'une incroyable tristesse, si bien que dans l'après-midi le jeune homme prit le chemin du retour, qui de bas en haut traversait tout le cimetière.
Il venait à peine de commencer à gravir les pentes du Campo Santo, lorsque ses sens toujours en éveil, lui révélèrent un bruit léger et continu qui venait de quelque part. Intrigué et curieux comme toujours, il arrêta sa progression pour essayer d'en déterminer la cause. C'est alors qu'il tomba rapidement en arrêt sur une fontaine, dont le robinet qui fuyait doucement, avait largement humidifié le sol avoisinant.
Mais, Ô miracle ! Il n'en crût pas ses yeux !
Au pied de la fontaine, un épais tapis de poireaux sauvages jonchait le sol à portée de main. Quelle aubaine en ces temps de restriction, pensa-t-il, tout heureux de ce présent tombé tout droit du ciel. Alors sans perdre de temps, d'une main douce et légère, le petit Callaïoun fit ce jour-là des poireaux sauvages, la plus belle des récoltes, que sans tarder et fier de lui il devait ramener à la maison.
Un festin champêtre était donc de circonstance !
Le soir au souper et servis à discrétion avec une bonne vinaigrette, les poireaux sauvages firent le bonheur de toute la famille. A la vérité ce ravitaillement inopiné, avait enchanté tous les convives et le jeune homme était en passe - de recevoir l'oscar du meilleur poireau sauvage de la journée.
Du moins le pensait-il, lui, qui d'habitude, recevait surtout en guise de récompense, de magistrales volées maternelles pour quelques espiègleries dont il avait le secret.
Le repas tirait presque à sa fin, lorsque la mama demanda à son fils - l'origine géographique de sa récolte ?
Explication simple et facile puisque de tous, le lieu étant bien connu, le jeune homme indiqua naïvement que ces succulents poireaux sauvages, poussaient en abondance au pied d'une fontaine dans le cimetière.
Dans le cimetière ! ? Demanda la mama.
Oui, oui ! En bas du cimetière au milieu des tombes... Répéta le jeune homme.
Autour de la table familiale un silence pesant tomba soudain… A présent, tous les regards étaient braqués sur l'infortuné héros. Manifestement et à n'en pas douter, une violente tempête s'annonçait dans la maison !
En effet, furieuse et offusquée à l'extrême, la mama tout à coup s'est brusquement levée, pour s'approcher du gamin qui déjà relevait ses deux bras, pour tenter de parer les taloches maternelles.
En guise de félicitations, la mama très en colère lui cria dans les oreilles:
Espèce de petit saligot ! tu nous as fait manger des poireaux sauvages - qui ont poussé avec le jus des morts
C'était peut-être vrai, mais lui le pauvre il n'y avait même pas pensé !
Il est vrai qu'à force de faire des bêtises de tout bord, la mama a dû croire que pour rigoler, son rejeton avait monté de toutes pièces l'opération " poireaux sauvages " et que par conséquent, une correction urgente s'imposait.
Et comme de bien entendu, cette histoire a dû se conclure à coup de louche sur la caboche !
Un de ces jours, il faudra bien que je lui demande !
Jean-Claude PUGLISI.
de La Calle de France
83400 - HYERES.
|
|
|
NEIGE EN ALGERIE
Envoyé par M. Louis Aymés
|
Le Bien Public Dijon 14- 15 février 1953

|
Algérie catholique N°2, 1936
Bibliothéque Gallica
|
Sainte Jeanne d'Arc
Gardienne de l'unité française
Conférence prononcée à la Cathédrale d'Alger, le dimanche 10 mai 1936, par le R. P. Bliguet, et applaudie par l'assistance entière malgré la sainteté du lieu).
Tous les partis la réclament, toutes les familles spirituelles de la nation la veulent, Sainte Jeanne d'Arc, car elle est à tous, elle est "bien nationale " et trésor commun de tous les Français.
Dans sa prodigieuse carrière, si courte et si féconde, je veux souligner un trait, rien qu'un, mais souverainement important : elle fut et demeure l'assembleuse de toutes les terres de la Patrie, le lien doux et fort - puisse-t-il n'être jamais rompu - de l'unité française.
Lien du peuple et des grands. Masse énorme de pierres vivantes jointes pour le travail, et trop souvent, hélas, cimentées dans la misère, le peuple porte sur ses assises toute la bâtisse sociale. S'il bouge, tout l'édifice tremble, s'il se révolte et se soulève, tout menace de s'écrouler. C'est de ces masses profondes que sortit Sainte Jeanne. Peuple, elle est par son origine, humble et modeste travailleuse comme tant et tant de jeunes filles de France. Peuple aussi par sa vue positive et diverse des choses, son ignorance de toute littérature, son robuste bon sens et sa joyeuse simplicité. Le peuple, qui avait tant prié pour qu'elle apparût, qui l'attendait avec une espérance si passionnée, la reconnut tout de suite, et du peuple lui vinrent ses premiers fidèles.
Au moment même où Jeanne était à Poitiers, sévèrement examinée par un tribunal de théologiens, le grand Jubilé de Notre-Dame du Puy avait attiré de toutes parts des foules si compactes que trente-trois personnes périrent étouffées dans les remous de ce fleuve humain ! Guidé par ce mystérieux et puissant instinct qui le mène aux grandes heures de son histoire, le peuple de France reconnut tout de suite en elle sa libératrice. Et partout où elle se montrait les masses populaires se portaient vers elle, d'un élan spontané et irrésistible. Le journal du siège d'Orléans nous décrit cette ferveur populaire en traits inoubliables.
" Ils se sentaient tous réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur avait dit être en cette Pucelle, qu'ils regardaient moult affectueusement, tant hommes et femmes que petits enfants. Et il y avait très merveilleuse presse à toucher au cheval sur lequel elle était... Ils ne pouvaient se saouler de la voir. " Et elle-même, c'était merveille de voir à quel point elle aimait le peuple. "Que voilà un bon peuple, disait-elle ! "
Et, en plein procès de Rouen, elle eut, devant la cruauté de ses juges ce mot charmant de tendresse et de mélancolie : " Ils venaient volontiers vers moi parce que je ne leur faisais pas déplaisir et les aidais selon mon pouvoir."
Cette amitié profonde et réciproque du peuple d'autrefois pour Jeanne et de Jeanne pour le peuple justifie les revendications du peuple français d'aujourd'hui : Jeanne est nôtre, dit-il, qu'on nous la laisse !... Doucement, mes amis, elle est des nobles aussi. Elle eut, dans la noblesse de son temps, d'illustres et précieuses amitiés. Les Seigneurs Guy et André de Laval, qui écrivaient à son sujet des lettres d'admiration enthousiaste. Le duc d'Alençon qu'elle appelait son beau duc, pour lequel elle avait une exquise affection et qui la lui rendait bien. Le Dauphin Charles, qui, malgré son caractère hésitant et pénible, lui donna des marques indubitables de déférente confiance et pour lequel elle conserva jusqu'au bout un affectueux loyalisme. Il ennoblit la famille d'Arc... Etait-ce nécessaire ? Jeanne émerveillait la Cour et les Grands par la noblesse exquise de sa conversation, par la distinction de son attitude.
On l'eût dite en vérité de sang royal. De fait il y a tant de grandeur dans l'histoire du peuple de France que l'on peut bien dire du plus humble des Français qu'il a du sang de roi dons les veines. Qui, plus qu'elle, en aucun temps, assemble plus habilement, plus solidement grands et petits pour une même tâche.
Cette grande œuvre de liaison elle la fit entre les partis eux-mêmes. Envahie par l'étranger, la France était divisée, littéralement dépecée et déchirée en partis contraires. Ce n'était point l'affaire de l'héroïne. Elle voulait toute la France unie. Elle n'a point dit que je sache la formule célèbre : union sacrée... mais elle a fait la chose. Le baron de Montmorency avait pris parti contre le roi. Gagné par le charme exquis de la sainte, conquis par la grandeur sublime de sa mission, il vint se mettre à son service avec soixante gentilshommes, et ces dissidents se fondirent dans l'unité nationale. Plus significative encore est l'aventure du connétable de Richemont. Il avait à la Cour, en la personne de La Trécuville, un implacable ennemi. Cette inimitié avait jusque-là suffi à le maintenir hors des rangs de ceux qui besognaient pour la France.
Mais son cœur dur fondit aux rayons de celui de Jeanne. Pendant qu'elle faisait campagne sur la Loire, il vint se mettre sa disposition, sacrifiant au bien public ses rancunes personnelles. C'était un renfort considérable : il amenait quatre cents lanciers et huit cents archers, bien entraînés et bien aguerris. Mais tout le monde le savait en état de révolte ouverte contre le roi. Défense avait été faite aux capitaines de le recevoir. En conséquence le duc d'Alençon déclare tout net qu'il quitterait l'armée plutôt que de le recevoir. Mais sainte Jeanne intervint énergiquement et réussit à tout apaiser. Richemont supplia la Pucelle d'obtenir grâce du roi, elle promit. Elle lui fit jurer, en présence des autres capitaines et du duc d'Alençon qu'il servirait désormais fidèlement le Souverain et, en lui, la France.
Elle exigea que le duc d'Alençon et les Seigneurs présents se portassent garants de sa fidélité, par acte signé, ce qui fut fait. La bataille de Patay se préparait. Les troupes de Falstaff n'étaient pas loin. " Ah, s'écria Jeanne, beau connétable, vous n'êtes pas venu de par moi. Mais, puisque vous êtes venu, soyez le bienvenu ! " Magnifique parole et qui traduit, de façon si émouvante une vérité française de toujours et particulièrement d'aujourd'hui.
Je l'imagine, la chère sainte, combattant aujourd'hui de nouveau pour l'unité de la nation. Elle dirait aux partis qui s'affrontent, elle crierait aux uns : Croix de feu, mes frères... Aux autres : frères socialistes et communistes, reconnaissez-vous les uns les autres, à l'ardeur même, à la bravoure acharnée que vous mettez à vous combattre ; vous n'êtes pas venus de par moi, mais puisque vous êtes venus, soyez les très bienvenus et besognons tous ensemble.
Assembleuse aussi fut-elle de toutes les provinces françaises. Son grand cœur unissait, dans un fraternel amour, la Bretagne à la Flandre, la Touraine à la Bourgogne. Les habitants du Tournaisis lui furent acquis dès l'origine et lui demeurèrent fidèles jusqu'au bout. Le duc de Bretagne resta d'abord dans son isolement, se contentant de vagues promesses qu'il ne tenait pas. Peu à peu l'attirance de la Sainte guerrière le conquit. Et il lui Envoya toute une armée. La lettre par laquelle Jeanne apprend à ses chers Tournaisiens la nouvelle est justement célèbre : " Vous aurez bientôt de mes nouvelles plus à plein. Autre chose à présent ne vous écris.
Sinon que toute Bretagne est française et doit le duc envoyer au roi trois mille combattants, payés pour deux mois. " Toute Bretagne est française... Et peut-on dire, après le passage de la sainte, toute Champagne, toute Ile-de-France, plus tard, par le miracle de son intervention, toute Bourgogne. On eût dit que la terre même la reconnaissait et lui faisait bon accueil.
Oui, sous ses pas, la terre française tressaillait, du granit breton aux grasses plaines flamandes, des douces collines de l'Ile-de-France aux rudes montagnes d'Auvergne, joyeuse de porter l'héroïque chevauchée de la libératrice et de l'assembleuse.
Sur sa personne, enfin, s'unissent les deux pouvoirs qui se partagent la responsabilité de l'ordre, l'Eglise, gardienne de l'ordre spirituel, l'Etat gardien de l'ordre temporel. Jeanne forte, au milieu des pires embûches, fidèle toujours soumise à l'Eglise et au "Pape de Rome " comme elle disait. Et jamais, en aucun temps, si merveilleuse "citoyenne " n'honora de son loyalisme l'Etat français.
Pourtant, dites-vous, l'Etat ni l'Eglise ne lui furent très tendres. L'évêque Cauchon la condamna. Le roi Charles VII l'abandonna. - Cauchon ne représentait pas l'Eglise et n'avait point mandat officiel ni officieux pour juger et condamner la prisonnière de Rouen. Aveuglé par son ambition, il était au service de l'Angleterre, ce qui ne lui conférait aucun droit de présider le procès d'une Française.
L'Eglise, un peu plus tard fut saisie officiellement de la cause. Et alors ce fut une sentence de réhabilitation, préludant à la béatification et à la canonisation solennelle. Dans ce procès glorieux le roi Charles VII eut un rôle effacé mais très actif et ainsi, en contribuant à réhabiliter Sainte Jeanne, il se réhabilita lui-même quelque peu. La réhabilitation de Jeanne est donc l'œuvre commune de l'Eglise et de l'Etat. Ainsi, continuant du sein de la Béatitude son œuvre Sainte Jeanne devint, et demeure lien de sympathie et d'action commune entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux.
Oh, n'interrompez jamais votre sublime besogne. Demeurez le lien d'indestructible amitié entre toutes les familles spirituelles de la Patrie. Guidez-nous. Aidez-nous, jusqu'à ce qu'il n'y ait, de Brest à Strasbourg et de Calais à Perpignan qu'une seule France aimée ; de Casablanca à Tunis, d'Alger à Tombouctou qu'une seule France cadette, pour les siècles des siècles !
R.P. BLIGUET,
des Frères prêcheurs.
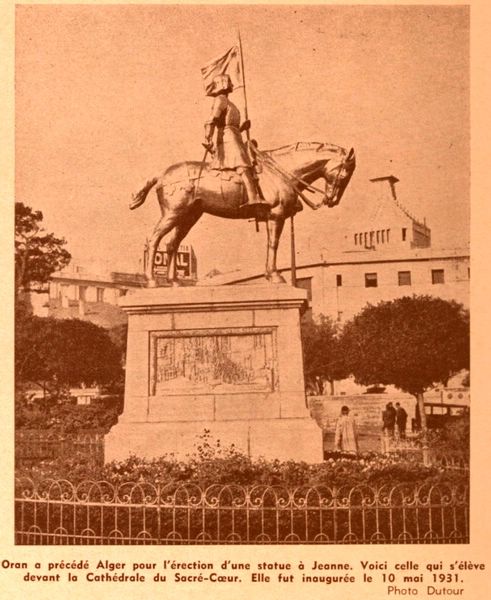
|
|
|
Piqûre de Rappel -Soixante après
Par M. Alain Algudo avril 2022
|
|
ABOMINATION !!
Avril 62 - Avril 2022
"Avril 62, Daniel, un Français, fait son service dans la Marne. Il se voit confier la mission de ramener en Algérie des harkis réfugiés en France depuis plusieurs mois.
Témoignage :
" Nous les avons descendus jusqu'au port de Marseille dans les fameux camions FIAT et lorsqu'on est arrivé, on a vu arriver d'autres camions qui venaient de plusieurs villes de France dont Tours, Orléans et Clermont-Ferrand et qui transportaient, aussi, des harkis à renvoyer en Algérie. On s'est retrouvé avec 400 ou 500 harkis. On a eu beaucoup de mal à les canaliser pour les faire monter dans le bateau, le soir même sur " Le ville d'Alger ". C'est sûr que là, il y en a qui reculaient… Il y a eu des regards qui étaient terribles…
On a passé avec difficulté la nuit de la traversée parce qu'ils ne voulaient pas rentrer. C'était une décision militaire et politique à laquelle, nous, nous étions obligés d'obtempérer. D'ailleurs, on nous a imposé un comptage régulier de l'effectif la nuit, pendant le voyage en mer. On n'avait jamais le même nombre. On ne savait pas forcément où ils étaient.
La traversée de nuit a été angoissante parce qu'il y avait là plusieurs centaines de types couchés, debout, accroupis dans des conditions pas toujours très propres et nous avions une trouille terrible car nous étions seulement une dizaine d'hommes de troupe et trois sous-officiers pour tout ce monde. S'ils s'étaient rebellés, je l'aurais compris.
On sentait chez ses hommes une certaine rancœur. Ils étaient prêts à se révolter. Avec un copain sous-officier, on a vraiment eu la trouille et ça nous prenait aux tripes. Les harkis nous disaient mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ils nous renvoient ?
Et le problème est que nous avions les PM (des pistolets mitrailleurs) armés. Nous les avions parce que c'était un ordre. S'il avait fallu tirer… J'avais 20 ans et je ne sais pas ce que j'aurais fait… Je n'aurai sûrement pas tiré… mais avec la peur ?... On ne sait jamais quelle attitude adopter dans ce genre de situation surtout à 20 ans… On a eu la trouille parce qu'on a senti une espèce de haine… On était devant un fait…
Ce qui a été terrible, c'est lorsqu'on les comptait dans la nuit et que l'on ne retrouvait pas un que l'on avait repéré, on nous disait" Il n'est plus là… ". On demandait " Mais il est où ? ". On nous répondait : " Il a sauté du bateau ". Je répliquais " Ce n'est pas possible ! ". On avait du mal à croire qu'ils s'étaient suicidés. Lorsqu'on était au trois quart du voyage, on s'était rendu compte, qu'il en manquait vraiment… On ne pouvait pas dire le nombre exact parce que c'était une ruche… Ça bougeait de partout dans la cale… On était ébahi, étonné que plusieurs aient sauté dans l'eau… C'était très triste…
J'ai voulu raconter cette expérience. C'était une injustice, même à l'époque… Et pourtant on ne parlait pas de politique à 20 ans… Mais cette injustice… Que de Gaulle prenne la décision de renvoyer des harkis, des gars qui normalement nous ont aidés certainement du mieux qu'ils pouvaient et de leur avoir promis de les loger, de les accueillir puis les renvoyer six mois après… Moi, j'ai trouvé ça, là maintenant, parce qu'à l'époque je ne savais pas… pour être clair…
J'ai trouvé ça dégueulasse… C'est pas normal, … C'est tout !
Nous sommes arrivés à Alger dans la matinée et ils ont été débarqués purement et simplement. Et là, vogue la galère, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. On n'a jamais eu de nouvelles particulières.
En fait on n'a pas su ce qu'ils sont devenus. Je sais, qu'il y en a qui m'ont dit en sortant que de toute façon ils auraient forcément le sourire kabyle (la gorge tranchée) dans très peu de temps. Ce qui était clair. Nous, on connaissait bien l'expression… A 20 ans, on ne mesurait pas…".
Le témoignage complet de Daniel est à retrouver dans le numéro 666 de la revue " Les Temps Modernes " de décembre 2011. "
LE MASSACRE DES HARKIS
Ce qu'ils sont devenus. Lettre de Voltaire.
"Loin d'oublier ces temps abominables, il faut les remettre fréquemment sous nos yeux"
Privés par les Accords d'Evan de la nationalité française , dépouillés de leurs armes, sans protection de l'armée française qui a reçu l'ordre express de ne pas intervenir pour leur porter secours, isolés dans leurs villages au sein d'une population souvent hostile, les harkis sont à la merci de l'ALN (Armée de Libération Nationale), dont les troupes qui étaient stationnées en Tunisie et au Maroc, entrent en Algérie, après l'intervention du cessez-le-feu du 19 mars 1962. En nombre et avec leurs armes. Dans un premier temps, le nouveau pouvoir algérien alterne promesses d'amnistie et menaces. Puis les sévices, les assassinats, les enlèvements commencent, souvent du fait des "Marsiens", combattants de la 25ème heure qui veulent racheter leur passivité antérieure. Les harkis sont arrêtés et abattus. En masse, lors des deux principales vagues de répression en été et en automne 1962. Quelquefois par unité entière, par village entier, par famille entière, les femmes et les enfants n'étant pas épargnés. Les massacres perpétrés sont d'une barbarie et d'une ampleur sans précédent.
L'HORREUR DES MASSACRES
Les supplices qui précédent la mort sont d'une cruauté inouïe et peuvent durer plusieurs heures, quelquefois plusieurs jours : corps ébouillantés, dépecés, enterrés ou brûlés vifs, énucléations, membres découpés en lanières et salés, anciens combattants contraints d'avaler leurs médailles avant d'être brûlés vifs dans le drapeau français....
Selon des témoignages rapportés par Camille Brière "certains harkis furent crucifiés sur des portes, les yeux crevés, le nez et les oreilles coupés, la langue arrachée, systématiquement émasculés... D'autres furent dépecés vivants à la tenaille, leur chair palpitante jetée aux chiens... Quant aux familles, voici ce qui les attendait : des vieillards et des infirmes étaient égorgés, des femmes violées puis éventrées, des nourrissons, des jeunes enfants avaient la tête écrasée contre les murs sous les yeux de leur mère..."
Dans un compte-rendu destiné à sa hiérarchie, M. Robert, sous-préfet en poste à Akbou, arrondissement situé en Kabylie, dresse de façon précise et détaillée la chronique macabre des exactions - supplices, assassinats, enlèvements, viols collectifs, enfermement dans des camps - subies par les harkis et leurs familles dans sa circonscription après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, jusqu'à la fin décembre 1962.
Il note parmi les victimes "la proportion non négligeable de civils qui est de l'ordre d'un tiers, constitué d'élus de tous rangs, de chefs de villages, d'anciens combattants..." . S'agissant d'un document officiel, établi par un haut fonctionnaire concernant des faits dont il a été amené à avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être soupçonné d'exagération.
L'aspect cathartique des massacres est souligné par Mohand Hamoumou : "la plupart furent humiliés et torturés publiquement, longuement avec un luxe de raffinement dans l'horreur. La mort était une délivrance, d'où la recherche de morts lentes pour faire durer l'expiation. Le supplice est destiné à rendre infâme celui qui en est la victime et à attester le triomphe de celui l'impose. Plus le doute est permis sur le l'infamie de l'accusé plus le supplice doit être démesuré pour persuader l'assistance de la culpabilité de la victime".
D'autres sont faits prisonniers et enfermés dans des camps , dans lesquels la Croix Rouge recensera, en 1965, 13 500 personnes.
Certains seront employés à des taches dangereuses telles le déminage, à mains nues, avec une jambe coupée préventivement.
D'autres enfin sont enlevés : ce sont ainsi des milliers de harkis et de pieds-noirs qui disparaissent dès après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, puis au cours des deux principales vagues de répression qui interviennent en été et en automne 1962, et de celles qui interviendront plus tard entre 1963 et 1966. Sans que les autorités françaises pourtant souvent informées des lieux de leur détention ne s'en inquiètent, et donnent même des ordres pour qu'aucun secours ne leur soit apporté (6), et pour que soient sanctionnés ceux des militaires, souvent anciens responsables de SAS, qui de leur propre initiative, achemineront leurs hommes et leurs familles vers la métropole et vers le salut . Et pour que soient chassés des bateaux les harkis qui auront embarqué clandestinement, et renvoyés en l'Algérie ceux qui seront parvenus à rejoindre clandestinement la France...
L'AMPLEUR DES MASSACRES : 150 000 VICTIMES
Les chiffres peuvent toujours donner lieu à controverse. Il est cependant possible d'avancer le nombre de 150 000 victimes, en s'appuyant sur différentes estimations rappelées notamment par Abd-El-Azziz Meliani, et par Mohand Hamoumou : celle du service historique des armées qui, dans une note officielle en 1974, estime à environ 150 000 le nombre des harkis et leurs proches disparus ou assassinés ; celle du chef du 2ème bureau à Alger qui retient également ce chiffre de 150 000 ; celle de monsieur Robert, sous-préfet d'Akbou, qui dans le compte-rendu officiel où il relate les faits survenus dans son arrondissement après le cessez-le-feu, fait état de 2000 victimes en moyenne par arrondissement, soit 150 000 environ pour les 72 arrondissements algériens (3) ; celle de l'historien Guy Pervillé qui situe ce chiffre entre 30 000 et 150 000 ; celle d'Anne Heinis qui, dans un mémoire de 1977 sur l'insertion des français-musulmans (10) situe également ce chiffre entre 30 000 et 150 000 ; celle enfin d'André Santini Secrétaire d'état aux Rapatriés en 1986-1988 qui, pour les harkis et les pieds-noirs massacrés ou disparus au moment de l'indépendance de l'Algérie, donne les chiffres de 150 000 et 10 000.
Dans un rapport officiel de mai 1962 le contrôleur général monsieur de Saint-Salvy a pu écrire : "les crimes de guerre commis en Algérie depuis le 19 mars 1962 sont sans précédent depuis la dernière guerre mondiale, dépassant tout ce qui avait pu être constaté en Asie ou en Afrique noire" (10). De ces crimes de guerre, l'état français s'est rendu coupable de complicité par sa passivité volontaire, alors qu'il connaissait parfaitement la situation et qu'il disposait encore des moyens militaires suffisants en Algérie pour protéger et secourir ses ressortissants.
Raphaël DELPARD a enquêté sur le drame de ces 25 000 français enlevés et jamais retrouvés.
Communiqué pour ceux qui se réfèrent encore aujourd'hui à DE GAULLE.
Alain ALGUDO ex Président CDFA/UCDARA
- ex Vice Président de VERITAS
|
|
| STAOUELI
Envoi de M. Christian Graille
|
|
Histoire du monastère de la Trappe de Staouéli
Le 10 août 1843, deux Trappistes s'embarquaient à Toulon à bord de l'Etna. La traversée fut heureuse et, cinquante heures après, la svelte frégate entrait fièrement dans la rade d'Alger, Alger la Blanche (Djezaïr-el-bahadja), d'Alger désormais la bien gardée !
Dans notre jeune colonie, que venaient faire ces deux religieux ? …
Tout simplement planter dans une plaine inféconde et stérile une modeste croix.
Mais l'un de ces deux religieux s'appelait Dom François Régis, la plaine avait le nom de Staouéli, et, sur la croix de bois plantée par les deux Trappistes, allaient bientôt venir s'attacher, courageuses abeilles, le premier essaim de la ruche d'Aiguebelle.
Mille hectares étaient concédés, soixante-deux mille francs prêtés, cinquante condamnés militaires promis et, sur l'ancien champ de bataille allait bientôt flotter le pacifique étendard des enfants de Saint Benoît.
On allait fonder une Trappe, ce vivant symbole du travail, de la prière et de la charité. Le R. P. François Régis était venu le 18 août visiter l'emplacement du futur monastère, le surlendemain il revint le bénir.
Sous les mouvants arceaux des vieux palmiers qui contemplèrent notre gloire, un humble hôtel de gazon est dressé ; la voûte azurée du ciel lui sert de tenture, des tronçons de palmes supportent les flambeaux.
Dom Régis asperge d'eau bénite et purifie ces lieux souillés par l'infidélité revêt les ornements sacrés, et avec le sacrifice de lui-même et de ses futurs compagnons, offre à Dieu la victime dont le sang divin doit féconder et rendre méritoires :
- leurs travaux, leurs privations, leurs souffrances.
Cette touchante cérémonie s'achève et déjà l'on voit poindre la petite armée de travailleurs que l'on attendait.
- Sept sapeurs du génie,
- des condamnés militaires,
- des surveillants, précèdent plusieurs voitures chargées d'objets de campement et d'outils indispensables.
Les tentes sont dressées, le soir tombe, et la fumée des bivouacs monte vers le ciel en spirales blanchâtres.
Le lendemain, 21 août, l'aube naissante voit tout le monde au travail.
- Les charpentiers construisent des baraques,
- les maçons se mettent à la recherche des carrières de pierre, de sable ;
- ceux-ci défrichent,
- ceux-là nivèlent le sol,
- d'autres enfin creusent les fondations du nouveau monastère.
Quelle vie, quelle animation dans cette plaine, il y a deux jours encore si morne et si déserte. Un mois se passe, et les premiers frères d'Aiguebelle arrivent, et la première pierre de Notre Dame de Staouéli est posée. Cette pierre repose sur un lit de boulets recueillis par les ouvriers sur l'ancien champ de bataille.
Sa place est aujourd'hui dans la partie du cloître qui longe l'église, et sous la statue de la Mater Dolorosa qui s'y trouve.
Elle fut posée le 14 septembre 1843, pour de l'Exaltation de la Sainte Croix, par Monseigneur Dupuch, premier évêque d'Alger, en présence de S E le maréchal Bugeaud gouverneur général de l'Algérie, et d'autres notables d'alors.
Quant à ces frères d'Aiguebelle qui furent les premiers au péril, il est juste qu'ils soient les premiers à l'honneur. Voici leurs noms :
- R. P. Jean-Marie et P. Hilaire, religieux de chœur, FF. Jacques, Camille, Symphorien, Mathieu, Dorothée, Mathias, frères convers, FF. Casimir, Maxime, Rémy, Abraham, novices.
Les constructions avancent rapidement mais la question du défrichement n'est pas encore abordée. C'est le but principal à atteindre et, pour ne le jamais perdre de vue, le R.P Dom Régis prend une plume et, en tête d'un registre, écrit ce qui suit :
Colonie de Staouéli
Au nom de Dieu et de Marie est commencé le présent livre.
" Ce que je me propose d'enregistrer ici, jour par jour, et année par année ce n'est pas l'histoire du monastère de Staouéli, c'est uniquement le détail des travaux agricoles exécutés sur la concession faite aux Trappistes par le gouvernement. Ce qui me détermine à en tenir une note exacte, c'est :
1° Que l'acte par lequel le territoire de Staouéli a été concédé aux Trappistes, les obligent à exécuter des travaux de différentes natures, de telle sorte que la propriété, possession et jouissance définitive de ces terrains ne pourra leur être adjugée que lorsque ces travaux auront été terminés.
2° C'est qu'ayant reçu de l'administration des subventions de plusieurs sortes, je puisse au besoin prouver que les Trappistes n'ont rien négligé pour seconder sa bienveillance, et qu'ils ont mis à profit tous les moyens dont ils ont pu disposer pour donner à leur domaine toute la valeur possible, en retirer des revenus proportionnés à leurs efforts, se rendre utiles à la colonie et répondre par-là aux vœux du gouvernement ;
3° Enfin je veux en ayant constamment sous les yeux ce qui aura été fait, mieux juger de ce qui restera à faire, et, par-là m'encourager moi-même aussi bien que les enfants que la Providence a rassemblé autour de moi, à parvenir au plus tôt à cet état désirable que Saint Benoît signale dans sa règle lorsqu'il dit :
" Mes disciples seront véritablement moines, alors qu'ils vivront du travail de leurs mains comme nos pères et les Apôtres."
Et voilà que ce journal des travaux des champs enregistre, avec la naïve simplicité des vieux âges les héroïques efforts de la lutte engagée entre la lande sauvage de l'islam et la charrue chrétienne. Plus on avance dans la lecture de ce biblique récit, plus on est émerveillé.
La terre est couverte de marais stagnants et pestilentiels : vite on ouvre de larges fossés pour l'écoulement des eaux, on capte, on dirige les sources ; le palmier nain résiste à la pioche : on invente des scarificateurs ; des roches s'opposent au passage de la charrue ; on les fait sauter à coup de mine, et les bœufs, pliés sous le joug, creusent sans cesse un nouveau sillon.
Et le grain tombe dans une bonne terre ; les jeunes plants d'orangers, rafraîchis par une eau courante et limpide prennent de la force et font déjà songer à leurs futures moissons de fleurs et de fruits : boutons d'argent, pommes d'or.
On suit ainsi pas à pas le travail assidu, persévérant des Trappistes, on applaudit à leur courage, on se réjouit de leurs succès, on entrevoit la récompense…. Elle n'est que dans le ciel, pour le moine comme pour nous tous !
Ici-bas, la douleur s'enchaîne ; Le jour succède au jour et la peine à la peine. (Lamartine, méditations poétiques).
II
En 1844, le voyageur qui, nouvellement arrivé de France, venait, par un beau jour d'été, visiter la Trappe de Staouéli, ne se lassait pas d'admirer ce site enchanteur, ses jeunes cultures, ses naissants travaux.
Sous un ciel mat, foncé au zénith, plus pâle à l'horizon, il voyait d'un côté se dessiner les vaporeux contours, les lignes onduleuses de l'Atlas ; de l'autre, s'étendre la mer toute bleue sur laquelle, au loin, quelques voiles errantes découpaient leur blanc triangle, pareil aux ailes relevées en ciseaux d'un goéland qui pêche.
Devant lui se déroulait la plaine immense, avec ses lauriers roses groupés en buissons, ses arbousiers aux fruits éclatants, ses lentisques, ses jasmins sauvages ; puis cent hectares de terres en culture, puis, riant pour ainsi dire sous ses yeux, de plantureux jardins et de verdissantes pépinières.
L'étonnante beauté du ciel, l'excessive pureté de l'atmosphère faisaient valoir les moindres reliefs et les plus légères teintes de ce riche décor.
Ici des cactus énormes à palettes hérissées ; là des oliviers étendant leurs bras noueux où tremble un pâle feuillage puis, tout le long des talus, d'immenses aloès avec leurs feuilles pointues comme des glaives et leurs hautes hampes fleuries qui semblent des candélabres de bronze.
Notre voyageur attendait dans l'air sonore la voix grêle des troupeaux, le tintement irrégulier de leurs sonnettes et les petits cris joyeux des bergeronnettes et des lavandières.
Et, songeant aux Trappistes qui vivaient au sein de cette belle nature il était tenté de s'écrier : " Bon Dieu ! Que de bonheur tu donnes à tes pauvres (Saint Bernard). "
Ah ! Qu'ils viennent les voir ces religieux ; qu'il entre dans cette sordide baraque en planches où ils vivent pêle-mêle avec leurs animaux.
Sous le léger abri qui ne les défend ni contre le froid de la nuit, ni contre les ardeurs du soleil africain, tous sont dévorés de fièvre, tous gisent languissants.
Alors qu'ils habitaient leur douce et paisible Aiguebelle, ils étaient plein :
- de force, de sève et de santé.
Un jour leur supérieur leur avait dit : " Allez en Algérie, " et ils étaient partis et ils étaient venus sur ce sol hérissé de :
- stériles bruyères,
- de lentisques,
- de tristes et perpétuels palmiers nains
- landes sauvages d'où les hyènes et les chacals s'enfuyaient à leur approche.
Tâche ingrate, à coup sûr, et pénible labeur que de défricher cette plaine de Staouéli. Mais Dieu était avec eux, et l'effort n'était pas au-dessus de leur vaillante énergie, le péril au-dessus de leur intrépide héroïsme.
Ils s'étaient mis à arracher immédiatement les palmiers nains, pied à pied, brin par brin, et quand, par derrière eux, le palmier repoussait, ils étaient retournés sur leurs pas et s'étaient courbés de nouveau sur leurs reins brisés pour l'arracher de nouveau.
Cependant le printemps avait eu de longues pluies et d'épais brouillards ; puis, un soleil de feu survenant tout à coup, des effluves morbides et des miasmes pestilentiels s'étaient dégagés des sillons nouvellement ouverts.
La fièvre était apparue et la mort qui en connaissant bien le chemin avait passé et repassé sans cesse sur l'ancien champ de bataille.
Au signe qu'elle lui avait fait, il y avait toujours eu un trappiste qui avait abandonné la charrue. En moins de deux mois dix religieux avaient succombé. Ils n'étaient pas morts tout d'un coup.
On les avait vu, les uns après les autres se traîner des semaines entières autour des nouvelles constructions,
- les joues creuses,
- le regard brûlant,
- la démarche chancelante.
Puis un jour était venu où la fosse toujours béante du cimetière s'était refermée sur chacun d'eux ; et frères en sacrifice, tous deux tombés au champ d'honneur, le Trappiste était allé reposer auprès du soldat.
Vous qui avez semé dans les larmes ce que d'autres récoltent maintenant dans la joie, ouvriers de la première heure, courageux enfants d'Aiguebelle, soyez bénis !
Lecteur, si vous alliez à Staouéli répondez : Quitteriez-vous le monastère sans vous être agenouillé sur leurs tombes ?
Les pères et les frères que la mort avait épargnés, consumés par la fièvre et ne pouvant même plus, dans leur extrême faiblesse, psalmodier (vos louanges, O mon Dieu !) comptaient avec regret la longue suite des heures qui s'écoulaient pour eux dans l'inaction et la stérilité.
Les novices moins forts contre l'épreuve, fatiguaient leur âme à prévoir la fin de leurs maux, et suivaient d'un long regard de tristesse, sur les flots bleus qui scintillent, quelque blanche voile fuyant l'horizon.
Cette année-là, on eut dit que tous les malheurs du monde s'étaient donnés le mot pour fondre sur la naissante colonie :
- Tantôt c'était un mur de l'église, mur élevé à la hauteur de six pieds, qui, ruiné par les pluies, s'écroulait subitement.
- Tantôt les sauterelles, qui en quelques jours dévoraient la récolte, puis, et toujours et sans cesse, la mort qui revenait sur ses pas et prélevait une nouvelle victime. Ajoutez pour achever ce tableau, une bourse vide, des constructions à peine commencé et déjà interrompues, nul crédit, nulle ressource.
Dom Régis ne perdit pas courage.
Il fit transporter ceux de ses frères les plus gravement atteints à Mustapha Supérieur, dans la villa que l'évêque d'Alger venait de mettre à sa disposition, puis il s'efforça, par l'autorité de sa parole, de ranimer les quelques religieux qui lui restaient.
Leur rappelant l'admirable patience dans les premiers fils de Saint Bernard firent preuve en 1115, lors de la fondation de Clairvaux, il leur dit : " La mort les décimait comme vous et, comme vous, ceux qui survivaient, consumés par la fièvre, traînaient une vie inutile et languissante ; mais, bien que chaque jour leur apportât comme un flot renouvelé d'invincible tristesse, ils demeuraient plein de confiance en la bonté de leur Père céleste, répétant avec le saint homme Job : Il n'est rien arrivé que ce qui a plu au Seigneur ; que son Saint soit béni !
Leur confiance ne fut pas trompée.
Un jour que Saint Bernard, les yeux baignés de larmes était prosterné sur les marches de l'autel, implorant pour ses frères la miséricorde du Sauveur, tout-à-coup, dans le profond silence du sanctuaire, une voix suave, éblouissante, d'une douceur infinie, se fait entendre, et, toute miraculeusement, toute céleste, prononça ces paroles : Bernard, lève-toi. Ta prière est exaucée ! C'est cette même voix, dit encore Dom Régis, s'adressant à ses frères qui me parle encore dans ce moment au fond de mon âme. Elle m'annonce que Dieu nous a pris en compassion, que nos forces vont renaître et la mort s'éloigner. Revenu à la santé, remettons-nous donc sérieusement au travail et laissons se lever l'avenir avec cette modestie que Dieu donne à tout ce qu'il fait et qui en ôte la gloire aux hommes par la lenteur du succès ".
Ainsi parlait Dom Régis, et l'affliction s'éloignait du cœur des pauvres moines, et ils éprouvaient un réel soulagement dans tout leur être, soulagement inattendu, surprenant pour le regard des hommes, mais non pour le regard de Dieu.
A dater de cette consécration qui mettait ainsi la nouvelle Trappe sous la protection de Marie de Staouéli, ce fut un vrai miracle :
- La fièvre disparut subitement,
- les fraîches roses de la santé refleurirent sur les joues des jeunes novices,
- les yeux des pères reprirent cette vivacité singulière dans le regard des Trappistes ;
- et l'appétit revenant à tous,
- l'argent affluant de tous les côtés à la fois,
- on se remis à jeûner et à construire avec un merveilleux entrain.
- Monastère, église, grange, ferme modèle, ateliers,
- on bâtissait tout à la fois.
Tout :
- se commence, se poursuit, s'achève avec une vertigineuse rapidité.
Le lecteur nous pardonnera de nous être si longuement étendu sur ces jours heureux et tristes, sur ces jours dévorés par lev travail et l'enthousiasme et qui virent fonder Staouéli.
En retrouvant dans ces pages le parfum de ses plus chers souvenirs, il nous pardonnera surtout celui qui le premier donna la vie au monastère que nous allons visiter ; œuvre admirable, bâtie pour les siècles avec les efforts d'un jour.
Dom Régis n'a pas connu les joies du moissonneur, ces joies mesurées aux sueurs qui tombèrent avec le grain de blé dans les premiers sillons.
- Ses frères qu'il a soutenus, encouragés dans les efforts de la lutte,
- ses fils, qu'il a enfantés par une surabondance de force et d'amour à la vie religieuse, sont disparus ou disparaissent peu à peu.
Que le temps fasse encore un pas et l'oubli descendra sur lui, et le silence couvrira son nom. Nul ne le prononcera plus … excepté vous, pierres de Staouéli qui gardez à jamais l'empreinte de sa grande âme.
III
Ce qu'on a dit des hommes on peut le dire, à plus forte raison, des monastères : ceux qui sont heureux n'ont pas d'histoire.
Désormais Staouéli est fondé, désormais les années ne vont plus lui apporter dans leurs cours rapides que des jours bénis et des moissons fertiles.
Le peu d'étendue que nous avons donné à notre modeste étude ne nous permet pas de suivre la nouvelle Trappe dans son magnifique épanouissement.
Un tel travail serait au-dessus de nos forces et demanderait tout un gros volume Resserré par l'espace, citons seulement quelques dates :
- Le 11 juillet 1845, Grégoire XVI érige le prieuré de Staouéli en abbaye :
- le 15 décembre 1849 un titre définitif de propriété est délivré à la Trappe de Staouéli pour la concession qui lui avait été provisoirement attribuée,
- le 20 octobre 1854, Dom Régis donne sa démission, devient procureur de l'Ordre et est provisoirement remplacé à Staouéli par le R. P. Timothée, peu après abbé de la grande Trappe.
- Enfin le 21 novembre 1856, le R. P. D. Dom Augustin, prieur, est élu abbé de Staouéli.
La première partie de notre tâche est achevée et nous nous empresserions déjà de heurter à la porte du monastère si un scrupule, que le lecteur a déjà compris, n'arrêtait notre main. Avons-nous une plume :
- assez pure,
- assez délicate pour écrire la vie des religieux qui vivent dans cette nouvelle Thébaïde et n'est-ce pas de notre part témérité grande que de venir ainsi soulever le voile épais qui recouvre tant de saintes mortifications, de si pieuses austérités ?
Sans doute, bien d'autres avant nous, poussés par la curiosité, ont franchi cette porte devant laquelle nous nous arrêtons, hésitant ; mais tous ou presque n'étaient pas invités comme nous à jouir, pendant tout un mois, de la douce intimité des moines.
Ne sera-ce donc pas méconnaître l'affectueuse hospitalité qu'ils nous préparent que de livrer à la publicité les mystérieux tableaux de leur vie pénitente ?
Que le fait suivant nous servir d'excuse. C'était dans un club à Alger, au bon, au vrai moment en septembre 1870.
L'assemblée était orageuse. Elle agitait la question de savoir comment, enfin établie en Algérie la commune procurerait l'argent nécessaire à son fonctionnement. " Dans la poche des conservateurs, hurlaient les frères et amis.
- Très bien reprenait l'orateur, je suis complètement de votre avis, mais ces conservateurs peuvent, quoique ce ne soit pas dans leurs habitudes,
- s'unir entre eux,
- se défendre et
- conserver ce qu'ils possèdent.
La discussion menaçait de traîner en longueur, lorsqu'un citoyen,
- cravate rouge,
- chapeau mou,
- barbe révolutionnaire, demanda … non, prit la parole :
" Citoyens ! s'écria-t-il, d'une voix formidable que l'absinthe n'avait pas encore trop éraillée, citoyens, qu'elle est la question ? …
Nous voulons de l'argent, beaucoup d'argent. Rien de plus simple. Allons à Staouéli. Nous en trouverons chez ces êtres inutiles qui, abrutis par la superstition, ont renoncé aux droits imprescriptibles de l'humanité, chez ces frelons de la ruche démocratique qu'on appelle les Trappistes."
Cette motion, couverte d'applaudissements frénétiques, fut mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
Hélas ! C'est le destin.
On ne fait pas toujours tout ce qu'on se propose, Et le chemin est long du projet à la chose.
La gendarmerie coloniale ne laissa pas aux abeilles de la ruche démocratique le loisir d'aller rendre visite aux frelons de Staouéli.
Eh bien ! Lecteur, que vous en semble ?
Hésiterons-nous plus longtemps ?
Non, car ceux qui applaudissaient ce jour-là ces lâches menaces, ces ineptes insultes, les applaudiront encore à la plus prochaine occasion.
De deux choses l'une : Ce sont des méchants ou des ignorants.
- Des méchants ? Les Trappistes prient et s'immolent chaque jour pour le salut de leur âme !
- Des ignorants ? Qu'ils veuillent bien prendre la peine de feuilleter ce livre, et ils verront que le plus utile don que la France puisse faire à l'Algérie, c'est de lui envoyer beaucoup d'hommes :
- aussi laborieux,
- aussi énergiques,
- aussi charitables que ceux que nous allons rencontrer à Staouéli.
Peut-être le spectacle de leurs saintes austérités irritera-t-elle d'abord leur vue, mais bon gré, mal gré, ils subiront la fascination singulière qu'exerce le sacrifice et se sentiront troublés dans leurs jouissances …
Cette étude, que nous commençons aujourd'hui ….
Novembre 1875, veille de la fête de la Présentation de la très sainte Vierge, cette modeste étude sera certainement notre joie et notre édification dans la solitude : mais dût-elle nous donner quelque peine, nous nous estimerons largement récompensé de notre léger labeur, si quelque âme troublée par le scepticisme moderne disait en fermant notre livre :
" Il faut bien qu'il y ait dans le christianisme quelque force surnaturelle pour produire des existences d'hommes si fort au-dessus de la nature, et par-delà la tombe, d'immortelles réalités, pour inspirer un si prodigieux mépris de toutes le joies de la terre ! "
Le monastère
L'arrivée
La première chose qui fixe l'attention du visiteur en arrivant à la Trappe de Staouéli, ce sont ces deux sentences écrites sur l'un et l'autre côté du grand portail du monastère :
Tous les plaisirs de la terre
Ne valent pas une larme de pénitence.
Celui qui n'a pas le temps de penser à son salut
Aura l'éternité pour s'en repentir.
Graves conseils ! Salutaires avertissements.
Il semble entendre la grande voix de Saint Bernard disant à tous ceux qui vint entrer dans le silencieux cloître de ses enfants : " Vous qui allez pénétrer dans cette maison, laissez dehors le corps que vous apportez du monde, les âmes seules sont admises en ces lieux ". (histoire de Citeaux, tome 3)
Ce portail abrite deux larges bancs de pierre où la pauvreté vient s'asseoir à toute heure du jour, sans avoir besoin de tendre la main ; l'ange de la charité les y attend sans cesse.
Les moines de Staouéli qui s'intitulent eux-mêmes les pauvres du Christ aiment les pauvres, s'empressent de les nourrir, de leur donner des vêtements, et leur porte n'est jamais fermée, non seulement à l'indigent, mais à toutes les âmes fatiguées de la vie, courbées sous le poids de leurs fautes, ou simplement épris de l'étude et du silence.
A tous ces hôtes divers le Trappiste offre sa paix et la partage avec eux.
A peine a-t-on pénétré sous le vaste porche de la Porterie que deux autres sentences viennent invinciblement attirer aussi nos regards :
Que sert à l'homme de gagner l'univers entier
S'il vient à perdre son âme ?
Merveilleuse parole de l'Évangile !
En effet notre âme, c'est nous-même, et que peut-il nous rester après l'avoir perdue ?
La seconde est celle-ci :
S'il semble dur de vivre à la Trappe,
Il est bien doux d'y mourir.
Oui certes, il est dur de vivre à la Trappe : le jeûne et l'abstinence y sont continuels, les veilles prolongées, le labeur incessant et pénible, le silence absolu, et cependant la paix et la gaîté, ces deux sœurs charmantes qui se tiennent toujours par la main, accompagnent partout le Trappiste. Aurait-il donc choisi, même en ce monde, la meilleure part ?
A droite de la Porterie se trouve une petite salle où les visiteurs, en s'adressant au frère portier, peuvent se procurer des chapelets, des médailles et surtout les magnifiques épreuves photographiques qui sortent de l'atelier du père. Avançons-nous sur le perron et embrassons d'un rapide regard l'immense cour fermée par les diverses constructions du monastère.
Cette cour rectangulaire n'a pas moins de cent-dix mètres de long sur trente de large. Elle et limitée :
1° Sur le côté où nous nous trouvons par le petit palais de Monseigneur l'archevêque d'Alger, et plus loin par des grenadiers.
2° A gauche, par les remises qui découpent leur imposant massif sur le ciel et encadrent le bleuâtre horizon dans cinq magnifiques arcades hautes de neuf mètres.
3° A droite, par l'hôtellerie et en dernier lieu en face, par le cloître, l'église et la ferme cistercienne.
Nous allons, accompagné du R.P abbé Dom Augustin, ou d'un de ses frères, délégué par lui, pénétrer immédiatement dans le cloître.
Toutefois, n'avançons pas dans le pieux asile de l'austère pénitence avant de saluer ce bouquet de palmiers qui projette son ombre sur la façade du cloître et dont les éventails de feuilles se découpent sur l'impassible azur du ciel.
Ces grands arbres qui, en juin 1830, sous le dôme de leurs rameaux entrelacés, virent flotter le pavillon du Bey Achmet, et qui, témoins du succès de nos armes, abritèrent treize ans après, en 1843, l'autel champêtre où le R. P Dom Régis célébra, pour la première fois, sur le sol africain, la fête de Saint Bernard, ces arbres tutélaires, par leur orientale beauté, par les glorieux souvenirs qu'ils évoquent, sont la poésie et l'ornement de Staouéli.
A la tombée du jour une multitude d'oiseaux viennent nicher et se mettre à couvert dans les verdoyantes ramures des arbres ; ils y passent paisiblement la nuit ; à peine l'horizon commence-t-il à s'emparer des premières lueurs du matin, qu'aussitôt tous les oiseaux s'éveillent et à leur tour chantent les matines. Dès qu'ils ont ainsi célébré à leur guise leur Créateur, ils secouent leurs ailes encore humides de rosée, puis, comme un collier qui s'égrène, ils s'éparpillent dans l'air bleu et vont se poser sur tous les toits.
IV
La réception
La porte du cloître va s'ouvrir devant nous. Nous allons pénétrer dans ce séjour des âmes où l'on entende que des cantiques de joie et de salut. Mais savons-nous bien ce que c'est qu'une Trappe et quel est l'esprit qu l'anime ?
Si nous l'ignorons Saint Bernard va nous l'apprendre. " Notre ordre, dit ce grand saint, lumière et gloire de son siècle, notre Ordre est :
- abjection, humilité, pauvreté volontaire,
- paix et joie dans le Saint Esprit.
Notre Ordre est de vivre sous la dépendance :
- d'un supérieur, d'un abbé,
- d'une règle, d'une discipline.
Notre Ordre est :
- de garder le silence, de jeûner,
- de psalmodier,
- de travailler des mains et, par-dessus tout cela,
- de tendre à la perfection, de profiter de tous les jours dans cette voix de la charité et d'y persévérer jusqu'à la mort.
Cette vie, qui ferait de nous les plus malheureux des hommes si, n'y étant pas appelés par la grâce, nous étions condamnée à la subir,
- cette vie obscure, pauvre,
- misérable est embrassée avec joie par le Trappiste.
D'où vient cela ?
C'est que, quittant tout pour trouver tout, le Trappiste aime Dieu de toute son âme, de toutes ses forces et que, l'aimant ainsi, sa peine disparaît.
Car dit Saint Augustin, il n'y a pas de peine dans l'amour de Dieu.
La Trappe ne fait donc pas de malheureux et n'est effrayante que de loin ; le monde en voit les croix, mais il ne voit pas l'onction qui aide à les porter.
Le bonheur des moines dit M. de Montalembert, est naturel, durable, profond. Ils le trouvent d'abord dans le travail, dans un travail régulier, soutenu et sanctifié par la prière, puis dans tous les détails de leur vie :
- si logique, si sereine, et
- si libre, libre de la souveraine liberté.
Ils le trouvent dans cette si enviable insouciance des besoins de la vie matérielle et domestique, dont les délivrent d'une part la simplicité et la pauvreté de leur régime. ' De l'autre l'organisation intérieure de la communauté où toutes les sollicitudes de ce genre reposent sur un chef, sur l'abbé, qui assisté de cellurier, s'acquitte de cette charge pour l'amour de Dieu et la paix de ses frères.
Leur vie se prolonge et s'achève ainsi au sein d'une tranquillité laborieuse, d'une douce uniformité. Mais elle se prolonge sans s'attrister. Ils savent l'art de consoler et de sanctifier la vieillesse toujours si triste dans le monde.
Dans le cloître, on la voit toujours non seulement :
- chérie, écoutée,
- honorée par les jeunes gens, mais, pour ainsi dire,
- supprimée et
- remplacée par cette jeunesse de cœur qui persiste chez tous à travers les glaces de l'âge comme le prélude de l'éternelle jeunesse de la vie bienheureuse. "
On ne saurait mieux dire.
Pour nous, nous sommes convaincus que s'il existe quelque part sur la terre un endroit où l'on puisse être à l'abri des orages de la vie, ce doit être assurément sous le ciel pur d'un monastère, au milieu de ses paisibles habitants.
- Ne pensez-vous pas comme nous ?
- N'êtes-vous pas persuadés ?
Eh bien ! Suivez-nous, entrez avec nous dans ce cloître où tout est silence et calme et douce quiétude.
La petite salle qui se trouve à notre gauche, sous la voute du cloître est la salle d'attente des hôtes.
Voulez-vous pendant quelques jours, vingt-quatre heures seulement, goûter le charme et le repos du monastère ? (Eh ! Quel est celui d'entre nous qui n'a pas éprouvé, du moins une fois dans sa vie, l'attrait de la solitude) !
Manifestez votre désir au père hôtelier.
C'est dans cette petite salle dont nous vous parlons que l'on vous fera entrer.
Bientôt revêtus de la coule, de cette blanche robe flottante qui donne aux Pères cet air digne et majestueux, air véritablement solennel dont sont frappées les personnes les plus étrangères aux émotions religieuses, bientôt, disons-nous, deux moines entreront, et voyant devant vous le divin Maître tomberont à vos pieds et se prosterneront de tout le corps devant vous.
Ils vous conduiront ensuite à l'église, ils y prieront pour vous ; puis vous ayant ramené dans cette même salle, ils vous feront la lecture d'un chapitre de l'Imitation et se retireront comme ils sont entrés, silencieux et recueillis.
Le cérémonial de votre réception se trouvant ainsi terminé, vous n'avez plus qu'à écrire votre nom sur le registre des visiteurs.
Merveilleux recueil d'autographes que ce registre ! Il semble, à le parcourir, que toutes les grandeurs de la France se soit données rendez-vous à la Trappe de Staouéli. Tous ceux qui y sont venus, et de la patrie et de l'étranger :
- souverains, princes, évêques, ministres, ambassadeurs, officiers généraux,
- célébrités dans les sciences, les arts ou les lettres.
Tous, sans exception ont tenu à l'honneur de signer leurs noms illustres sur ce registre, livre d'or de l'humble monastère.
La longue énumération des noms les plus remarquables ne serait pas sans intérêt, mais elle nous retarderait, au moment où il nous est permis de visiter le cloître.
V
Le cloître
Le cloître de Staouéli est d'une sévère simplicité.
Copié sur celui de l'abbaye de Maubec, et construit par un frère, italien d'origine, qui mourut après l'avoir achevé, en 1848, il forme un rectangle régulier ayant intérieurement vingt-quatre mètres de côté et deux rangs d'arcades superposées.
Suivant la règle établie dans l'architecture monastique, l'église longe un des portiques, le réfectoire est accolé au portique opposé et la salle capitulaire (lieu où se réunit quotidiennement la communauté religieuse) fait face à l'entrée qui donne accès à des chapelles particulières, au secrétariat et à la cellèrerie (bureau de l'intendant ).
Le premier étage surmonté d'une terrasse circulaire (solarium) est occupé :
1° par l'infirmerie, située au-dessus du chapitre des Frères et de la salle capitulaire,
2° par le dortoir qui correspond au réfectoire, et enfin
3° par la bibliothèque et la salle des novices dont les fenêtres donnent sur la façade extérieure, celle de l'entrée.
Le préau du cloître est formé :
- de quatre beaux massifs d'orangers,
- de néfliers du Japon,
- de bambous et
- de bananiers,
Sous l'abri desquels s'épanouissent :
- des roses, des œillets, des violettes, mille fleurs odorantes.
Au centre, au point de jonction de ces massifs, un jet d'eau murmure sans cesse en retombant dans la double vasque d'un lavatoire (lavatorium).
Ce bassin toujours rempli d'une onde fraîche et cristalline, est surmonté de quatre tiges de fer qui se courbent en gracieuses volutes (ornement sculpté en spirales) pour supporter une croix ; un jasmin, y allonge ses fins rameaux étoilés de petites fleurs
Oh le paisible cloître ! Oh la bienheureuse retraite toute pleine, toute parfumée de la présence de Dieu !
Ne vous semble-t-il pas voir l'ange du silence planer dans l'air bleu sur ce petit coin de paradis ?
Voyez glisser, tantôt dans la lumière et tantôt dans l'ombre des piliers, ce moine revêtu de sa blanche coule, c'est à peine si on entend le bruit de ses pas.
Il passe près de nous et nous salue d'un air amical.
Vous ne vous contentez pas de le suivre vaguement des yeux, vous vous inclinez devant lui, et, dans votre étonnement indiscret mais cependant plein de pitié pour lui, vous cédez à la tentation de lui adresse la parole et lui demandez comment il a pu se résigner à embrasser une vie aussi pénitente, aussi terrible à la nature.
Alors ce moine vous montre du doigt une des sentences écrites sur les murs du cloître et charge la pierre de répondre pour lui.
Voici quelles sont ces sentences :
Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu.
Fuit les hommes, Arsène, viens dans la solitude, et tu seras sauvé.
La croix qui est une folie pour les gens du monde, est un trésor pour les religieux.
Le monde se réjouira ; pour vous vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
Le plaisir de mourir sans peine vaut bien la peine de vivre sans plaisir.
Ce cloître est mon tombeau où la mort commence ma vie.
Ces sentences, nous les lisons rapidement, en passant, et nous ne serons pas sortis du cloître que nous les aurons déjà oubliées.
Et cependant comme elles mériteraient, par leur haut spiritualisme chrétien, par leur noble élévation morale, d'être l'objet de nos réflexions.
Méditées longuement dans le silence du monastère, où elles trouvent leur continuelle consécration, ces sentences ranimeraient en nous :
- le désir du ciel,
- la sève de la vertu,
- les saintes joies de la paix et de la piété, et surtout
- l'amour de Dieu, amour sans lequel la vie n'est plus que peine et affliction d'esprit, n'est plus qu'un long jour de deuil !
Car (et Saint Augustin avait bien raison de s'écrier ainsi) : Vous nous avez fait pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur n'a pas de repos jusqu'à ce qu'il repose en vous !
VI
L'Église
L'église, nous l'avons dit, occupe une aile entière du cloître. Elle a cinquante mètres de long sur neuf de large. Elle est partagée en trois parties distinctes :
- le presbytère,
- le chœur des Pères,
- le chœur de frères convers.
Le maître autel et d'une simplicité toute monastique et qui semblerait mesquine si l'on ne se rendait pas compte des motifs d'humilité qui l'ont inspiré.
Le chœur des Pères a dix-sept stalles sur chacun des côtés, et six appuyées contre le jubé (tribune transversale élevée entre la nef et le chœur) qui le sépare des frères convers.
Celui-ci a quarante stalles disposées sur deux rangs et quatre chapelles dédiées :
- à la très sainte Vierge,
- à saint Joseph,
- à saint Bernard et
- à saint Augustin.
Une vaste tribune située au fond de l'église est affectée aux familiers et au condamnés militaires ; ces derniers, au nombre d'une centaine, travaillent pour la communauté et sont rétribués par elle.
A proprement parler, cette église qui fut consacrée par Monseigneur Dupuch, évêque d'Alger le 30 août 1845, n'est qu'une grande chapelle.
Bientôt une véritable église abbatiale, de plus pur style roman sera construite entre le cloître et les bâtiments d'exploitation, alors reculés et juste en face du petit palais de monseigneur l'archevêque d'Alger.
Quand les deux clochers de cette église se dresseront dans le ciel, que la statue de l'Immaculée Conception, le front ceint d'une couronne d'or, placée au sommet de la façade, quarante-cinq mètres d'élévation, se détachera, toute blanche, sur le profond azur du ciel, enfin lorsque le Salve Regina (prière dédiée à la Vierge Marie) résonnera dans une nef qui n'aura pas moins de dix-sept mètres de hauteur, alors Marie de Staouéli sera véritablement exaltée dans ses enfants.
Et tout chrétien qui verra ce miracle de foi, cette idéalisation du travail et de la prière, saluera le moyen âge non plus dans les lointains souvenirs de l'occident, mais avec la joie de sa naissance et de sa glorification sous le splendide soleil de l'Afrique !
Église ou chapelle, comme on voudra l'appeler, les pères Trappistes ne quittent guère cet humble sanctuaire où nous nous trouvons. Qu'on en juge par ce tableau de la vie quotidienne du Trappiste, tableau que nous empruntons à M. Casimir Gaillardin.
" Le Trappiste, dit ce savant historien commence sa journée :
- à deux heures du matin les jours ordinaires,
- à une heure, les dimanches et certains jours de fête, à minuit aux grandes fêtes. Au sortir du dortoir il descend à l'église pour chanter ou psalmodier, selon l'importance du jour, l'office nocturne.
- Cet office finit exactement à quatre heures. Suit une heure d'intervalle, que les prêtres consacrent à dire la sainte messe, les autres à la servir ou à faire de pieuses lectures.
- A cinq heure en été on chante prime (chant à la première heure du jour), puis on assiste, en communauté, à la messe matinale ; si l'importance du jour l'exige, on entre au chapitre des coulpes où chacun s'accuse des fautes qu'il a pu commettre contre la règle.
- A six heures commence le travail des mains qui dure jusqu'à neuf heures.
On rentre ensuite au monastère pour chanter tierce la grande messe et sexte.
Après sexte, à onze heures et demie le dîner qui dure ordinairement quarante minutes. Après les grâces, la méridienne jusqu'à une heure et demie.
Du dortoir on passe à l'église pour chanter none (service liturgique lu ou chanté à 15 heures).
Quelques minutes avant deux heures on retourne au travail.
A cinq heures vêpres, suivies d'un quart d'heure d'oraison.
A six heures le souper, suivi d'un intervalle d'une demi-heure.
A sept heures la lecture en commun, sous le cloître, complies (dernières prières du jour) et le Salve Régina (prière dédiée à la Vierge).
On se couche à huit heures. "
On le voit par ce rapide exposé, les Trappistes chantent ou psalmodient dans leur église à peu près neuf heures sur vingt-quatre.
Qu'on se fasse une idée de la fatigue qui en résulte pour eux.
Il est des moines à Staouéli qui, après les plus longs offices, ont la poitrine tellement exténuée qu'ils ne peuvent plus respirer. Se tairont-ils pour cela ? Nullement. Ils recommenceront et continueront ainsi jusqu'à extinction.
Leur joie est de souffrir.
Et puis, que voulez-vous ? Ils se sont condamnés au silence ; il faut bien que ce silence, à moins de ressembler à celui de la tombe, ait une âme. Or l'âme du silence n'est-ce pas la prière, et la prière chantée, la psalmodie ?
Un fait digne de remarque, c'est qu'à l'heure où les Trappistes se lèvent pour réciter Matines, ils sont les seuls religieux que leur règle appellent à l'église.
Eux seuls, pour que l'humaine supplication ne cesse de monter de la terre au ciel, veillent et psalmodient tandis que tout se tait, que tout se repose. Il est deux heures du matin.
Ce n'est pas cette nuit froide et effrayante de nos régions. C'est une nuit :
- claire, chaude et pure.
La lune inonde de sa rêveuse clarté le cloître de Staouéli. Un souffle si doux glisse dans les feuilles que vous ne devinez son passage qu'au léger tremblement des ombres projetées sur les piliers et sur les murs.
Regardez. Voici les religieux ! Les voici venir avec leur blanche coule et leurs capuces relevés. Il en est qui sont jaunes et desséchés comme des momies à force de veilles et d'austérité ; les fatigues des jeûnes prolongés se lisent sur leurs visages où les yeux seuls semblent vivants.
Les voyez-vous défiler silencieusement : on dirait une procession de fantômes.
Ils entrent dans l'église éclairée seulement par l'astre des nuits et la vacillante lueur de la lampe du sanctuaire.
Les stalles disposées dans le chœur les reçoivent un à un.
Ils se prosternent la face contre terre, mais, au signal de Dom Augustin, ils se relèvent et répondent de toute la puissance de leur voix à l'intonation de Matines.
Le chant de la Trappe est le chant grégorien, ce chant que les contemporains de Citeaux comparent à la mélodie des esprits célestes ; ce chant don chaque mot, chaque note palpite de vie.
Maintenant, après bientôt quinze jours passés à la Trappe nous ne pouvons entendre les cent vingt cénobites (religieux) du couvent chanter de toute la force de leur poitrine, de toute l'ardeur de leur foi, la triple invocation de Saint Bernard " O clemens, o pia, o dulcis virgo maria ", sans éprouver quelque chose qui palpite et qui bat des ailes en nous. Oui, nous le sentons, c'est notre âme qui voudrait s'envoler avec cette invocation d'extase et d'enthousiasme, avec ces accents passionnés de l'amour vers la patrie céleste et l'éternel repos !
VII
L'hôtellerie
Il est un livre ignoré du monde. Ce livre a pour titre : Directoire spirituel à l'usage des cisterciens réformés, vulgairement dits Trappistes, publié par l'ordre des supérieurs.
Voici ce que nous y lisons à propos du jeûne (chapitre 7, page 345) : Notre ordre a des traditions de charité et d'hospitalité qui ont toujours fait sa consolation et sa gloire. Dieu lui a donné ce bonheur de comprendre les besoins du pauvre et le désir de soulager tous ceux qui, viennent l'implorer.
On ne concevrait pas un monastère de la Trappe qui n'exercerait pas, à tout venant, l'hospitalité, tant ces devoirs sont regardés comme inhérents à notre destination, et, en quelque sorte, à notre nature religieuse.
Or, quel moyen pour des pauvres comme nous de subvenir aux nécessités des autres pauvres, nos frères bien-aimés ?
Il n'y a que les privations, le travail et le jeûne. Grand sujet de joie pour nous de donner non pas de notre superflu, mais de notre nécessaire !
Douce mortification que celle qui s'ôte le pain de la bouche afin de le partager avec de plus pauvres que soi ! "
- En quels termes plus simple pourras-t-on jamais exprimer des sentiments plus élevés ?
- Quand pourra-t-on, plus naïvement, pousser plus loin l'esprit d'abnégation ?
- De quoi nous étonnerons-nous ?
Celui qui parle ainsi est un Trappiste s'adressant à des Trappistes. Nous venons de visiter les moines de Staouéli ; nous avons été les témoins recueillis de leurs exercices de piété, de leurs continuelles pénitences ; plus tard, nous les verrons faire succéder l'action à la prière, le travail à la méditation, le mouvement au repos. Le monastère fera place à la colonie agricole.
Mais en attendant acceptons l'aimable hospitalité qui nous est offerte.
Entrons à l'Hôtellerie. Elle occupe la partie droite de la grande cour qui précède le monastère.
Au rez-de-chaussée et sous les arcades, se trouver la salle à manger ; au-dessus les chambres des hôtes. Chaque chambre meublée très simplement est tenu avec le plus miraculeuse propreté.
Le règlement suivant est affiché dans chaque chambre :
Été Hiver
- Lever 5 h 6 h
- Déjeuner 6 h 7 h
- Assister à la grand' messe 7 h 8 h
- Diner 11 h 11 h
- Souper 6 h 5 h 1/4
- Assister au Salve 7 H 1/2 6 H ½
- Retraite dans la chambre 8 h 7 h
- Dimanche, grand'messe 9 h 1/2 9 h ½
- Dimanches vêpres 4 h 3 h
- Carême : jour de travail, messe 10 h 1/2
- vêpres 3 h ½
Messieurs les hôtes ne peuvent parler :
- qu'au R.P. abbé ou
- à celui qui tient sa place,
- au confesseur,
- à l'hôtelier, et
- au frère chargé des objets de piété.
Défense de fumer :
- dans les appartements et
- dans la ferme.
Il est aussi défendu d'entrer dans :
- le monastère,
- les ateliers,
- les écuries et
- les jardins, sans être accompagné ou sans en avoir obtenu préalablement obtenu la permission.
L'été se prend de Pâques au 1er octobre et l'hiver du 1er octobre à Pâques."
L'homme le plus insouciant des vérités éternelles, le plus oublieux de son salut, qui, conduit à Staouéli par la seule curiosité, passe deux ou trois jours dans l'une de ces demeures, y éprouve des émotions qui jusqu'alors lui étaient inconnues.
A peine est-il entré dans sa cellule, qu'il entend au milieu du grand silence qui se fait en lui et autour de lui, une voix qui lui dit :
- D'où viens-tu ?
- Où vas-tu ?
- Comment as-tu vécu jusqu'à ce jour ?
- En continuant à faire ce que tu fais, peux-tu te rassurer ? … "
Il se retourne, regarde, personne. Il est seul, bien seul.
Qui donc se demande-t-il vient me parler ?
Il découvre aussitôt que cette voix est partie du fond de sa conscience.
Et alors, comme dans l'éblouissement d'un rapide éclair, son passé se dresse devant lui. Il voit la première tache dont il ne craignit pas de souiller sa robe d'innocence. La première faute qui vient ternir sa primitive candeur son pur regard d'enfant.
Il aperçoit sa mère telle qu'il la voyait autrefois, alors qu'il buvait si largement à la coupe du mal : elle s'efforce de lui sourire mais ses yeux sont remplis de larmes.
- Les pauvres qu'il a repoussés,
- les innocents qu'il a scandalisés,
- tous ceux qu'il a humiliés,
- tous ceux qu'il a calomniés, et
- ceux qu'il a trahis, et
- ceux qu'il a poursuivi de sa haine défilent devant lui.
A la vue de tous ces fantômes tristes et menaçants, il comprend que l'heure du remords est enfin venue, et son âme brisée n'en peut supporter le poids.
Combien d'âmes sont venues trouver ainsi l'ineffable paix et l'immense bonheur du retour en Dieu dans ces petites chambres si calmes et si mystiques ! Combien d'âmes s'y réfugiant par un temps d'orage, n'ont plus voulu partir dès les premiers rayons. Tels sont très bienfaits que la Trappe de Staouéli répand autour d'elle par la généreuse et large hospitalité de son hôtellerie.
Les Mahométans, si hospitaliers eux-mêmes, ne sont pas à l'abri de cette salutaire influence.
L'Arabe on le sait, nous repousse moins comme chrétien que comme incrédules, et rien ne frappe autant son imagination que la vue d'un chef de la prière, les rabbins toutefois exceptés.
Les moines de Staouéli, qu'il voit vivre dans la continence, la mortification, l'austère travail, exerce sur lui un tel prestige, que si un Père Trappiste, ce qui arrive bien rarement, va dans une des tribus voisines, il y est aussitôt l'objet d'une véritable ovation.
Les femmes lui présentent leurs petits enfants pour qu'ils les bénissent ; les infirmes se traînent jusqu'à lui et baisent ses mains ou touchent ses vêtements, dans l'espoir d'obtenir leur guérison. Ce sont :
- des acclamations,
- des marques de respect,
- des salam-alek à n'en plus finir
Allah yaïchek ! Que Dieu te fasse vivre !
Allah yaoun-ek ! Que Dieu te soit en aide !
Allah iatik saha ! Que Dieu te donne la santé !
Alla Staouéli-ek ! Que Dieu sauve Staouéli !
Mais c'est le révérend père abbé, celui qu'ils appellent le grand marabout de Staouéli qui est surtout l'objet de leur vénération.
Le cheik de la tribu de Béni-Méred n'eut-il pas un jour la singulière idée d'écrire au R. P. Dom Régis pour le supplier d'échanger son chapelet contre le sien.
Nous ne résistons pas au plaisir de citer le dernier passage de sa lettre :
" Nous savons, vénérable serviteur de Sidi Aïssa (Jésus) et de Lella-Mariem (Marie) que nos pauvres reçoivent à la porte de ta grande maison les mêmes secours que tes pauvres.
Tous nos frères qui reviennent ici font l'éloge de ta charité. Pour te remercier en leur nom et au mie, je t'envoie une chèvre avec son petit qui tête encore ses mamelles pendantes. Daigne excuser le peu de valeur de ce présent ; tu sais que le don ne se mesure pas à son prix, mais au bon cœur qui l'offre. Que Dieu tout-puissant et miséricordieux te protège et te conduise toujours dans sa lumière. "
Cette demande d'échanger un tsbeha (chapelet musulman) contre un chapelet chrétien, cette lettre si solennelle pour annoncer l'envoi d'une pauvre chèvre et de son biquet, tout cela peut paraître plus ou moins comique ; mais ce qui ne l'est vraiment pas, c'est de voir les mahométans apprendre à certains chrétiens le respect dans lequel on doit toujours tenir l'homme revêtu du caractère religieux.
Que penseraient les Arabes, eux qui professent pour les Trappistes de Staouéli une si profonde admiration, s'ils apprenaient que ces marabouts du désert, ces Tolbas, comme ils les appellent, sont, dans quelques journaux, l'objet de sarcasmes et du ridicule. Quoi de plus vrai cependant.
Telle feuille que nous ne voulons pas nommer ne dénonce-t-elle pas, chaque matin, à ses lecteurs, dans un style un peu lourd, il est vrai les aberrations et les ignorances béatifiées des moines de Staouéli, et ne représente-t-elle pas leur Trappe bénie tantôt comme un asile d'aliénés, tantôt comme un repaire de scélérats non atteints, sans doute, par la justice des hommes, mais torturés par celle d'inexplicables remords. Tenons compte à cette feuille de ne pas avoir appelé les Trappistes des forçats en rupture de ban.
- Dignes enfants de Saint Benoît,
- citoyens pacifiques,
- humbles colons de Staouéli,
On ne vous voit pas, avec les infatigables écrivains dont notre conquête a doté l'Algérie, parler à tort et à travers :
- d'égalité,
- de fraternité,
- d'extinction du paupérisme et cætera …
Mais vous avez au fond du cœur, ce que tous ces beaux esprits ne connaissent pas : la charité, l'ardente charité chrétienne, qui donne à tous et ne demande à personne.
Le soleil s'abaisse lentement à l'horizon ; ses derniers feux revêtent le Zakar et le Chenoua d'un voile de pourpre et d'or.
Après une rude journée de marche ou de travail, le voyageur indigent et fatigué voit, sur le haut de la colline, étinceler les vitres d'une villa.
C'est le petit palais mauresque d'un véritable ami du peuple, d'un chaud démocrate, qui dans les journaux, dans les clubs déclare à qui veut l'entendre que " nul n'a le droit d'avoir du superflu lorsque chacun n'a pas le nécessaire. "
Le voyageur hâte le pas, il arrive devant la villa, il frappe à la porte.
On lui ouvre.
- Que voulez-vous lui demande le propriétaire démocrate.
- L'hospitalité. J'ai faim et je suis fatigué.
" Ce n'est pas ici une auberge. A recevoir tous les pauvres qui passent sur la route, aucune fortune ne résisterait …. Allons, va-t'en. "
Et on le chasse ; et ce riche, plus impitoyable peut-être que celui de l'Évangile, ne voudra pas même tolérer Lazare sur les marches de son palais.
Mais voici qu'une cloche résonne dans le lointain. C'est l'Angélus qui tinte, doux comme un appel, suave comme une prière, qui tinte lentement au couvent de Staouéli.
Messagère des religieux, la voix ailée de cette cloche murmure à l'oreille du voyageur :
Venez à la Trappe, mon frère,
Venez notre humble monastère
Ne vous repoussera jamais.
A tous, sur la route déserte,
Elle est l'hôtellerie ouverte
Où chacun peut s'asseoir en paix.
La dernière heure
VIII
Bientôt notre tâche sera terminée, mais cette tâche nous semblerait incomplète si, après avoir dit comment on vit dans cette Trappe, nous ne racontions pas aussi comment on y meurt.
Rappelons-nous la sentence que nous avons lue sur la porte du monastère :
S'il semble dur de vivre à la Trappe,
il est bien doux d'y mourir.
La mort n'est pas pour le Trappiste une punition mais une récompense. Vous vous souvenez quelle est sa vie. Le Trappiste quitte tout :
- Parents, amis, patrie, espérances dans le monde.
Il couche sur un matelas de deux pieds et demi, épais de quelques pouces, dur comme du bois et posé sur une planche ; la cellule où il repose n'est qu'un étroit compartiment dans un dortoir commun. Il dort dans ses vêtements et enveloppé d'une couverture.
Il se lève à minuit, à deux heures du matin au plus tard.
En hiver il dîne à deux heures ; en été à midi et lorsqu'il jeûne, il ne fait qu'un seul repas vers la fin de la journée.
Ses aliments dont :
- la viande, le poisson, les œufs, le beurre et l'huile sont exclus, sont cuits à l'eau et au sel.
Il chante ou psalmodie le petit et le grand office. Prime, tierce, la grand'messe, les vêpres, les complies et le salve c'est-à-dire huit heures sur dix-sept.
Il travaille cinq heures.
Il est soumis à l'obéissance la plus passive, au silence le plus absolu.
Et cette vie d'abnégation, de sacrifice, de pénitence, qu'il a volontairement embrassée n'a pour lui ni repose ni relâche ; elle est toujours la même et elle se continue ainsi du matin au soir et du soir au matin, pendant des mois et des années, jusqu'à son dernier soupir.
Une existence aussi étrange ne peut qu'amener une mort extraordinaire.
Les sombres tableaux qui vont suivre sont peints avec une sobriété qui leur donne encore plus de relief. Ils sont tirés d'un livre dont voici le titre :
Us de la Congrégation cistercienne
de notre Dame de la Trappe.
Primitive observance rédigés par le Chapitre général.
IX
Des derniers sacrements
" Conformément à l'ancien usage de l'Ordre, on tâchera d'administrer les derniers sacrements à l'église.
Durant cette cérémonie, les religieux sont prosternés sur les formes dans les stalles voisines du presbytère…Le malade est assis au milieu du cœur. En arrivant à la chambre du malade, la communauté se met à genoux et se place de manière à ne pas gêner le prêtre dans ses fonctions …
Les fonctions terminées, on administre au malade le saint Viatique (sacrement de l'eucharistie) Lorsqu'un infirme approche tout à fait à sa fin, on le met à terre dans un drap de serge (tissu produit par l'une des 3 armures principales de tissage appelé le serge) sous lequel on a dû étendre de la paille placée sur une croix de cendre bénite. Quand le supérieur le juge à propos, l'un des infirmiers va frapper la tablette à coups redoublés.
Cette tablette placée dans le cloître de Staouéli auprès de la chapelle et en forme de pupitre et munie d'un heurtoir en fer.
On sonne en même temps la grosse cloche quatre fois, c'est-à-dire en faisant trois interruptions …
La communauté est présente, on interrompt la psalmodie et on se lève …
On lave ensuite le corps dans le lieu destiné ; le Père prieur désigne ceux qui doivent le faire : ils ne lui lavent que :
- la figure,
- la poitrine,
- les bras et
- les jambes.
Ils revêtent le défunt de ses habits de chœur, observant de ramener tant soit peu le capuce (petit capuchon) devant le visage.
Ils lui donnent aussi des bas et des vieux souliers, mais ils ne lui changent point la serge et le caleçon, à moins d'une grande nécessité. Cela fait, ils l'étendent sur le brancard : s'il est prêtre, ils lui mettent au cou une étoile violette.
Tandis qu'on lave le corps les religieux se tiennent comme ils peuvent, autour de l'abbé qui récite alors les Collectes … Après qu'un défunt a été bien lavé, on sonne les cloches durant un quart d'heure. "
X
Nous n'oublierons jamais que, pendant notre séjour à Staouéli, nous avons entendu retentir, au milieu d'une nuit jusqu'alors silencieuse, l'effrayante tablette des agonisants.
Un frère convers (laïc) malade depuis longtemps allait mourir.
Les sombres tableaux que nous venons de reproduire nous furent cachés ; mais la cloche qui, dans l'espace de quelques heures, sonna d'abord deux fois, puis quatre fois, puis enfin pendant un quart d'heure, nous permit d'assister, en esprit, aux scènes lugubres qui se passaient à quelques pas de nous.
Dans l'infirmerie vaguement éclairée par un cierge, nous apercevions deux longues files de moines, ceux-ci avec leur coule (vêtement à capuchon) blanche, cela avec leur chape brune (long manteau de cérémonie sans manches), ayant tous le capuce baissé.
Ils psalmodiaient lentement le Miserere.
Au milieu d'eux le moribond étendu par terre sur la cendre et la paille.
Il était là sous nos yeux, baigné des sueurs de la mort, la poitrine oppressée, la respiration suspendue. Nous l'entendions réciter d'une voix éteinte son Confiteor.
Il recevait l'Extrême-Onction, le saint Viatique.
Enfin en brisant les derniers liens qui la retenaient à la terre, son âme sur l'aile des psaumes chantés pour son départ, s'envolait libre, joyeuse, légère. Elle s'élevait au-dessus des nues, au-dessus du firmament, au-dessus des étoiles, et, radieuse, enivrée d'elle-même, prenait place parmi les anges.
Et tandis que nous suivions ainsi par la pensée le joyeux essor de cette âme qui, franchissant l'éther d'un coup d'aile, allait des esprits purs accroître la tribu, et tout éblouie, s'avançait toujours plus avant dans les resplendissements et les fulgurations de la Jérusalem céleste …
Le corps que cette âme venait d'abandonner, tel un papillon, sa chrysalide, le corps était là, devant nous, ; étendu sur un brancard, entouré de cierges, embaumé d'encens. Étrange vision !
Nous étions dans notre petite chambre de Saint Bernard au milieu de l'obscurité la plus complète, et cependant tout ce que nous écrivons en ce moment nous paraissait alors avec la plus saisissante réalité. Et nous disions :
Est-ce bien un cadavre que nous avons sous les yeux ?
N'est-ce pas plutôt un enfant endormi qui lavé, habillé attend que sa mère vienne le coucher doucement dans un tombeau d'immortalité ?
Lecteurs, trouvez-vous souvent, dans le monde des soins aussi tendres et aussi pieux ?
Entrez dans cette chambre luxueuse où des centaines de bougies éclairent vingt imbéciles. C'est une soirée que donne un riche célibataire à sa famille, à ses amis.
- Il boit son vin de champagne,
- écoute des concerts,
- se couronne de fleurs
- est heureux,
- plein de joie ! …
C'est à qui :
- le complimentera,
- le félicitera,
- lui promettra de longs jours …
Le lendemain revenez dans cette même chambre. Regardez : il est mort.
Ses amis, ses parents même n'approchent qu'avec horreur et dégoût de son cadavre à peine refroidi.
Vingt-quatre heures ne sont pas encore écoulées, et déjà chacun commence à craindre que les fossoyeurs ne se fassent attendre.
Qu'ils viennent, ah ! Qu'ils viennent vite clouer ce cadavre dans son cercueil et s'empressent d'en débarrasser sa maison.
Enfin les voici ! Ils emportent, ils enterrent le défunt, et les parents les plus affligés se consolent promptement avec la par d'héritage qui leur est échue …
Que disons-nous ! Bientôt ils se réjouiront de sa mort. Oui, bientôt :
- on dansera, on mangera,
- on jouera, on rira dans cette chambre où ce riche aura rendu l'âme.
Cette âme où sera-t-elle ?
L''enterrement du frère convers eut lieu le lendemain dans l'après-midi, sur les quatre heures. Au moment où les cloches annonçaient la levée du corps, nous nous rendîmes au cimetière.
Le cimetière de Staouéli occupe une ancienne redoute construite en juin 1830 par le capitaine de génie Vaillant (depuis Maréchal de France), pour protéger la route de Sidi-Ferruch à Alger.
C'est un carré de trente mètres planté de cyprès sur ses côtés.
Au milieu s'élève une croix de fer dominant majestueusement l'enceinte sacrée.
Il faisait un temps admirable, et cette lumière si vive, si pure de l'Algérie, mettait en relief les moindres accidents d'un paysage qui n'était pas sans beauté.
Tout au loin, nous apercevions, d'un côté les montagnes de l'Atlas toutes bleues et d'un profil sévère ; de l'autre la mer splendide d'un azur doux moiré de larges raies de couleur nacre ; puis des champs, des vallons tachetés çà et là de blanches fabriques, et, devant nous, la grande allée du cimetière tout enfouie dans l'ombre de ses hauts cyprès.
A l'extrémité de cette allée on voyait poindre le funèbre cortège.
Il s'avançait au nombre de près de deux cents personnes et dans l'ordre suivant :
- les jeunes profès (qui ont prononcé leurs vœux),
- les anciens,
- l'abbé avec le sous-diacre,
- les novices,
- les convers,
- les familiers.
Au milieu des rangs :
- le porte-croix, les acolytes,
- l'eau bénite, l'encens.
- Puis quatre céroféraires environnant le corps, et enfin
- un frère portant la croix du défunt.
Moines et novices chantaient le psaume de la délivrance avec une telle ampleur, un ensemble si parfait, qu'au lieu d'un chant funèbre on croyait entendre un hymne de triomphe. C'est que chaque religieux sentait en lui-même que c'était moins une prière qu'il adressait au ciel pour le repos de ce bien-aimé frère qui s'était endormi dans le Seigneur, qu'un hommage rendu à sa mémoire, et comme une fête célébrée en son honneur.
Le convoi arriva dans le cimetière, le porte bénitier se plaça au pied de la fosse, les religieux de chaque côté, les céroféraires (servants d'autel portant des cierges) entre les religieux et la fosse, auprès de laquelle on déposa le défunt, en observant de lui mettre les pieds à l'Orient.
Dès que le R. P. Dom Augustin eut aspergé et encensé le corps pour la dernière fois, les quatre frères qui avaient porté le défunt le déposèrent dans la fosse.
L'infirmier y était déjà descendu. Il disposa décemment le cadavre en lui couvrant le visage du capuce et après que l'abbé eut jeté un peu de terre sur le corps on commença à le couvrir. La terre s'éleva peu à peu au-dessus de lui, forma un petit monticule que chacun connaît et on se retira en silence.
Le soleil couchant enflammait de ses plus beaux rayons les religieux qui s'éloignaient, et la croix d'argent, et le bénitier, et les coules blanches, et les chapes brunes, et l'air environnant.
Nul souffle n'agitait l'atmosphère qui était d'une transparence parfaite. Tous les détails du paysage se dessinaient nets, précis même aux derniers plans.
Çà et là la hampe fleurie d'un aloès pointait dans le ciel comme un grand candélabre de bronze. Un palmier au fût écaillé, terminé par un éventail de feuilles dont pas une ne bougeait, se découpait majestueusement dans le ciel.
La nuit venait rapidement. Les teintes le plus vives s'affaiblissaient et l'air prenait cette suavité caressante qui donne tant de charme aux soirs de l'Algérie.
Et comme les étoiles s'allumaient une à une dans le ciel, ce fut dans ce cimetière que je fis mes adieux à Staouéli que je devais quitter le lendemain.
Songeant à tous ceux qui reposaient dans l'enceint sacrée, O leur dis-je, que vous êtes heureux, vous qui êtes désormais passés de la mer orageuse du monde au port du repos éternel.
Un pape qui fut de votre ordre, venant à Clairvaux et passant près du cimetière s'écriait : " O élus de Dieu, priez pour moi ! " Et nous que dirons-nous de cette enceinte si calme, si profondément assoupie ? …
Nous répèterons ce mot de Charles Quint dans le cimetière de Saint Just : Je les envie parce qu'ils reposent.
Et nous ajouterons : Adieu Staouéli!
Oui, adieu, cher et doux Staouéli.
J'ai laissé dans tes murs assez de souvenirs pour remplir une vie plus longue que la mienne.
Chacune des dalles, chacun des piliers de ton cloître me seront toujours présents, et les rêves qui me rappelleront les jours que j'ai passés dans tes murs seront les plus doux que je rêverai.
Adieu Staouéli !
Staouéli : Histoire du monastère depuis sa fondation
par E. Delaunay 1877
|
|
| A propos de la question des Étrangers.
Envoi de M. Christian Graille
|
|
Après la communication si documentée de notre collègue M. Paoli, il ne peut rester dans l'esprit de personne la moindre illusion non seulement au sujet de la situation dans laquelle se trouve la population française vis-à-vis de la population étrangère, mais encore et surtout au sujet de l'avenir qui est réservé à notre faible groupement, si l'on ne s'attaque pas au plus tôt aux causes du mal.
Déjà les Étrangers naturalisés ou non, sont égaux en nombre aux Français d'origine dans l'ensemble des trois départements.
Dans celui de l'Ouest, ils ont une supériorité écrasante. Au chef-lieu du département, ils sont 40.000 en face de 20.000 Français d'origine et le chiffre des électeurs naturalisés équilibre celui des électeurs français.
Ces tristes constatations ont-elles ému l'opinion publique ? Hélas non !
- Que dans un assez grand nombre de communes, l'élément naturalisé soit absolument maître des élections,
- que dans beaucoup d'autres, il fasse pencher la balance en faveur du parti auquel il se joint,
- que dans les élections générales, il soit dès à présent l'arbitre de nos luttes politiques, ces constatations n'ont pas dépassé le cercle de quelques conversations ou de quelques discussions en petits comités.
En vain, depuis plus de vingt ans, quelques hommes ont-ils jeté le cri d'alarme ? Nos concitoyens sont restés, pour la plupart absolument indifférents.
L'histoire, fantaisiste peut-être mais assurément très suggestive, du touriste qui, après avoir visité la ville d'Oran, demande à son guide de le conduire au consulat français, les a tout bonnement forts réjouis.
Ils ont trouvé très originale la boutade de ce journaliste qui invita le conseil municipal de Mers-El-Kébir, lequel est composé de 11 conseillers naturalisés et de 1 français. (Les 323 électeurs naturalisés ont bien voulu permettre aux 55 électeurs français d'envoyer un d'entre eux siéger à côté de leurs représentants) à exiger un passeport de tout étranger, c'est-à-dire de tout Français voulant pénétrer sur le territoire de la commune.
Dans ce fait que certains conseillers municipaux ont voté des subsides à l'Espagne, pour l'aider dans la guerre de Cuba, nos concitoyens n'ont vu qu'une expression de sentiments peut-être déplacés, mais très louables.
Lorsque l'organe des " revendications espagnoles ", el correo espagnol, journal imprimé dans la langue maternelle, a demandé " que l'on fasse enfin place à ses compatriotes dans toutes les assemblées électives ", ils ont trouvé la prétention un peu excessives, mais en somme très justifiable.
Ils ont fait très bon accueil au Heraldo espagnol " organe des aspirations de la colonie espagnole " et qui avait pris pour devise : " l'amour de la Mère-patrie ! " Ils ont accepté, les yeux fermés les raisons qu'on leur a données, pour expliquer la conduite chevaleresque de la très grande majorité des Italiens naturalisés, qui ont en poche leur livret de l'armée du roi bien aimé.
Une assemblée élective, le conseil général d'Oran s'est cependant quelque peu ému de la situation ; il faut malheureusement constater que le vrai motif de sa manifestation n'avait pas précisément un objectif supérieur.
" Considérant que sur cent communes dont se compose le territoire civil, l'élément étranger est plus important que l'élément français dans quarante-trois d'entre elles et que dans vingt de ces dernières, l'élément étranger est de 2 à 6 fois plus important que l'élément français,
Considérant que la promulgation de loi du 26 juin 1889 en Algérie aura pour effet, dans un temps relativement très court de confier l'administration de nos communes et du département à des Français de la veille, n'ayant pas nos mœurs et les mêmes aspirations nationales, bien que légalement français,
Considérant qu'en vertu de la convention de 1862, un Espagnol venant on ne sait d'où et n'offrant par cela même aucune garantie de moralité, peut ouvrir un débit de boisson, ce qui rend les investigations de la police bien difficiles :
Émet le vœux pour éviter plus tard les plus graves complications :
- 1° que la loi du 26 juin 1889 ne soit plus applicable en Algérie,
- 2° que les demandes de naturalisation soient examinées avec plus de circonspection,
- 3° que le gouvernement prenant souci de cette situation d'infériorité, concentre tous les efforts de la colonisation sur le département d'Oran pour arriver à contrebalancer l'influence de l'élément étranger,
- 4° que la convention de 1862 soit révisée. "
On le voit, il s'agit plutôt de mettre fin à la concurrence que font les naturalisés aux marchands de goutte français !
Tout d'abord, demandons-nous si la mentalité algérienne dont l'indifférence de la population française en face de l'avenir est un des symptômes, existe réellement.
Le député Legrand, dans son rapport sur le budget de l'Algérie, affirme n'avoir rien constaté de nature à lui faire croire à une mentalité particulière et qui se traduirait par des tendances à la séparation. " En toute franchise, dit-il, plus nous avons regardé et écouté et moins nous avons cru à ce soit disant péril. "
Mais voici deux autres députés qui ne sont pas du même avis ; ils ont entendu, eux, un autre son de cloche. C'est d'abord M. Pourquery de Boisserin qui s'exprime ainsi :
" L'enquête nous a révélé qu'il existait malheureusement en Algérie les germes d'un esprit :
- particulier, indéniable, avoué.
Il est le fruit malsain des causes que le temps ne nous permet pas d'analyser.
Sans danger immédiat, il peut devenir un péril.
Les Français d'origine que les liens d'intérêts de famille attachent à la Mère-patrie qu'ils aiment avec le sentiment puissant fait :
- des souffrance,
- des espérances communes
- du souvenir des gloires et des défaites héroïques,
- de la pensée reportée vers ce coin de terre où les pères ont vécu où reposent la mère, le frère, la sœur, sont enserrés au milieu d'une population étrangère prolifique qui ne connaît pas la France.
Naturalisés globalement par des lois successives, toutes regrettées, ces étrangers, qui n'avaient point sollicité le titre de citoyen français, n'en comprennent pas la grandeur ; ils n'en aiment pas les devoirs.
Un grand nombre, pour ne pas dire tous, parlent et pensent dans une autre langue. Les souvenirs, les intérêts les écartent de nous et très lentement viendra l'heure (si même elle ne doit jamais venir pour quelques-uns) de l'assimilation qui leur donnera l'âme française. Grossir ce péril serait une faute. Ne pas :
- le voir, le surveiller, l'éviter serait plus qu'une faute. "
Voici ensuite l'opinion de M. Berthet, rapporteur du budget de l'Algérie en 1902 : " Nous croyons enfin devoir signaler une des conséquences déjà perceptibles de l'autonomie financière accordée à l'Algérie.
C'est la nécessité de nous préoccuper, dès à présent, d'un danger, déjà né, qui menace d'aller toujours grossissant et qui, si l'on y porte remède, deviendra capital.
Nous voulons parler de l'accroissement formidable de la population de sang étranger et indigène par rapport à la population de race française.
Quels sont les sentiments de la grande masse de tels naturalisés ?
- Connaissent-ils notre pays ?
- nos mœurs ?
- nos traditions nationales ? …
La grande masse des naturalisés n'a donc que bien peu l'âme française.
Mais il ne faudrait pas conclure de là que les naturalisés auraient gardé autre chose qu'un attachement platonique à leur ancienne patrie et qu'ils rêveraient de livrer à celle-ci l'Algérie, s'ils avaient un jour le pouvoir.
Mais il ne faut pas oublier que tous ces naturalisés, ou du moins l'énorme majorité, ont été chassés de leur pays par la misère et les exigences du fisc.
Ils ne se soucieraient nullement de voir un jour le fisc du pays natal pressurer l'aisance qu'ils ont acquise sur notre sol ; mais ils se font peu à peu une âme algérienne, si nous pouvons parler ainsi, et rien qu'algérienne.
C'est là un sujet de préoccupation pour l'avenir et c'est par-là que l'autonomie financière pourra constituer un grave danger, le jour où ces hommes seront la majorité dans les corps élus, comme dans les assemblées financières.
Ce jour-là, en effet, comment pourra-t-on obtenir d'eux les mesures, les sacrifices nécessaires pour conserver chez les Algériens le sentiment national, aujourd'hui si vivace, et pour faire que notre colonie reste ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle doit rester, le prolongement de la France par-delà la Méditerranée ?
Comment obtiendrons-nous notamment les sacrifices nécessaires pour l'instruction publique, du développement de laquelle on peut surtout espérer un tel résultat ? Pour les naturalisés la France comptera de moins en moins et le détachement s'en fera peu à peu, sans heurts ni secousses et se fera même, on doit le craindre, dans l'esprit des Français de race.
Certes les Algériens d'aujourd'hui aiment ardemment la France.
Combien encore y sont nés et combien de fois, en visitant les colons, n'avons-nous pas été frappés et émus de ce touchant amour du pays natal, dont ils parlent avec autant d'enthousiasme à leurs enfants ?
Mais cet amour vient chez nous de ce qu'ils connaissent la France, qu'ils y ont vécu et souvent souffert ; mais parmi leurs descendants, combien la connaîtront autrement que par les récits de leurs ancêtres ! Nous ne voulons certes pas exagérer le danger, qui est né, qui existe, mais qui peut encore être aisément conjuré, pour peu qu'on veuille s'en donner la peine …
Notre conclusion est qu'il faut dès à présent se préoccuper de conserver à l'Algérie la mentalité française et ne pas laisser s'y développer, par la prédominance de l'élément étranger, les idées particularistes qui derrière la formule anodine de " l'Algérie aux Algériens ", feraient naître dans un délai éloigné peut-être mais fatal, le désir de joindre l'autonomie politique à l'autonomie financière et amèneraient de fil en aiguille les tendances séparatistes.
On peut déjà relever parfois des traces encore timides de ces idées particularistes : citerons-nous cette opinion assez courante en Algérie que tous les emplois, que toutes les concessions de la colonie devraient être réservés aux Algériens ? "
Il y a un péril, un vrai péril. Pour notre compte personnel, à une époque où nous ne passions pas encore pour un retardataire, nous l'avons signalé en 1883 au conseil général d'Alger et en 1885 devant l'association scientifique d'Alger.
Les évènements n'ont fait que confirmer notre conviction, déjà bien assise, il y a plus de vingt ans. Les étrangers sont devenus et sont restés des " Algériens ".
Quant aux Français, ils ont subi l'influence de leurs nouveaux concitoyens.
Tant qu'ils ne les ont eus que comme voisins, plus ou moins immédiats, le mal a marché lentement ; mais depuis que la naturalisation automatique a introduit par fournées des étrangers dans la famille française, il a fait des progrès tels que les moins clairvoyants sont obligés d'en reconnaitre l'existence.
Les plus optimistes ont eu beau se boucher les oreilles, il a bien fallu qu'ils entendent le cri de ralliement des jeunes générations : " L'Algérie aux Algériens !
Les fonctions algériennes aux Algériens ! "
Il a été question de l'Algérie libre, il y a quelques années ; mais, depuis, nous avons eu mieux que cela : nous avons eu la libre Algérie, ce qui est, paraît-il, un progrès considérable dans les revendications du peuple algérien.
Ne veut-on voir dans ces manifestations que les intempérances de langage chez les ultra-méridionaux ?
Nous demanderons alors comment on appellera cette autre manifestation émanant, celle-là, d'une personnalité qui jouit d'une très grande autorité aux Délégations financières :
" On ne doit pas oublier que, depuis 1900, un fait considérable est survenu qui a profondément modifié les rapports de l'Algérie avec la France…
Les députés et les sénateurs n'ayant plus un centime de dépenses à inscrire à notre budget, ni à en distraire un centime de recettes, doivent scrupuleusement s'abstenir de proposer des mesures qui y tendraient….
Nous ne voulons plus d'un gouverneur trop puissant vis-à-vis des Délégations et, par contre, trop faible vis-à-vis des ministres métropolitains, qui peuvent le congédier à leur gré…
Que penses-t-on d'un statu quo équivoque et commode qui fournit à la représentation algérienne placée près des ministres les moyens de pénétrer indirectement dans cette sphère des intérêts locaux, dont la loi du 19 décembre 1900 a prétendu cependant rigoureusement les écarter ? "
Dans ce langage bien qu'il ne respire pas la cordialité, on ne peut voir toutefois un acte de séparatisme, mais on ne peut pas être frappé du soin avec lequel l'auteur de ce langage parle des profondes modifications déjà survenues dans les relations entre l'Algérie et la France.
Dans les paroles suivantes le séparatisme n'est pas encore en question non plus ; on se borne à demander des gouverneurs omnipotents et affranchis de la tutelle ministérielle.
Ainsi la suppression des décrets de rattachement devrait avoir, selon nous, pour conséquence de placer sous l'autorité immédiate du gouverneur les services rattachés en 1848, comme de lui attribuer un droit prépondérant d'immixtion dans les affaires militaires.
Affranchi de la tutelle ministérielle, le gouverneur aurait désormais des pouvoirs propres qui s'exerceraient librement dans le domaine :
- administratif, financier, judiciaire, militaire.
A cette condition seulement, l'énergique formule proposée par M. Cambon et adoptée par la Chambre, deviendra une réalité, car à cette condition seulement, on pourra dire qu'en Algérie, il n'y a qu'une seule main, tenant un seul drapeau.
(Édition Cat ; l'Algérie nouvelle 1896).
L'Algérie aurait donc à sa tête un gouverneur qui réunirait tous les pouvoirs entre ses mains, y compris la justice et l'armée et qui, point dominant serait " affranchi de la tutelle ministérielle ".
Comme " pouvoirs forts ", on ne peut souhaiter mieux ; mais, après tout, le vice-roi d'Algérie ne serait-il pas tenu à quelques devoirs envers la France ?
Le moins possible ; il aura surtout à traiter avec " le conseil algérien élu ".
Qu'est ce conseil élu ?
Ce qu'il faut surtout souhaiter, c'est que ce conseil de transition (Délégations financières) s'applique, par des mesures bien étudiées, de nous sortir de l'embarras où nous nous sommes mis, en matière fiscale surtout, les rattachements, et qu'il s'applique avec sagesse et esprit de suite à nous valoir, au jour le plus rapproché possible, le conseil algérien élu, qui est le rêve de tous les autonomistes dont je fais partie…
Ne pas confondre s'il vous plait avec séparatistes car vous me connaissez assez pour savoir que je suis un bon Français. Le gouverneur ne présiderait pas le nouveau conseil élu ; il y serait représenté par des commissaires du gouvernement, tout comme dans les parlements. (Dépêche algérienne ; interview de M. Alcide Treille, candidat sénatorial).
Enfin parait le décret de 1900.
Bien que le décret du 23 août 1900, portant créations des délégations financières ait réalisé une fameuse innovation dans le domaine de l'organisation politique et administrative de l'Algérie en introduisant la principe d'un parlement colonial composé de deux chambres, la chambre des Délégués et le Conseil supérieur, tout n'est cependant pas à admirer, loin de là, dans les articles dont il se compose… (Félix Dessoliers).
Le décret donne satisfaction au chef du parti autonomiste, en ce sens qu'il consacre le " principe du parlement colonial " (sic) mais il n'est pas parfait, parait-il ; aussi signifie-t-on, quelques jours après, au Parlement français d'avoir à cesser au plus tôt la plaisanterie : La prétention est au moins singulière de vouloir river à perpétuité la seule assemblée élue que possède l'Algérie, les Délégations financières, à un rôle consultatif en matière de budget algérien …
La France n'aura jamais rien à craindre des représentants légaux et loyaux de l'Algérie qui, tout en défendant les intérêts de leurs mandants, ne marchanderont pas à la Métropole ce qu'ils lui doivent de soumission et de respect.
Mais si vous leur fermez la bouche, sous prétexte d'assurer un ordre que, de votre aveu, ils n'ont jamais pourtant troublé, comme il faut une voix à tout pays opprimé, c'est le peuple, soyez-en sûr, qui criera dans la rue. Le passé et un passé récent vous répond de l'avenir sur ce point ; prenez garde ! " (Félix Dessoliers, délégué financier, dépêche algérienne 20 janvier 1900.)
Le gouvernement français prit-il peur et s'exécuta-t-il sous les menaces du délégué financier respectueux et soumis ? Nous l'ignorons ; mais ce que nous savons, c'est que ces menaces furent proférées.
Leur auteur ne nous fait pas connaitre ce que le peuple, une fois victorieux, aurait fait de sa victoire ; mais comme ce n'eût pas été probablement pour acclamer l'oppresseur qu'il eût pris les armes, n'est-il pas un peu en droit de croire que ledit oppresseur eût reçu un congé définitif ?
C'est là une bien grave accusation, sans doute ; mais elle repose sur des précédents qui ne sont pas précisément des propos en l'air.
Voici quelques-uns de ces précédents : Puisque les députés algériens ont l'esprit si césarien,
- que ne disent-ils avec César : les premiers dans un village plutôt que les seconds dans Rome ?
- Que ne réclament-ils avec nous le régime qui conviendrait à leurs hautes facultés ! Ici on voit en eux que les satellites du Président de la Chambre.
A Alger dans la représentation coloniale, rien ne les empêcherait, je suppose, de briguer eux-mêmes la présidence et le pouvoir exécutif…
Il n'est pourtant pas indispensable d'être par profession député colonial, pour savoir que les colonies anglaises les plus florissantes se gouvernent elles-mêmes.
Il y a sans doute des colonies qui ne seront jamais assez fortes pour se séparer de la Mère-patrie.
En général c'est une question d'âge et de développement … Il ne faut pas plus compter sur l'Algérie que sur les autres colonies ; un jour ou l'autre, la séparation se fera ; tôt ou tard le moment de l'émancipation viendra fatalement.
Il n'a a donc qu'à en prendre son parti ; tout ce que l'on peut espérer c'est de conserver avec l'Algérie de bonnes relations qui permettront à la France de faire le plus de commerce possible avec elle. (Longuet, la justice.)
Cet article publié dans un journal de Paris eût très probablement passé inaperçu en France ; ici il fut recueilli avec empressement et reproduit en entier dans le journal le plus répandu d'alors, le petit colon avec une circonstance aggravante qu'il lui fût donné pour titre : un courageux conseil à suivre.
Depuis il y eut d'autres manifestations non moins catégoriques. A un autonomiste qui se plaint que J. Ferry, dans son projet de nouvelle organisation de l'Algérie, ne voit que le gouverneur, un autre autonomiste répond : " M. Ferry, autoritaire, tend à organiser l'autonomie du gouvernement général au profit du seul gouverneur. Laissons donc faire, en attendant mieux. La logique des choses nous amènera forcément à l'autonomie coloniale, au profit des colons. " (Ch. Marchal, petit colon 1892).
Ici, le dirons-nous, nous avons constaté une résolution virile qui va jusqu'à … l'autonomie coloniale, que certains traduirons par l'expression encore plus énergique de séparation. L'avenir seul apprendra si ces tendances isolatrices sont favorables à la prospérité du pays.
Dans tous les cas, les procédés déplorables de la métropole à l'égard de sa pupille ont presque légitimé les idées les plus radicales à ce sujet.
Il ne faudra pas oublier cela, lorsque plus tard le moment sera venu d'établir les responsabilités de scission, si jamais la scission morale qui se prononce de plus en plus aujourd'hui, faisait arriver les choses à ce point. " (Le Télégramme, octobre 1896).
En fait de résolution virile, voici qui est on ne peut plus explicite : L'Algérie prochaine… Déjà une Algérie nouvelle se dessine vaguement dans la masse confuse et inorganique où s'élabore notre avenir.
Un jour commence à poindre, dont le soleil ne sera plus celui qui resplendit aujourd'hui.
Les peuples ont leur vie propre, à laquelle contribuent les influences multiples du milieu où ils sont plongés, comme aussi les influences législatives qui leur faut subir.
L'âme algérienne est à peine esquissée, mais elle se constitue peu à peu et s'affirme lentement, sous la juxtaposition accidentelle des individus :
- d'abord étrangers,
- progressivement solidaires et
- finalement confondus.
Certains besoins, les mêmes pour tous, telles difficultés qui se dressent en face du colon quel qu'il soit, préparent une sympathie mutuelle qui rapproche et cimente les ennemis de la veille, que la même fatalité accable.
D'autre par les souvenirs de la métropole, encore si vifs, s'atténueront peu à peu, après quelques générations, issues du sol même et adaptées aux conditions particulières des lieux.
Dans une cinquantaine d'années, il y aura des Algériens en Algérie, toujours Français, mais quelque peu :
- Espagnols, Italiens ou Maltais, sinon légèrement teinté d'Arabe.
Les traditions historiques et la domination administrative, nous retiendrons toujours cramponnés au cœur de la France, et aussi à sa bourse, mais lentement nous lâcherons prise pour retomber enfin sur nos propres jambes, sans autre patrie que celle où nous aurons vécu, avec d'ailleurs, le souvenir de nos ancêtres immédiats.
La dislocation est fatale : l'homme suit toujours la nature ; une mer profonde sépare les plaines algériennes de la falaise métropolitaine.
Un abîme aussi profond se creuse silencieusement entre les deux âmes, qui déjà commencent à s'isoler.
Le Français aura vécu chez lui ; nous vivrons chez nous, hélas ! Et de plus en plus éloignés.
Heureusement nous avons l'affection tenace ; heureusement aussi l'Algérie n'arrive pas à se suffire matériellement.
- Nos yeux, tout notre cœur et aussi nos mains sont tendues vers la Métropole qui reste encore nécessaire à notre sentimentalité comme à notre relative misère.
Mais :
- si la fortune revenait, surgissant tout à coup du désert aride où nos colons peinent sans espoir,
- si l'Algérie, soudainement prospère, prenait, sur ses propres ailes, son vol dans l'espace libre du progrès,
- si un jour nous pouvions vivre, hélas ! Nous voudrions vivre seuls.
Les individus ont quelquefois de la reconnaissance ; les peuplent rapidement l'ignorent.
Un peuple est un organisme qui ne s'embarrasse guère d'une moralité quelconque ; il évolue et se complète sans être jamais retenu par d'autres liens que les besoins matériels ou les intérêts immédiats.
L'Algérie n'est pas la France mais les Algériens sont encore des Français, parce qu'ils ont encore, et pour longtemps peut-être, le cœur imprégné de cette solidarité émue dont l'histoire très longue les pénétra.
La France d'ailleurs contribue à notre existence par les subventions nécessaires à notre pitoyable misère.
Demain ou après-demain l'Algérie sera simplement algérienne.
Le jour où la France aura retiré son bras qui conduit aujourd'hui note marche hésitante, le jour aussi où notre famille aura pris racine et fait souche dans un sol qui n'est plus celui de la métropole.
Les fleurs et les fruits conservent à peine leur fragile apparence sous les climats différents où ils sont transplantés ; la métamorphose est plus lente pour les hommes ; elle n'en est pas moins fatale, surtout si la législation en facilite la rapidité.
M. Félix Dessoliers a le premier poussé le cri d'alarme et, mélancoliquement signalé l'inévitable danger.
Avec les portes grandes ouvertes par la loi du 26 juin 1889, le torrent étranger fut prématurément précipité au sein même de notre race.
Cette situation devrait obliger à certaines précautions ; la métropole qui nous accable sans pitié hâtera peut-être, et malheureusement, la redoutable échéance.
Puisqu'un jour l'Algérie ne doit plus être la France, qu'au moins elle ne soit pas l'ennemi de la France. (Akbar 1885, Daniel Daurin).
Nous ne nous sentons pas le courage de faire suivre ces lignes de commentaires quelconques ; nous nous bornerons à relever les lignes où l'auteur met à nu les sentiments dont sont ou seraient animés ses concitoyens vis-à-vis de la Mère-patrie. Qu'on en juge !
S'ils sont cramponnés au cœur de la France, les Algériens le sont aussi à sa bourse ; il s'est contenté de placer sur le même pied d'égalité le cœur et la bourse de la France.
Et afin qu'on ne croit pas à une pensée fugitive et sans importance, il insiste plus loin sur le même sujet.
Et pour qu'il ne subsiste pas le moindre doute sur sa pensée il ajoute : " La France d'ailleurs contribue à notre existence par les subventions nécessaires à notre pitoyable misère. Demain ou après-demain, l'Algérie sera simplement algérienne… "
La note donnée par M. Daniel Saurin n'est pas restée sans écho. Voici d'abord celle de M. de Solliers : " Ce qui peut empêcher, ce qui empêchera pendant longtemps et si l'on veut, ce qui empêchera toujours l'Algérie de vouloir la séparation, c'est une raison financière ; c'est l'impossibilité de faire face aux charges de souveraineté.
Le jour où on lui enseignera qu'elle peut ou doit les acquitter, la séparation deviendra possible. "
Voici ensuite la note donnée par un auteur anonyme mais connu : " Nous devons désirer que l'Algérie cesse d'être une charge et qu'elle nous indemnise au plus tôt de nos sacrifices.
Nous devons également prévoir la séparation comme une échéance fatale et nous y préparer par un régime de transition approprié aux circonstances.
Le rêve des assimilateurs a fait son temps.
L'œuvre néfaste de l'administration n'est plus à dire. Nous avons les pouvoirs forts ; nous possèderons plus tard un conseil colonial et un budget distincts, une administration et des finances à part.
Ce sera l'autonomie mitigée qui conduira à l'émancipation complète. " (Choses d'Algérie, brochure, 1897).
Voici enfin la note la plus récente donnée au sujet du séparatisme :
" Ce sont là les raisons principales de la scission de plus en plus profonde qui s'opère entre la France et l'Algérie ; et si les procédés de la métropole continuaient à être les mêmes nous allons tout droit et à toute vitesse vers le séparatisme.
Ceux qui nient le moment où le fossé qui se creuse de plus en plus entre les deux pays, deviendra infranchissable, ne veulent pas se rendre à l'évidence…. " (Revue Nord-Africaine, avril 1903).
Mais que dira l'Europe de la naissance de cette nouvelle nation ?
Quant à l'Europe elle ne pourrait que d'un bon œil l'établissement au Sud de la Méditerranée d'une quatrième nation latine qui diminuerait la puissance de la France.
Ainsi donc tout est prévu. La puissance de la France pourrait-être diminuée par le nouvel état de choses ? Qu'importe ?
Sont-ce là des manifestations ambiguës ?
Leurs auteurs sont-ils des personnalités sans valeur et sans influence ?
Il nous semble que l'on n'est guère autorisé à n'y voir qu'un péril imaginaire comme on l'a dit, et qu'il ne suffit pas de fermer les yeux pour le nier ou le traiter " d'impie " pour l'écarter.
Qu'à part les individualités qui n'ont pas craint de préconiser la scission ou de la faire envisager comme une échéance fatale, qu'à part ces individualités, disons-nous, la grande majorité de la population française repousse énergiquement toute pensée de séparation, nous en sommes convaincus.
Mais qui donc peut se porter garant de l'avenir, surtout quand cet avenir est engagé de telle façon que les appels à la rébellion ils sont restés sans de très nombreux échos, n'ont pas toutefois soulevé les pavés ?
Le terrain d'aujourd'hui est encore réfractaire aux idées que quelques-uns y ont jetées ; mais vienne sa transformation sous l'influence d'agents modificateurs plus énergiques que ceux d'aujourd'hui et les semences germeront et porteront des fruits.
Les séparations des colonies d'avec les métropoles ne sont jamais spontanées, affirme M. Solliers, que nous citerons souvent dans cette étude, parce qu'il figure au premier rang parmi les autonomistes de marque :
" Une séparation entre membres d'une même famille, dit-il, est un déchirement auquel on ne se résout qu'à la dernière extrémité et l'histoire nous apprend que c'est malgré elles, entraînées par les évènements que les fautes de leurs gouvernements avaient précipitées, que leurs colonies s'étaient séparées de leurs métropoles. "
Bien que l'auteur de ces lignes soit convaincu, avec un historien américain, Ellis Stevens, que " les colons anglais jusqu'à la veille même de la guerre, étaient contraires à toute idée de séparation ", il voudra bien nous permettre d'avoir une autre opinion. Un incendie ne peut éclater là où il n'existe point de matériaux combustibles ;quand cet accident survient, " il n'est pas proportionné à l'étincelle qui lui a donné naissance, mais à la combustion et à l'agglomération des matières qu'il rencontre. " (Fauvel)
Il est bien difficile d'admettre qu'une faute, aussi grave qu'elle eût été, commise par le gouvernement anglais, ait subitement éveillé l'idée de scission chez des gens qui n'y avaient jamais songé.
Nous préférons la première explication, à savoir que les fautes des gouvernements anglais ont précipité la scission.
La rupture ou le maintien de la bonne harmonie ne dépendrait donc que du gouvernement français. Celui-ci n'aurait qu'à bien prendre garde de fournir au peuple " franco-algérien ", comme l'appelle M. le délégué financier, aucun sujet de mécontentement.
Le conseil est probablement excellent ; mais comment le mettre en pratique avec succès ?
Nous ne voyons pas bien comment, avec ce peuple qui entend être et rester maître chez lui, ses débuts sont pleins de promesses à cet égard, on vient le voir, on pourra entamer une conversation quelconque, sans arriver à le mécontenter.
Déjà en France, nous dit M. de Solliers " après les malentendus financiers et les mécomptes économiques des dernières années, une pensée de crainte et de défiance flotte dans l'air. " Et aussi en Algérie ajouterons-nous.
Comme la France et l'Algérie se trouvent actuellement être dans la position tendue ou délicate qui existe presque toujours entre créanciers et débiteurs, les malentendus financiers passeront à l'état aigu, surtout si les mécomptes économiques se répètent comme il faut s'y attendre dans un pays neuf et dont le climat est irrégulier.
Les sujets de mécontentement s'amasseront donc et la séparation deviendra le thème favori des leaders du peuple " néo-latin," ainsi qu'on l'appelle aussi.
Que la France refuse cette fois d'obtempérer à une nouvelle sommation d'un nouveau délégué financier en vue, qu'à l'appel de ce délégué le peuple " opprimé " descende dans la rue et l'heure propice aura sonné.
Tout en envisageant ainsi l'avenir, nous nous défendons d'accuser de pensées criminelles les auteurs des lignes que nous venons de reproduire, bien qu'elles soient très significatives ; mais nous disons et nous affirmons qu'avec nos dirigeants, ils préparent sans qu'ils en aient conscience très probablement les voies qui mènent tout droit à la catastrophe.
Et toutes leurs protestations indignées d'aujourd'hui auront été vaines, puisqu'ils ne seront plus là quand viendra le moment psychologique.
" En résumé, qu'on le veuille ou non, des symptômes très nets de séparatisme existent en Algérie et l'heure de la scission, de l'émancipation comme disent ceux qui ont honte du mot séparation, sonnera fatalement, si l'on ne coupe pas court aux errements actuels. "
Le temps où fleurira dans toute son intensité est encore assez loin de nous, Dieu merci ! Nous n'en sommes encore qu'à la période préparatoire, à l'Algérianisme. Voyons s'il ne serait pas possible d'arrêter le cycle de l'évolution de cette première période.
Pour cela examinons d'abord les causes qui ont créé la mentalité algérienne actuelle ; nous nous occuperons ensuite des moyens de remédier à ces causes.
A notre avis cette mentalité procèderait de trois sources différentes :
- d'abord du contact d'une population étrangère qui a ni nos mœurs, ni nos traditions, ni, comme on l'a dit, notre génie national,
- en second lieu, du milieu particulier crée par les institutions spéciales qui nous ont été imposés,
- en troisième lieu, de l'indifférence de la Métropole vis-à-vis de l'Algérie.
Notre collègue M. Paoli n'a envisagé que le premier point de vue ; nous l'examinerons après lui et nous dirons ensuite quelques mots des deux autres.
De l'influence de la mentalité des populations étrangères sur la mentalité des Français, nous n'entendons pas, est-il besoin de le dire ?
Faire le procès de la mentalité des Espagnols et des Italiens, pour ne parler que ces deux catégories d'étrangers.
Les uns et les autres ont toutes les raisons de s'en montrer satisfaits et même très fiers. Mais nous, de notre côté, nous avons au moins autant de bonnes raisons pour rester résolument attachés à la nôtre.
Sans vouloir établir si peu que ce soit un parallèle désobligeant pour nos voisins, nous pouvons dire que nous ne puisons pas notre mentalité dans de vains sentiments d'amour propre ou dans un étroit esprit de clocher ou dans les fumées du chauvinisme.
Notre génie national s'inspire de plus grandes pensées ; il s'inspire surtout du grand rôle humanitaire que notre patrie a su toujours remplir, de l'aveu même de ses ennemis.
" La France a dit un homme qu'on ne peut guère suspecter d'exclusivisme, Elisée Reclus, quoique l'envie et la haine l'aient souvent déclarée à jamais déchue, a certainement sa grande part dans le travail commun.
On influence et ses idées la rendent tellement utile au monde, qu'on ne saurait s'imaginer l'histoire prochaine des nations, si la France venait à y manquer. "
Voilà pourquoi nous sommes, avec le grand penseur, de ceux qui s'attardent encore à l'idée de patrie. Par sentimentalisme dira-t-on !
C'est la science qui seule doit diriger l'organisation et la vie des nations. Certes le rôle que la science aura désormais à jouer dans les sociétés est considérable ; mais elle devra compter avec un autre facteur :
" Elle ne saurait rien supprimer. Le sentiment n'abdiquera jamais ses droits ; il sera toujours le premier mobile des actes humains. "
C'est un fanatique de la science, c'est un maître qui a dit cela ; c'est Claude Bernard.
Nous n'aurions pas osé opposer notre opinion personnelle à la formule sentencieuse dans laquelle on prétend enfermer aujourd'hui la vie des peuples ; mais fort de l'appui que nous trouvons chez l'un des chefs de l'École positive nous dirons que la principale raison d'être de la France, c'est son sentimentalisme.
- C'est pourquoi nous ne voulons pas que, dans cette autre France que doit être l'Algérie, la mentalité sentimentaliste soit troublée si peu que ce soit,
- c'est pourquoi nous ne voulons pas que la plus haute expression de cette mentalité qui est l'amour de la patrie souffre la légère atteinte.
- Or, n'avons-nous pas à redouter dans ce pays la diffusion d'un esprit national étranger ?
La contagion morale d'idées et de principes différents des nôtres, sinon opposées aux nôtres n'est-elle pas un véritable danger, alors que le foyer d'où elles émanent est déjà si vaste et si près de nous ?
S'il ne s'agissait que d'une petite minorité vivant à nos côtés, il n'y aurait certes pas lieu de s'émouvoir.
Mais les chiffres apportés par notre collègue Paoli vous ont montré qu'il n'en est pas ainsi et que les Français d'origine, qui sont déjà en minorité dans ce pays français, ne seront plus un jour qu'une quantité négligeable au milieu de la grande masse des étrangers, si la courbe de progression de ces deniers continue sa marche toujours ascendante.
Or c'est une loi fatale que les majorités absorbent les minorités ; cette absorption exige un temps plus ou moins long mais le résultat est toujours le même.
Il y a non seulement à compter avec les conséquences du nombre, mais encore avec celles qui résultent de la vie publique commune.
La fraternité d'armes pendant les luttes électorales rapproche les distances, rend les relations plus intenses ; et c'est le Français qui en raison de son caractère ouvert et droit, subit l'influence de son nouveau concitoyen, plus subtil et plus pratique.
D'un autre côté, espérer qu'à notre contact et par le seul jeu de nos institutions, les Espagnols et les Italiens prendront nos mœurs et s'assimileront nos traditions est une profonde illusion :
- Ce n'est pas lorsqu'ils ne sont qu'à quelques heures de leur pays natal,
- lorsque de leurs nouveaux foyers ils aperçoivent en quelque sorte le clocher de leur village,
- ce n'est pas lorsqu'ils conservent des relations de tous les instants avec leurs familles et
- lorsqu'à toute occasion ils s'empressent de se rendre au milieu des leurs,
- ce n'est pas lorsqu'ils se font un point d'amour-propre de ne se servir, entre eux, que de la langue nationale,
- ce n'est pas dans de telles conditions qu'on peut leur demander d'oublier la patrie et de s'imprégner de nos usages et de nos mœurs.
L'idée de la patrie s'efface à la longue dans les colonies lointaines ; les difficultés des relations avec la Métropole amènent insensiblement :
- la tiédeur, puis l'indifférence et l'oubli.
Le pays où l'on a fait souche devient la patrie.
Il ne peut en être de même pour les étrangers qui sont venus se fixer dans un pays si voisin du leur, qu'ils se sentent encore pour ainsi dire chez eux.
On ne saurait exiger d'eux ce que les Espagnols estimeraient puéril d'exiger des Français établis dans leur pays.
M. de Solliers qui est un des plus ardents partisans de la fusion des races en Algérie estime que ce sont les Français qui absorberont les étrangers par le jeu des mariages mixtes. Il s'appuie tout d'abord sur un texte emprunté à Ellis Stevens : " Dans toute nation, il y a d'habitude un élément qui est plus qu'un élément, qui est en réalité par essence un noyau, un centre, en un mot quelque chose qui attire et absorbe les autres éléments, si bien que ceux-ci ne sont plus des éléments constitutifs mais de simples unités absorbées dans un tout préexistant. "
Commentant ce texte M. de Solliers ajoute : " Ce centre, ce noyau en Algérie c'est l'élément français qui d'ailleurs est merveilleusement constitué par ses traditions historiques, pour exercer cette fonction à laquelle il doit l'unité nationale. "
Si nous ne nous abusons, il nous semble que le délégué financier n'a pas pris gade que l'historien dont il invoque l'autorité parle de " nation " c'est-à-dire d'un groupement déjà fortement constitué.
Il est évident qu'un tel groupement n'a rien à craindre d'une infiltration étrangère.
Il n'est pas douteux qu'en France cette infiltration ne représente aucun inconvénient. Mais est-ce bien le cas en Algérie ?
Le noyau qui doit être le centre d'attraction, constitue-t-il " le tout préexistant " dont parle l'historien américain ?
- N'est-il pas ce noyau, plutôt un milieu de moindre résistance vis-à-vis des éléments qu'il doit absorber ?
- N'y a-t-il pas lieu de craindre plutôt que c'est lui qui sera absorbé par la masse de ces éléments ?
M. de Solliers est loin de partager cette crainte, parce que le noyau français, même quand en apparence, il est attiré, subjugue encore par sa supériorité mentale le groupe étranger. Nous ne demanderions pas mieux que de croire à la force d'attraction que le délégué financier admet comme une vérité parfaitement démontrée ; mais nous qui ne voulons juger que par les faits, nous n'avons à relever comme résultats de la fusion des races jusqu'à ce jour que la profonde transformation de l'esprit et du caractère français, transformation qu'il n'est plus guère possible de nier, après les accablants témoignages que nous avons cités il y a un instant.
M. le délégué financier cite volontiers la grande expansion de l'Australie due au mélange des races. Mais ne sait-il pas qu'en dépit des déclarations loyalistes faites à S M. britannique par ses sujets coloniaux lors d'un récent défilé pompeux, la séparation de l'Australie n'est qu'une affaire de jours, peut-être d'heures ?
L'exemple n'est donc pas bien choisi.
D'un autre côté, voici le Canada qui regimbe et refuse de mettre la main à la poche pour augmenter la marine du Royaume Uni.
Au surplus M. de Solliers n'est probablement pas aussi rassuré qu'il tente de le paraître, sur la francisation du peuple qui doit se substituer à la race française :
" Il est bien préférable pour la France, dit-il, de prendre nettement son parti du nouvel état de choses et d'accepter sans arrière-pensée et sans humeur, qu'il se crée en Algérie un peuple nouveau. "
Si l'auteur de ce conseil est convaincu que son peuple " néo-algérien " conservera intact le génie national français et les grandes traditions humanitaires de notre patrie, pourquoi engage-t-il la France à accepter de bonne grâce un évènement aussi souhaitable, aussi en harmonie avec ses aspirations ?
Le conseil est au moins inutile. On dit que l'Algérie est un théâtre éminemment propice à une tentative de fusion des races latines ; nous n'y contredisons pas.
Mais d'abord il y aurait lieu de se demander ce que donnerait comme résultat cette fusion, si jamais elle aboutissait.
N'est-il pas à craindre qu'il n'en résulte qu'un produit hybride, sans vitalité ?
Ce produit, composé d'éléments hétérogènes, se disloquera aisément au moindre heurt entre ces éléments.
Ce sera la guerre la guerre civile à propos d'une question quelconque et le sort des armes décidera de la nouvelle orientation politique à donner à l'Algérie.
Ou bien un gouvernement mécontent appellera des Vandales à son aide et ces derniers resteront.
Il n'y a plus de Vandales aujourd'hui ; mais il y a des nations puissantes qui sont toutes prêtes à voler au secours des opprimés.
L'histoire de Cuba est d'hier.
Admettons toutefois que tout aille pour le mieux et que se crée, sur cette terre inhospitalière, ouverte à tout venant, une nation comprenant ses devoirs envers la France.
Combien de temps faudra-t-il pour en arriver là ? Un siècle, au minimum.
Et pendant ce temps que se passera-t-il s'il survient, comme cela est probable sinon certain, une conflagration générale en Europe et peut-être dans le monde entier ?
Du moment où c'est le plus fort qui imposera sa volonté on doit prévoir le cas où la fortune nous sera défavorable.
C'est alors que, pour tenter justifier les actes du ou des vainqueurs, on verrait encore intervenir le principe des nationalités.
Nos nouveaux concitoyens sauraient alors, invoquant dans quelle conditions ils ont dû subir leur naturalisation, se débarrasser prestement des principes de solidarité qu'ils auraient acquis dans la vie commune de quelques années.
|
|
| A Président que je t’aime que je t’aime…..
Envoyé Par Hugues
|
Peut-être un peu excessif quoi-que !!!!
Et puis un jour je me suis déclaré homo !
Je vais vous expliquer comment et pourquoi :
Dans mon pays, je suis marié à trois femmes. C'est possible là-bas.
Une fois, j'ai fait venir en France, une de mes femmes, enceinte.
Elle a accouché à Paris durant son séjour. Et maintenant, mon fils, il est Français !
Ça s'appelle le droit du sol !
Ça, c'est bien !!
Comme elle est la mère d'un Français, elle n'a pas été expulsée.
Elle est restée et elle a même obtenu facilement la nationalité française.
Ça, c'est bien !!
Nous nous sommes remariés à la mairie française et on m'a dit que dans le cadre du regroupement familial, je pouvais rester en France avec mes 4 autres enfants.
Ça, c'est bien !!
J'ai fait la même chose avec mes 2 autres femmes et elles sont maintenant toutes Françaises ainsi que mes 12 enfants.
Ça, c'est bien !!
Elles ont dit qu'elles étaient des parents isolés, alors elles ont chacune l'allocation et aussi un appartement HLM.
Ça, c'est bien !!
Et l'école et les vacances de tous mes enfants sont pris en charge par la République française !
Ça, c'est bien !!
Et je n'ai aucun problème d'avoir 3 femmes !!
Pourtant on m'avait dit qu'en France, c'était interdit !
Ben, finalement non !!
Je ne suis officiellement marié qu'avec une.
Les autres sont mes maitresses.
l n'y a pas de lois contre le fait d'avoir plusieurs maitresses.
Ça, c'est bien !!
La France nous construit aussi des belles mosquées toutes neuves et gratuites !!
Ca fait vraiment plaisir, vue notre identité religieuse.
On peut aller prier tous les jours et plusieurs fois par jour.
Ça, c'est bien !!
Et puis après avoir entendu des renseignements, j'ai décidé de divorcer.
C'est gratuit.
Ça, c'est bien !!
C'était pour aider mon cousin Mourad.
J'ai dit que je préférais les hommes. En France c'est autorisé.
Ça, c'est bien !!
Je me suis marié avec mon cousin qui était encore au bled.
C'est possible grâce au mariage pour tous.
Ça, c'est bien !!
Mourad est venu en France avec ses 14 enfants.
Comme ça, les enfants à Mourad, ils sont Français aussi !!
Ça, c'est bien !!
La France elle est généreuse.
Ça, c'est bien !!
On est bien payé. On a :
- les allocations familiales,
- la sécurité sociale
- les soins chez le docteur et à l'hôpital,
- les allocations logement,
- même le secours catholique nous aide,
Ça, c'est bien !!
On paye rien, tout est gratuit !!
Heureusement car il parait que c'est cher.
On nous dit que ce sont les nantis de retraités (je ne sais pas trop ce que cela veux dire... je crois que c'est parce qu'ils sont bien riches) qu'ils payent pour nous, avec des impôts genre C S G.
La France elle est généreuse.
Ça, c'est bien !!
Mourad et moi, on vit tranquillement avec quelques milliers d'euros d'allocations.
On ne travaille pas car on a assez pour vivre, et avec toute notre petite famille, nous pouvons aller en vacances chaque année au bled avec notre voiture neuve.
Ça, c'est bien !!
Notre voiture est à chaque fois super chargée avec tous les cadeaux pour faire plaisir à toute la famille.
Au bled, Ils n'arrivent pas à croire qu'on a tout ça sans travailler...!
Maintenant on attend que l'on nous donne le droit de voter !
Comme ça, on sera vraiment chez nous !
Ça, ça sera bien !!
La France, elle sera alors bien à nous.
Ça, sera encore mieux !!
On aura un super avenir pour nous tous et pour nos enfants.
D'ailleurs, nos enfants sont Français comme tout le monde, non ?
Déjà la France, elle organise pour nous des classes de pas plus de 12 élèves, on va même apprendre l'arabe à l'école.
Ça, c'est bien !!
Notre avenir est assuré, on a maintenant une belle vie, bien mieux que là-bas au pays.
Et tout ça payé par des gens qu'on a viré ...
Ça, c'est bien !!
Il y en a beaucoup au pays maintenant qui ont fait comme nous !!
Ça, c'est super bien !!
|
|
|
| Livourne le 12 décembre 1803.
Envoi de M. Christian Graille
|
|
A mon honorable frère Abraham Cohen Bacri.
" Le motif de ces lignes est pour vous faire savoir que j'ai vu par les lettres que vous m'avez écrites par l'entremise de Simon Cohen, que vous augmentiez mes peines en vous livrant à la crainte au sujet de votre argent, quoique vous ne deviez avoir aucun soupçon sous ce rapport, attendu que l'énorme somme que la nation française nous doit est suffisante pour vous satisfaire, vous et bien d'autres et pour vous laisser un bon solde.
Quant à mon compte avec ma maison et Busnach, leur capital est rentré dans leurs caisses, et s'il leur reste encore à recevoir, c'est bien peu de chose relativement à tout ce qui nous reste chez la nation française. Pour ce qui est des intérêts, je me rends à Paris, et je leur enverrai de là-bas leur compte arrêté net…
Vous pouvez être certain que je ne vous ferai pas perdre votre bien, et vous l'aurez avec intérêt.
Répondez promptement à cette lettre afin que je sache comment je dois me régler. Si vous me demandez combien il reste dû par la nation, je vous apprendrai qu'elle nous reste devoir sept millions.
Le boiteux (par boiteux Jacob Bacri désigne Talleyrand) qui est intéressé à la chose s'est donné beaucoup de mouvement pour avoir une lettre de notre maître (le Dey) pour terminer l'affaire, tandis que la famille l'a abandonnée en nous écrivant de quitter, de laisser toute chose, en disant qu'elle ne demande rien !...
J'ai reconnu maintenant son intention qui est de nous faire quitter pour se présenter et recevoir toute seule… Comment ! Moi qui ai éprouvé tout le désagrément pour les recouvrer, je les lui abandonnerais pour les lui laisser à elle seule ?
C'est ce qu'elle ne verra pas car je les recevrai moi-même, ou bien je m'arrangerai avec elle pour en prendre ce que je pourrai.
Voici une lettre que vous remettrez à Nathan et une autre pour mon fils Joseph.
Quant à votre affaire, vous pouvez être fort tranquille ; écrivez-moi avec soin et longuement et faites-moi part de tout ce qui arrive ; ayez soin que Ben Salomon m'envoie le solde qu'il doit à Seguin, car Seguin s'en est prévalu sur moi.
Il lui reste dû environ quatre mille cinq cents piastres, si je ne me trompe ; faites en sorte qu'il les lui envoie en toute célérité ; non seulement je lui ai rendu service, mais il faudra encore que je paie pour lui ; si j'avais à mon aise, je lui ferais cette avance. Quant à Michel, soyez sûr qu'il ne sortira pas de Paris que je ne m'y sois rendu pour régler nos comptes d'Alger et terminer mon compte avec lui pour alors aller où bon lui semblera si le gouvernement le lui permet.
Moi je suis venu ici sans passeport. Car si j'étais allé pour prendre un passeport, on ne m'aurait pas laissé partir.
O Abraham, si vous pouvez porter Nephtali à lui faire écrire une lettre par notre maître (le Dey) au petit (Bonaparte) où il lui dira que l'argent réclamé par Bacri et Busnach est à lui et qu'il le prie de le faire payer à cause de lui, et de plus qu'il n'approuve pas le premier acompte qu'il nous a donné sur l'argent du navire et qu'il ait à nous satisfaire entièrement pour l'amour de lui.
Si l'on peut avoir une lettre en ces termes on sera sûr de recevoir, et alors nous pourrons contenter les gens d'Alger sur le reste de leurs intérêts et de leurs bénéfices.
Vous prendrez, vous et les autres, et malgré cela il restera encore beaucoup.
Quoi qu'il ne doive vous en rien coûter, dites-leur que, s'ils attendent de recevoir par eux-mêmes, par l'entremise de notre chef ou par celle d'autrui, j'en jure par notre prophète Moïse qu'ils ne retireront pas un sol (forme ancienne du sou) ; car si le boiteux n'était pas dans ma main, je ne compterais ni sur la lettre de mon maître, ni sur aucune autre chose, parce que le petit n'aime pas qu'il lui soit rien demandé avec force, mais il veut que les demandes soient présentées avec douceur.
Je vous promets que je ne demeurerai pas deux mois à Paris et que je me rendrai à Marseille, que j'ai reçu l'argent ou non.
Vous pouvez engager Nephtali en mon nom pour qu'il me fasse cette faveur ; que, s'ils prennent d'autres moyens, l'affaire de la nation française ira tout de travers… "
Marseille le 5 juillet 1803.
Par la voie d'Alicante et de Mayorque.
A mon honorable frère Abraham Cohen Bacri.
J'ai reçu vos deux chères lettres, desquelles j'ai appris que vous étiez en bonne santé. J'ai reçu également la lettre de Michel et je l'ai remise à son adresse.
Par les lettres que j'ai écrites à notre aîné vous serez informé de tout ce que je lui ai mandé.
Je suis réconcilié avec Michel mais nous n'avons pas arrêté nos comptes ; cependant je suis occupé à les terminer et j'attends le règlement pour attaquer Gozlan en justice de façon à ne pas lui laisser la chemise qu'il a sur le corps ; mais je m'arrangerai avec Michel comme Dieu en décidera pour ne pas en venir à de plus longues discussions.
Il parait que Michel a retiré sa confiance à Gozlan qui l'a trompé en le volant indignement. Il s'est aperçu de tout.
" O Abraham ! Le paiement que l'on m'a fait de la somme de douze mille francs, moins les frais de recette qui ne sont pas déduits, a été accordé moitié par rapport au navire et l'autre moitié à compte de ce qui m'est dû.
De laquelle somme totale Michel a pris le tiers, et les deux tiers me sont restés soit à compte de ce qui m'est dû comme à cause de la valeur du navire.
Si vous voyez que ma maison ne veuille pas faciliter ma réclamation auprès de la nation (française) alors tant elle que la maison Busnach seront obligés de nous rembourser à raison de 75 pour cent l'intérêt que vous avez sur le navire et qui est de quinze mille piastres fortes.
Mais si elle veut faciliter les réclamations de la nation, je vous engage à ne faire aucune démarche à ce sujet, car vous serez satisfait entièrement à la première somme que je recevrai.
C'est une faveur que je vous prie de me faire et je vous recommande de ne point vous relâcher sur cela.
Je désire que vous me procuriez aussi une lettre de Nephtali et de ma maison, adressée à Michel où il lui sera recommandé de me laisser terminer avec Gozlan les comptes que nous avons ensemble et de ne point se mêler de nos affaires.
Je vous recommande ma famille et celle de Busnach et engagez celle-ci à envoyer de quoi payer toutes les dettes de Michel pour extirper la rapine de Goslan qui n'était pas content de recevoir six mille francs par mois pour procurer de l'argent à Michel. Ayez soin de la famille et faites qu'elle termine les affaires de la nation pour qu'elle ne les laisse pas attachées.
C'est votre intérêt et le leur. Car autrement, j'en jure par notre prophète Moïse, on n'en retirera pas un sol.
Dieu nous consolera de la perte de cet argent.
Ecrivez-moi toujours en me faisant savoir ce qu'il y aura de nouveau.
Je vous salue. "
Destinées glorieuses de la France civilisatrice ! Hussein, ancien marchand de grains devient Dey d'Alger.
Il continue son commerce avec les Bacri, les Busnach pour courtiers et les correspondants européens de ces Juifs d'Alger. Il est en affaires avec la nation française ; ladite nation lui doit de l'argent.
Le souple génie de Jacob Bacri durant des années embrouille l'affaire :
- créances des Deys précédents,
- créances du Dey actuel,
- créances des maisons Busnach et Bacri,
Tout cela fait l'affaire internationale, bien dans les mœurs de l'époque :
- les maisons, les familles d'Alger en sont,
- le consul en est,
- les gens de Marseille, de Livourne en sont,
- Toulon y trempe,
- il y a des créances Aguillon.
Jacob va d'Alger en Italie, à Paris ; il a Talleyrand dans la main ; il présente à Bonaparte ses demandes en douceur…la confiture de roses de l'Oriental :
- il achète, il donne, il promet,
- on lui ouvre la Caisse d'escompte ,
- il a un courtier d'usuriers qu'il paie six mille francs par mois ; et quand il faut dans cette bouffonne, en cette sinistre aventure montrer le Dey, l'homme du Dey, on promène Simon Aboucaya dans les bureaux de ministres, à Tivoli…
Quand il faut des lettres du Dey, le consul Deval enregistre les " diplômes " dont j'ai donné l'échantillon… Et quand après des années :
- la comédie est jouée,
- que la France a versé quelques millions,
- que les millions sont partagés,
- que les préteurs qui ont permis d'acheter Talleyrand, de donner quelques douceurs à Bonaparte sont remboursés,
- que le Dey réclame, proteste, veut son argent, pour le faire taire, M. Deval l'insulte et M. de Bourmont prend Alger…
Le nom de Jacob Bacri, j'en atteste les glorieux destins de ma nation de héros, doit être plaqué en lettres d'or au fronton des palais consulaires d'Algérie ; sa statue, la gloire civilisatrice de mon pays d'apôtres l'exige au milieu de la place du gouvernement à Alger.
Jacob Cohen Bacri, chef de la nation hébraïque, je salue ta mémoire…
Aux enfers où tu fais des comptes avec Talleyrand, lorsque Jules Ferry vous y vint retrouver, ce dut être jolis rires entre vous, surtout si le Deval y amena le Bonaparte et que vous ayez parlé de la mission providentielle et civilisatrice de M. de Bourmont en Alger….
La vérité sur l'Algérie, Jean Hess. Édition 1905.
|
|
| Domination romaine.
Envoi de M. Christian Graille
|
|
1) La République (149- 31 avant J. C)
En détruisant Carthage, Rome ne se substitua pas immédiatement à son empire.
Elle comprit tout d'abord les difficultés qu'allaient lui offrir l'administration directe d'un pays où le prestige de son nom ne prévalait pas encore et de borne à exercer un haut patronage sur l'Afrique.
Les tribus tributaires aux coloniales de la côte qui s'étaient signalées par un trop grand attachement à leur métropole furent détruites ou démantelées ; les autres, au contraire, comme Utique, s'enrichirent de ses dépouilles et s'emparèrent de son commerce.
Des colonies italiennes ne tardèrent pas à se former, et bientôt Rome put revendiquer comme sienne cette mer que son orgueil désignait depuis longtemps sous le nom de Mare Nostrum.
Quant à tous ces petits princes numides qui, dans la lutte des deux Républiques, avaient pris parti pour l'une ou pour l'autre, elle les maintint en suivant à leur égard la politique de Carthage.
Elle partagea entre eux une autorité qu'elle ne voulait pas exercer elle-même, sans toutefois abandonner le droit de souveraineté que lui donnait la conquête.
Dès les premiers pas qu'elle fit sur le sol africain, Rome s'appliqua donc à récompenser magnifiquement ses alliés.
Mais à mesure que son pouvoir se consolida, ses libéralités devinrent plus rares, et elle finit même par retirer aux fils les largesses qu'elle avait faite aux pères : c'est ce qui arriva pour les descendants de Massinissa. (roi numide berbère 128-148 avant J.C.)
Micipsa, fils de ce chef intrépide, dont les continuelles agressions contre Carthage avaient préparé le triomphe des Romains continua l'œuvre de civilisation entreprise par son père. Sous ce prince, Cirta s'enrichit de magnifiques édifices.
Une colonie composée d'émigrants grecs et romains vint s'y établir et peu à peu se familiarisèrent avec les arts de l'Europe.
Telles étaient à cette époque l'importance et la richesse de Cirta, qu'au dire de Strabon (géographe et historien grec) elle pouvait mettre sur pied dix mille cavaliers et un nombre double de fantassins.
Les trente années que Micipsa passa sur le trône furent très favorables à la prospérité du royaume de Numidie. L'agriculture surtout y prit un développement extraordinaire ; plusieurs branches d'industries y furent cultivées avec succès et la littérature de la Grèce et de l'Italie y trouva d'habiles interprètes.
Mais cette grande prospérité disparut avec lui. En mourant Micipsa avait distribué son royaume entre deux de ses fils, Hiempsal et Adherbal, et un neveu qu'il avait adopté et appelé au partage de sa succession, moins par affection que par crainte.
Ce dernier célèbre dans l'histoire sous le nom de Jugurtha était connu des Romains parmi lesquels il avait servi en Espagne sous le commandement de Scipion (Jugurtha s'est surtout distingué au siège de Numance dans la campagne qui suivit la prise de cette ville).
- Sa force prodigieuse, sa rare beauté, son courage indomptable,
- son esprit vif, souple et pénétrant, le faisaient adorer des Numides qui croyaient voir revivre en lui, Massinissa le fondateur de leur empire.
Son ambition ne connaissait ni le scrupule ni la crainte : elle amena sa chute et la ruine de sa patrie.
Appelé au trône conjointement avec deux princes plus jeunes que lui, dénués de talents et d'expérience, il ne lui fut pas difficile de s'en défaire et de régner seul.
Hiempsal, l'aîné, fut assassiné dans sa résidence de Thermida.
Adherbal, le second, ayant pris les armes pour venger son frère et se défendre lui-même,, fut prévenu par son farouche compétiteur qui l'attaqua à l'improviste et le chassa de ses États.
Adherbal ne se trouvant plus en sureté en Afrique, vint à Rome chercher un refuge et implorer l'assistance du sénat.
Mais déjà une démoralisation profonde régnait chez ces fiers patriciens ; l'or était sur eux tout puissant. Jugurtha le savait.
Des ambassadeurs numides partirent aussitôt avec ordre de se concilier la faveur de tous les hommes influents de la République.
Ses riches présents ne tardèrent pas à l'emporter sur les justes plaintes de son parent dépouillé.
Les sénateurs qui l'avaient accusé avec le plus d'acharnement se montrèrent ses plus ardents défenseurs ; et si quelques autres, restés incorruptibles, demandèrent que l'on punit Jugurtha et que l'on secourût Adherbal, la majorité, gagnée par les émissaires de l'usurpateur sut comprimer ce généreux élan.
Au lieu de faire passer sur-le-champ une armée en Afrique, on se contenta donc d'y envoyer dix commissaires chargés de faire entre les deux compétiteurs un nouveau partage de la Numidie.
Déjà ébranlés à Rome par les promesses de Jugurtha, ces commissaires se laissèrent entièrement corrompre par ses largesses, et dans le partage ordonné par le sénat, les districts voisins de la Maurétanie, les plus fertiles et les plus guerriers, lui furent attribués.
Adherbal eut ceux de l'Orient, qui, par le nombre des ports et l'éclat des cités, lui faisaient une part plus brillante que solide, car ils ne lui donnaient aucun moyen de défense contre son ennemi.
Aussitôt après le départ de ces commissaires, Jugurtha plus que jamais persuadé qu'il obtiendrait tout de Rome à prix d'argent, attaqua Adherbal, le battit dans plusieurs rencontres et l'enferma dans Cirta (Constantine) sa capitale dont il pressa le siège avec vigueur.
Ce malheureux prince n'eut que le temps d'envoyer de nouveau à Rome d'implorer du secours.
D'autres commissaires vinrent en Afrique ; mais, cette fois encore, les uns furent séduits par les promesses, les autres gagnés par les riches présents de Jugurtha.
Le siège de Cirta n'en continua donc pas moins, poussé avec l'opiniâtre énergie de l'ambition qui se voit près d'atteindre son but.
Trop forte pour être enlevée d'assaut, la ville fut étroitement investie et bientôt réduite à la famine.
Des marchands italiens et des soldats étrangers sur qui reposaient principalement la défense de la place, lassés de la longueur du siège, persuadèrent Adherbal de se rendre sous promesse de sa vie : l'imprudent écouta ce dangereux conseil, et, sans respect pour le droit des gens et pour sa parole, Jugurha le fit périr dans d'affreux supplices.
Les italiens et les numides qui avaient combattu avec lui furent passés au fil de l'épée. Ce crime atroce excita dans Rome une telle indignation que les nombreux amis que Jugurtha comptait dans le sénat ne purent détourner l'orage qui le menaçait. Une armée romaine envahit la Numidie et s'empara de plusieurs villes.
Mais autant ces troupes restaient braves et disciplinées, autant leurs chefs devenaient avares et cupides.
Le Consul et ses principaux officiers se laissèrent corrompre comme l'avaient été d'abord les sénateurs, puis les commissaires, et Jugurtha obtint d'eux un traité qui, moyennant un faible tribut, le laissa maître de tout le royaume.
- Quelques éléphants, quelques chevaux,
- une faible somme d'argent furent livrés pour la forme, après quoi le consul se retira avec son armée dans la province romaine.
Cependant à la nouvelle de cette honteuse pacification, le peuple, excité par l'un de ses tribuns rendit, malgré l'opposition du sénat un plébiscite qui mandait Jugurtha à Rome.
Ce prince obéit et ses intrigues accoutumées son or répandu avec profusion sur le peuple et les sénateurs, allaient peut-être encore lui assurer l'impunité, lorsqu'un nouvel assassinat commis dans la ville même sur la personne d'un prince numide, Massiva, petit-fils de Massinissa, autre compétiteur dont il crut utile de se défaire, ralluma l'indignation populaire que ces détails avaient amortie.
La guerre lui fut de nouveau déclarée, et le sénat lui ordonna de quitter l'Italie.
On rapporte qu'en s'éloignant, Jugurtha tourna plusieurs fois les yeux vers Rome, et s'écria : " O ville vénale, tu périras le jour où il se présentera un homme assez riche pour t'acheter ! "
Un nouveau Consul passa en Afrique : cette fois enfin les hostilités prirent un caractère sérieux. Cette guerre de Numidie est réellement la première que les Romains aient soutenue dans ces contrées. Carthage s'était défendue moins bien chez elle qu'en :
- Sicile, en Espagne, en Italie et sur la Méditerranée.
Lorsqu'elle tomba, elle ne laissa au pouvoir de ses vainqueurs que la place qu'avaient occupée ses murailles et un droit de suprématies sur les provinces les plus voisines, droit souvent contesté, qu'il fallait sans relâche soutenir les armes à la main. L'insurrection de Jugurtha fut une guerre nationale ; si elle eut été couronnée de succès, elle aurait pu compromettre à jamais la puissance de Rome en Afrique.
Le sénat le sentit, et ne négligea rien pour s'assurer le triomphe. Cette guerre est importante à connaître car elle a beaucoup d'analogie avec notre situation actuelle en Afrique.
La guerre contre Jugurtha dura sept ans, sans interruption. Six grandes armées commandées par les généraux les plus habiles y furent successivement envoyées, et chacune d'elles, à diverses reprises, reçut d'Europe des renforts qui la renouvelèrent presque entièrement.
- Quoique maîtres des côtes et d'une partie du pays,
- quoique alliés à plusieurs tribus numides et maures qui combattaient dans leurs rangs, les Romains n'étaient pas moins obligés de faire venir d'Italie presque tout le matériel nécessaire pour l'entretien et la subsistance des troupes.
Le génie opiniâtre du prince numide tirait parti de tout :
- du temps, des lieux, des saisons.
Le premier Consul C. Bestia, envoyé contre lui, s'était laissé séduire et avait signé un traité honteux ; le second Albinus, hésitant entre le désir de suivre cet exemple et la crainte d'être puni s'il le suivait, consuma dans cette indécision l'année entière de son consulat, et revint à Rome pour les comices, sans avoir fait aucun progrès.
Son frère Aulus, chargé pendant son absence de commandement de l'armée, trompé par des paroles de paix et de feintes promesses de soumission, se laissa entraîner, à la poursuite des Numides, dans des lieux difficiles, coupés de bois et de défilés.
Là, enveloppé, trahi par une partie de ses officiers et de ses soldats, qui ne faisaient qu'imiter l'exemple contagieux de leurs généraux, il fut obligé, pour sauver le reste de son armée, de s'engager à évacuer sous les dix jours toute la Numidie, et même de passer sous le joug, ce qui était alors la dernière ignominie pour les vaincus.
Le peuple de Rome, exaspéré, se souleva de nouveau contre les indignes fauteurs de Jugurtha.
Le troisième Consul Metellus, chargé de répare la honte des armes romaines, parvint à leur rendre l'éclat qu'elles avaient perdu ; mais quoique aussi habile général que bon citoyen, et incapable de céder aux mêmes séductions que ses prédécesseurs, il ne put terminer la guerre.
- Il gagna des batailles,
- s'empara de places réputées imprenables,
- employa tour à tour la force et la ruse ; tout fut inutile ; le prince numide lui échappa sans cesse.
- La gloire de le saisir et de le trainer au Capitole était réservée à son lieutenant Marius.
Celui-ci, à qui échut enfin le département de l'Afrique, l'an 646 de Rome, prit le commandement de l'armée. Toutefois malgré les victoires de Metellus qui semblait ne lui avoir laissé rien à faire,
- malgré son incontestable capacité militaire,
- malgré les négociations habiles de son lieutenant Sylla, la guerre dura encore près de trois ans.
Privé de toutes ressources dans son royaume Jugurtha en trouva de nouvelles dans celui d'un prince voisin : Bocchus, roi de Maurétanie, son beau- père et son allié, unit ses forces aux siennes.
Les Romains qui croyaient la guerre finie, eurent encore de grandes batailles à livrer. La force même ne suffit pas ; le prince numide ne fut vaincu que par l'arme qu'il avait si souvent employée : la trahison.
- Ébranlé par les propositions des généraux romains,
- épuisé par les sacrifices qu'il faisait pour la cause de son allié,
- craignant enfin de perdre ses États dans la lutte prolongée contre toutes les forces de la République, Bocchus abandonne Jugurtha et le livre à ses ennemis.
Pris et conduit à Rome, le prince de Numidie fut un des ornements du triomphe de Marius ; puis on le jeta dans un cachot humide et fangeux où il mourut de faim après d'horribles angoisses.
Ainsi périt, à l'âge de cinquante-quatre ans un prince qui, malgré ses crimes, était devenu, par son courage et son génie, une des gloires de l'Afrique.
Les Romains eurent tant de peine à le vaincre, qu'ils le regardaient comme un autre Annibal. Après sa mort ses États subirent un démembrement.
Nouveau partage dans lequel Rome ne manqua pas de se faire la part du loin.
La portion occidentale fut donnée au roi Bocchus en récompense de sa trahison.
Du centre on fit un petit royaume à la tête duquel le sénat mit Hiempsal II, moins par égard pour les grands services de son aïeul Massinissa que pour cacher les secrets desseins de sa politique envahissante.
Tout le reste fut réuni à la province proconsulaire, c'est-à-dire à l'ancien territoire de Carthage augmenté de quelques cantons limitrophes qui avaient appartenu à la Numidie.
La conquête de la Numidie assura la domination des Romains en Afrique.
La chute de Carthage lui avait donné l'empire des côtes. La défaite de Jugurtha ouvrit l'intérieur du pays. De vastes contrées qui n'avaient jamais obéi aux Carthaginois, passèrent sous l'autorité de Rome ; on peut même rapporter à cette époque l'établissement de cette longue chaine de colonies européennes qui s'étendit en fort peu d'années depuis Tanger jusqu'à l'Égypte.
Le littoral ne fut plus pour ainsi dire qu'une seule colonie romaine.
Et là comme dans tout l'Occident l'élément national fut absorbé par l'élément latin avec une prodigieuse rapidité.
Néanmoins, il resta toujours dans les vallées de l'Atlas et au midi de cette chaine de montagnes, une masse considérable de nomades qui subissaient les lois de la civilisation, sans jamais se laisser dompter par elle.
Si cette contrée, désolée par des siècles de barbarie, apparait encore aujourd'hui si belle aux regards des voyageurs, qu'on juge de ce qu'elle dut être aux jours de Carthage et de Rome !
Sa fertilité, qui n'est surpassée peut-être dans aucune partie du globe, secondée par le génie industrieux des Carthaginois, produisait d'immenses richesses naturelles. Trois cents villes couvraient son sol ; la seule Carthage avait renfermé dans ses murs sept cent mille habitants.
Cette prospérité qui nous paraitrait fabuleuse si elle n'était attestée par tous les écrivains de ces époques reculées, s'accrut encore sous la domination romaine ; car avec cet admirable instinct d'assimilation qui leur faisait adopter tout ce qu'ils trouvaient de bon et d'utile chez les peuples soumis par leurs armes, les Romains suivirent, pour coloniser l'Afrique et y affermir leur puissance, le système que leur avait indiqué les Carthaginois.
Ils s'efforcèrent, comme l'avaient fait leurs rivaux, de lier, par le commerce et l'agriculture, leurs intérêts à ceux des indigènes afin de les dominer et de les exploiter plus sûrement. C'est surtout à la production du blé qu'ils s'attachèrent avec le plus de persévérance et d'ardeur.
- Ils portèrent en Afrique leurs méthodes de culture et
- répandirent les lumières de leur vieille expérience sur l'industrie naissante des vaincus,
- desséchèrent les marais et les lacs,
- élevèrent des ponts, creusèrent des canaux,
- tracèrent des routes d'une solidité admirable.
Ainsi aidée par le travail de l'homme, cette terre fit des prodiges et devint le grenier de Rome.
Sous Auguste, lorsque le luxe des grands arrachant l'Italie aux bras qui la cultivaient l'eut transformée en un immense jardin de plaisance semé de somptueux palais, la métropole demanda la moitié de sa subsistance aux moissons africaines, et chaque année le port de Carthage expédiait de quoi la nourrir pendant six mois au moins. Enfin, car telle est l'influence du travail sur les mœurs, sur le caractère des peuples, l'on vit une foule de tribus numides adopter comme à l'envie la vie sédentaire des colons et préférer aux fatigues de la vie nomade les paisibles travaux de l'agriculture.
- Les ravages, les rapines
- les guerres de tribu à tribu cessèrent graduellement.
Depuis Auguste jusqu'au premier Antonin, c'est-à-dire pendant l'espace de près de deux siècles, une seule légion suffit dans les temps ordinaires (et les exceptions furent rares), pour garder tout le pays compris depuis Tanger jusqu'à Cyrène et pour y maintenir l'ordre et la paix.
Plus tard, l'empire s'affaiblissant, chaque révolte de la colonie menaça Rome d'une disette. On suit, sous ce rapport, d'année en année l'action de l'Afrique sur l'Italie.
Ainsi, par exemple on voit successivement l'empereur Sévère, repoussant les prétentions de Niger à la pourpre des césars :
- envoyer à la hâte ses légions à Carthage afin que son compétiteur ne puisse pas s'en emparer et affamer la population de Rome.
- Le préfet Symmaque s'opposait, dans le sénat, à l'expédition méditée contre le rebelle Gildon, de crainte que les blés de l'Afrique cessant d'arriver, il en résulte au centre de l'empire une sédition dangereuse.
- Enfin Alaric s'emparer du port d'Ostie où les premiers césars avaient fait bâtir d'immenses greniers destinés à recevoir les tributs en blé et en huile qu'envoyait la colonie africaine, et par cette conquête préluder à la prise de la capitale du monde.
Les guerres civiles allumées par les rivalités :
- de Marius et de Sylla, de César et de Pompée, vinrent à leur tours diviser l'Afrique.
La fondation, sur divers points du sol, de petites colonies romaines et de municipes (cités romaines) avait donné naissance à une population qui, à l'époque dont nous parlons, prit une part active à la lutte.
Les rois indigènes eux-mêmes, selon leurs engagements antérieurs ou leurs affections particulières s'y mêlèrent avec ardeur.
Ce fut durant les vicissitudes de cette longue guerre, que Marius, fugitif vint chercher un asile sur cette terre témoin de ses premiers triomphes.
Débarqué non loin de Carthage, il s'était arrêté au milieu de ces ruines, les contemplant sans doute avec un secret retour sur lui-même, lorsque le gouverneur de la province, le préteur Sextilius, craignant d'être compromis par la présence de l'illustre proscrit, lui fit notifier l'ordre de s'éloigner sans délai, sous peine d'être traité en ennemi du sénat et du peuple romain. " Va dire à, ton maître, répondit au licteur (garde escortant les magistrats) le vainqueur des Cimbres (peuple originaire du Jutland au Danemark) et des Teutons, que tu as vu Marius assis sur les ruines de Carthage ! "
Tandis que Marius (empereur romain) donnait au monde cet éclatant exemple de l'instabilité des plus hautes fortunes, son fils, avec quelques-uns de ses partisans, descendu un autre point des côtes d'Afrique, avait trouvé un asile à la cour d'Hiempsal, roi de Numidie.
D'abord traités favorablement ils ne tardèrent pas à s'apercevoir que leur hôte les considérait moins comme des alliés que comme des otages que la fortune venait de jeter entre ses mains.
Pour se concilier l'amitié de Sylla, il se disposait même à lui livrer lorsqu'une des concubines du roi, avec laquelle le jeune Marius avait lié des rapports intimes, vint à, la fois leur apprendre le danger qu'ils couraient et leur offrir les moyens de s'y soustraire.
Le fils rejoignit son père encore errant sur le rivage où ils se virent abandonnés de tous leurs partisans.
Alors ne prenant conseil que de leur désespoir, ils résolurent de tenter de nouveau le sort des armes et se réembarquèrent pour l'Italie.
Leur audace fut couronnée d'un plein succès : Marius mourut maître de Rome !
La mort de son rival rendit à Sylla l'empire du monde : le parti, plébéien fut vaincu pour la seconde fois.
Après la chute de ce parti en Italie, Domitius, gendre de L. Cinna (consul 135-84 avant J. C) entreprit de le relever en Afrique. Il s'adressa à, Hiertal, roi d'une partie de la Numidie et obtint de ce prince d'assez puissants secours pour envahir la province romaine.
Mais le dictateur résolut d'étouffer cette révolte dès sa naissance.
Sertorius, un des conjurés, commandait en Espagne : il fallait à tout prix empêcher qu'un autre chef du parti vaincu ne s'établit dans l'Atlas, car maîtres de deux provinces riches et belliqueuses, ces deux chefs eussent pu recommencer la lutte avec avantage, et peut-être même, en unissant leurs efforts, venir chercher leur revanche jusqu'en Italie.
Pompée reçut donc l'ordre de passer de Sicile en Afrique.
Cent vingt galères et huit-cent bâtiments de charge y portèrent six légions ; une partie débarqua à Utique, l'autre à Carthage sous les ordres du jeune général.
Les troupes campées sur les ruines de cette dernière ville donnèrent à cette circonstance un exemple de cupidité et d'indiscipline qui atteste la décadence du caractère romain.
Quelques soldats en creusant la terre y avaient trouvé un trésor considérable ; le bruit de cette découverte se répandit aussitôt dans les rangs : on assurait que les Carthaginois, à l'époque de leurs derniers désastres avaient enfoui qu'ils avaient de plus précieux ; et pour retrouver ces richesses imaginaires, officiers et soldats, sans respect pour la discipline, quittèrent leurs armes et se mirent à fouiller le sol en tous sens.
Les conseils de Pompée, ses ordres mêmes restèrent sans force sur ces imaginations exaltées.
Enfin, après plusieurs jours employés à ce travail, fatigués d'inutiles recherches et honteuse de sa folie, l'armée demanda de marcher à l'ennemi.
Pompée et ses troupes rencontrèrent bientôt Domitius qui avait un puissant motif de terminer promptement la guerre : en effet la désertion faisait de grands ravages dans son armée.
A la nouvelle du débarquement de Pompée, sept mille hommes l'avaient abandonné et il lui fallait une victoire pour rattacher à sa cause ces esprits inquiets et inconstants.
Toutefois la fortune lui refusa cette faveur. Un ravin profond séparait les deux armées, et ni l'un ni l'autre des deux généraux ne voulant le franchir le premier, ils restèrent quelque temps en observation réciproque.
Tout à coup, un de ces orages de pluie et de vent si fréquents sous le ciel africain éclate avec violence.
Domitius, jugeant dès lors que tout engagement était devenu impossible, fait sonner la retraite. Mais en présence de l'ennemi et au milieu des vents déchaînés ce mouvement ne pouvait s'effectuer sans désordre.
Pompée profite avec habileté de cette manœuvre imprudente, passe le ravin et conduit l'attaque avec la plus grande vigueur.
En quelques instants les troupes de Domitius sont enfoncées sur tous les points, et leur défaite devient aussi complète que sanglante.
Sur vingt-mille hommes, trois mille à peine regagnèrent leur camp.
Domitius perdit la vie dans cette déroute et la guerre se trouva terminée en un seul jour.
Parmi les villes qui avaient embrassé son parti, les unes se rendirent sans résistance, les autres furent prises d'assaut ; en un mot, toute la contrée se soumit ; les tribus Gétules, saisies de terreur, levèrent leurs tentes et s'enfuirent vers le désert.
De retour à Utique, Pompée y trouva un ordre de Sylla qui lui enjoignait d'y rester avec une seule légion pour attendre l'arrivée d'un successeur auquel il remettait le gouvernement de la province pacifiée et de renvoyer en Italie le reste de son armée victorieuse.
Une telle marque d'ingratitude étonna le général et irrita violemment les soldats.
Ils ne voulaient point, disaient-ils le laisser à la merci d'un tyran, et se répandaient en invectives contre le dictateur.
Cette sédition se prolongea tellement que le bruit en parvint jusqu'à Rome où bientôt l'on rendit Pompée complice de ses troupes.
Sylla, lui-même, parut croire à cette complicité et se plaignit publiquement de passer sa vieillesse à combattre contre des enfants. Par ces paroles il faisait allusion au jeune Marius qui lui avait si opiniâtrement disputé la victoire.
Tandis qu'au forum ou dans le sénat on représentait Pompée comme un rebelle, celui-ci au contraire, luttait contre ses troupes mutilées, et pour vaincre leur obstination les menaçait de se tuer à leurs yeux si elles refusaient plus longtemps d'obéir. Elles cédèrent enfin et s'embarquèrent pour l'Italie.
Après avoir remis entre les mains de son successeur le gouvernement de la province, le jeune général suivit ses légions. Rome toute entière alla à sa rencontre pour lui faire honneur ; et Sylla l'embrassant avec tous les signes d'une extrême affection, le salua du surnom de " grand ", titre qui depuis lors n'a cessé d'être joint au nom de Pompée.
Dans l'intervalle qui sépare la première guerre civile de la seconde, les colonies africaines restèrent paisibles mais eurent à subir un fléau plus cruel que la guerre même, la préture (magistrature romaine) de Catilina (homme politique romain 108-62 avant J. C).
Les exactions, les violences de ce gouverneur devinrent si insupportables, qu'un cri unanime s'éleva contre lui. De tous côtés les plaintes arrivèrent à Rome.
Quelques-uns des sénateurs opinèrent pour la mise en jugement ; mais les nombreux amis qu'il comptait dans l'assemblée lui épargnèrent cette juste honte. A l'expiration de sa charge, il rapporta dans sa patrie d'immenses richesses qui lui servirent à fomenter cette fameuse conjuration sous laquelle la République faillit périr.
Les convulsions politiques de la métropole se succédant presque sans interruption, réagissaient sur la colonie africaine, sans toutefois arrêter l'essor de sa prospérité. Les tributs que Rome lui imposait :
- en blé, en huile,
- en fruits de toute espèce, allaient toujours croissant.
On en trouve, dès cette époque, une preuve remarquable.
Peu d'années après la conjuration de Catilina, une disette ayant menacé Rome, Pompée reçut du sénat et du peuple la mission de remédier au mal.
Il mit à contribution les trois greniers de la République :
- l'Égypte,
- la Sicile,
- l'Afrique, et en peu de temps il rassembla plus de denrées qu'il n'en fallait pour faire cesser la cherté des vivres et dissiper les craintes de la multitude.
Le parti plébéien avait expiré en Afrique avec Marius, celui de Pompée et de l'aristocratie républicaine vint aussi y chercher un tombeau.
Ces grands évènements dont elle fut le théâtre attestent tout à la fois et son importance et le génie guerrier de ses populations, auxquelles les débris de tous les partis vaincus venaient tour à tour demander assistance.
Le parti de Pompée eut pendant quelque temps la prépondérance de cette province. Le préteur A. Varus, qui déjà en avait été gouverneur, chassé d'Italie par César après le passage du Rubicon, s'était réfugié à Utique.
Arrivé en suppliant et en fugitif, ses anciennes liaisons avec les principaux habitants, ses habiles négociations avec des rois alliés de Rome, lui eurent bientôt rendu la prépondérance.
Gouvernant pour Pompée au nom du sénat, il contracta une étroite alliance avec Juba, roi de la Numidie et de la Maurétanie, auquel la prévoyance du rival de César avait confié le gouvernement des populations qui ne se trouvaient pas sous l'administration immédiate de la métropole.
Une très grande partie de l'Afrique était donc à eux.
Ne pouvant aller en personne le leur arracher, César y fit passer son lieutenant Curion, à la tête de quelques troupes ; mais ce général qui n'avait aucune connaissance du pays, se laissa surprendre sous les murs d'Utique dont il faisait le siège ; son armée fut entièrement détruite, et lui-même perdit la vie.
Pendant que la grande querelle entre César et Pompée se décidaient dans les plaines de la Grèce, Varus, resté en Afrique, rassemblait de toutes parts :
- des soldats, des armes et des munitions de guerre.
L'arrivée de Metellus-Scipion, échappé au désastre de Pharsale, vint imprimer à ces préparatifs une nouvelle activité ; le roi Juba joignit ses troupes à celles de ces généraux.
Toutefois la discorde ne tarda pas à éclater entre Varus d'une part, Juba et Metellus-Scipion de l'autre, car l'orgueilleux numide faisait durement sentir aux Romains vaincus et fugitifs le besoin qu'ils avaient de lui.
La présence de Caton, qui sur ces entrefaites vint les joindre à la tête des débris de Pharsale, mit fin à leurs débats : sa renommée imposa au roi, et ses conseillers réconcilièrent les deux Romains.
Leur donnant à tous l'exemple de l'abnégation, il refusa le commandement qu'ils lui déféraient d'une commune voix et en fit investir Scipion dont le rang était supérieur au sien :
- Caton, Varus et Labiénus, anciens lieutenants de César dans les Gaules, ardents comme tous les transfuges, servirent sous les ordres de Scipion ;
- Juba conserva le commandement exclusif de son armée.
Le premier soin de ces généraux fut de s'assurer de tout le pays et de prévenir les mouvements des partisans de César. Utique paraissait vouloir pencher en sa faveur, et c'était un grave danger, car :
- le nombre de ses habitants,
- la commodité de son port,
- la force de ses murailles,
- lui donnaient la suprématie sur toutes les autres villes de la province.
Juba proposa :
- de la détruire,
- d'en massacrer la population, et
- de raser jusqu'au sol, ses édifices et ses remparts.
Ce conseil n'était sans doute rien moins que désintéressé car tout ce qui tendait à affaiblir les conquérants de l'Afrique servait ses intérêts personnels.
Scipion ne reculait pas devant une telle proposition, mais Caton (politicien, écrivain) la rejeta avec indignation.
Il répondit d'Utique et offrit de rester lui-même dans la place pour contenir les habitants. Mieux valait en effet, la question d'humanité à part, conserver Utique que de la détruire. Caton y :
- amassa de nombreuses munitions de guerre et de bouche,
- fit exhausser les tours,
- élargir les murailles et
- creuser des lignes de circonvallation très profondes.
Enfin ceux des habitants dont il se méfiait reçurent ordre de livrer leurs armes.
La sagesse de ces mesures mit en état de défense une ville à laquelle sa mort stoïque allait bientôt donner une éternelle célébrité.
La nouvelle de ces préparatifs parvint promptement à Rome et y ranima les espérances du parti républicain, que la défaite de Pharsale et la mort funeste de Pompée avait jeté dans la consternation.
Révolté par la conduite des lieutenants de César, le peuple semblait près de se réveiller ; les rapines de Dolabella (homme politique, consul), les débauches d'Antoine, lui devenaient de jour en jour plus odieuses et plus insupportables.
On disait aussi que l'activité si vantée de César s'était amortie ; qu'un fol amour pour une reine étrangère lui avait fait perdre un temps précieux dans une expédition inutile et sans but, et qu'il laissait respirer le parti ennemi qui se relevait déjà de tous côtés :
- En Espagne, sous le fils de Pompée,
- en Afrique sous Caton, Varus et Scipion.
Ces plaintes dont la plupart étaient fondées, l'inquiétude qu'éprouvaient ses partisans, la joie de ses ennemis, ranimèrent enfin chez César cette activité que les amis de la cause républicaine se plaisaient à croire éteinte.
Selon un usage, le dessein et l'exécution marchèrent simultanément. Résolu de porter la guerre en Afrique, il partit pour la Sicile au cœur de l'hiver, et ne s'arrêta qu'à Lylibée (base navale importante des Carthaginois, actuelle Marsala en Sicile).
Là, n'ayant encore sous la main qu'une légion de nouvelle levée avec six cents chevaux tout au plus, il fit dresser da tente sur le rivage et si près de la mer que les vagues en venaient presque battre le pied.
Malgré le vent toujours contraire et la saison peu favorable, les équipages furent consignés à bord des navires afin que chacun se tînt prêt à partir au premier signal. César mit à profit ce retard involontaire en expédiant des ordres et des proclamations qui allaient réveiller au loin le zèle de ses partisans.
Bientôt des galères lui arrivèrent de tous côtés, puis des soldats qu'il fit monter sur ces galères, tandis que la cavalerie était répartie sur les bâtiments de transport. Ces premières forces ainsi rassemblées, il donna le signal du départ et fit voile pour l'Afrique.
Les commencements de la campagne ne furent point heureux : n'étant maître d'aucun port sur cette côte ennemie, il n'avait pas assigné à sa flotte de rendez-vous commun, mais seulement recommandé aux pilotes d'aborder le plus près possible du point de départ. Cette circonstance faillit lui devenir fatale car :
- une partie de ses transports fit naufrage
- ou furent capturés,
- plusieurs galères périrent.
Le plus grand nombre de ses vaisseaux se dispersèrent de côté et d'autre ; quelques-uns même retournèrent en Sicile où les vents contraires les retinrent longtemps encore.
Le jour de son débarquement, César ne parvint à réunir que trois mille hommes et cent cinquante chevaux. La ville d'Adrumète (Hammamet) près de laquelle il avait pris terre, défendue par une population nombreuse, deux légions et trois mille Maures, ne pouvait être enlevée par un coup de main.
Il voulut parlementer avec le gouverneur ; mais son envoyé ayant été mis à mort, il battit en retraite, vivement poursuivi par un corps de cavalerie numide qu'il ne contint qu'à grand' peine.
Heureusement pour lui le gros des troupes ennemies se trouvant à quelque distance, il eut le temps de recevoir des renforts qui lui amenaient les navires restés en arrière.
Quelques jours après, il se vit attaqué en rase campagne par Labiénus, à la tête d'une nombreuse cavalerie maure et numide soutenue par cent-vingt éléphants.
La bataille se prolongea et la victoire resta indécise depuis le matin jusqu'au coucher du soleil.
Par une tactique due à Labiénus, (général romain) la cavalerie numide, mêlée à de l'infanterie légère, qui chargeait et se retirait avec elle, portait surtout le trouble parmi les troupes romaines, habituées à combattre à pied ferme.
Les soldats de nouvelle levée qui composaient la plus grande partie des légions de César étaient effrayés par la multitude des ennemis et les vétérans eux-mêmes paraissaient ébranlés par cette étrange manière de combattre, qui consistait, alors comme aujourd'hui, à attaquer et à fuir avec une égale rapidité.
Ces vieux soldats se demandaient l'un à l'autre comment ils s'y prendraient pour vaincre des ennemis insaisissables.
Mais, dans cette situation difficile, César prouva mieux que jamais qu'aucune des qualités d'un grand général ne lui était étrangère : résolu à ne plus accepter de combat qu'il n'eût reçu de nouveaux renforts de Sicile et d'Italie, il se renferma dans son camp, et tandis que ses ennemis l'y croyaient retenu par la crainte, il y préparait en silence la victoire, rendant sa position inexpugnable au moyen de grands ouvrages, faisant élever deux lignes de retranchements, l'une de la ville de Ruspina, près de laquelle il se trouvait, jusqu'à la mer, l'autre de la mer à son camp, afin d'assurer ses communications avec ces deux points d'une égale importance.
Les manœuvres de la politique vinrent aussi se joindre aux ressources de l'art militaire. Connaissant l'inconstance et la mobilité des Numides et des Maures, les rivalités qui existaient entre les tribus, leur indocilité au joug, il existait sous-main la révolte. Ainsi, quoique renfermé dans son camp, César était présent partout et remuait l'Afrique entière.
Le contre coup de ces menées se fit sentir jusque dans le royaume de Juba.
Un romain du nom de Sitius, profitant des désordres inséparables des guerres civiles, avait levé pour son propre compte un corps de partisans qu'il louait tantôt à un chef numide, tantôt à un autre, pour soutenir les querelles particulières.
Gagné par les promesses des émissaires de César, il embrassa son parti et envahit les États de Juba que le départ de ce prince avec toute son armée laissait sans défense. Bogud, roi d'une partie de la Maurétanie, s'étant joint à Sitius, ils ravagèrent ensemble les campagnes, puis s'attaquèrent aux villes.
Cirta la capitale et la plus forte place de la Numidie tomba entre leurs mains. A cette époque Juba quitta l'armée des coalisés pour voler au secours de ses États et ramena toutes ses troupes, ne laissant à Scipion que trente éléphants.
C'était là une heureuse diversion pour César dont les convois tant attendus n'arrivaient pas, et à qui Scipion pouvait interdire la campagne.
Chaque jour, plus étroitement resserré par l'ennemi, il se voyait menacé d'être bientôt complètement renfermé dans l'étroite enceinte de son camp. Le fourrage même vint à lui manquer tout à fait.
Les vétérans pour qui de semblables épreuves n'étaient pas une nouveauté, ramassaient sur le rivage de l'algue marine, la lavaient dans l'eau douce, et ainsi préparée la faisaient servir à la nourriture de leurs chevaux.
Néanmoins de si dures extrémités ne purent ébranler la constance de César ; il supportait avec une rare patience les insultes et les bravades de l'ennemi.
Chaque jour Scipion lui présentait la bataille, chaque jour il la refusait, pensant bien que ses adversaires n'auraient pas l'audace de venir l'attaquer jusque dans son camp.
Tenant sans cesse sa pensée et ses yeux tournés vers la mer, il demandait aux vents et aux tempêtes, ses vieux compagnons d'armes, contraint de cacher à tous les regards l'impatience qui le dévorait.
Les renforts si impatiemment attendus parurent enfin. Deux convois considérables, chargés de troupes et de vivres abordèrent au camp de Ruspina, où ils apportèrent la joie et l'abondance.
Sortant aussitôt de ses lignes, César déploya ses légions dans la plaine au bord de la mer. A cette vue, les troupes de Scipion, rangées en bataille à peu de distance, s'effrayèrent et rentrèrent dans leur camp.
Maître du terrain et satisfait d'avoir donné cette leçon à ses adversaires, César ne poussa pas plus loin son avantage.
Avant de reprendre activement l'offensive, il voulait aguerrir ses troupes et leur inspirer une confiance à toute épreuve.
Cependant Caton, renfermé dans Utique, recevait avec inquiétude les nouvelles qui leur arrivaient de toutes parts. Redoutant la fortune de César, il écrivait à Scipion :
- de ne pas engager d'action décisive,
- de trainer la guerre en longueur et
- offrit même de passer en Italie afin de faire en faveur de la cause républicaine une puissante diversion.
Mais s'il lui était donné de prévoir la ruine de son parti, il se trouva hors d'état de l'empêcher.
La prudente circonspection de César, le retour de Juba, vainqueur de Sitius avaient rendu à Scipion son aveugle présomption que partageait le roi numide.
De son côté, jugeant le moment favorable pour terminer la lutte par une grande bataille, César s'y préparait avec un art admirable.
Il lève son camp pendant la nuit et va mettre le siège devant Thapsus (ville de Sicile), place importante où Scipion, depuis le commencement des hostilités, tenait renfermer ses provisions de guerre et de bouche, et dont les habitants s'étaient toujours montrés fidèles à sa cause.
Celui-ci marcha en toute hâte au secours de Thapsus, et la bataille qui devait décider du sort de la guerre fut livrée sous les murs de cette ville.
Pour Scipion et Juba, ce ne fut qu'une honteuse déroute ; ils virent leur armée dispersée et détruite en un instant.
Le vainqueur ne perdit que cinquante hommes. Cette disproportion entre les pertes réciproques parait peu vraisemblable, mais Hirtius et Plutarque, d'ailleurs en contradiction si fréquente, sont d'accord sur ce point.
César recueillit le fruit de sa victoire avec sa célérité habituelle : laissant son infanterie devant Thapsus pour en continuer le siège, faisant poursuivre vivement Scipion et Juba, il marcha lui-même sur Utique avec un corps de cavalerie.
Le trouble régnait dans la ville dont les habitants étaient descendus dans les rues, s'interrogeant les uns les autres avec anxiété et poussant des cris d'effroi.
En effet les débris de l'armée vaincue y étaient arrivés pendant la nuit et leur nombre allaient toujours croissant, ils devenaient plus à craindre que l'armée victorieuse. On disait que la cavalerie de Scipion, fuyant du champ de bataille, avait attaqué la ville de Parada (ville du Portugal) ; qu'après l'avoir brûlée et saccagée de fond en comble, elle avait attaqué le camp établi par Caton entre les retranchements de cette même ville, sous le prétexte que les habitants s'étaient montrés favorables au parti qui venait de vaincre. Bientôt enfin le bruit se répandit que César était aux portes.
Au milieu de cette agitation, Caton s'occupait avec calme du salut des habitants et de celui des Romains émigrés.
Aux premiers, que leur naissance et que leurs intérêts attachaient au sol de l'Afrique, il conseillait de rester étroitement unis, soit qu'ils voulussent continuer la résistance ou implorer la clémence du vainqueur ; les seconds, pour la plupart chevaliers ou sénateurs, il les accompagna jusqu'au port et reçut leurs adieux.
Quant à lui, désespérant de sauver la ville, il se tua de sa propre main, résolution fatale inspirée par la faiblesse " d'une grande âme ou si l'on veut par l'erreur d'un stoïcien mais qui n'en a pas moins été une tache sur sa vie ! "
Les magistrats d'Utique firent à ce général romain de magnifiques funérailles, auxquelles assista toute la population sans distinction de partis et malgré la crainte qu'inspirait l'approche de César.
Un tombeau lui fut érigé sur le rivage.
Du temps de Plutarque, on y voyait encore sa statue, une épée nue à la main : de nos jours il ne reste plus que son nom.
Entré victorieusement dans Utique, César exprima de vifs regrets de la mort de son ennemi, ce qui ne l'empêcha pas de lever de fortes contributions sur les habitants. Nous trouvons ici une nouvelle preuve des richesses de l'Afrique.
Les citoyens romains d'Utique furent taxés à la somme de deux millions de sesterces, payables en trois années (le sesterce représente 20 centimes 5/10 de notre monnaie) ; les biens de tous ceux qui avaient eu des commandements furent confisqués et vendus à l'encan (vente à l'enchère).
César imposa la ville de Thapsus à deux millions de sesterces et son territoire à trois millions ; la ville d'Adrumète à trois millions et son territoire à cinq.
Leptis et Cisdra, villes moins riches ou moins coupables aux yeux du vainqueur, furent taxées seulement à trois cent mille livres d'huile, la seconde à une certaine quantité de blé.
Ces mesures ne rencontrèrent aucune espèce de résistance : tout était soumis et silencieux.
De tant de chefs qui avaient pris les armes contre César, il n'en restait pas un seul :
- Scipion s'était embarqué pour l'Espagne, mais rejeté sur les côtes par la tempête, il périt non loin d'Hippone,
- Caton était mort à Utique,
- Juba abandonné de ses sujets, repoussé de sa capitale, s'était suicidé,
- son fils lui survécut et figura dans le triomphe de César à côté du gaulois Vercingétorix et de la sœur de Cléopâtre.
Les généraux de l'armée combinée ne furent pas plus heureux :
- les uns s'ôtèrent eux-mêmes la vie,
- les autres trouvèrent la mort sur le champ-de-bataille ou dans leur fuite.
Ceux qui se rendirent volontairement furent épargnés ; le plus petit nombre parvint à gagner l'Espagne.
La chute de Juba fut suivie de la réunion de la Numidie à la province romaine. César en forma un gouvernement particulier dont il donna l'administration au préteur Salluste.
La conduite rapace de ce gouverneur fut peu en rapport avec les maximes qu'il étala depuis dans ses ouvrages.
Enfin César se rembarqua pour Rome. En moins de six mois, il avait commencé et terminé cette guerre, détruit deux puissantes armées et accru la province romaine d'un vaste royaume.
Ce royaume est celui que les tribus arabes nous disputent depuis dix ans car Juba réunissait à la plus grande partie de la Numidie la Maurétanie orientale (Alger et Oran.)
La mort de César suivit de près ces derniers évènements. Les troubles dont elle fut la cause, la chute du gouvernement républicain et surtout les fureurs du triumvirat jetèrent en Afrique un grand nombre de proscrits que le proconsul Cornificius accueillit avec humanité.
Les indigènes recommencèrent à s'insurger mais ces hostilités conduites par des chefs subalternes n'eurent aucune influence sur les affaires générales de Rome : ce fut sur les flots, en vue du rivage d'Actium (ville de la côte ouest de la Grèce) que se décidèrent les destinés du monde.
A SUIVRE
|
|
EXAMEN !!!
Envoyé par Mme Eliane
|
L’évêque interroge les futurs communiants et il s’adresse à un premier enfant :
- Qu’a dit le Seigneur en instituant le baptême ?
- Il a dit : Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
- Très bien.
Il s’adresse à un deuxième enfant :
- Qu’a-t-il dit pour l’eucharistie ?
- Prenez, mangez et buvez, ceci est mon corps et mon sang.
- C’est bien.
S’adressant à un autre enfant, il demande :
- Et toi, qu’a-t-il dit pour le mariage ?
- Heu ... heu ... ah oui, il a dit :
- Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.
|
|
| 2) Domination romaine.
Envoi de M. Christian Graille
|
|
Les Empereurs. Première époque (32 avant J. C et de 297 de J. C)
La nouvelle organisation que César avait donnée au gouvernement d'Afrique ne fut que provisoire ; elle reçut de graves modifications par la mort des rois Bocchus et Bogud (32 avant J-C) qui commandaient aux deux portions du pays nommées depuis :
- Maurétanie Césarienne et
- Maurétanie Tingitane.
Ces deux princes léguèrent leurs états au peuple romain qui en forma d'abord une seule province, puis ensuite un royaume qu'Auguste donna à Juba II, prince éclairé dont l'éducation toute romaine assurait la soumission.
Juba signala son règne par la fondation, sur l'emplacement de l'ancienne Iol, d'une ville nouvelle à laquelle il donna le nom de Césarée (Cherchell), en mémoire des bienfaits qu'il avait reçus de l'empereur.
Enrichies de magnifiques édifices, cette ville devint la capitale de son royaume et se ruines témoignent encore aujourd'hui de l'importance qu'elle ne tarda pas à acquérir. Le rétablissement du royaume de Numidie au profit de l'héritier légitime fut tout à la fois un acte de générosité et de bonne politique qui gagnait le cœur des Numides en les habituant peu à peu à recevoir leurs chefs des mains de Rome, et qui ne diminuait le territoire immédiat de l'empire que pour fortifier en réalité la domination de l'empereur.
D'ailleurs Auguste abandonnait moins à Juba la propriété que l'usufruit de son royaume, disposant des territoires, les divisant, les morcelant à son gré sans jamais éprouver la moindre résistance.
Il n'avait point non plus à craindre les effets ordinaires de l'ambition sur l'esprit du nouveau roi qui lui était attaché par les liens de la reconnaissance et de l'intérêt, car après avoir pris de son éducation les soins les plus affectueux, l'empereur lui donna pour épouse Sélène, fille d'Antoine et de Cléopâtre, et, de son propre mouvement, créa pour lui un royaume.
Juba ne pouvait oublier tant de bienfaits ni montrer trop de gratitude.
Aussi long que paisible, le règne de ce prince fut de quarante-cinq ans.
N'ayant rien à craindre des Romains, trop sage pour penser même à le combattre, Juba tournait vers les arts de la paix cette activité naturelle aux Africains que ses ancêtres avaient déployée dans la guerre.
Les loisirs que lui laissait l'administration de son royaume, il les consacrait à l'étude, et bientôt il acquit dans les sciences et dans les lettres une grande réputation. Malheureusement ses ouvrages sont depuis longtemps perdus ; il n'en reste que les titres et quelques fragments. (C'était une histoire d'Arabie ; une histoire des antiquités d'Assyrie, des antiquités romaines, de la peinture ; enfin une histoire de la nature et des propriétés des différents animaux. Il existe plusieurs médailles du règne de Juba II.)
De tels travaux, accomplis sur le trône et dans une contrée où la température ardente stimule les passions de l'homme, disent assez quelles devaient être les heureuses dispositions de ce prince.
Aussi les Numides firent-ils de si rapides progrès dans la civilisation que, jaloux d'étendre et de propager ce mouvement, Auguste :
- reprit à Juba les cantons de Numidie qu'il lui avait cédés,
- les annexa de nouveau à la province romaine et en dédommagement
- lui accorda plusieurs districts de la Gétulie (le Grand Atlas et le Beled-el-Djerid ).
Grâce à une si habile politique, l'influence civilisatrice se fit sentir dans cette autre partie de l'Afrique, car en imitant un roi de leur race et de leur sang, les indigènes ne croyaient pas imiter les étrangers et leur amour-propre restait satisfait.
Juba fut également cher aux barbares et aux Gréco-Romains. Pendant sa vie, Athènes lui avait élevé des statues ; à sa mort, ses sujets le mirent au rang des Dieux et lui dressèrent des autels.
Le rétablissement de Carthage n'eut pas moins d'influence que le règne de Juba sur la prospérité de l'Afrique.
Cette malheureuse cité était détruite depuis deux cents ans ; la place qu'elle occupait avait été labourée et semée de sel ; des imprécations terribles avaient été solennellement proférées contre quiconque entreprenait de la rebâtir.
Aussi peut-on croire que, si la république romaine eut continué d'exister dans ses formes politiques, sa religion exclusive, ses mœurs, ses préjugés, Carthage n'aurait jamais été relevée.
L'inutile essai de reconstruction tenté par Caïus Gracchus le prouve suffisamment. (Ce premier essai de reconstruction eu lieu l'an 122 avant J. C.) Ce tribun célèbre avait conduit sur les ruines de Carthage une colonie de six mille citoyens ; quelques travaux préparatoires avaient eu lieu ; des craintes superstitieuses les arrêtèrent.
Des loups, emblèmes vivants du peuple de Romulus, apparurent, dit-on, tout à coup au milieu des travailleurs et renversèrent les fondements commencés ; l'ouvrage fut interrompu.
Le sénat et la plus grande partie du peuple avait vu avec répugnance cette entreprise contraire aux instincts nationaux ; Caïus Gracchus revint à Rome et les colons qu'il avait amenés avec lui allèrent s'établir dans les autres possessions romaines de l'Afrique.
La reconnaissance effective de Carthage est indiquée d'une manière très confuse par les historiens. Les uns l'attribuent à Jules César, les autres à César-Auguste. Le récit d'Appien (historien grec) est le plus plausible et concilie les deux opinions : Il attribue le projet à César et l'exécution à Auguste. " Pendant la guerre d'Afrique, dit-il, Jules César ayant assis son camp sur les ruines de Carthage, eut un songe extraordinaire ; il crut voir une multitude éplorée lui tendre les mains et le supplier avec des cris et des larmes.
L'esprit fortement frappé par cette vision, il s'imagina que c'étaient les citoyens de Carthage dont les ombres plaintives lui demandaient le rétablissement de leur patrie. " Il faut voir dans cette tradition, sinon une réalité, du moins une forme poétique des idées et des sentiments véritables de César l'homme qui fit asseoir des Gaulois dans le sénat, au grand déplaisir des citoyens romains, fut, à bien des égards, le patron du monde vaincu contre la nationalité trop exclusive de Rome.
Le premier il comprit et prépara la fusion de toutes les races antiques, et sa politique, souvent inspirée par un glorieux instinct de l'unité du genre humain, se rattache par un synchronisme providentiel à l'avènement prochain de la religion du Christ.
Le projet de relever Carthage et Corinthe pour consoler l'Afrique et la Grèce, en fut la manifestation. D'autres motifs secondaient encore les tendances générales du génie de César.
Il fallait pourvoir à l'existence d'une multitude d'hommes ruinés par les guerres civiles et dont la misère et l'irritation pouvaient devenir dangereuse.
Quoi de plus convenable que les envoyer dans des colonies nouvelles ?
Une mort violente arrêta César dans l'exécution de ses desseins ; son successeur les reprit et les réalisa.
Auguste fit passer en Afrique environ trois mille familles pauvres : il leur fournit les ressources nécessaires pour leur établissement et leur accorda en outre des immunités de toute espèce.
D'anciens habitants de la colonie, des Africains mêmes, s'unirent à ces nouveaux émigrants, et Carthage fut reconstruite. Mais Auguste défendit que les murs d'enceinte de la nouvelle ville s'élevassent à la même hauteur que ceux d'autrefois. La nouvelle Carthage ne fut point bâtie sur l'emplacement de l'ancienne. Vraisemblablement Auguste voulut, par ce changement de lieu, désarmer les répugnances des Romains.
Il parait que le terrain seul était maudit à leurs yeux et que les matériaux dispersés sur le sol, ne partageant point cette réprobation superstitieuse, furent employés à la reconstruction.
Bientôt sa population et son commerce s'accrurent à tel point qu'elle fut regardée comme la troisième ville de l'empire ; placée immédiatement après Rome et Alexandrie, elle conserva ce rang jusqu'à la fondation de Constantinople.
(La Carthage phénicienne avait duré six cents ans, la Carthage romaine subsista sept siècles, la cité musulmane élevée sur les communes ruines, sans égaler leurs splendeurs, a toujours été dans les temps modernes, la ville la plus riche et la plus florissante de toute la côte. Cette persistance de la prospérité commerciale dans ces lieux privilégiés est une preuve remarquable de l'intelligence qu'apportaient les Phéniciens dans le choix de leurs colonies.)
La sage administration de l'Empereur Auguste fut on ne peut plus favorable à la prospérité de l'Afrique. Ces peuples si remuants, si indociles, paraissaient soumis et contents de l'être.
Parmi leurs chefs, le seul qui méritait le titre de roi, si prodigué par les Romains, Juba, était plutôt le vassal de l'empereur qu'un souverain indépendant.
Depuis la conquête la puissance romaine n'avait pas encore paru si bien affermie mais peu de temps après la mort d'Auguste, les fautes de l'héritier de Juba, jointes à l'ambition d'un simple soldat, excitèrent de nouveaux troubles et allumèrent en Afrique une guerre dévastatrice qui dura sept ans.
Ptolémée, successeur de Juba n'avait point hérité des vertus de son père ; il ne prit de la civilisation romaine que ce qu'il y en avait pour le rendre méprisable aux yeux d'un peuple guerrier et demi-barbare, c'est-à-dire l'indolence et un amour effréné du luxe et de la parure.
Tandis que renfermé au fond de son palais, il s'abandonnait à de honteuses voluptés, laissant à d'orgueilleux affranchis l'administration de son royaume, ses sujets payaient sa lâcheté par l'outrage et le mépris.
De l'insulte à la violence il n'y avait qu'un pas ; aussi n'attendaient-ils qu'une occasion favorable pour s'insurger. Un aventurier maure, nommé Tacfarinas, ne tarda point à la leur fournir.
Inconnu jusqu'à cette époque, Tacfarinas avait commencé par prendre du service dans l'armée romaine, moins cependant pour combattre au profit de ses maîtres que pour se façonner à leur tactique militaire et étudier l'organisation de leurs troupes. Lorsqu'il se crut suffisamment instruit, il abandonna ses drapeaux et alla apporter chez ses compatriotes les connaissances qu'il avait acquises, connaissances qui devaient lui donner sur eux un grand ascendant.
Il réunit d'abord quelques brigands, et se mit à piller les colons isolés.
La nouvelle de ses succès ranima cette soif de sources guerrières et aventureuses qui fit le caractère distinctif des tribus africaines.
Sa troupe grossit de :
- déserteurs romains,
- de Maures,
- de Numides mécontents du gouvernement de leur roi,
- et devint bientôt une armée capable de tenir la campagne.
Tacfarinas :
- organisa son infanterie en cohortes composées de plusieurs compagnies,
- de ses cavaliers forma des escadrons et
- donna le commandement de ces différents corps à des officiers exercés par lui aux manœuvres européennes.
Sa réputation s'accrut avec sa puissance.
Une nombreuse tribu voisine du désert, les Musulons, l'investit de l'autorité suprême. Mazippa, chef d'une tribu maure, ne dédaigna point son alliance et traita d'égal à égal avec ce soldat parvenu. Tous deux réunirent des forces vraiment redoutables au moins par le nombre.
Tacfarinas avait pris le commandement du corps d'armée qui devait soutenir le choc des troupes romaines. De son côté Mazippa, à la tête de la cavalerie irrégulière, s'était chargé de ravager le pays.
Leurs incursions combinées jetaient l'épouvante parmi les colons et tenaient en alarmes toute l'Afrique.
L'unique légion cantonnée dans la province semblait d'autant moins en état de repousser de si nombreux ennemis, que le proconsul en fonction, Furius Camillus, passait à Rome pour être entièrement étranger à l'art de la guerre. Cependant il montra tout d'abord une énergie digne du héros dont il descendait.
Confiant dans la supériorité de la discipline sur le nombre ; certain d'ailleurs par la connaissance qu'il avait acquise du caractère des barbares, qui rien ne pouvait être plus dangereux que de leur laisser soupçonner qu'ion les redoutât, il joignit à sa légion un petit nombre d'auxiliaires rassemblés à la hâte, et marcha au-devant de l'ennemi.
Tacfarinas accepta le combat mais malgré sa bravoure et sa capacité personnelle, il fut complètement défait.
Ce simulacre d'armée régulière qu'il avait eu tant de peine à créer ne tint pas plus devant les Romains que la cavalerie indisciplinée de Mazippa.
Un grand nombre de barbares périrent dans le combat ou en fuyant.
Tacfarinas gagna le désert, où il parut s'être confiné pour toujours.
Mais, de son côté, prévoyant bien qu'un seul revers ne suffirait pas pour détourner l'audacieux aventurier de ses projets, Tibère fit passer en Afrique une légion qu'il détacha de l'armée de Pannonie. (région d'Europe centrale : Hongrie, Autriche, Croatie, Serbie). En effet, trois ans après Tacfarinas :
- sortit tout à coup de sa retraite,
- ravagea une vaste étendue du pays et
- vint assiéger une cohorte qui occupait un fort isolé sur les bords de la rivière Pagida. (Cette rivière coule entre Constantine et Gigeri).
L'officier qui la commandait, Décius, n'écoutant que son courage, et regardant comme une humiliation trop grande d'être assiégé par des barbares, sortit imprudemment de ses lignes.
Dans l'action qui s'ensuivit il succomba avec plusieurs des siens. Les autres rentrèrent précipitamment dans le fort abandonnant aux ennemis les corps mutilés de leurs camarades et de leur chef.
A la nouvelle de ces désastres, l'empereur fit partir en toute hâte un nouveau proconsul pour l'Afrique. C'était Apronius, ancien lieutenant de Germanicus, un homme dont la sévérité disciplinaire allait jusqu'à la cruauté.
Dès son arrivée, il fit impitoyablement décimer la cohorte vaincue et mourir sous le bâton tous les soldats désignés par le sort.
Ce châtiment eut un salutaire effet : A quelques jours de là, Tacfarinas s'était porté sur la ville de Thala (ville assez considérable située non loin de Constantine. Les enfants de Jugurtha y avaient été élevés.) Cinquante vétérans seulement la repoussèrent.
Ces braves soldats avaient senti qu'il valait mieux périr sous les traits de l'ennemi que sous les verges des licteurs. Dès ce moment la guerre fut poussée avec vigueur.
De son côté Tacfarinas, instruit par les échecs successifs de son impuissance de s'emparer de postes fortifiés et à combattre en rase campagne, changea de plan et de méthode :
- Il n'attaqua plus les villes,
- n'offrit plus de combats réguliers, incendiant les campagnes dont il massacrait les habitants,
- il porta la désolation et la mort tantôt dans un canton, tantôt dans un autre, partout enfin où les Romains ne l'attendaient pas.
Puis, dès que ceux-ci se montraient en force,
- il lâchait pied et se mettait à les poursuivre aussitôt qu'ils se retiraient, ne se laissant jamais approcher pour qu'on pût le saisir.
- Longtemps il les fatigua de ses ruses,
- longtemps il leur échappa.
- Mais enfin son habileté fut mise en défaut.
Cerné tout à coup par le fils du proconsul dans un lieu resserré entre la mer et les montagnes, chargé d'un butin qui l'embarrassait, il fut obligé de combattre de pied ferme et ne se tira qu'à grand'peine de la mêlée : la meilleure partie de ses troupes resta sur le chemin de bataille.
Au proconsul Apronius succéda Blésus, oncle du célèbre Séjan (préfet de la garde prétorienne de l'empire romain) et général d'une habileté consommée.
Sous lui la guerre prit un nouvel aspect.
La dernière défaite de Tacfarinas n'avait pas plus que les précédentes découragées cet intrépide partisan ; retiré au désert, son asile accoutumé, bientôt sa réputation réunit autour de sa personne une armée plus nombreuse que les précédentes. Il eut alors l'audace d'envoyer à Rome des ambassadeurs chargés de demander une portion du territoire africain où il pût s'établir, lui et ses alliés, menaçant, en cas de refus, d'une guerre qui n'aurait point de terme.
Irrité de cet outrage fait à la majesté du nom romain par un brigand et un déserteur qui empruntait les formes ordinaires de la guerre, Tibère, pour toute réponse, expédia au proconsul l'ordre de poursuivre à outrance le chef des rebelles jusqu'à destruction complète et fit répandre dans toute l'Afrique des proclamations par lesquelles il mettait à prix d'or la tête de Tacfarinas et promettait amnistie complète à ceux de ses complices qui déposeraient les armes.
En attendant l'effet de ces proclamations, Blésus ne perdit pas un instant pour mettre à exécution le plan qu'il avait conçu.
Comprenant par les résultats dans les campagnes précédentes la nécessité de faire face partout et d'embrasser dans le cercle de ses opérations la plus grande étendue possible de pays, il partagea son armée en trois corps :
- Le premier placé à la gauche, eut ordre de protéger le territoire de Leptis et de le mettre à l'abri du pillage,
- le second, commandé par le fils du proconsul dut se porter sur la droite, couvrant la Numidie et l'importante ville de Cirta,
- Blésus enfin se mit lui-même à la tête du troisième qui formait le centre, et tous trois, combinant leurs mouvements, s'avancèrent d'une manière lente mais sûre et sans laisser entre-eux d'intervalles. Partout où :
- la nature du terrain,
- le voisinage des rivières,
- la difficulté des passages le permettaient on éleva des forts dans lesquels on mit des garnisons qui ne devaient pas se borner à la défensive, mais harceler l'ennemi en se prêtant un mutuel appui.
Suivies avec persévérance, ces mesures déconcertèrent Tacfarinas : s'il parvenait par quelque ruse à traverser les lignes de l'armée active, il se trouvait aussitôt serré entre cette armée, qui revenait sur ses pas, et les garnisons des forts ; contraint alors à la retraite, il y perdait souvent ses meilleurs soldats.
Le proconsul accrut encore les perplexités de son adversaire en divisant de plus en plus ses propres troupes et en couvrant le pays d'une multitude de détachements qu'il pouvait rassembler en un instant.
L'hiver arrivé, Blésus ne ramena point ses soldats dans leurs quartiers, mais les cantonna dans les forts qu'il venait de bâtir et d'où il envoyait sa cavalerie traquer les brigands de retraite en retraite. La province se vit ainsi débarrassée de leur présence.
Cependant cette guerre difficile traînait en longueur, l'Atlas et le désert protégeaient encore les rebelles. Las du fardeau d'une lutte si opiniâtre, le proconsul cherchait un prétexte pour s'en décharger sur un successeur.
Ce prétexte s'offrit bientôt dans une des excursions journalières que faisait la cavalerie romaine, le frère de Tacfarinas fut pris.
Blésus annonça cette capture comme un évènement important qui devait terminer la guerre et revint à Rome solliciter les honneurs du triomphe. Oncle de Séjan, ministre tout puissant alors, il obtint ces honneurs et fut salué du titre d'impérator.
Mais tandis que le proconsul triomphait à Rome, la guerre se ravivait en Afrique, plus ardente que jamais. Profitant de l'absence intempestive de Blésus, l'habile Maure avait réorganisé ses bandes avec une incroyable activité.
- Tous les repris de justice de la province romaine,
- tous les esprits turbulents,
- tous les hommes perdus de dettes ou couverts de crimes, étaient venus se ranger sous ses étendards.
Les sujets mécontents du roi Ptolémée surtout, ne cessaient d'affluer dans son camp.
A ces anciens alliés, que ses défaites ne lui avaient point fait perdre, il sut en ajouter de nouveaux.
Le roi de Garamantes, peuple gétulique de la partie orientale du grand désert :
- s'unit à Tacfarinas,
- lui fournit disposition des retraites sûres pour y déposer son butin.
Une circonstance habilement exploitée par le chef rebelle accrut encore ses ressources.
Trompé par Blésus et croyant la guerre finie, Tibère venait de rappeler la légion qu'il avait précédemment envoyée.
A cette nouvelle Tacfarinas fit courir le bruit que les Romains ayant une grande guerre à soutenir en Europe, s'apprêtaient à quitter leurs principaux établissements et même à évacuer toute l'Afrique.
Propagé rapidement parmi les tribus nomades, ce brui produisit sur elles l'effet désiré. La plupart de celles qui étaient alliées des Romains les abandonnèrent et fournirent des troupes et des vivres à leur astucieux adversaire.
Ses forces étant ainsi augmentées et celle de l'ennemi diminuées, il reprit son premier plan d'agression et vint mettre le siège devant Thubusque.
(Thubusque paraît être identique avec la Tubusaptus des littéraires. Cette place fortifiée est à 25 milles de Saldae, la Tedalès de nos jours.)
Tandis que la guerre continuait en Afrique des statues triomphales s'élevaient à Rome sur les places publiques en l'honneur des prétendus vainqueurs de Tacfarinas. Ces statues accusaient les proconsuls plutôt qu'elles les honoraient ; ils avaient moins cherché en effet à détruire l'ennemi qu'à obtenir les honneurs du triomphe et s'étaient arrêtés aussitôt qu'ils avaient cru avoir assez fait pour atteindre ce but. Cependant Dolabella qui avait succédé à Blésus, n'osait pas redemander cette légion de Pannonie qu'on lui avait retirée si à contre temps.
En détrompant l'empereur, il craignait d'irriter Séjan.
L'audace de Ticfarinas, qui poussait avec ardeur le siège de Thubusque, (ville de Maurétanie) leva ses incertitudes.
Ne pouvant se résoudre à laisser tomber entre ses mains une ville si importante Dolabella réunit pour la défendre toutes les forces dont il disposait.
Il écrivit au roi Ptolémée de venir le joindre et se mit en marche avec sa légion et le contingent fourni par quelques tribus qui lui étaient restées fidèles.
Averti que les chefs d'une de ces tribus complotaient de l'abandonner, il leur fit trancher la tête afin de retenir les autres dans leur devoir.
Adoptant la tactique de son prédécesseur, il divisa son armée en quatre corps et distribua les troupes de Ptolémée en plusieurs escadrons, commandés par des chefs de leur nation.
Lui-même se transportant rapidement d'un corps à l'autre, en dirigeait les principaux mouvements.
Il fermait ainsi toutes les issues de la province à Tacfarinas qui, au premier bruit de sa marche, avait levé le siège de Thubusque et se rejetait de jour en jour vers le désert.
Bientôt prévenu par ses espions que les ennemis avaient dressé leurs tentes au milieu des bois, près des ruines du fort d'Auzea (l'emplacement de ce fort a été reconnu par Shaw près de Bordj-el-Hamza, ville où les Deys d'Alger tenaient garnison), Dolabella résolut de profiter de la confiance que la difficulté des lieux lui inspirait pour les surprendre dans cette position et les forcer à accepter le combat.
Réunissant ses détachements, il donna l'ordre express de ne prendre aucune espèce de bagage et de n'emporter que ses armes.
Les mesures furent si bien prises, le secret si bien gardé, que, parti pendant la nuit, il arriva au point du jour en vue du camp de Tacfarinas, et l'attaqua brusquement.
Les rebelles dormaient avec sécurité sous leurs tentes ; leurs chevaux, laissés en liberté, paissaient çà et là dans la campagne.
Surpris au milieu du sommeil par les cris des assaillants et le bruit de leurs trompettes, ils n'eurent pas même le temps de courir aux armes et tombèrent dans une épouvantable confusion.
Les soldats du proconsul n'eurent que la peine de prendre et de tuer.
Irrités par le souvenir de leurs fatigues, heureux de tenir enfin ces insaisissables barbares qui leur avaient échappé tant de fois, ils furent sans pitié et versèrent des flots de sang.
Tacfarinas :
- soit que toute issue lui fût fermée,
- soit qu'il ne voulut pas survivre à sa défaite, opposa longtemps aux Romains une résistance désespérée.
Ceux-ci, dont il était parfaitement connu, les pressaient avec d'autant d'ardeur, qu'une grande récompense était promise à celui qui le livrerait mort ou vif.
Son fils avait été fait prisonnier sous ses yeux ; ses amis, ses chefs les plus braves étaient tombés autour de lui.
Voyant enfin qu'il ne lui restait aucune chance de salut, il se jeta tête baissée au milieu des rangs ennemis où il trouva une mort honorable.
Cette nouvelle répandit la joie la plus vive parmi les colons et fut reçue à Rome avec enthousiasme. Délivrée de Tacfarinas, l'Afrique resta paisible pendant l'espace de dix-sept ans.
Dans cet intervalle, Tibère mourut et Caligula lui succéda.
On sait que la folie furieuse de ce nouveau tyran fit regretter aux Romains la fureur froide et hypocrite de son prédécesseur, que contenaient du moins l'intérêt et la politique.
Un des crimes de Caligula eut une assez grande influence sur les destinées de l'Afrique.
On vient de voir la part active qu'avait prise Ptolémée à la défaite de Tacfaérinas : Tibère l'en avait magnifiquement récompensé, et l'avènement du nouvel empereur semblait devoir encore resserrer les liens qui unissaient le roi de Maurétanie aux intérêts de Rome, la mère de ce dernier et la femme de Caligula était toutes deux du sang de Marc Antoine.
Cette parenté ne fut pas assez puissante pour protéger Ptolémée contre les fureurs du tyran :
- Soit que celui-ci eut d'abord l'intention de traiter ce prince honorablement,
- soit qu'il eu déjà résolu sa morts,
- il l'engagea à venir à Rome, et commença par lui montrer la plus vive amitié.
La catastrophe qui suivit cette réception est expliquée diversement par les historiens.
- Les uns disent que les richesses étalées par le roi maure excitèrent la cupidité de l'empereur.
- les autres, qu'il fut jaloux de l'éclat de sa parure dans une circonstance solennelle.
Quel qu'en ait été le prétexte, à la suite d'un spectacle où Ptolémée s'était montré vêtu d'une robe éclatante de pourpre, Caligula lança contre lui un décret d'exil et le fit assassiner par les gardes qu'il lui avait donnés pour escorte.
Bientôt après il prononça la confiscation de ses États qu'il réunit à l'empire.
Ce double crime, consommé par un tyran en délire, excita dans la Maurétanie une indignation générale.
Ptolémée était plus faible que méchant : lorsqu'il eut cessé de vivre, on oublia ses vices pour ne se rappeler que les vertus de son père.
D'ailleurs on n'en sentit que plus vivement le joug que la prudence d'Auguste et de Tibère avait rendu si léger.
Ces dispositions à la révolte inspirèrent à un certain Ædémon, affranchi de Ptolémée, l'audacieux dessein de succéder à son maître.
Sous prétexte de le venger, il soulève les Maures, recrute parmi eux une armée et ravage une partie de la province romaine.
Mais Lucius Paulinius :
- s'avance contre ce nouvel ennemi,
- le bat en plusieurs rencontres,
- traverse en vainqueur toute la Maurétanie et
- franchit la double barrière de l'Atlas.
Cette marche triomphante au-delà des Alpes africaines fut regardée comme un exploit extraordinaire car aucun général n'avait encore porté ses armes aussi loin.
Ce ne fut pas cependant Paulinius mais son successeur Hasidius Géta qui eut l'honneur de terminer sous le règne du faible Claude une guerre allumée par les fureurs de Caligula et d'ajouter un autre royaume à la vaste étendue des possessions romaines.
L'Afrique septentrionale était donc entièrement subjuguée depuis la vallée du Nil jusqu'au grand océan. Pour assurer sa conquête, l'empereur partagea la Maurétanie en deux grandes provinces :
- la première prit son nom de Tingis, aujourd'hui Tanger et s'appela Maurétanie Tingitane ; c'est le Maroc.
- La seconde fut nommée Maurétanie Césarienne parce qu'elle avait pour capitale Julia Cæsarea, résidence des derniers rois numides aujourd'hui Cherchell.
Elle comprenait nos provinces actuelles :
- d'Alger, d'Oran et Titteri.
Césarée de Maurétanie fut élevé par Claude au rang de colonie romaine, l'an 43 de Jésus-Christ, Tingis l'avait été longtemps auparavant par Auguste. La nouvelle de cet heureux évènement qui semblait garantir à tout jamais la sécurité des établissements romains en Afrique, se répandit avec rapidité dans les différentes parties de l'empire.
Chacun eut hâte de le mettre à profit et de venir recueillir sa part des richesses que la féconde terre d'Afrique prodiguait à tous ceux qui les lui demandaient par l'agriculture ou par le commerce.
Une multitude d'émigrés volontaires y affluèrent :
- de l'Italie, de l'Espagne et des Gaules.
Les villes de la côte, les établissements de l'intérieur, s'accrurent et s'enrichirent par ces émigrations.
Dans la Maurétanie Tingis surtout reçut de cette affluence d'étrangers une grande impulsion ; les historiens citent aussi Lixes, ville très commerçante, située au-delà du détroit, sur l'océan atlantique, mais qui n'a point laissé d'héritières de ses richesses et de son nom.
Les obstacles intérieurs qui à plusieurs reprises entravèrent la prospérité de l'Afrique, avaient à peu près disparu ; ses maux ne lui vinrent plus désormais que de la métropole c'est-à-dire de l'ambition et de la rapacité des gouverneurs que Rome lui envoyait.
Les impôts déjà si lourds sous Caligula et Claude devinrent accablants sous Néron. Il fit périr les six plus riches propriétaires de l'Afrique pour confisquer leurs immenses possessions et annexer ainsi au domaine impérial les champs fertiles qui nourrissaient Rome.
L'anarchie qui succéda à la tyrannie de Néron faillit être plus fatale encore à l'Afrique. Sa chute et sa mort laissait l'empire sans maître.
Le sénat songeait à rétablir la république ; les armées voulaient un empereur, et chacune d'elles prétendait s'arroger le droit de le nommer ; de leur côté, les gouverneurs de province, ne sentant plus le frein de l'autorité centrale, s'abandonnaient à tous les caprices d'une ambition déréglée.
Dès les derniers temps du règne de ce monstre, l'Espagne et les Gaules avaient vu leurs gouverneurs se révolter ; l'Afrique suivit leur exemple. le propréteur (ancien préteur à qui l'on confiait le gouvernement d'une province) Macer, qui en était le chef militaire excité par une ancienne maîtresse de Néron, Crispinilla (femme de la cour sous l'empire romain) leva des troupes pour son propre compte et commença par retenir dans le port de Carthage les bâtiments chargés de porter à Rome le subside annuel qui assurait la subsistance de la multitude.
On ignore si Macer avait dessein de se frayer un chemin à l'empire ou seulement de se créer en Afrique une puissance indépendante.
Quel qu'il en soit, au lieu de s'attacher le peuple en diminuant les impôts sous lesquels on succombait, on les augmenta et fit gémir toute la province sous la tyrannie beaucoup plus dure que celle dont il avait annoncé vouloir la délivrer.
Un tel état de chose amena un soulèvement général, et Galba fut invité à passer sur-le-champ en Afrique s'il ne voulait pas voir la colonie lui échapper.
Le nom de Galba y était populaire ; il en avait été gouverneur et s'était distingué par un grand amour de la discipline et l'ordre.
Les ressources de Macer étaient trop faibles pour exiger l'envoi d'une armée.
Galba se contenta d'écrire à Trébonius, intendant de la province, de réprimer ces tentatives de révolte.
Celui-ci réunit quelques troupes, auxquelles se joignirent en foule les habitants opprimés. La lutte ne fut pas longue, les soldats de Macer l'abandonnèrent ; et tous, colons ou indigènes aidèrent également à sa ruine. Sa mort ne coûta presque aucun effort au vainqueur. (An 68 de J. C).
L'année suivante l'anarchie recommença. Trois empereurs :
- Galba, Ithon et Vitelllius se disputaient le monde : tous trois moururent de mort violente ;
- un quatrième concurrent, l'heureux Vespasien, resta enfin maître de l'Égypte, ces deux greniers de Rome, étaient toujours le point décisif de la question.
L'Afrique souffrit peu de ces sanglantes querelles, mais, de même qu'au temps des discordes civiles de la république, les débris des partis vaincus vinrent tour à tour lui demander asile.
Les partisans de Vitellius (empereur romain) s'y réfugièrent en grand nombre, et y tramèrent d'impuissants complots qui n'autre résultat que de coûter la vie au proconsul Pison. Ce gouverneur compromis par des démarches imprudentes, n'eut pas le courage d'aller jusqu'à la révolte ouverte : il fut mis à mort par ordre de Vespasien.
Cet incident n'eut aucune influence sur la prospérité de l'Afrique, raffermie par l'administration éclairée de l'empereur.
(Au commencement de ce règne, la seule Maurétanie Césarienne comptait treize colonies romaines, trois municipes libres ; la Numidie et l'ancienne province romaine, ou Afrique proprement dite (régences de Tunis et de Tripoli) en comptait un bien plus grand nombre encore.
Les habitants de ces cités jouissaient des droits des citoyens romains. A la vérité, quelques-uns de ces privilèges remontaient au temps de la république mais la politique impériale les avait de plus en plus multipliés.
Ainsi les forces de l'empire, au lieu d'être concentrées dans une seule ville, se trouvaient disséminées dans les colonies : ces colonies étaient de deux sortes, civiles et militaires. Les premières sur la côte, les secondes dans l'intérieur.
Elles étaient habillement distribuées de manière à pouvoir se porter secours en cas de danger ; c'est ce qui explique comment une seule légion suffisait à la garde d'une immense ligne de côtes.
En état de résister par elles-mêmes à un coup de main, ces colonies n'avaient besoin d'assistance que dans le cas où, la révolte devenant générale, les barbares attaquaient avec de grandes masses et sur plusieurs points à la fois.)
Du règne de Vespasien à celui d'Adrien entre lesquels parurent successivement trois bons princes :
- Titus, Nerva et Trajan,
- et un seul mauvais Domitien (de l'an 70 jusqu'à l'an 117 de Jésus-Christ), aucun évènement important ne se passa en Afrique.
Sous Adrien, une multitude de Juifs y furent transportés comme esclaves ou bien y passèrent volontairement, après la destruction définitive de leur patrie.
Ils y retrouvèrent un grand nombre de leurs compatriotes que la ruine de Jérusalem, sous Titus y avait jetés un demi-siècle auparavant.
Depuis longtemps la Judée entretenait un grand commerce avec l'Afrique ; et bien, avant sa dispersion entière, des hommes de cette race s'étaient établis à Cyrène et ailleurs.
L'élément juif, favorisé vraisemblablement par sa parenté avec une partie des populations primitives, y acquit une grande influence.
Le mosaïsme (religion se référant au message religieux de Moïse) se propagea rapidement parmi les indigènes et s'y est maintenu jusqu'à nos jours malgré les nombreuses vicissitudes qu'a traversées ce pays.
Aucun prince n'avait encore montré pour la prospérité générale de l'empire une activité aussi constante et aussi éclairée que le fit Adrien.
Durant les vingt et une années qu'il occupa le trône, il parcourut presque continuellement ses vastes États, travaillant à la destruction des abus et à la bonne administration de la justice.
Il visita l'Afrique la dixième année de son règne, l'an 129 de J. C, apporta de grandes améliorations au gouvernement de cette province, et s'acquit l'amour des populations par la sagesse de ses réformes.
Un incident fortuit lui attira surtout les bénédictions de ces peuples superstitieux.
Privée de pluie depuis cinq ans, l'Afrique était pour ainsi dire devenue stérile :
- Les récoltes nouvelles dépérissaient sur pied,
- les greniers étaient vides,
- une famine générale la désolait.
A l'arrivée de l'empereur, le ciel se chargea de nuages et la pluie tomba par torrents. Cet heureux hasard fut regardé comme une protection des Dieux et l'on en fit honneur à la divinité de César.
Quelques mouvements insurrectionnels eurent lieu parmi les Maures sous le gouvernement d'Adrien, mais de si peu d'importance et de si courte durée que son successeur crut pouvoir diminuer le nombre des troupes d'occupation et remettre l'autorité toute entière aux mains du magistrat civil.
Cette réforme, fondée sur le désir d'alléger les charges de la province, produisit un effet contraire à celui qu'on attendait : Une révolte générale éclata en Maurétanie. Il fallut de nouveau mettre les garnisons au complet et rétablir l'autorité militaire.
Jusque-là ces barbares avaient borné leurs incursions aux pays limitrophes de leurs montagne ; mais sous le signe de Marc-Aurèle, ils franchirent le détroit malgré la vigilance romaine et après avoir ravagé les côtes d'Espagne, qu'ils trouvèrent sans défense, revinrent en Afrique chargés de butin : Cette expédition sans importance quant à ses résultats immédiats, semble être le prélude de cette longue suite de pirateries qui pendant plusieurs siècles épouvantèrent l'Europe.
Sous les règnes rapides de :
- Commode, Pertinax, Didius Julianius, Septime Sévère, de Caravolla,
- Géta, Macrin, Héliogabale, d'Alexandre Sévère,
L'Afrique est paisible, car on ne peut compter comment un évènement de quelque importance la révolte de Furius Celsus, qui, sous le dernier de ces empereurs prit le titre de roi d'Afrique et fut tué après sept jours de royauté.
Ces divers règnes occupent un espace de cinquante- cinq ans (de 180 à 235 de J.C).
De toutes les provinces du monde romain, celle d'Afrique c'est peut-être la seule qui n'ait pas vu sortir de son sein un prétendant à l'empire, circonstance qui s'explique par la faiblesse de corps de l'armée qui l'occupait. (Septime Sévère qui régna de 193 à 211 de J.C était né en Afrique ; mais son élévation au trône impérial fut l'ouvrage dees légions qu'il commandait en Yllyrie). Elles le soutinrent avec succès contre les efforts de ses compétiteurs.)
Une seule légion ne pouvait songer à suivre l'exemple des grandes armées :
- d'Yllérie,
- de Gaule ou
- de Syrie, pour le choix des empereurs.
Elle acceptait ses maîtres et ne le faisait point. Cette obéissance était sans doute forcée, mais du moins la guerre civile ne pénétrait que rarement dans cette province et n'augmentait pas par ses fureurs les maux qu'entraînent les brusques changements de règne.
L'avènement du féroce Maximin vint mettre un terme à cette passagère tranquillité. Digne ministre de ce tyran, qui faisaient des amendes et des confiscations une des principale branche du revenu impérial, l'intendant d'Afrique avait porté contre quelques jeunes gens des plus riches familles de la province, une sentence qui les dépouillait de la plus grande partie de leurs biens : Ils résolurent de prévenir leur ruine ou de la rendre complète.
Trois jours seulement leur étaient accordés pour se soumettre ; ils profitent de ce délai pour rassembler une multitude d'esclaves armés, tous disposés à leur obéir aveuglément, puis avec des armes cachées sous leurs robes, ils se présentent à l'audience de l'intendant et le poignardent sur son tribunal.
De là, suivis d'une troupe tumultueuse, ils se portent sur Thysdrus, petite ville située dans le fertile territoire de Bysacium à cent cinquante mille au Sud de Carthage.
Maîtres de cette place, qui leur ouvre ses portes, ils y arborent l'étendard de la révolte.
Cependant ils n'ont point de chef encore. Leurs espérances se fondent sur l'horreur générale qu'inspire Maximin. Il faut donc lui opposer un compétiteur qui se soit déjà concilié l'estime des populations et dont l'autorité morale donne à leur rébellion la consistance qui leur manque.
Gordien, alors proconsul d'Afrique est l'homme qu'ils choisissent. Gordien appartenait à l'une des familles les plus illustres du sénat romain. Il descendait des Gracques (nom donné à deux frères Iibérius Gracchis et Caïus Gracchis ayant tenté de refaire le système social romain) par son père, et par sa mère de l'empereur Trajan.
Son caractère noble et généreux le rendait digne de cette glorieuse origine.
Agé de quatre-vingt ans lorsqu'on lui offrit la pourpre impériale, il la refusa longtemps, et ne l'accepta enfin que par une sorte de violence.
Son fils lui fut associé et tous deux furent reconnus par le sénat.
L'Afrique donnait donc à son tour un empereur à l'Italie. ; mais ce ne fut qu'une souveraineté éphémère.
Tandis que les statues de Maximin étaient abattues sur les places publiques de Rome et remplacées par celles des deux Gordiens, Capellanius, gouverneur de la Maurétanie et partisan de Maximin, levait une armée considérable pour combattre les nouveaux empereurs.
Ceux-ci, entourés d'amis dévoués, mais sans expérience dans le métier des armes s'avancèrent contre lui.
Le jeune Gordien, après avoir déployé un grand courage, périt glorieusement sur le champ de bataille ; son vieux père se donna la mort en apprenant cette triste nouvelle. (leur règne n'avait duré que trente-six jours).
Hors d'état de se défendre, Carthage ouvrit ses portes sans tirer aucun fruit de sa propre soumission.
Le féroce Capallanius mit à mort tous les partisans des Gordiens, pilla les édifices publics et les maisons des particuliers car il savait que le plus sûr moyen de plaire à son maître était de paraître devant lui les mains pleines d'or et teintes de sang.
Cependant le sénat poursuivit la guerre contre le tyran et lui opposa à la fois trois empereurs : Maxime et Balbin le suivirent de près ; ils périrent de la main des troupes qui méprisaient des chefs nommés par le sénat et dont l'élévation n'était pas leur ouvrage.
Ainsi en peu de mois le glaive avait tranché les jours de six princes.
La pourpre resta au troisième Gordien qui bientôt tomba sous les coups de l'Arabe Philippe et fut remplacé sur le trône par son assassin.
Aux guerres civiles l'empire voit bientôt succéder de grands revers au dehors, revers qu'ont préparés les affreux désordres de l'intérieur.
L'empereur Décius périt sur les bords du Danube, vaincu par les barbares du Nord (251 de J. C) ; l'empereur Valérien tombe vivant au pouvoir du roi de Perse (260).
L'empire se déchire par lambeaux :
- les gouverneurs de province se révoltent ;
- le propréteur des Gaules Posthumus, arrache la Gaule, l'Espagne et la Bretagne au fils de Valérien ;
- enfin les hordes teutoniques pénètrent de tous côtés jusqu'au sein du monde romain !
Elle-même ressentit le contre coup de ces catastrophes : des bandes errantes de Franks, après avoir exercé de terribles ravages en Gaule :
- franchissent les Pyrénées,
- se jettent sur la province tarragonnaise (Catalogne, valence),
- pillent et renversent un grand nombre de villes, puis
- s'emparent des navires qu'ils trouvent dans les ports,
- ils envahissent la Maurétanie et
- saccagent pendant douze ans les côtes d'Afrique et d'Espagne sans rencontrer le moindre obstacle.
Quelques années plus tard, (297), les Africains semblent se réveiller à l'appel des barbares étrangers : A l'Est et à l'Ouest, un double mouvement insurrectionnel s'opère simultanément. Tandis que Julianus se fait proclamer empereur à Carthage, les tribus qui habitent la partie centrale et montagneuse de l'Algérie actuelle se déclarent indépendantes. Cette double tentative parut tellement grave à Maximien Galère, l'héritier présomptif du trône impérial qu'il crut devoir venir en personne la réprimer.
Les partisans de Julianus n'essayèrent pas de lutter contre les troupes de Maximien, et l'usurpateur, promptement abandonné, se donna la mort.
Les tribus insurgées, favorisées par la nature du terrain qu'elle occupait, opposèrent au contraire une vigoureuse résistance, et Maximien ne parvint à les vaincre qu'après plusieurs engagements sérieux.
Ensuite pour éviter de nouveaux troubles, il les transplanta dans différentes parties du territoire.
A la suite de cette expédition l'ancienne province proconsulaire fut scindée en deux parties : l'une prit le nom de Bysacène, l'autre garda celui du proconsulaire ou d'Afrique proprement dite.
La Numidie assimilée à la Bysacène fut gouvernée, comme elle, par un consulaire et prit le deuxième rang après la province d'Afrique.
La Maurétanie césarienne fut partagée en deux provinces :
- l'une retint le nom de césarienne et eut pour capitale Césarée,
- l'autre emprunta à son chef-lieu, Sitifis (Sétif) le nom de sitifienne.
La partie comprise entre les deux Syrtes conserva la dénomination de Tripolitaine et sa capitale était Tripoli.
Quant à la Maurétanie tingitane, nommée ainsi de Tingis (Tanger), sa capitale, elle était annexée à l'Espagne dont elle formait la septième province.
Quoique déterminée par une connaissance plus intime de la situation du pays et du caractère des habitants, cette nouvelle organisation ne devait pas y maintenir longtemps la tranquillité.
Une cause puissante de trouble et de discorde va désormais soulever l'Afrique.
L'importance des évènements politiques et militaires disparaîtra bientôt sous l'intérêt immense qu'existe la révolution religieuse qui s'accomplit dans le monde entier. L'ère du christianisme a commencé ; le Jupiter romain, qui avait chassé des temples africains le Moloch (divinité dont le culte était pratiqué dans la région de Canaan selon la tradition biblique) sanglant de Carthage, chancèle à son tour sur son piédestal.
Les symboles usées et les ivresses sensuelles du polythéisme (conception religieuse philosophique selon laquelle il existe plusieurs divinités) vont disparaître devant une foi plus haute et plus pure :
- Saint Cyprien, Tertullien, Lactance, Saint Augustin seront les propagateurs irrésistibles de cette religion nouvelle.
A SUIVRE
|
|
PHOTOS de CONSTANTINE
Envoyé par diverses personnes
|
PONT SIDI RACHED

PONT SIDI RACHED

PONT EL KANTARA
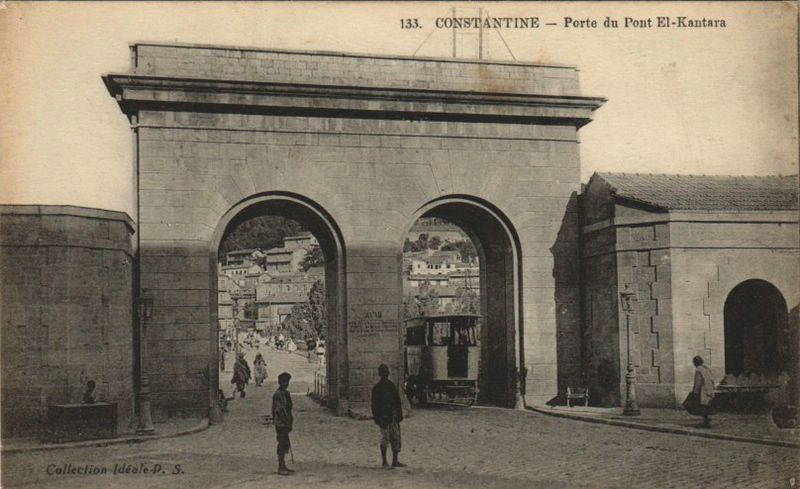
QUARTIER BÄB EL DJABRA

QUARTIERS DES BOUCHERS ARABES

MAIRIE RUE DES GALETTES
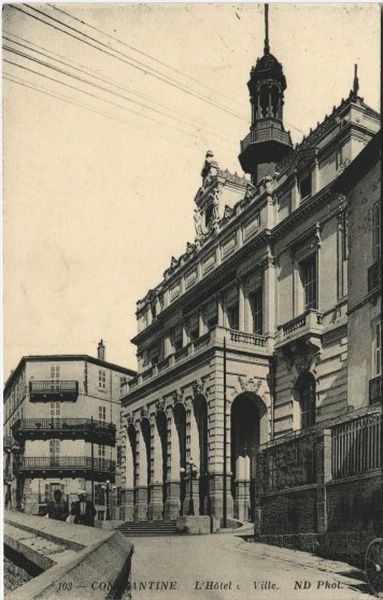

|
|
| 3) Domination romaine
Envoi de M. Christian Graille
|
|
Les empereurs (251-439 de J. C). Décadence de l'empire
Introduit dans l'Afrique civilisée, qui par ses mœurs licencieuses semblait mal préparée à recevoir ses sévères doctrines, le christianisme ne commença à y faire de notables progrès qu'à la fin du IIe siècle.
Vers cette époque, le célèbre Tertullien, jetait déjà sur les églises naissantes de cette contrée un grand éclat.
Les bornes de ce livre ne permettent pas d'exposer ici la vie et les œuvres de ce prêtre de Carthage que M. de Chateaubriand appelle un Bossuet africain et barbare, comme pour exprimer la fougue méridionale et la puissance incorrecte de l'impétueux génie qui mit à combattre la chair et le monde autant de violence et de passion que les hommes de son temps en employaient à poursuivre les jouissances des sens.
En effet, beaucoup d'âmes élevées, entraînées par le dégoût de la corruption qui régnait alors, embrassèrent les principes de la religion nouvelle.
A l'époque où Tertullien florissait, l'église d'Afrique se faisait déjà remarquer par sa pureté et sa constance dans la foi ; éprouvée comme les autres par les persécutions. Elle renaissait toujours plus brillante et plus nombreuse.
L'histoire a conservé les noms de ceux qui les premiers versèrent leur sang pour la confession du nom du Christ indiquant le chemin du martyre à Perpétue et à Félicité (premiers martyrs chrétiens d'Afrique romaine dont la mort soit documentée ) qui s'y engagèrent plus tard avec non moins de résignation.
Tel était alors le progrès de cet enthousiasme, que la cruauté des gouverneurs romains fut vaincue par la foule des victimes. " Que ferez-vous, disait Tertullien, de tant de milliers d'hommes, de femmes de tout âge, de tout rang, qui présentent leurs bras à vos chaînes ?
De combien de feux, de combien de glaives n'aurez-vous pas besoin ?
Décimerez-vous Carthage ? "
Sous cette puissante influence, toute la province de l'Afrique se couvrit d'églises, d'évêchés. Le nombre des chrétiens s'accroissait dans les époques de tolérance, le zèle et la foi s'exaltaient dans les jours de persécution ; alternative qui favorisait doublement l'essor du culte nouveau.
Au temps de Saint Cyprien, vers le milieu du IIIe siècle, l'église d'Afrique comptait plus de deux cents évêques qui présidaient dans toutes les villes la société chrétienne chaque jour plus nombreuse.
L'Empereur Dèce voulut arrêter ce progrès par de sanglantes persécutions ; il ne fit qu'en déplacer la source :
- les cavernes,
- les sables brûlants,
- les solitudes les plus affreuses se peuplèrent de chrétiens qui fuyaient la cruauté des bourreaux
Les seules mines de la Numidie refermaient neuf évêques et un nombre infini de prêtres et de fidèles.
L'infatigable Cyprien, que l'on peut à bon droit considérer comme l'organisateur de l'église d'Afrique :
- les soutenait par ses exhortations,
- les louait de leur persévérance,
- les consolait de leurs afflictions.
Puis il retournait dans les villes prodiguer les mêmes encouragements à ceux qui se trouvaient plus immédiatement exposés aux coups des persécuteurs.
Arrêté par les soldats romains dans une de ses saintes pérégrinations, il fut amené devant le tribunal du proconsul.
Là il reçut l'ordre de sacrifier aux Dieux ; sur son refus, sa sentence de mort fut aussitôt prononcée.
Elle portait que Thascius Cyprianus serait immédiatement décapité comme ennemi des Dieux et de Rome, et comme chef d'une association criminelle qu'il avait entraînée dans une résistance sacrilège aux lois des très sacrés empereurs Valérien et Gallien. " (An 258 avant J. C).
Le supplice de l'illustre évêque de Carthage ne fit que redoubler l'énergie du mouvement chrétien, contre lequel vinrent se briser tous les efforts de Dioclétien (empereur romain ayant régné de 284 à 305) et de Maxence (empereur romain de 306 à 312).
Cette religion qui entraînait à sa suite tant de persécutions et de martyres agissait puissamment aussi sur l'esprit de ces peuples enthousiastes et avides d'émotion.
Mais par malheur les querelles et les dissidences suivaient la lumière nouvelle.
" Nulle part, dit l'éloquent appréciateur de Saint Augustin, les disputes sur les dogmes, ou même sur quelques points de discipline, ne furent aussi sanglant qu'en Afrique.
La principale secte fut celle des Donatistes (doctrine chrétienne jugée à postériorité schismatique puis hérétique par l'Église qui refusait de valider les sacrements délivrés par les évêques) espèce de rigoristes et de mystiques sanguinaires dont les maximes et les fureurs offrent plus d'un rapport avec celle des anabaptistes et des indépendants. "
D'autres sectes étrangères au christianisme, et purement orientales, agitaient encore les turbulentes imaginations des habitants de l'Afrique.
Nulle part la secte des Manichéens, qui, partie des confins de la Perse, s'était répandue presque partout sur les pas du christianisme, n'avait plus de partisans et de plus habiles missionnaires.
Elle adoptait en particulier les dogmes du culte chrétien, contrefaisait sa hiérarchie ; et s'il n'était pas rare de trouver même dans les petites villes de la province d'Afrique :
- un évêque catholique, un évêque donatiste et un évêque manichéen,
- animant chacun ses sectateurs, se disputant la foi des peuples,
- distribuant des livres et des symboles.
Les Manichéens n'étaient que des mystiques et des illuminés ; ils s'abstenaient dans leur diète pythagoricienne (abstinence de viande, régime végétarien), de toutes choses qui avaient eu vie.
La plupart de leurs rêveries étaient innocentes, et, quoique frappés par de cruels édits sous Théodose et ses fils, on ne voit pas qu'ils aient usé de représailles.
Mais les Donatiens plus nombreux et d'humeur plus violente, ensanglantèrent souvent l'Afrique.
Comme presque toutes les sectes, ils renfermaient deux partis : les modérés et les furieux.
Les premiers, qui se composaient de quelques prêtres ou de riches citoyens des villes :
- soutenaient des discussions,
- écrivaient des livres et
- tâchaient d'éluder les édits impériaux qui leur interdisaient le droit de tester et leur infligeaient la peine de l'amende et du bannissement.
Les autres que l'on nommait circoncellions, presque tous paysans et pâtres des villages de Maurétanie et de Numidie, n'avaient qu'un fanatisme farouche entretenu par les discours de quelques prêtres plus féroces que leurs que leurs ignorants sectateurs. A certaines époques :
- ils abandonnaient par troupes leurs demeures,
- erraient dans les campagnes,
- dévastaient les propriétés de la secte dominante, et quelques fois
- massacraient les prêtres catholiques qui tombaient dans leurs mains.
Ils se croyaient alors visité par l'esprit divin, et prenaient leurs meurtres pour des holocaustes agréables à Dieu.
La rigueur des lois et même la cruauté des soldats romains ne pouvaient rien sur ces hommes ; on les tuait sans les émouvoir. Ils se vantaient du nombre de leurs saints. Souvent, parmi eux, des hommes et même des femmes, se donnaient la mort par le fer, ou se jetaient volontairement dans les précipices, comme pour devancer le martyre.
Tandis que ces troubles religieux bouleversaient l'Afrique, les fils du grand Constantin, poussés par l'ambition les uns contre les autres, s'étaient détruits mutuellement.
Julien, son neveu si connu sous le nom de Julien l'Apostat, réunit pour un moment et sut porter avec gloire tout le fardeau d'un monde romain.
Après sa mort et celle de Jovien son successeur, Valentinien, appelé au trône par l'armée, s'associa son frère Valens.
Ces deux princes se partagèrent l'empire : l'un régna en Occident et l'autre en Orient, division fatale qui activa la chute de la puissance romaine.
Dans ce partage (365 de J. C), Valentinien, à qui était échu l'Occident (à cette époque, les possessions romaines en, Afrique s'étendaient depuis Alexandrie jusqu'au Cap Blanc ; mais il s'en fallait de beaucoup que toutes les parties de ce vaste domaine eussent accepté avec la même soumission le patronage de la métropole. Ainsi, tandis que les provinces de l'Est recevaient en échange de leur docilité :
- la paix, les arts et la richesse,
La Maurétanie protégée par ses montagnes, garde durant trois siècle une attitude farouche, toujours prête à courir aux armes pour repousser un joug qu'elle déteste.
L'insurrection, lorsqu'elle éclate, y déploie cet acharnement profond et indomptable que lui communique l'esprit national.
A Césarée il avait fallu, pour protéger la ville contre les ravages des Maures, couronner d'une muraille continue les hauteurs qui la dominent.
La civilisation apportée par les vainqueurs ne jeta donc de fortes racines en Afrique que dans les villes du littoral et dans quelques localités de l'intérieur.
Carthage seule était devenue une ville toute romaine qui, par sa magnificence et ses richesses rivalisait avec Antioche et Alexandrie.
Conservant, sous l'autorité proconsulaire, des libertés municipales, un sénat ou conseil public, révéré dans toute la province, elle déploya le génie commercial qui caractérisait l'antique colonie phénicienne.
- Son port, ses quais,
- ses édifices faisaient l'admiration des étrangers.
La nouvelle Carthage ne négligeait pas les lettres : elle avait des écoles nombreuses et célèbres où l'on enseignait l'éloquence et la philosophie ; on s'y pressait en foule sur les places publiques pour entendre un sophiste, un rhéteur célèbre : l'ingénieux Apulée dissertait devant le peuple sur les fables et la littérature des Grecs et briguait les applaudissements d'une ville si studieuse et si savante.
L'ingénieux Apulée dissertait devant le peuple sur les fables et la littérature des Grecs et briguait les applaudissements d'une ville si studieuse et si savante. Ces imaginations africaines se passionnaient pour les arts avec une étonnante ardeur et un enthousiasme moins éclairé mais aussi vif que celui des peuples de la Grèce.
Carthage qu'on appelait la muse d'Afrique avait des théâtres sur lesquels on représentait les plus beaux ouvrages dramatiques de l'ancienne Rome et les meilleures imitations de la tragédie grecque.
Les comédies de l'Africain Térence, esclave en Italie, avait fait admirer de ses maîtres, étaient applaudies dans sa patrie, devenue romaine par la langue et les mœurs.
La carte de l'ancienne Afrique nous montre les provinces de l'Est couvertes d'un réseau de routes qui les sillonnent dans tous les sens.
- Sétif, Cirta, Lambèse, Hippone, Théonte, Carthage
Etaient autant de riches carrefours où les communications venaient se croiser.
- Dix routes passaient à Sétif,
- six à Cirta,
- cinq à Lambèse,
- six à Hippone,
- sept à Théonte.
- Du milieu de Carthage partaient six faisceaux qui, au sortir de ses murs se ramifiaient dans toutes les directions.
Mais ces routes et les stations militaires disséminées dans toute la contrée étaient impuissantes pour contenir le vif sentiment de réaction que nourrissaient les indigènes contre la civilisation étrangère.
On ne domptait les tribus que par la force ; on transplantait ensuite les vaincus dans des lieux éloignés ; mais à la première occasion favorable, ils quittaient le lieu de leur exil et, animés par la soif de la vengeance, rentraient dans leurs vallées ou dans leurs montagnes après avoir massacré tout ce qui s'opposait à leur passage.
Ainsi, à toutes les époques, comme le dit fort judicieusement M. le général Duvivier, l'occupation romaine fut précaire.
Elle ne parut assurée que lorsque les rois esclaves commandèrent aux populations indigènes et les courbèrent sous l'obéissance de l'étranger) fixa sa résidence à Milan. De là il commandait :
- à l'Illyrie, ( actuelle Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Montenegro, Albanie, Kosovo)
- à l'Italie,
- à l'Espagne,
- à la Gaule,
- à la Bretagne, et
- à l'Afrique.
Sous son règne ces vastes provinces éprouvèrent d'effroyables calamités :
- les Germains envahirent la Gaule,
- les peuples du Nord infestèrent l'océan de leurs pirateries,
- les Pictes (confédération de tribus habitant l'actuelle Ecosse) inondée de sang et ravagé par ses propres chefs sous les yeux même de l'empereur.
L'Afrique fut peut-être plus malheureuse encore : le comte Romanus, son gouverneur, se ligua secrètement avec les tribus du désert contre les provinces que son devoir était de protéger.
Trois villes : Oca, Leptis et Sabrata formaient alors, sous le nom de district de Tripoli, une confédération riche et puissante.
- Un vaste territoire,
- des campagnes fertiles,
- un commerce très étendu,
- tels étaient les résultats de la demi-liberté dont elles jouissaient sous la protection des gouverneurs romains.
Il y avait là de quoi tenter les pillards de la Gétulie.
Assurés de l'impunité par la connivence du comte Romanus, ils parurent tout à coup en armes sous les murs de ces florissantes cités, surprirent et massacrèrent un grand nombre de leurs habitants.
Les citoyens consternés implorèrent le secours du complice secret de leurs ennemis. Celui-ci ne refusa point ouvertement son assistance, mais le prix auquel il la mit équivalait à un refus : il exigeait quatre mille chameaux et une somme d'argent exorbitante. Les Tripolitains en appelèrent au tribunal de l'Empereur.
Trompé par de faux rapports, Valentinien regarda leurs plaintes comme calomnieuses et y répondit par un décret de proscription.
Cinq des principaux citoyens furent exécutés à Utique, deux autres eurent la langue arrachée.
Le comte Romanus conserva son commandement.
L'Afrique entière vit avec une profonde indignation cette aveugle cruauté ; et le rapide déclin de la puissance romaine relevant le courage des Maures, ils s'insurgèrent sous la conduite de Firmus, un de leurs principaux chefs.
Ce Firmus n'était point un chef sorti du désert, mais un de ces princes tributaires auxquels obéissaient les populations agricoles et à demi civilisées établies dans la zone intermédiaire entre les colonies romaines et les tribus nomades.
- Son ambition effrénée,
- son esprit rusé et fécond en stratagèmes,
- sa vie et sa mort enfin en firent comme un reflet lointain et une pâle image de Jugurtha.
Ses premiers efforts dirigés contre un gouverneur méprisé et haï furent partout couronnés de succès.
Après avoir battu les Romains en plusieurs rencontres, il assiégea l'importante ville de Césarée (Cherchell), la prit, la livra aux flammes.
La terreur de ses armes se mêlant alors, dans l'esprit des peuples, au désir de retrouver leur indépendance, la Numidie et la Maurétanie se rangèrent sous ses ordres.
Déjà il se croyait maître de l'Afrique entière et semblait hésiter seulement entre le diadème d'un roi maure et le pourpre de l'Empereur romain.
Ce général venait de soumettre la grande Bretagne ; il fut choisi pour pacifier l'Afrique.
Une flotte, rassemblée à la hâte le transporta de l'embouchure du Rhône sur cette côte où il débarqua près d'Igilgilis, aujourd'hui Djidjelli.
Il n'était suivi que par un petit nombre de vétérans, mais sa réputation valait une armée.
Ayant recours aux ruses ordinaires des Maures, Firmus offrit de déposer les armes et de se soumettre. Théodose accueillit ces propositions de paix mais sans suspendre un seul instant ses opérations militaires.
L'évènement justifia la sagesse de cette précaution.
En effet, au moment même où Firmus promettait de congédier ses troupes et d'envoyer des otages, deux de ses frères Mascizel et Mazuca, chacun à la tête d'un corps considérable s'avançaient pour le soutenir.
Théodose ne leur en laissa pas le temps et marcha d'abord contre Mascizel.
Les Maures acceptèrent le combat et soutinrent même avec fermeté le premier choc des troupes romaines, mais ils finissent par être rompus ; leur avant-garde fut taillée en pièce, et le reste s'enfuit en désordre.
Théodose poursuivit ses avantages avec vigueur se préparant à pénétrer plus avant dans le pays.
Tout à coup il apprend que les Maures de Mascizel rallié par leur chef reviennent sur leurs pas.
- Il les prévient,
- les attaque avec impétuosité et
- les met une seconde fois en pleine déroute.
Effrayé par ce double échec, Firmus sollicite un sauf conduit ; dès qu'il l'eut obtenu, il se rendit au camp romain et, se prosternant aux pieds du vainqueur, demanda humblement la paix.
Théodose y consentit mais en exigeant des garanties plus solides que ces vaines manifestations de repentir. Il mit pour condition :
- que Firmus fournirait des vivres à l'armée,
- laisserait quelques-uns de ses parents en otage et
- mettrait en liberté tous les prisonniers faits par lui depuis l'origine des troubles,
- qu'il restituerait les enseignes romaines et tout ce qu'il avait pris sur les sujets de l'empire, enfin
- qu'il licencierait ses troupes.
Après quoi il rentrerait en grâce auprès de l'empereur.
Firmus parut accepter son pardon avec reconnaissance ; pressé par les circonstances et ne pouvant reculer, il remplit en deux jours presque tous ses engagements. Mais, tandis qu'il fournissait des vivres à ses ennemis et leur livrait des otages, il répandit l'or dans le camp romain pour exciter les soldats à la révolte et envoyait au loin des émissaires afin de mettre dans ses intérêts les chefs les plus puissants de la contrée et les tribus indépendantes du désert.
La prudence de Théodose déjoua les ruses de l'audacieux Africain.
A Césarée où il s'était rendu pour en relever les murailles, il apprit ces sourdes menées, dont quelques-unes avaient déjà réussi.
En effet un corps d'archers s'était laissé séduire et un tribun militaire avait eu l'insolence de poser son collier sur la tête du rebelle, en guise de diadème.
Le premier soin du général fut de punir les traîtres :
- il marche contre eux,
- les surprend et
- les livre à la vengeance de ses troupes irritées.
- Le tribun fut mis à mort après avoir eu le poing coupé,
- les officiers eurent la tête tranchée,
- les soldats périrent presque tous de la main de leurs camarades.
Après cet acte d'une utile sévérité, Théodose, se porta contre une forteresse où les Maures s'étaient enfermés.
- Il la prit d'assaut,
- passa la garnison au fil de l'épée et
- rasa les murailles jusqu'aux fondements.
Se dirigeant ensuite vers la Tingitane (Tanger) que menaçait l'antique tribu des Maziques il attaqua ces barbares sans leur laisser le temps de se reconnaître et les réduisit à implorer sa clémence.
La victoire accompagnait partout les armes romaines, et cependant il semblait que, loin de décourager les Maures, ces échecs réitérés ne fissent qu'exciter leur ardeur guerrière.
Presque toutes leurs tribus prirent les armes et environnèrent Théodose, entraîné trop loin par la chaleur de la poursuite.
Pressé par une multitude innombrable, et n'ayant sous la main que trois mille cinq cents chevaux et un faible corps d'infanterie, sa position était très critique.
Il se décida à la retraite qu'il fit avec calme et sang-froid, choisissant habilement les postes les plus avantageux pour contenir la fougue indisciplinée des assaillants. Un jour cependant il faillit avoir sa retraite coupée ; tous les passages étaient fermés et, pour les franchir, il se voyait près d'être réduit à combattre malgré lui, lorsqu'un incident inattendu le sauva.
Les Maziques vaincus s'étaient engagés à fournir un contingent de troupes et le lui envoyaient sous la conduite de quelques escadrons romains.
Ce renfort aperçu au loin par les coureurs maures, fut pris pour une armée entière qui venait dégager Théodose.
Aussitôt l'alarme se répand parmi les barbares. Mettant à profit cette terreur panique, il franchit les défilés et ramène sa petite armée sous les murs de Tavès où il prend une bonne position.
De là il travaille à désunir ses ennemis, promettant aux uns des capitulations honorables, aux autres des récompenses pécuniaires, s'ils lui livrent le rebelle.
Cette politique habile eut tout le succès qu'il en espérait.
La plupart des partisans de Firmus l'abandonnèrent ; lui-même, craignant d'être livré par le petit nombre de ceux qui l'entouraient encore les quitta pendant la nuit et s'enfuit presque seul dans les montagnes.
Privés de leur chef, les Maures se débandèrent.
De même que celles de Jugurtha et de Tacfarinas, cette guerre peut servir d'exemple à nos généraux en Afrique.
Tant que le chef ennemi subsiste, le succès n'est point assuré : même vaincu, il sert encore de point de ralliement à toutes ces populations habituellement divisées ; la vague nationale africaine se concentre et se personnifie momentanément dans un seul homme. C'est donc lui surtout qu'il faut atteindre.
Théodose l'avait compris.
Au milieu des innombrables vallées du mont Atlas, il lui avait été impossible d'empêcher la fuite de Firmus mais il le poursuivit sans relâche et ne s'arrêta point que sa mort n'eût terminé la guerre.
- Firmus, Mazuca son frère, et
- plusieurs de leurs principaux adhérents s'étaient réfugiés chez le roi des Isafiens (ils occupaient les montagnes situées au Sud de Titteri), comme jadis Jugurtha chez Bocchus et avait obtenu de lui aide et protection.
Depuis longtemps ces peuples sauvages, habitant le pays des palmiers, sur les confins du grand désert, avaient oublié la majesté du nom romain.
Théodose voulut leur apprendre de nouveau à le respecter et à le craindre.
Il marcha contre eux, et les somma de lui livrer le chef rebelle et ses partisans.
Sur leur refus, il pénétra plus avant et les dispersa dans une première rencontre.
Mazuca fut blessé à mort, et Firmus perdit le peu de soldats qui lui restait.
Cependant le chef des Isafiens, Igmazen, s'avançait à la tête de vingt mille combattants.
Dès qu'il aperçut Théodose, il courut à sa rencontre avec une faible escorte.
" D'où es-tu et que viens-tu faire ici ? " lui dit arrogamment.
" Je suis, répondit le Comte, je suis le général de Valentinien, monarque de l'univers ; il m'envoie ici pour poursuivre et punir un brigand sans ressource.
Remets-le à l'instant entre mes mains et sois assuré que si tu n'obéis au commandement de mon invincible souverain, toi et ton peuple vous disparaîtrez de la terre. "
Ces paroles n'intimidèrent pas le chef barbare qui ne tarda pas à reparaître à la tête de ses vingt mille hommes rangés en bataille.
Derrière cette masse confuse se cachait un corps de réserve et une grosse troupe de cavalerie auxiliaire, chargée de se détacher successivement par peloton afin d'envelopper la petite armée de Théodose.
Les Romains soutinrent pendant tout le jour ce combat inégal, sans se laisser entamer. Vers le soir comme les Barbares redoublaient d'efforts, Firmus se montra aux deux armées sur une hauteur voisine.
Vêtu d'une riche robe de pourpre et assez près du lieu du combat pour que sa voix pût être entendue des deux partis, il Criait aux soldats de Théodose : " Livrez votre général au roi Igmazen, sinon point de quartier pour vous ; vous allez être entourés de toutes parts et écrasés ! "
La présence de Firmus jeta quelque trouble dans l'armée romaine déjà épuisée par la fatigue. Heureusement, la nuit survenant mit fin au combat et elle put opérer sa retraite.
Théodose ne tarda pas à prendre sa revanche. Renforcé de quelques détachements tirés des garnisons, il contraignit les Barbares à diviser leurs forces et leur fit éprouver des pertes successives.
Effrayé de ses revers, lassé d'une lutte dans laquelle il exposait sa couronne et sa vie pour soutenir les intérêts d'un chef d'état étranger, Igmazen demanda secrètement la paix et promit de livrer Firmus aussitôt que les tribus qui lui obéissaient sentiraient plus vivement encore les maux de la guerre.
Théodose hâta ce moment en ne laissant échapper aucune occasion de fatiguer, de décourager les Isafiens.
Il brûlait leurs habitations et ne cessait de ravager leur territoire.
Firmus s'apercevant avec effroi du refroidissement de ses alliés, tenta de s'enfuir de nouveau dans les montagnes, mais Igmazen le prévint et le fit arrêter.
Pour éviter la honte de servir au triomphe des Romains, le Maure rebelle s'étrangla pendant la nuit.
Igmazen fit jeter son cadavre sur un chameau et l'envoya à Théodose qui, après l'avoir fait reconnaître par quelques prisonniers, et certain que la guerre était enfin terminée, reprit avec ses troupes victorieuses le chemin de Sitif (Sétif).
Partout sur son passage de joyeuses acclamations le récompensèrent du service qu'il venait de rendre à ces malheureuses provinces,
- ruinées tantôt par l'avarice des gouverneurs,
- tantôt par la cruauté des rebelles.
L'issue de cette guerre avait prouvé que jamais les indigènes ne parviendraient à renverser seuls la domination romaine.
Romanus avait failli faire perdre l'Afrique aux Romains ; Théodose la leur rendit.
La manière dont la cour impériale récompensa l'un et punit l'autre caractérise le gouvernement de cette déplorable époque.
En arrivant en Afrique, Théodose avait suspendu de ses fonctions le comte Romanus qui, placé jusqu'à la fin de la guerre, sous une garde sûre, fut néanmoins traité avec déférence.
On avait les preuves les plus incontestables de ses crimes, et chacun attendait avec impatience qu'on le livrât à la sévérité de la justice.
Mais la protection des courtisans l'enhardit à récuser ses juges légitimes, à solliciter des délais répétés qui lui donnèrent le temps de suborner une foule de faux témoins et de couvrir ses anciens crimes par des crimes nouveaux.
Pendant que les lois se taisaient ainsi devant l'intrigue et l'imposture, on faisait tomber à Carthage la tête du libérateur de la Bretagne et de l'Afrique sur l'unique motif que ses services le rendaient trop puissant pour un sujet.
Valentinien n'existait plus alors et l'on peut imputer aux ministres qui abusaient de l'inexpérience de ses fils le meurtre de Théodose et l'impunité de Romanus.
La mort de Firmus n'avait détruit l'influence de sa famille en Afrique.
Son frère Gildon qui servait dans les légions romaines au moment où ce chef leva l'étendard de la révolte, hérita de ses richesses et de son rang qui lui furent transmis en récompense de sa fidélité.
Sous le successeur de Valentinien, il obtint la dignité de comte militaire et l'empereur Théodose, le fils même de celui qui avait vaincu son frère, lui confia le commandement de l'Afrique.
Telle était dans ce siècle de désordre la politique imprudente ou plutôt forcée des empereurs même les plus éclairés que partout ils s'étayaient du concours et de l'influence des chefs barbares, dévorant ainsi l'avenir au profit du présent, et n'éloignant le péril de leur tête qu'en le rejetant sur celle de leur successeur.
La tyrannie que Gildon exerça sur les cinq provinces qui composaient alors le gouvernement de l'Afrique ne peut être comparée qu'à celle de Néron et de Caligula sur Rome.
Comme eux il se livrait sans remords aux débauches les plus honteuses, les crimes les plus atroces.
- Il se faisait un jeu barbare d'effrayer les convives qu'il forçait de s'asseoir à sa table et le moindre signe de crainte était l'arrêt de leur mort.
- Il arrachait les filles à leurs mères,
- les épouses à leurs maris, et après avoir déshonoré ces femmes,
- il les livrait, quel que fut leur rang, à la brutalité d'une troupe de satellites recrutés parmi les hordes sauvages du désert.
Cette horrible tyrannie dura douze ans.
Au moment où possesseur tranquille du reste de l'empire par la mort ou la ruine de ses rivaux, le grand Théodose s'apprêtait à délivrer l'Afrique de son odieux gouverneur, il mourut,
- la faiblesse de ses fils,
- leurs discordes, ou plutôt
- celles de leurs ministres, affermirent l'autorité de Gildon.
Celui-ci n'était déjà plus un vassal de l'empire ; c'était un véritable souverain qui se contentait de la réalité du pouvoir sans en revêtir les insignes.
Encouragé par l'impunité, il arrêta le départ de la flotte qui devait porter à Rome les blés de Carthage, manifeste ordinaire des proconsuls d'Afrique lorsqu'ils voulaient se déclarer indépendants.
Le faible Honorius, qui régnait alors sur l'Occident, était peu redoutable pour Gildon ; mais son ministre Stilicon, grand capitaine, politique habile, inspirait à ce dernier des craintes que l'évènement justifia.
Afin d'échapper à l'orage qui le menaçait, le rebelle tâcha d'accroître les divisions qui existaient entre les deux empires, en offrant au souverain de Byzance, l'hommage qu'il devait à l'empereur d'Occident.
L'expédition préparée par Stilicon contre le tyran de l'Afrique, fut confiée à un général qui avait à venger des injures personnelles.
C'était le propre frère de Gildon, Mascizel que nous avons vu combattre à côté de Firmus, et qui depuis, rentré en grâce auprès des Romains, s'était attiré l'inimitié de l'usurpateur.
Forcé de quitter l'Afrique pour se dérober à la vengeance de son frère, il y avait laissé ses deux enfants encore en bas âge. Gildon les avait fait massacrer.
Ainsi une haine mortelle séparait les deux frères. Un corps choisi vétérans gaulois, confié à Mascizel fut embarqué à Pise.
L'expédition se composait en outre des légions :
- Jovienne, Herculéenne et Augustienne.
- Des auxiliaires Nerviens (peuple du nord de la Gaule et de l'actuelle Belgique), soldats qui portaient pour symboles un lion sur leurs drapeaux, enfin
- des légions distinguées par les beaux noms de Fortune et d'Invincible.
Cependant telle était la décadence de l'empire que ces sept corps d'élite réunis n'allaient pas au-delà de cinq mille hommes effectifs (la légion sous Romulus comptait trois mille fantassins et trois cents cavaliers.
On la doubla après la réunion des Sabins aux Romains
Sous la République elle fut tantôt de quatre, tantôt de cinq mille hommes avec deux ou trois cents chevaux
Sous les premiers empereurs elle fut portée à six mille hommes de pieds quelquefois même à six mille deux cents, avec trois cents chevaux) Gildon attendait l'armée romaine à la tête de soixante-dix mille combattants.
Les tribus de la Gétulie lui avaient fourni de nombreux contingents ; mais les troupes de la province étaient peu sûres et n'attendaient qu'une occasion pour abandonner le tyran et passer du côté de son frère.
Ainsi malgré la nombreuse cavalerie qui devait, au dire de Gildon, ensevelir sous un nuage de poussière ces soldats venus des froides régions de la Germanie, dès que les armées furent en présence, un simple accident décida de sa ruine.
Au moment d'organiser le combat, Mascizel s'était porté en avant de ses légions pour offrir aux troupes de l'usurpateur le pardon de leur révolte, un porte-étendard de Gildon voulut l'arrêter, mais Mascizel l'ayant frappé de son épée sur le bras, la force du coup fit abaisser l'étendard et ce mouvement fut interprété comme un signe de soumission. Un inexprimable désordre s'ensuivit :
- les barbares prirent la fuite,
- se dispersèrent et
- les cohortes proclamèrent Honorius.
Le Maure rebelle gagna l'un des ports de la côte où il s'embarqua à la hâte sur un petit navire ; les vents contraires l'ayant poussé vers l'île de Tabarka, les habitants se saisirent de lui et le jetèrent dans une prison en attendant qu'ils puissent le livrer aux ministres de l'empereur dont ils avaient déjà reconnu l'autorité.
Comme Firmus, Gildon échappa au supplice par une mort volontaire. Mais l'Afrique ne devait pas jouir longtemps de sa délivrance.
Trente ans à peine s'écoulèrent entre la chute de Gildon et l'invasion des Vandales. Le règne de l'imbécile Honorius, qui remplit presque tout cet intervalle, est l'époque de la dernière agonie de l'empire.
Ce vaste corps tombe en dissolution. Toutes les parties qui le composaient s'en détachent et passent, de gré ou de force, sous la domination des Barbares.
- Alaric assiège Rome, s'en empare cependant n'ose y rester tant que cette grande ombre lui cause encore d'épouvante.
- Les Goths ravagent l'Italie,
- les Francs et les Bourguignons se jettent sur la Gaule,
- les Alains, les Suèves et les Vandales pénètrent en Espagne,
- les Saxons envahissent la Grande-Bretagne. Il ne reste à l'empereur d'Occident 'autre asile assuré que les marais de Ravenne.
Ce fut à cette déplorable époque, et au milieu du conflit de toutes les opinions religieuses que l'Afrique vit naître l'homme qui est peut-être sa plus grande gloire.
Augustin dont le génie n'appartient pas seulement à sa patrie mais à l'humanité toute entière et dont le nom domine toute l'histoire de la philosophie chrétienne.
Sa mère était catholique fervente, son père païen ou indifférent.
La ville de Tagaste, où il était né, avait récemment passé de la secte Donat (le donatisme, mouvement chrétien hérétique des IVe et Ve siècle estime que la valeur des sacrements dépend du caractère moral du ministre et L'Eglise trop laxiste envers les chrétiens qui, trop faibles devant la persécution, ont abjuré le christianisme) à la communion de Rome. (Tagaste figurait parmi les sièges épiscopaux de l'Afrique. Plusieurs conciles y furent tenus. Elle était située à 40 milles environ de Bône. Il n'en existe aujourd'hui que quelques faibles traces. Tout auprès se trouvait Madazure, ville un peu plus considérable.)
Augustin étudia d'abord dans la ville de Madaure, puis à Carthage. Mais l'étude des lettres ne lui suffisait pas. Son âme tendre et expansive éprouvait le besoin de croire et cherchait partout la vérité. Il crut la voir dans la secte des Manichéens (ceux qui expriment une façon de voir ou de juger sans nuance en termes opposés de bien et de mal) dont la métaphysique subtile plaisait à son esprit avide de nouveautés.
Sa mère, pleine d'horreur pour cette secte, suppliait les évêques chrétiens de l'en éloigner : " Allez en paix, lui dit l'un d'eux, et continuez de prier pour lui car il est impossible qu'un fils pleuré avec tant de larmes périsse jamais ! "
Revenu près de sa mère, Augustin se mit à enseigner la rhétorique mais le chagrin qu'il conçut de la mort d'un ami l'éloigna de cette ville et le fit retourner à Carthage, toujours professeur d'éloquence, manichéen peu convaincu et philosophe emporté par les plaisirs.
Lassé de tout, il vint à Rome puis à Milan.
On sait comment, touché des paroles de Saint Ambroise, évêque de cette dernière ville, il se retira dans la solitude et trouva dans le christianisme un terme à la longue inquiétude de son esprit et de son cœur.
Après avoir reçu le baptême des mains du vénérable prélat il résolut de retourner en Afrique suivi de sa famille et de ses amis.
Dans ce but il vint à Ostie pour s'y embarquer. Là sa mère tomba malade et mourut au bout de quelques jours.
Sa douleur fut extrême ; il renonça d'abord à son voyage et s'arrêta quelques temps à Rome où il écrivit un traité des mœurs de l'église catholique et commença à combattre les Manichéens dont il avait longtemps partagé la croyance.
La victoire de Théodose sur Maxime ayant pacifié l'empire, Augustin retourna en Afrique.
Après un court séjour à Carthage, il se retira non loin de sa ville natale, dans une terre qu'il possédait, pour s'y livrer avec ses amis à la méditation des Écritures et à la prière.
Dans ses contemplations religieuses, ce nouveau converti n'aspirait aucunement au sacerdoce.
Cependant une circonstance l'ayant conduit à Hippone, Valère, évêque de cette ville, grec de naissance, et qui éprouvait quelque difficulté à prêcher en langue latine, résolut de l'ordonner prêtre afin de s'aider de son éloquence.
Augustin refusa d'abord cette mission, mais le peuple, malgré sa résistance, se saisit de lui, le demandant pour pasteur.
Valère le fit prêcher dans son église, de même que Chryostôme avait remplacé Flavien dans l'église d'Antioche.
Augustin parlait avec une onction extraordinaire et s'attendrissait quelquefois jusqu'aux larmes.
Ses discours pleins de vives images saisissaient l'esprit de ses auditeurs ; il les captivait et les dominait par son éloquence persuasive.
C'est ainsi qu'il fit abolir l'usage des festins sur les tombeaux des martyrs en retenant les fidèles dans l'église le jour même où se célébrait d'ordinaire cette fête licencieuse.
- Il s'occupait également de l'éducation des enfants,
- adoucissait le sort des esclaves, et
- communiquait par lettre avec les différentes sociétés chrétiennes de l'Afrique. Valère vieillissant le fit nommer coadjuteur avec le titre d'évêque.
Augustin continua à diriger l'église d'Hippone, prêchant l'union et la charité, donnant en un mot, par sa vie entière, la preuve de sa foi.
- Il fit bâtir un hospice pour les étrangers,
- établit l'usage de donner chaque année des vêtements aux pauvres, et
- alla même jusqu'à vendre les vases sacrés pour racheter les captifs.
Il ne quittait jamais son troupeau que pour aller à Carthage ou à Madaure dont les habitants étaient encore en partie attachés au paganisme.
Toutefois, de son modeste asile, il portait ses regards sur toutes les églises chrétiennes. Rien ne peut donner l'idée de cet ardent apostolat :
- prédication,
- livres de philosophie,
- controverses avec les païens, avec les schismatiques , avec les docteurs de sa religion il suffisait à tout.
Cependant sa lutte la plus ardente était contre les manichéens et les donatistes, dont il détestait profondément les erreurs.
La petite ville d'Hippone semblait être devenue un amphithéâtre scolastique où s'agitaient les questions les plus importantes du dogme et à la discussion desquelles prenait un égal intérêt toutes les classes même les plus infimes de la population. Dans toute l'Afrique l'esprit indomptable des sectes religieuses avait restitué aux malheurs de l'empire ou plutôt y avait puisé un nouvel aliment.
Lassé de leur opiniâtreté, le faible Honorius s'était laissé persuader d'infliger aux sectaires les plus rigoureux châtiments. Mais au lieu de les abattre,
- l'exil, les confiscations,
- la mort ne faisaient qu'augmenter la résistance.
Partout ce n'était que :
- sang, tumulte,
- désespoir et pour que rien ne manquât aux malheurs de cette malheureuse contrée, le compte Héraclius qui en avait alors le commandement, leva l'étendard de la révolte et prit le titre d'empereur.
Étant parvenu à équiper une flotte nombreuse que les historiens du temps, avec une ridicule exagération, comparent à celles de Xercès ou d'Alexandre, il arriva sans obstacle en Italie et jeta l'ancre à l'embouchure de Tibre.
Attaqué et vaincu dans sa marche sur Rome, par un des généraux de l'empereur, il se sauva avec un seul vaisseau, retrouva l'Afrique soumise aux lois d'Honorius, et fut livré par ses complices aux magistrats de Carthage qui lui firent trancher la tête. Telle était la situation des choses lorsqu'après la mort d'Honorius et sous le gouvernement de la célèbre Placidie (princesse impériale, 388-450) qui régnait en Occident au nom de son fils Valentinien III (on compte trois empereurs du nom de Valentinien. Le dernier Valentinie III, fils de Constance et de Placidie resta longtemps sous la tutelle de sa mère.)
La jalousie mutuelle d'Aétius et de Boniface, ses deux ministres et ses meilleurs généraux, livra l'Afrique aux Vandales.
Ces deux hommes qu'un historien célèbre appelle les derniers Romains, auraient pu, en réunissant leurs efforts, soutenir quelque temps encore cet empire chancelant ; mais leur jalousie et leurs divisions les perdirent.
Aétius est demeuré célèbre par la défaite d'Attila dans les plaines de la Champagne.
Les exploits du comte Boniface sont moins éclatants : le temps d'ailleurs les a couvert d'un voile épais. Cependant son caractère parait avoir été plus grand et plus généreux que celui de son rival.
Aétius appela souvent les Barbares au sein de l'empire, et trahit presque toujours, au profit de son ambition, la foi qu'il avait jurée à ses maîtres.
Boniface, au contraire, jusqu'au jour où il tomba dans cette et fatale erreur, défendit sa patrie avec une fidélité admirable.
Il employa les troupes et les trésors de l'Afrique, dont il était gouverneur, tantôt contre les Barbares, tantôt contre les révoltés et ne se laissa détourner de son devoir par aucun motif d'intérêt personnel.
Lorsque enfin, enveloppé dans une machination inextricable, il se départit de cette noble conduite, il hésita longtemps à se défendre contre sa reine trompée, quoiqu'il y allât de sa vie ; et aussitôt que Placidie, instruite de la trahison dont il avait été victime, eut reconnu son innocence, il se hâta de rentrer dans le devoir et de réparer, autant qu'il dépendait de lui, les maux qu'il avait causés.
- Si ses efforts furent inutiles,
- si l'Afrique fut définitivement perdue et livrée aux fureurs des Vandales,
L'histoire en doit rejeter la responsabilité moins sur lui que sur le rival dont la trahison le réduisit à appeler ces barbares à son secours.
Par les circonstances funestes qu'elle entraîna, cette trahison d'Aétius demande quelques développements. Pendant que Boniface gouvernait l'Afrique avec gloire, les Vandales, réunis aux Alains dévastaient l'Espagne et s'établissaient dans la riche et fertile Bétique (sud de l'actuelle Espagne, l'Andalousie).
Le comte reçut de Placidie l'ordre de se rendre auprès de Gondéric, leur roi, et d'en obtenir un traité qui mit un terme à leurs envahissements.
Ce voyage fut l'occasion et le commencement de sa perte.
Épris des charmes d'une jeune Vandale, il la demanda en mariage et obtint sans peine l'assentiment du roi, qui comprit combien cette alliance pouvait devenir utile aux intérêts de sa nation.
Pélagie était arienne comme tous ses compatriotes ; Boniface était catholique.
Cette difficulté disparut par l'abjuration de la nouvelle épouse qui entra volontairement, du moins en apparence, dans le sein de la communauté orthodoxe. Mais, à peine arrivée en Afrique abusant de son ascendant sur son époux, elle remplit son palais d'Ariens, ajoutant ainsi un nouveau ferment aux discordes religieuses qui troublaient depuis longtemps cette malheureuse contrée. Les catholiques d'une part, les ariens et les donatistes de l'autre, se détestaient bien plus entre eux qu'ils ne haïssaient les Maures païens ou les Vandales.
Le mariage de Boniface avec une princesse vandale et l'introduction de l'arianisme en Afrique ouvrait un vaste champ aux intrigues d'Aétius et lui fournissaient la plus favorable occasion de perdre son rival auprès de Placidie.
Il fit entendre à cette princesse que l'union contractée par Boniface n'était pas un entraînement de l'amour mais un calcul de l'ambition, qu'il voulait ainsi s'assurer l'appui des barbares et se rendre indépendant.
Puis affectant un grand zèle pour les intérêts de la vraie religion qu'il disait menacée, il déplorait l'introduction en Afrique d'une hérésie déjà si fatale à l'empire, et qui avait fait dans le monde chrétien plus de ravages que les guerres les plus sanglantes : enfin, il suppliait l'impératrice, par tous ces motifs réunis, d'ôter sa confiance à un traître qui en avait tellement abusé et de le rappeler de son gouvernement.
" Son refus d'obéir, ajoutait-il, prouvera la justice de mes accusations.
Plutôt que de renoncer à ses projets d'usurpation, vous le verrez prendre les armes et proclamer la révolte. Il est urgent d'arracher le masque dont se couvre le traître. "
Cette prophétie d'Aétius était faite à coup sûr car il en avait lui-même préparé l'accomplissement.
Sa noire et profonde intrigue était telle, qu'une femme faible et un homme plein de loyauté ne pouvait guère la soupçonner, nous allons bientôt en exposer le résultat.
Pendant qu'il veillait et entretenait, par tous les stratagèmes possibles, les craintes de l'impératrice, il avait avec le comte une correspondance secrète et lui cachait ses perfides desseins sous le voile d'une feinte amitié.
- Pour Boniface, le rappel était une sentence de ruine, peut-être même de mort.
- Pour Placidie, la désobéissance était un indice certain de révolte.
Les trames d'Aétius eurent tout le succès qu'il en attendait.
Boniface rappelé, refusa d'obéir, et Placidie envoya contre lui une armée sous la conduite de trois généraux :
- Mavortius, Galbio et Sinox.
Mais cette expédition échoua par suite des rivalités qui s'élevèrent entre ces trois chefs pour le partage du commandement.
Sinox fit assassiner ses deux collègues et tomba lui-même sous les coups des émissaires de Boniface.
L'armée impériale se trouva dès lors dans l'impossibilité de continuer la lutte.
Ce premier succès n'éblouit pas le comte. Il ne se flattait point de pouvoir résister à toutes les forces de l'empire d'Occident, qu'un rival, dont il connaissait enfin les véritables intentions, mettrait sans doute en mouvement pour assurer sa ruine.
A l'annonce d'une nouvelle expédition dirigée contre lui, après de violents combats intérieurs, derniers cris de la conscience et du devoir, il passa lui-même en Espagne et offrit aux Vandales le partage de l'Afrique trahissant tout à la fois :
- son honneur,
- sa patrie,
- sa religion.
Il convint avec Gondéric que les Vandales prendraient possession des trois Maurétanie :
- la Tingitane (Maroc et Fez),
- la Césarienne (Oran, Alger, Titteri) et
- la sétifienne (province de Sétif) région détachée de la Numidie ; à Boniface devait appartenir le reste de l'Afrique.
Les deux nouveaux alliés se promirent assistances mutuelles contre les agressions dont ils pourraient être menacés.
Tel fut le funeste traité qui décida de la ruine de la puissance romaine en Afrique. " Rien de plus curieux pour l'histoire, dit M Villemain, que le langage d'Augustin à ce général romain, qui perdait son pays par ambition et par colère. Souviens-toi lui dit-il, qui tu étais, tant qu'a vécu ta première femme, de religieuse mémoire et dans les premiers jours de sa mort. A quel point la vanité du siècle te déplaisait, combien tu désirais le service de Dieu. Qui aurait supposé, qui aurait craint que Boniface, comte du palais et de l'Afrique, occupant cette province avec une si grande armée et une si grande puissance, les barbares :
- deviendraient si hardis,
- avanceraient si loin,
- désoleraient un si grand espace et
- rendraient déserts tant de lieux habités ?
Qui n'aurait dit, quand tu prenais la puissance de comte, que non seulement les barbares seraient domptés mais qu'ils deviendraient tributaires de la puissance romaine ?
Et maintenant tu vois à quel point l'espérance des hommes est démentie.
Si tu as reçu de l'empire romain des bienfaits, ne rends pas le mal pour le bien ; si, au contraire tu as reçu d'injustes traitements, ne rends pas le mal pour le mal.
Laquelle est vraie de ces deux suppositions, je ne veux pas l'examiner ; je ne puis les juger. Je parle à un chrétien et je lui dis : " Ne rends pas le mal pour le bien, ni le mal pour le mal. "
Cette fois l'éloquence d'Augustin fut impuissante ; le comte Boniface n'écouta que la voie de son ressentiment et lorsque plus tard il reconnut la faute immense qu'il avait commise, il n'était plus temps : les Vandales étaient devenus les maîtres de l'Afrique.
Histoire de l'Algérie ancienne et moderne
depuis les premiers établissements carthaginois
par Léon Galibert, directeur de la revue britannique. Édition 1842
|
|
| L'affaire Bacri, Deval … et compagnie.
Envoi de M. Christian Graille
|
Je n'ai jamais compris que les Européens d'Algérie soient les ennemis des Juifs de ce pays. On chasse les israélites de ce magnifique palais consulaire qui, près de la mosquée du port, près du passé, marque, lourde masse, l'état nouveau.
Lorsque les Algériens y inscriront comme en un Panthéon les grands noms de la conquête, à la première ligne, en tête, ils devront mettre celui de Bacri.
L'Algérie est folle de ne pas aimer le juif. C'est au juif Bacri qu'elle doit être colonie française.
Sans lui, c'est Mehemet Ali qui serait venu châtier le Dey et l'Afrique du Nord serait un grand État musulman allié de la France. Il est ridicule de dire " si ", d'écrire " si ".
Quand chez moi j'entends ma femme dire : " si on avait fait ceci, si on avait fait cela ", j'ai toujours envie de répondre par une phrase des charretiers de mon pays, bien jolie, mais hélas, trop grossière pour mon répertoire de citoyen poli…
" Si " ne devrait jamais être employé par un homme sérieux.
Tout de même… pour vous distraire… un instant remontez dans le passé. Imaginez Mehemet Ali prenant Alger.
Le pacha d'Égypte avec nous, contre le sultan de Turquie établissant d'Alexandrie à Tanger un empire musulman… à cet empire musulman nos savants, nos capitalistes donnant la vie, la force ; et notre diplomatie marchant avec ça …
Rêve éblouissant. France riche et puissante ; et quelle paix ! Quels progrès au monde !
Oui… mais il y avait l'émancipation des Juifs et l'affaire Bacri.
Elle est aujourd'hui bien oubliée ; on se rappelle seulement que M. de Laborde, lors des discussions relatives à l'expédition, s'écria : " Cette guerre est-elle juste ? Non. On vole le Dey ; il réclame, il se plaint et on le tue. "
Cela est demeuré non pas à l'honneur mais à la confusion de ce parlementaire d'opposition.
C'est pour railler les adversaires du projet d'expédition qu'on rappelle ce fait.
Celui des vols auxquels il faisait allusion est oubli. L'affaire Bacri n'existe plus.
Ne reste que la victoire civilisatrice de la France et la mauvaise âme de ceux qui s'y opposaient, des mauvais Français que l'on flétrit ou dont on se moque. Voilà l'état d'esprit.
Depuis quatre ans que je travaille plus spécialement à cet ouvrage, en des centaines de conversations j'ai amené le propos. Ce fut toujours ce que je viens d'écrire. Les livres classiques ne peuvent cependant ignorer l'affaire Bacri :
- mais ils glissent,
- ils n'appuient pas,
- ils escamotent.
Voici dans Wahl : " … L'affaire Bacri, plus que tout le reste, tenait au cœur du Dey. Bacri et Busnach, deux juifs algériens avaient fait au Directoire d'importantes fournitures de blé qui n'avaient pas été payées intégralement. L'Empire donna quelques acomptes.
En 1819 la créance fut réglée à sept millions, mais la convention alors conclue, réserva expressément les droits des Français dont Busnach et Bacri étaient les débiteurs.
Des oppositions se produisirent et une partie de la somme fut retenue en attendant la décision des tribunaux.
Hussein, qui avait de gros intérêts dans l'affaire et qui n'entendait rien aux formes compliquées de la justice française, s'indignait de ces lenteurs.
Il se croyait victime d'une intrigue ourdie contre lui par le consul Deval.
Il s'adressa directement au gouvernement du roi, réclama deux millions et demi qui lui étaient dus, ajoutant que les ayants-droit n'auraient qu'à se présenter ensuite devant son tribunal pour obtenir justice.
Il ne reçut pas de réponse et ce silence lui parut un outrage.
Dans son audience solennelle du 27 avril 1827, le consul s'était présenté devant lui, il l'interpella avec vivacité. L'autre qui s'exprimait bien en langue turque, répondit sur le même ton.
Le Dey furieux, le frappa de son éventail et le chassa de sa présence.
Un consul plus prudent et plus digne n'aurait pas provoqué une pareille scène, mais Deval représentait la France. Il fallait une réparation. "
La scène du coup d'éventail n'a pas toujours été racontée de la sorte.
Galibert écrit : " D'après le Maure Sidi Hamdan, la réponse de M. Deval fut on ne peut plus insultante : " mon gouvernement, aurait-il dit, ne daigne pas à répondre à un homme comme vous. "
Ces paroles prononcées en présence de toute sa cour froissèrent tellement l'amour-propre d'Hussein qu'il ne put maîtriser un mouvement de colère et lui donna un coup d'éventail. "
Ainsi vous voyez que dans les évènements fortuits apparaît une volonté, celle de Deval, le consul qui, pendant que d'autres intriguent à Paris, comme de Bourmont, brouille à Alger les cartes et est responsable du coup d'éventail autant que le Dey.
Henri Martin n'est pas tendre pour ce Deval : " La France, depuis la Restauration, était assez mal représentée à Alger. Notre consul ne tenait pas une conduite et ne gardait pas une attitude de nature à se faire respecter. "
Galibert en dit : " M. Deval, né dans le Levant, connaissant la langue turque et les usages des Orientaux, fut nommé consul général à cette résidence en 1815.
Il avait exercé, pendant plusieurs années, les fonctions de drogman (interprète) à Péra et y avait contracté l'habitude de ces formes souples et obséquieuses que les autorités musulmanes exigent toujours des agents inférieurs.
Ainsi, il avait consenti, sans faire d'objections, à ce que la redevance de la Compagnie d'Afrique fut portée de 6.000 à 200.000 francs. "
Doux Galibert ! Il appelle cela de la faiblesse.
J'ai patiemment lu les pièces du consulat général de France à Alger. Beaucoup de liasses de papiers inédits ainsi quelques pièces publiées.
Et il en apparaît très nettement qu'en suivant la loi de l'époque, Deval se servait de son consulat comme d'une maison de commerce, marchant tantôt avec, tantôt contre le Dey.
Le bougre ne se refusait même pas les enlèvements de mineurs et de mineures.
Il y a une histoire d'enfant espagnol qui ferait le plus curieux scénario de roman.
Le Dey, qui connaissait bien Deval, ne se trompait point lorsqu'il l'accusait de complot pour voler son bienfaiteur.
Précisons l'affaire Bacri.
Je regrette de ne pouvoir citer ici toutes les pièces consulaires typiques, de quoi se dégage, avec la physionomie de l'affaire Bacri, le caractère de cette époque.
Ce caractère a frappé, le même toujours, tous les auteurs qui ont écrit sur l'histoire d'Alger en consultant ces pièces.
Pellissier de Reynaud, dans ses annales algériennes, tout réservé qu'il soit, tout pénétré qu'il s'affirme de la mission civilisatrice et des destinées providentielles de la France en Afrique, ne peut celer qu'il y eu " fourbi ".
" ... Le Dey, qui s'était habitué à considérer la créance de Bacri sur la France comme le meilleur gage de celle de son gouvernement sur ce négociant, fut contrarié de voir ce gage diminué chaque jour par les paiements opérés au profit des créanciers français.
Il crut ou affecta de croire que tous n'avaient pas eu lieu de bonne foi. Cette opinion a été partagée par d'autres personnes en France et en Afrique.
Il était donc possible que les nombreuses réclamations que le Dey éleva contre le monde de liquidation de la créance Bacri ne fussent pas sans fondement. "
Les auteurs qui écrivaient peu après la conquête nous montraient aussi le Bacri sous des couleurs plus vives que celles des écrivains de maintenant.
Citant M. Labbey de Pompières, Galibert dit : " Sous la République, le juif Jacob Bacri nous avait fait diverses fournitures de blé.
S'il faut en croire M. Labbey de Pompières, la maison Busnach et Bacri vendait à la France des blés qu'elle embarquait en Barbarie sur des bâtiments neutres.
Des corsaires prévenus à temps enlevaient les navires à leur sortie du port et les ramenaient à Alger ou à Gibraltar.
Là, les blés étaient rachetés à bas prix par les Bacri qui les revendaient à la France. Alors ils arrivaient à Toulon tellement avariés qu'on était obligé de les jeter à la mer pendant la nuit.
Le 15 février 1808, les Bacri reçurent en paiement du ministre de la marine, M. Pléville de Pelley, une somme de 1.580.518 francs, et, en outre, des munitions navales de toute espèce en grande quantité ; mais ce n'était là qu'un faible acompte, car ils portaient le chiffre total de leur créance à 14 millions.
Les Bacri imaginèrent donc de faire appuyer leurs réclamations par un de leurs commis qu'ils firent passer pour un ami du Dey et pour le frère de l'une de ses femmes. Ce commis, Simon Aboucaya, avait pris rang parmi les ambassadeurs.
Il allait chez les ministres, dans leurs bureaux et menaçait tout le monde de la colère de son prétendu beau-frère, lorsque, reconnu dans le jardin de Tortoni, il fut enfermé au temple avec Jacob Cohen Bacri, son maître ; on les mit quelque temps après en liberté. L'affaire était assoupie et les demandes parurent abandonnées. "
N'est-ce pas délicieux, l'aventure du commis Simon Aboucaya faisant bruit dans les bureaux pour le Dey ?...
M. Labbey de Pompières tendrait à faire croire qu'on ne devait rien au Dey, que le Dey ne réclamait point, qu'il y avait simplement créance Bacri… Erreur.
Feraud, dans son histoire des villes de la province de Constantine, a cité beaucoup de pièces prouvant le contraire.
C'est dans son ouvrage que j'ai noté que le Dey Baba Hussein prêta sans intérêt cinq millions au Directoire, que Bacri remit à Marseille, aux représentants du peuple, une lettre du Dey qui recommandait son commissionnaire à leur bienveillance, que dans la lettre de Bonaparte au Dey portée par Hulin avec la menace d'un bombardement, il y avait : " Je vous fais également connaître mon indignation sur la demande que vos ministres ont osé faire, que je paie 200.000 piastres fortes. Je n'ai jamais rien payé à personne… "
Payer n'était pas le propre de Bonaparte. Le Dey se le tint pour dit. Il écrivit : " Vous ne m'avez pas voulu donner deux cent mille piastres fortes que je vous avais demandées pour me dédommager des pertes que j'ai subi pour vous ; que vous me les donniez ou que vous ne me les donniez pas, nous serons toujours bons amis… "
En effet… un des Bacri, mis pour cette affaire en prison par le Dey, la famille paya cinq cent mille piastres fortes.
L'histoire la plus complète qu'on ait publié, je crois, sur l'affaire Bacri est de M. Pierre Vias : Incidents qui ont précédé la conquête d'Alger (Alger 1895).
Dans cette brochure nous voyons l'affaire se précise. La voici résumée en quelques notes :
" La paix d'Amiens avait mis fin aux hostilités avec l'Angleterre et la Porte, et un cadeau d'un million ayant été fait à Moustapha qui était aussi cupide que son oncle Hussein était désintéressé et chevaleresque, un traité fut signé et ratifié le 17 décembre 1801.
Ce traité nous rendait nos anciens avantages de la convention de 1628.
En échange le gouvernement s'engageait à payer 60.000 francs par an et à solder les créances Busnach et Bacri.
L'article 13 du traité disait : " Son Excellence le Dey s'engage à faire rembourser toutes les sommes qui pourraient être dues à des Français par ses sujets, comme le citoyen Dubois-Thainville prend l'engagement, au nom de son gouvernement, de faire acquitter toutes celles qui seraient légalement réclamées par des sujets algériens. "
Dans une lettre du 13 août 1802 au consul, Moustapha insistait sur le paiement de ces créances : Faites-moi le plaisir de donner des ordres pour faire payer à Bacri et à Busnach ce qui est dû par votre gouvernement ; une partie de cet argent m'appartiens et j'attends d'être satisfait comme me l'a promis votre Dubois-Thainville. …"
En 1817 on décida à régler MM. Monnier et Hély d'Oissel, conseillers d'État discutent avec M. Nicolas Pléville, ancien directeur de la caisse d'escompte, fondé de pouvoirs des héritiers Busnach et Bacri… Ceux-ci réclamaient 13.893.844 francs.
Talleyrand s'en était mêlé…Il y avait eu accord le 28 octobre 1814 sur sept millions… Il y a dans les préliminaires de la convention un passage suggestif : " Considérant que, s'il est dans l'intérêt du gouvernement français de terminer par un arrangement à l'amiable toute contestation avec la régence d'Alger, il n'est pas moins dans l'intérêt de MM. Bacri et Busnach d'éviter par la réduction de leurs prétentions les retards qu'entraîneraient une liquidation régulière et la nécessité de produire des pièces justificatives que l'éloignement des temps et des lieux rendraient difficiles à réunir … " On ne s'occupe point du Dey. Tous les intérêts furent sauvegardés sauf les siens…
On les invoqua seulement devant les Chambres pour obtenir le vote de 7 millions, mais on ne l'avisa de rien….
On avait spécifié par l'article 14 : il est bien entendu que sur la somme à délivrer le Trésor royal retiendra le montant des oppositions et transports de créances signifiés audit Trésor.
On accepta des créances présentées par des " tiers " à qui elles avaient été :
- cédées, vendues, transportées.
On retint pour être provisoirement versés à la caisse des dépôts et consignations, deux millions et demi, et quatre millions et demi furent remis à Bacri et Busnach. Ceux-ci ne donnèrent rien au Dey, ne reparaissent plus à Alger. Le Dey réclame les deux millions et demi de la caisse des dépôts, plus deux millions qu'il affirmait avoir été donnés à Deval, plus l'extradition de Bacri et Busnach.
On ne lui donna pas satisfaction… C'est la loi française… Il n'a pas légalement signifié son opposition…Toutes les lettres du gouvernement d'Alger, depuis des années, ne comptent pas, il fallait huissier, avoué etc…etc… Quant à Busnach, il n'est plus algérien, mais naturalisé français. Quant à Bacri, il vit à Livourne…et c'est le coup d'éventail. "
On a vu apparaître en l'affaire deux grands personnages : Bonaparte et Talleyrand. Cela avait piqué ma curiosité.
J'aurais voulu " dépouiller " les archives du consulat de France pour les années indiquées. Mais voici ce que j'ai lu dans la préface d'un manuscrit d'extraits de ces archives par Devoulz, à la bibliothèque municipale d'Alger.
Devoulz avait publié un volume d'extraits de ces archives. A sa mort ses copies, non publiées, furent remises à la mairie. Donc en sa préface, j'ai lu : " Les deux registres qui ont reçu les actes de chancellerie pendant la période comprise entre le 14 mai 1789 et le 5 mars 1811 ne font plus partie des archives du consulat.
On ignore leur sort. C'est là une lacune fort regrettable.
Cette disparition est d'autant plus surprenante qu'elle ne saurait être fort ancienne. Les deux registres dont il s'agit existaient encore en 1861 lorsque j'ai pris connaissance, sans déplacement des archives du consulat alors déposées chez Me Martin, notaire ".
Cela est regrettable, car les Bacri et Busnach en discussion dès les premiers jours sur les bénéfices de la célèbre affaire pour établir leurs droits respectifs donnaient à l'enregistrement du consulat leurs pièces importantes…
Il est même, comme le dit Devoulz, curieux que ces registres intéressants aient disparu… Les disparitions de ce genre ne sont d'ailleurs le fait ni d'une époque, ni d'une colonie. Alger en eut sous le gouvernement de M. Revoil.
A Paris, M. Jonnart m'avait parlé de dossiers caractéristiques sur l'histoire de l'antisémitisme et qu'il avait consulté lors de son premier voyage au gouvernement général.
A Alger je lui ai demandé l'an dernier s'il me serait possible de consulter ces dossiers. - Impossible…
Cependant…je suis discret … et ce qui est confidentiel je ne le publierais point.
Mais ils devaient me donner le caractère essentiel du mouvement…
Ils n'existent plus. M. Jonnart est franc. Ces dossiers qui desservaient les chefs de l'antisémitisme ont donc disparu entre ces deux passages au gouvernement général…
En 1861, le gouvernement de l'Algérie préparait la naturalisation des Israélites. Or les registres qui ont disparu contenaient des pièces désagréables pour les Juifs et sur un sujet peu connu ; désagréables aussi pour les associés de Bacri.. etc..
Je ne tire pas de conclusion. Je rapproche des faits.
Les archives de 1819 contiennent la transcription d'une pièce que Deval envoya en France ; c'était une déclaration du Dey affirmant que Jacob Bacri et le consul Deval avaient comparu devant lui, Bacri avait accepté la transaction avec le gouvernement français.
Il y avait dans la transmission de cette " singulière " pièce en France un joli " tour " permettant d'affirmer à Paris que le Dey approuvait, qu'on pouvait payer Bacri… Ce qui d'ailleurs fut fait… et remplit de colère le Dey ainsi roulé par Deval.
Il faut citer intégralement cette page de chancellerie :
" 24 décembre 1819. Acquiescement de Jacob Cohen Bacri à l'arrangement conclu relativement à ses créances sur le gouvernement français et enregistrement d'une déclaration de Hussein pacha Dey à ce sujet.
Bacri présente une déclaration originale en langue arabe donnée par son Altesse Hussein pacha Dey de la milice et régence d'Alger, portant que, conformément à la transaction conclue entre MM. Les commissaires du Roi et le fondé de pouvoirs du comparant et du sieur Michel Busnach, son associé, ledit comparant est content et satisfait… et par ampliation nous aurait requis l'enregistrement de ladite déclaration en langue arabe, de Son Altesse Hussein Dey et de sa traduction en langue française qu'il nous aurait demandé…
Traduction : louange à Dieu…
Quiconque aura lu le diplôme saura que notre serviteur et sujet Jacob Bacri est venu à nous, et avec lui le consul de France qui réside dans notre pays, et qu'eux deux étant en notre présence, notre dit serviteur Jacob Bacri aurait dit et déclaré qu'il approuve tout ce qu'a fait son procureur qui est en France avec eux des commissaires du gouvernement en vertu d'un traité authentique et pour les valeurs et quantités convenues et spécifiées, qu'il est satisfait de la transaction qui a été faite pour tous les objets qui sont mentionnés et que, si on lui paye et remet tout ce qui a été convenu, alors ils seront acquittés de tout ce qui est mentionné dans ladite transaction et il ne restera plus entre eux aucun motif de prétention ni de réclamation…
Le présent diplôme a été écrit avec l'assentiment du magnifique Hussein.
Le chancelier ajoute que Bacri remet cette déclaration au consul Deval pour qu'elle soit transmise au gouvernement français. "
Cela explique la colère d'Hussein qui, écrivant ensuite directement au gouvernement français pour être renseigné, ne recevait pas de réponse et s'entendait dire par Deval l'insulte rapportée par Sidi Hamdan et plus haut citée.
Le lecteur est assez intelligent, j'espère, pour voir maintenant la belle opération Bacri-Deval. Bacri avait le consul.
Il avait eu mieux. Il avait eu Bonaparte et Talleyrand.
Cela est dit dans des pièces enregistrées le 8 août 1821 à la chancellerie du consulat d'Alger pour la parution d'un billet de 15.000 piastres fortes dues à son défunt frère Abraham Cohen Bacri par Jacob Cohen Bacri " chef de la nation hébraïque. "
Au billet fixant la créance et fait à Marseille en 1797 étaient jointes deux lettres de 1803, 12 décembre, Livourne, et de 1804, 5 juillet, Marseille.
L'intérêt de ces lettre, qui nos montre bien vivants les protagonistes des évènements auxquels nous devons Alger, me les fait citer in extenso. (Publiées par ailleurs)
Rien ne vaut de tels documents pour que l'on voie une époque.
Tous les commentaires, seraient-ils d'un écrivain ayant le génie d'un Michelet, pâlissent devant la lumière qui sort de telles pièces.
La vérité sur l'Algérie par Jean Hess. Édition 1905.
|
|
| L'étrangère...magnifique !....
Envoyer par Mme Eliane
| |
Quelques années avant ma naissance, mon père connut une étrangère récemment arrivée dans notre village.
Depuis le début, mon père fut subjugué par cette personne, si bien que nous en arrivâmes à l'inviter à demeurer chez nous. L'étrangère accepta et depuis lors elle fit partie de la famille. Moi je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où elle venait, tout me paraissait évident. Mes parents étaient enseignants : ma maman m'apprit ce qu'était le bien et ce qu'était le mal et mon père m'apprit l'obéissance.
Mais l'étrangère, c'était une conteuse, une enjôleuse.
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.
Elle connaissait tout du passé, du présent, elle aurait presque pu parler du futur !
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.
Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer.
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles.
Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité
(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aille).
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis.
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman.
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent.
Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes et cigares faisaient distingué.
Elle parlait librement (peut-être trop) du sexe.
Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adolescence.
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là !
Des dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel.
Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'avons plus cette fascination.....
Il n'empêche que, si vous pouviez, pénétrer chez mes parents,
Vous la retrouveriez quand même dans un coin, attendant que quelqu'un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre…
Voulez-vous connaitre son nom ?
Nous, nous l'appelons… Télévision !!!!!
Il faudrait que cette belle histoire soit lue par tout le monde.
Attention :
Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur…
Un fils qui s'appelle Portable…
Une fille qui s'appelle Tablette…
Et un neveu pire que tous, Lui c'est Smartphone …
Et ils se lient tous ensemble pour nous éloigner les uns des autres !!!!!!
|
|
|
| Domination vandale (429-533 de J.C)
Envoi de M. Christian Graille
|
Partis des rives de la Baltique bien avant l'ère chrétienne, les Vandales s'étaient répandus d'abord dans la Haute Allemagne.
Convertis au christianisme en Pannonie (ancienne région de l'Europe centrale à cheval sur l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie), ils embrassèrent bientôt l'hérésie d'Arius (théologien) et le fanatisme avec lequel ils adaptèrent les doctrines de cette secte devint pour les catholiques orthodoxes qu'ils rencontraient sur leur passage une cause incessante de cruautés et de persécutions.
En 406, ils firent irruption dans les Gaules d'où ils passèrent en Espagne. Inquiétés dans cette dernière province par :
- les Suèves (peuple germanique)
- les Visigoths ( peuple germanique) et
- les Romains,
Les nouveaux envahisseurs avaient déjà plus d'une fois tourné leur regard vers cette terre d'Afrique si renommée par sa fertilité et dont ils ne pouvaient presque, au-delà du faible détroit qui les en séparait, apercevoir les villes florissantes ; aussi acceptèrent-ils avec empressement les offres de Boniface (général romain).
Quoique la province d'Afrique eut suivi le mouvement de décadence imprimé à l'empire, sa population était encore considérable : ses exportations :
- en grains, en huile, en fruits,
- en marbre précieux, n'avaient point diminué.
Carthage méritait toujours le surnom de la Rome africaine par :
- la magnificence de ses édifices (une de ses rues que l'on appelait la rue céleste était remplie de temples magnifiques ; une autre, celle des Banquiers, étincelait de marbre et d'or),
- l'étendue de ses murailles,
- la multitude de ses habitants .
- Hippone,
- Utique, (ville située à proximité de Carthage),
- Cirta,(capitale de la Numidie)
Présentaient quoique dans de moins vastes proportions, le même spectacle de luxe et de richesses.
Boniface, il est vrai, n'avait point promis aux Vandales ces opulentes cités.
Il ne leur cédait que la partie la moins civilisée du pays ; mais ces barbares n'étaient pas disposés à se contenter longtemps de leur partage.
C'est avec Gonderic (roi des Vandales 379-428 après J.C) que Boniface avait contracté ce pacte funeste ; ce fut avec Genséric (Ghenderic ou Ghiserck) qu'il l'exécuta.
Ce changement de personnes allait devenir fatal aux Romains.
A un prince médiocre avait succédé un des plus redoutables génies qu'ait produits le monde barbare.
Le portrait physique et moral de cet homme trop célèbre nous a été conservé par Jornandès (historien de langue latine, auteur d'une histoire des Goths).
Sa taille était médiocre, dit cet historien, et semblait presque difforme, parce qu'il boitait des suites d'une chute de cheval ; mais ce corps petit et contrefait renfermait une ambition démesurée.
Doué d'un courage brillant et d'une dissimulation profonde, il méprisait le luxe et haïssait la débauche ; bref, dans ses discours, prompt dans ses actions, la colère était la seule de ses passions qu'il ne sut pas réprimer. Tout en lui avait cette grandeur sauvage qui étonne et subjugue l'imagination. Sa renommée devint bientôt la plus sûre de ses armes.
Par elle il agitait les peuples placés dans le vaste rayon où l'action incessante de son ambition se faisait sentir, et jetait habilement de tous côtés :
- des semences de trouble et d'effroi,
- de division et de haine.
Les projets qu'il avait arrêtés, il les exécutait en moins de temps que d'autres n'eussent mis à les concevoir.
Tel était le dangereux allié que le comte Boniface avait appelé en Afrique.
Les préparatifs de départ des Vandales furent bientôt achevés. Genséric fit dénombrer la nation assemblée au pied du mont Calpé (Gibraltar) ; elle s'élevait à quatre-vingt mille hommes, traitant à leur suite un grand nombre de femmes et d'enfants. Parmi eux se trouvaient aussi :
- des Goths ( peuple germanique à 2 branches : les wisigoths et les Ostrogoths),
- les Alains (peuple iranien)
- et d'autre barbares qui s'étaient associés à leur fortune.
Toute cette multitude traversa le détroit sur des vaisseaux en partie fournis par Boniface, ne laissant que son nom (Andalousie, Vandalousie) à la belle province de la péninsule qu'ils avaient possédée.
Débarqués en Afrique, ils saccagèrent impitoyablement toute la côte de la Maurétanie. Puis s'avançant lentement, mais sans s'arrêter, vers la Numidie, ils mirent à découvert les intentions secrètes de leur chef, qui ne rêvait que de la possession de Carthage.
Malgré leurs dévastations, grâce à l'habileté de Genséric, les Vandales virent bientôt accourir autour d'eux une multitude d'auxiliaires :
- les Ariens (partisans niant la divinité du Christ),
- les Donatistes (qui adoptent une doctrine),
- les Maures et surtout
- les Gétules ne tardèrent pas à faire cause commune avec eux.
Le gouverneur romain sentit alors, mais trop tard, qu'en appelant de tels alliés à son secours, il s'était donné des maîtres.
Boniface s'était expliqué avec Placidie : Tous deux avaient reconnu l'erreur mutuelle où ils avaient jeté la fourberie d'Aétius.
Déchiré de remords et excité par son ami l'évêque d'Hippone, le comte essaya de réparer les maux qu'il avait attirés sur l'Afrique.
Mais Genséric avait étreint sa proie. Rien ne pouvait le décider à l'abandonner.
En vain Boniface lui offrit-il des sommes immenses pour l'engager à repasser en Espagne ; en vain le menaça-t-il de ses armes, l'orgueilleux Vandale repoussa dédaigneusement ses promesses et ses menaces, et reprochant avec hauteur à celui qui l'avait appelé son manque de foi, il le força à combattre.
Malheureusement la voie des armes offrait peu de chance de succès au repentir de Boniface ; il disposait bien des garnisons romaines mais les populations divisées par les discordes religieuses, lui étaient pour la plupart hostiles :
- l'approche de l'ennemi ne fit que redoubler la fureur des partis.
- Les sectaires favorables aux envahisseurs paralysaient les efforts des catholiques.
- Une foule de sauvages demi-nus sortaient comme toujours des déserts et des forêts du grand Atlas pour assouvir leur vengeance sur ceux qu'ils nommaient les usurpateurs de leur terre natale.
- Tout se réunissait en ce moment pour enlever aux empereurs romains l'Afrique civilisée.
Le tableau que les écrivains contemporains ont tracé des malheurs de ce pays est si affreux qu'on l'a accusé d'exagération.
Leurs plaintes ne sont cependant que trop réelles ; que ne devait-on pas attendre de la rage destructive des Vandales et des Maures réunis !
Vainqueurs dans une première bataille contre Boniface, qui n'avait à leur opposer qu'un petit nombre de vétérans, ils se répandirent comme un torrent dans toute la province.
Partout où ils trouvaient la moindre résistance, ils ne faisaient aucun quartier ; la mort d'un seul des leurs était toujours vengée par la destruction des villages, des villes devant laquelle il avait perdu la vie.
Ils faisaient subir à leurs captifs, sans distinction :
- de sexe, d'âge, ni de rang,
Les plus cruelles tortures pour arracher d'eux des renseignements sur les trésors qu'ils prétendaient leur être cachés.
On vit dit-on maintes fois les Vandales, lorsqu'ils assiégeaient une ville, massacrer leurs prisonniers en masse au pied des murailles afin que l'infection produite par ces cadavres portât la peste dans l'intérieur.
Une telle atrocité donne l'idée de celles qui furent commises dans tout le cours de cette guerre d'extermination.
Après sa défaite Boniface s'était jeté sur Hippone. Il y fut bientôt assiégé. Les Vandales qui voyaient en lui le seul obstacle à leurs desseins, s'opiniâtrèrent au siège de cette ville et l'investirent si étroitement que la famine ne tarda pas à s'y déclarer.
Ces rudes épreuves ne servirent qu'à mettre en lumière le dévouement et le courage de l'illustre évêque d'Hippone. Quoique fortement avancé en âge, il ne cessa de déployer dans l'exercice de son ministère toute l'énergie d'un jeune homme. Chaque jour, du haut de la chaire épiscopale :
- il prêchait le courage aux soldats,
- la charité aux riches,
- la patience aux pauvres,
- la constance à tous.
Pour lui, il ne demandait à Dieu que de cesser d'être le témoin des malheurs qui accablaient son troupeau. Ses vœux furent exaucés. Dans le quatrième mois du siège, accablé d'inquiétudes et de soins, il expira.
Le cœur déchiré par les maux de son pays et les yeux attachés sur cette cité céleste dont il venait d'écrire la merveilleuse histoire. Augustin fut le dernier grand homme de l'Afrique et le seul dont le nom soit demeuré dans la mémoire de ces peuples.
Les Maures d'aujourd'hui ignorent l'existence :
- des Massinissa, (roi numide berbère 238-148 avant J.C)
- des Jugurtha, (Roi numide 160-104 avant J.C)
- des Juba. (Dernier roi de Numidie orientale 85-46 avant J.C) Le grand nom d'Annibal lui-même est inconnu de la plupart des indigènes, mais tous savent qu'Augustin fut un ami de Dieu et des hommes.
Si douloureuse qu'elle fut pour les assiégés, cette perte n'abattit point leur courage. Ils continuèrent à se défendre avec une persévérance digne d'un meilleur sort.
Un instant ils crurent leur délivrance assurée : Après avoir ravagé tous les environs, les Vandales, pressés par la famine, s'éloignèrent.
Presque au même moment un puissant secours, envoyé à Placidie par l'empereur d'Orient Théodose II, arriva de Constantinople. Boniface :
- sortit d'Hippone,
- opéra sa jonction avec les Byzantins et
- marcha droit sur les Vandales.
Le sort de l'Afrique fut de nouveau lié aux hasards d'une bataille. Les Romains la perdirent. Boniface reçut les malheureux habitants d'Hippone sur ses navires et s'éloigna avec eux. Les Vandales, maîtres de la ville abandonnée, la réduisirent en cendres.
L'église de Saint Augustin fut seule épargnée.
Par une providence toute particulière à laquelle nous devons la conservation de la plupart de ses manuscrits, sa bibliothèque échappa aussi à ce grand désastre.
La victoire de Genséric ne porta pas immédiatement tous ses fruits.
La longueur du siège d'Hippone avait fatigué les Vandales, et Boniface, malgré sa défaite, était encore en état de défendre Carthage.
Montrant donc une modération inattendue, Genséric, au lieu de poursuivre la conquête de l'Afrique entra en négociation. Il parut vouloir se contenter des provinces qu'on lui avait cédées et consentit à reconnaître par un tribut la suprématie de l'empereur d'Occident, offrant, pour garantie de ses promesses, de nombreux otages, parmi lesquels se trouvait son propre fils Hunneric.
Ces propositions furent acceptées avec empressement par la cour de Ravenne et par Boniface qui n'aspirait qu'au moment de se venger d'Aétius (432).
En effet, à peine libre de quitter l'Afrique, il passa en Italie pour aller combattre son rival dans les plaines de la Cisalpine mais il mourut dans cette expédition, à la suite d'une brillante victoire et Genséric se vit ainsi débarrassé du seul homme capable de lui disputer sa conquête.
La mort de Boniface amena de nouvelles concessions de la part du faible Valentinien qui rendit à Génésic son fils et lui céda plusieurs districts de la Numidie. A ce prix le reste des possessions romaines put jouir de quelques années de repos. Le Vandale en profita pour consolider sa puissance car il avait à craindre à la fois de la haine qu'inspiraient aux catholoques africains un maître arien, et les complots de ceux qui voulaient rendre la couronne aux enfants de Gondéric, ce frère que lui-même avait remplacé sur le trône après l'avoir, dit-on, assassiné.
Pour mieux assurer son repos Genséric fit :
- tuer ses neveux,
- noyer leur mère dans l'Ampsaga (la rivière El-Kébir) et
- massacrer tous leurs partisans.
Certains que les catholiques embraseraient toujours contre lui, la cause de l'empire, il résolut d'étouffer le catholicisme par la terreur ; et pour atteindre ce but, il enjoignit aux évêques d'abjurer leur religion.
Sur leur refus, il les chassa de leurs églises et les remplaça par des Ariens (437).
Les supplices suivirent de près.
Afin d'inspirer plus d'effroi, Genséric choisit ses premières victimes dans sa propre maison, parmi ses amis et ses serviteurs.
Les historiens profanes et ecclésiastiques nous ont conservé d'affreux détails sur leurs cruautés.
- Les biens des victimes, leurs charges,
- leurs honneurs furent distribués aux bourreaux.
Il n'y eu bientôt plus d'asile assez caché, de retraite assez profonde pour dérober à la mort les confesseurs de la foi catholique.
Cependant le répit accordé par Genséric à l'empire ne pouvait être de longue durée. La possession de Carthage, et par elle, la domination de la Méditerranée, était le grand but de son ambition.
Pendant quatre ans il s'était appliqué à inspirer aux Romains une aveugle sécurité. Quand tout à coup, réunissant ses forces,
- il entre brusquement dans la province romaine,
- marche droit à la capitale,
- la surprend sans défense et s'en empare.
Ce fut le 20 octobre 439 que les Vandales, ministres des châtiments tant de fois annoncés à cette ville corrompue, entrèrent dans Carthage.
Les habitants eurent ordre de livrer aux vainqueurs :
- leur or, leur argent et tous les objets précieux.
Toutefois, afin de se rattacher les nomades païens et les paysans donatistes,
Genséric usa envers eux de ménagement ; mais il traita avec rigueur les villes où le catholicisme et les mœurs romaines étaient les plus vivaces et en fit démolir les murailles pour les contenir plus sûrement : Carthage seule conserva des fortifications.
(parmi les mesures que prit Genséric, il en est de très singulières et de très caractéristiques.
Il força les courtisanes dont le grand nombre attestait la dépravation des mœurs africaines à se marier et ferma les maisons de prostitution.
Ces Barbares du Nord associaient à leur farouche violence une chasteté qui leur a valu les louanges des écrivains ecclésiastiques malgré l'horreur de ceux-ci pour l'arianisme. La différence de religion fut le plus puissant obstacle que rencontra la domination vandale ; autrement Genséric eût pu être accepté en Afrique par les populations civilisées comme Clovis le fut en Gaule ; mais il éleva une barrière sanglante entre lui et les orthodoxes.
Beaucoup de personnes notables émigrèrent ou se laissèrent condamner à l'exil ou aux mines plutôt que d'apostasier.
Le reste des catholiques, épuré par le malheur, n'en devint que plus hostile aux conquérants. Carthage avait vu avec stupeur son évêque et presque tout son clergé jetés nus dans de vieux vaisseaux désemparés, livrés sans vivres à la merci des vents et des flots, qui par un bonheur inespéré les portèrent sains et saufs à Naples.
L'exercice public de leur religion fut interdit aux catholiques. Les cérémonies sacrées, même celles des funérailles furent absolument défendues. De nombreuses églises qui décoraient la Rome africaine, les unes furent données aux Ariens, les autres, en plus grand nombre, furent incendiées.
De Carthage les fureurs de Vandales s'étendirent sur les cinq vastes provinces dont elle était la métropole. Les dévastations y furent immenses.
La persécution ne se ralentit qu'au bout de plusieurs années : le catholicisme finit par être toléré, mais il fut toujours soumis à de nombreuses restrictions. "
Enfin la population vandale, à l'exception de quelques garnisons, évacua les Maurétanies pour se concentrer sur la région carthaginoise : le choix de cet établissement au centre des côtes qui baignent la Méditerranée, prouve l'intelligence politique du conquérant.
A la nouvelle de la prise de Carthage, Rome et Byzance furent frappées de stupeur ; ces deux capitales croyaient déjà voir les Vandales à leurs portes.
Aussitôt toutes les garnisons de la Gaule furent rappeler en Italie.
- On répara les murailles des villes fortifiées,
- on exhorta tous les habitants à prendre les armes.
Genséric ne se laissa pas effrayer par ces vaines démonstrations ; tandis qu'on organisait à Rome des moyens de défense, il s'empara de la Sicile et jetait en Calabre un corps d'armée.
Ce fut alors seulement que Théodose songea à venir au secours de l'empire d'Occident.
Une flotte nombreuse, portant trente mille hommes de débarquement mit à la voile de Constantinople (441) et aborda en Sicile sous la conduite de plusieurs généraux, Genséric eut recours à la ruse pour écarter le danger.
Il députa vers les chefs byzantins et leur fit proposer d'attendre dans cette île le retour des ambassadeurs qu'il allait envoyer à Constantinople pour traiter de la paix avec l'empereur. Cette proposition fut acceptée.
Mais il sut traîner les négociations en longueur, et rien n'était encore conclu, lorsque Attila, secrètement sollicité par lui, entra dans les États de Théodose à la tête de ses formidables Huns et le força de retirer ses troupes de la Sicile.
Les généraux de Théodose signèrent avec Genséric une paix honteuse, par laquelle ils validèrent les conquêtes des Vandales en Afrique (442).
Dès ce moment celui-ci ne s'occupa plus que d'organiser une puissante armée de terre et de mer pour l'accomplissement des projets qu'il méditait depuis longtemps. Enfin, après six siècles de stagnation, le port de Carthage vit de nouveau ses nombreux vaisseaux s'élancer sur la Méditerranée.
Une ivresse sauvage entraînait les Vandales sur les mers.
On raconte qu'un jour, prêt à mettre la voile, le pilote demanda à Genséric où il fallait aller : " Où Dieu nous poussera ! " répondit-il.
Toutefois en 455, le roi barbare savait bien où Dieu le poussait.
Aétius, le seul homme qu'il redoutât encore venait de mourir assassiné par Valentinien, et Valentinien tombait à son tour sous les coups du sénateur Maxime dont il avait déshonoré la femme.
Après le meurtre de son maître Maxime, par un raffinement de vengeance, avait forcé sa veuve à l'épouser. Eudoxie, dans son désespoir appela secrètement Genséric et lui révéla le désordre qui régnait dans Rome depuis l'usurpation de son nouvel époux. Celui-ci ne se fit point attendre.
Débarqué à l'embouchure du Tibre , il marcha sur Rome et y entra presque sans combat. En effet, à la nouvelle de son débarquement, Maxime venait d'être massacré par le peuple et par les soldats, après un règne de trois mois.
L'ancienne capitale du monde civilisé, la reine des nations, comptait encore de nombreux habitants, mais n'avait plus de citoyens.
Pour la seconde fois elle ouvrit ses portes aux Barbares.
Touché de respect, saisi d'une émotion inexprimable, en présence de cette grande infortune, Aléric avait préservé sa conquête du pillage.
Genséric, au contraire fut sans pitié. Rome vit :
- ses édifices profanés,
- ses maisons livrées aux flammes,
- ses habitants égorgés ou traînés en esclavage,
- les trésors de l'église et de l'empire,
- les chefs d'œuvres des Arts,
- les statues des Dieux, monuments de son ancienne grandeur, furent mutilés et transportés pêle-mêle sur les vaisseaux africains.
Gorgés d'or et de sang, les Vandales reprirent la route de l'Afrique mais avant de se rembarquer ils visitèrent les villes de la côte des bouches d'Ostie au cap d'Antium (une des principales villes du Latium) ; ils n'y trouvèrent plus les riches possesseurs ; tous avaient fui ; leurs dépouilles allèrent rejoindre celles de Rome sur les galères de Genséric.
Le vainqueur n'épargna point celle qui l'avait appelé en Italie : l'impératrice Eudoxie figura parmi les captifs emmenés en Afrique.
Deux filles qu'elle avait eues de Valentinien partagèrent son sort. Ces trois femmes étaient le seul reste de la famille du grand Théodose. La pitié publique suivit les jeunes princesses dans leur captivité, à laquelle la politique de Genséric mit bientôt un terme : L'aînée devint la femme de Hunneric, son fils.
Peu de temps après la seconde fut envoyée avec sa mère à Constantinople.
Le sac de Rome qui retentit dans toute l'Europe comme le signal de la destruction de l'empire d'occident, valut à Genséric, non seulement des richesse prodigieuses, mais lui procura encore un grand nombre de bâtiments, et des matériaux de toutes espèces pour ses constructions navales et ses armements.
La prise de cette capitale donnait en outre à son ascendant moral une force irrésistible.
Après le formidable Attila, le Vandale apparut à l'esprit des peuples comme le héros du monde barbare ; et il sut habilement tirer parti de ce prestige, car, dans l'espace de quelques mois, toute l'Afrique septentrionale, depuis l'océan jusqu'à la grande Syrte, reconnut sa domination.
- Il subjugua la province de Tripoli, puis envahit successivement les îles de la Méditerranée :
- les Baléares,
- la Sardaigne,
- la Corse et
- une partie de la Sicile.
Il était devenu le véritable empereur d'Occident.
Pendant que Genséric travaillait à organiser son empire (Suivant Procope ce n'est qu'après le sac de Rome que Genséric aurait commencé à régulariser son établissement en Afrique ; c'est donc ici le lieu de parler de l'organisation intérieure de l'empire des Vandales.
Des pays que Genséric acquit par la paix qu'il fit en 442 ave Valentinien, il garda pour lui la Bysacène, la Gétulie (ancienne région de l'Afrique du Nord au Sud de la Numidie et de la Maurétanie) et la partie de la Numidie que l'empereur romain lui avait cédée.
Il abandonna la proconsulaire ou la Zengitane à ses guerriers, et en partagea les terres héréditairement entre eux.
Quant aux contrées dont le roi vandale fit la conquête après la paix de 442, elles restèrent toutes au prince.
Ainsi les Vandales ne possédaient qu'une très petite partie des terres de l'empire, mais ces terres étaient les plus fertiles du pays. Elles s'étendaient le long de la mer, depuis le promontoire de Mercure (aujourd'hui Cap-Bon) jusqu'à l'embouchure du fleuve Tusca (aujourd'hui Zaïne) ; au milieu une ligne tirée parallèlement à l'équateur par Pusput, bourgade située autrefois près de l'extrémité Nord-Ouest du golfe d'Hammamet séparait la proconsulaire ou Zengitane, province vandale, de la Bysacène, province du prince.
Cette dernière comprend ordinairement tous les pays qui bornent au Sud de la rivière Zieg et le lac de Loudéa ; la province d'Abaritane était située sur les deux rives du Bagradas (aujourd'hui Mégerda) et du côté de Théveste (aujourd'hui Téfas).
La partie de la Numidie que Valentinien céda à Genséric en 442 était confinée entre la rivière Wad-el-Bul qui reçoit le Mégerda et le fleuve Zaïne qui sépare le territoire d'Alger de celui de Tunis.
Lorsque l'empire des Vandales prit par la suite plus d'extension en Afrique, toute la Numidie, les Maurétanies et la Tripolitaine faisaient partie des provinces du prince. Genséric, dit Procope, divisa les Vandales et les Alains en quatre-vingts cohortes et donna à chacun un chef. Il appela ces chefs chiliarques ou commandants de mille hommes pour faire croire qu'il avait avec lui une armée de quatre-vingt mille soldats ; mais le corps d'expédition des Vandales ne dépassait pas certainement les 50.000 combattants.
Plus tard, il est vrai, ce nombre s'augmentera prodigieusement tant par l'accroissement naturel des familles vandales que par l'union des vainqueurs avec les barbares indigènes car tous ceux qui n'étaient pas exclusivement maures se confondirent bientôt avec la race vandale.
Cette organisation féodale dit assez que les Vandales se regardaient non seulement comme formant un nation mais aussi comme les membres d'une grande armée permanente.
- Le roi était le commandant en chef de cette armée,
- les comtes, ou chefs de plusieurs milliers d'hommes,
- les chiarques, chefs d'un millier d'hommes,
- les centurions, ou chefs de cent hommes et
- les Décurions, ou chefs de dix hommes, composaient en même temps la magistrature civile
Et à l'étendre par de nouvelles conquêtes, l'héroïque Majorien, le dernier Romain véritablement digne de ce nom, en recevant la pourpre à Ravenne, avait formé le noble dessein d'arracher l'Afrique aux Vandales.
Une première bataille gagnée par lui sur le beau-frère de Genséric, dans les plaines de la Campanie, l'encouragea à poursuivre cette entreprise sans le concours des populations romaines, beaucoup trop énervées pour le seconder efficacement.
Les barbares auxiliaires composèrent presque seuls l'armée avec laquelle Majorien tenta de sauver l'empire de sa ruine. Vingt peuples divers :
- Gépides (peuple germanique proche des Goths),
- Ostrogoths (partie de la population appartenant au peuple des Goths, l'autre partie étant composée de Wisigoths),
- Rugiens (peuple slave vivant dans le Nord-Est de l'Allemagne),
- Bourguignons,
- Alains (peuple iranien) et
- Suèves (peuple vivant en Tchécoslovaquie, en Bohême, en Moravie et en Silésie)
Accoururent à son appel et s'assemblèrent dans les plaines de la Ligurie.
L'empereur passe les Alpes au cœur de l'hiver,
- s'empare de Lyon,
- bat Théodoric, roi des Visigoths,
- soumet les Bagaudes (bandes armées de paysans sans terre, d'esclaves, de soldats déserteurs, de brigands) et
- rétablit l'ordre dans la Gaule bouleversée.
L'Espagne aussi s'incline une dernière fois devant les aigles romains.
Arrivé à Carthagène Majorien rassemble dans le port de cette ville tous les éléments nécessaires pour assurer le succès de son expédition : trois cents grandes galères et un grand nombre proportionné de bâtiments de transport étaient sortis, comme par enchantement, des forêts de l'Apennin.
Le génie d'un seul homme renouvelait, à cette époque de complète prostration, les prodiges d'activité des anciens romains.
Procope raconte de Majorien quelque chose de plus étonnant encore.
Selon lui, l'empereur ne s'en rapportant à personne pour reconnaître les forces réelles de ses ennemis :
- teignait en noir ses cheveux d'un blond aussi éclatant que les rayons du soleil,
- passa la mer ainsi déguisé et
- se présenta à Genséric sous le nom de son ambassadeur : " Introduit par le terrible vandale dans l'arsenal de Carthage, dit cet historien, les armes en sa présence s'entrechoquèrent d'elles-mêmes et résonnèrent sans qu'on les touchât.
Instruit trop tard du rang de son hôte, Genséric rendit hommage à la ruse audacieuse de l'empereur et se mit en mesure de lui résister.
La flotte qu'avait rassemblé Majorien avec tant d'efforts se trouvait enfin réunie dans le vaste port de Carthagène, prête à faire voile pour l'Afrique lorsqu'une odieuse trahison renversa toutes ses espérances : une partie des officiers Goths étaient à son service, gagnés par Genséric fournirent à ce dernier les moyens de la détruire.
Un grand nombre de vaisseaux furent pris, coulés à fond ou brûlés et l'œuvre de trois années anéantie en une seule nuit.
Majorien, le désespoir dans l'âme, fit la paix avec son trop heureux adversaire et retourna mourir en Italie sous l'épée de ses soldats soulevés par un traître, pendant que Genséric demeurait le maître incontesté de l'Afrique et de presque tout le bassin occidental de la Méditerranée (459-460).
La Sicile seule continua à se défendre, grâce au talent d'un capitaine appelé Marcellin.
L'empire d'Occident touche à sa fin : la lutte ne tarda pas à s'engager entre Genséric et l'empire d'Orient.
Léon ayant fait quelques efforts pour rétablir l'autorité romaine en Italie et arrêter les ravages périodiques des Vandales, Genséric, lança ses pirates dans l'archipel jusque sur les côtes de l'Asie mineure.
L'empereur grec répondit à cette attaque en réunissant une armée de cent mille hommes et une flotte composée de tous les vaisseaux qu'il put rassembler.
Des largesses immenses furent faites aux matelots et aux soldats : la somme de cent-trente mille livres d'or suffit à peine à ces préparatifs.
L'attaque par mer et par terre était combinée d'une manière formidable : tandis que la grande flotte impériale commandée par Basiliscus, se dirigeait vers le cap Bon où elle vint jeter l'ancre, une armée partie d'Égypte sous les ordres du préfet Héraclius reprenait Tripoli. Mais les retards inexcusables firent perdre aux Romains tous leurs avantages.
Les contemporains ont attribué ce revers à la lâcheté ou plutôt à l'impéritie de Basiliscus et à la trahison de ses lieutenants : en effet ce n'était pas la première fois que Genséric faisait agir son or avant de tirer le glaive du fourreau.
Il est donc permis de croire que les chefs Goths et les autres barbares ariens qui étaient au service de Léon trahirent ce prince comme leurs compatriotes et coreligionnaires avaient trahi Majorien.
Quoiqu'il en puisse être Genséric avait offert de soumettre sa personne et ses États à l'empereur d'Orient se borna à solliciter une trêve de cinq jours pour stipuler, disait-il, les conditions de sa soumission. Ce délai fut accordé.
Pendant qu'il négociait, sa flotte s'approchait lentement, suivie d'une multitude de barques chargées de toutes sortes de matières inflammables.
Tout à coup le vent attendu souffle, les Vandales déploient leurs voiles et poussent leurs brûlots sur la flotte romaine, qui, trop confiante dans la foi des traités, ne se réveilla qu'au milieu des flammes.
Serrés les uns contre les autres, ces nombreux vaisseaux ne purent échapper à l'incendie, dont ils excitaient même l'activité par leurs mouvements.
Telle fut la fin désastreuse d'un expédition qui avait fait naître de si belles espérances. Les débris de la flotte gagnèrent la Sicile Héraclius fit une retraite pénible à travers le désert de Barea.
Quant à Basiliscus, de retour à Constantinople, il se réfugia dans l'église de Sainte Sophie et ne dut la vie qu'aux prières de sa sœur, femme de l'empereur (467).
Cette victoire mit le comble à la renommée de Genséric qui continua de couvrir la Méditerranée de ses vaisseaux, désolant sans relâche les côtes de l'Espagne et de l'Italie, menaçant l'Égypte même et donnant aux Maures un avant goût de cette piraterie dont ils ont fait, pendant de longs siècles, un si cruel usage.
Son principal but était atteint : l'empire d'Occident n'existait plus ; et un roi barbare, l'Hérule Odoacre, régnait sur l'Italie (476) Genséric traita avec lui, et bientôt après Zénon, empereur d'Orient sentant l'inutilité de ses efforts contre le maître de l'Afrique, consentit au partage de la Méditerranée.
Il reconnut la domination de Genséric sur toute la région de l'Atlas en y comprenant Tripoli, et sur toutes les îles du bassin occidental, la Sicile inclusivement.
De son côté le Vandale prit l'engagement de tolérer le culte catholique. Ce fut là le dernier acte de sa vie. Il mourut quelques mois après à Carthage, plein de gloire et de puissance (25 janvier 477). Son fils Hunneric lui succéda.
Il y avait déjà près d'un demi siècle que les Vandales étaient descendus en Afrique et depuis trente-huit ans ils occupaient Carthage.
Au lit de mort Genséric ordonna que son sceptre passât de génération en génération à l'aîné de ses descendants mâles, afin que le gouvernement ne tomba jamais entre les mains d'un enfant incapable de régner : inutile recommandation qui ne fut respectée par aucun de ses descendants. Cette terrible renommée des Vandales, dut au génie d'un seul homme disparut avec lui.
La paix de 476, en apparence si glorieuse pour ces peuples devint la cause de leur décadence ; n'ayant plus :
- d'ennemis à combattre,
- d'expéditions aventureuses à entreprendre,
- de riches proies à enlever,
Ils succombèrent sous les séductions de l'opulence oisive et l'influence du climat énervant de l'Afrique. Et perdant leur rudesse primitive, ils ne prirent de la civilisation que ses vices. L'amour du luxe rappela un moment le commerce extérieur de Carthage et dans les principales villes ; mais ce mouvement tout matériel n'apporta aucun élément nouveau de progrès qui pût compenser les maux causés par la barbarie.
D'un autre côté la puissante organisation militaire qui, du temps des Romains, avait contenu les indigènes, s'effaçant de plus en plus, les tribus nomades que Genséric était parvenu à dominer, moitié par la crainte, moitié par l'appât du butin, se montrèrent ouvertement hostiles dès le règne de son fils Hunneric et ses successeurs ne surent pas mieux réprimer les populations barbares que s'attirer l'affection des populations civilisées.
Les inutiles efforts de Genséric pour étouffer le catholicisme aurait dû leur inspirer des sentiments de tolérance : loin de là ; leur aveugle fanatisme suscita contre les orthodoxes des persécutions aussi insensées que cruelles. On eut dit qu'ils prenaient à tâche de rendre impossible, entre les Vandales et les Romains, cette fusion qui seule pouvait affermir leur puissance.
(Il y avait encore sous Hunneric 466 évêques catholiques en Afrique, dont 120 dans la Maurétanie césarienne, 42 ou 44 dans la province de Sétif, 123 ou 125 en Numidie. Il est évident que beaucoup de ces évêques ne régissaient que des diocèses d'une étendue très restreinte. Les évêques étaient réduits à 217 lors de la chute définitive de la monarchie vandale.)
Non contents d'opprimer leurs futurs sujets, les princes vandales se déchirèrent entre eux. Hunneric fit périr une grande partie de sa famille, sans excepter même le chef spirituel de sa communion, le patriarche des Ariens, pour assurer la couronne à son fils Hildéric, contrairement aux dernières volontés de son père.
Crimes inutiles : Gundamund, l'aîné de la race des Genséric, monta sur le trône après lui.
Ce prince se montra moins dur envers les catholiques ; mais sous le règne de son successeur Thrasamund les persécutions se rallumèrent avec une telle fureur et durèrent vingt-sept ans.
Cependant, aussi faible contre des adversaires belliqueux qu'impitoyables envers des prêtres et des populations désarmées, le gouvernement vandale reculait d'année en année devant :
- les Maures, les Numides et les Gétules.
La Maurétanie lui échappa d'abord, à l'exception de Cherchell et de quelques autres points de la côte.
En Numidie ses généraux se laissèrent refouler au Nord du petit Atlas, enfin l'Afrique proprement dite et la fertile province de Bysacène (au Sud de Tunis) se virent sans cesse ravagées par les irruptions des tribus nomades.
L'empire d'Orient voyait avec une joie mal dissimulée cette rapide décadence de la monarchie fondée par Genséric et se croyait à la veille de ranger l'Occident sous ses lois.
Justinien régnait alors et un progrès sensible dans les arts et dans la législation, une grande activité politique, se manifestaient parmi les Gréco-Romains.
Les évènements dont l'Afrique était alors le théâtre avaient mis entre les mains de l'empereur un instrument dont il se servit avec habileté : c'était le jeune Hildéric qui, après la mort de son père était venu chercher un refuge à Constantinople.
Lorsque Thrasamound descendit au tombeau, il se trouva l'aîné de la race de Genséric et par conséquent fut appelé au trône.
Doux et faible de caractère, élevé dans les idées et les mœurs byzantines, la conduite de ce prince fut moins celle d'un monarque indépendant que d'un lieutenant de l'empereur.
En correspondance continuelle avec Justinien il se plaisait à suivre ses inspirations, rendant aux catholiques l'entière liberté de leur culte et permettant la réunion d'un concile orthodoxe à Carthage.
(Sous la domination romaine et principalement à partir du règne de Constantin, Carthage était devenue le chef-lieu du diocèse d'Afrique. A ce titre elle fut choisie, pour la réunion de plusieurs conciles importants qui s'y tinrent de 215 à 644 de J. C. Le nombre en est de31 sous la domination vandale. Celui dont il s'agit ici fut présidé par l'évêque Boniface.)
Cette politique tolérante aurait pu sauver la monarchie vandale ; inspirée par l'étranger, elle n'eut d'autre résultat que de perdre Hildéric et d'entraîner sa ruine puis celle de la monarchie fondée par ses prédécesseurs.
Irrités de cette condescendance qu'ils regardaient comme une trahison, les Vandales s'insurgèrent enfin et les Maures firent cause commune avec eux.
Inhabile au métier des armes Hildéric chargea son neveu Oamer d'étouffer cette révolte ; mais celui-ci fut repoussé par Antalas, chef des Maures de la Bysacène, qui :
- se rendit maître de plusieurs villes,
- les mit au pillage et
- décima les habitants.
Dans cette extrémité, on eut recours aux talents militaires de Gélimer, prince le plus rapproché du trône.
Ce nouveau général avait déjà battu les insurgés en plusieurs rencontres, quand par un mouvement qui parut spontané, mais qui sans doute avait été préparé, on vit les deux armées ennemies confondre leurs rangs et le proclamer roi. Aussitôt :
- il marche droit à Carthage,
- détrône Hildéric,
- le jette en prison avec sa famille et
- fait massacrer tous ses partisans.
Justinien s'empressa d'intervenir entre les deux princes et fit sommer l'usurpateur de rétablir sur son trône le roi légitime ; mais Gélimer congédia brusquement ses envoyés et resserra plus étroitement encore le malheureux prisonnier.
Engagé dans une guerre contre la Perse, l'empereur dissimula son mécontentement, se bornant à demander qu'Hildéric fût renvoyé à Constantinople, et ajoutant qu'en cas de refus la force viendrait au secours du droit.
Ces mesures étant restées sans effet, la guerre fur résolue.
Une victoire remportée sur les Perses permit à Justinien de disposer de ses troupes ; il rappela à Constantinople le général qui commandait en Asie et se disposa à faire passer une armée en Afrique.
Ce projet trouva d'abord de nombreux contradicteurs dans le conseil : des ministres timides rappelaient les désastres des expéditions dirigées contre Genséric et en présageaient de semblables.
Mais Bélisaire soutint l'avis de l'empereur et fit observer que les Vandales étaient loin d'être aussi redoutables qu'autrefois.
" Sous le soleil ardent de l'Afrique, disait-il, le courage et les mœurs de ces hommes du Nord se sont amollis ; ils habitent des maisons de plaisance entourées de jardins magnifiques où ils entretiennent à grands frais des bassins et des jets d'eau ; chaque jour, en sortant du bain, il font servir sur leurs tables les mets les plus recherchés ; des broderies d'or couvrent leurs longues robes de soie flottantes comme celle des Médès.
L'amour et la chasse sont les seules préoccupations de leur vie, et ce qu'il leur reste de loisir, ou plutôt de vide et d'ennui, est rempli par :
- des spectacles de toute espèce,
- des pantomimes,
- des courses en chars,
- la musique et la danse.
En apprenant le plaisir les Vandales ont désappris la guerre et la discorde règne parmi eux. "
Cependant Gélimer redoublait de rigueur envers le malheureux Hildéric.
Deux princes, ses parents, enfermés avec lui, furent livrés au bourreau :
- l'un eut les yeux crevés,
- l'autre perdit la vie dans les supplices.
Mais ces inutiles cruautés ne firent qu'accroître le ressentiment des populations romaines et catholiques.
En effet une insurrection ne tarda pas à éclater : un Romain de distinction nommé Pudentius, s'empare de Tripoli, y appellent les troupes impériales et quelques jours lui suffisent pour chasser les Vandales de cette province.
- La Bysacène s'ébranle,
- la Sardaigne se déclare indépendante.
Cette dernière perte fut la plus sensible de toutes pour Gélimer.
Il y avait envoyé, en qualité de gouverneur, un soldat de fortune nommé Godas, Goth d'origine et que rien n'attachait à son maître que la reconnaissance, faible lien pour un ambitieux.
Imitant le catholique Pudentius, Godas, l'arien, offrit de remettre à l'empereur la souveraineté de l'île, se reconnaissant pour son vassal : Justinien s'empressa d'y faire passer des troupes pour en prendre possession.
En proie à une cruelle perplexité, Gélimer hésitait s'il porterait ses efforts sur Tripoli ou la Sardaigne ; mais le désir de punir Godas l'emporta. Il espérait qu'après avoir reconquis cette île son armée aurait le temps de revenir au secours de Carthage. L'élite de ses troupes partit donc sous le commandement de l'un de ses frères, nommé Tzazon.
Funeste résolution, qui devint une des causes principales de sa ruine.
Ainsi la guerre se préparait de tous côtés, et l'entreprise de Justinien s'annonçait sous d'heureux hospices. Tout était en mouvement à Constantinople où la haine contre Carthage s'était allumée aussi vive qu'elle le fut jamais à Rome.
Ces préparatifs ne furent pas indignes de ces grands souvenirs, les Scipion semblèrent revivre dans l'héroïque et vertueux Bélisaire :
- Cinq mille cavaliers,
- dix mille fantassins, tant Gréco-Romains que Barbares,
- cinq cents navires montés par vingt mille matelots, et chargés d'armes et de munitions de toute espèce.
- Quatre-vingt-douze brigantins (grands voiliers à deux mâts à voiles carrées) en un seul rang de rames, mais fermés et couverts afin que les soldats fusent à l'abri des traits de l'ennemi, montés par deux mille hommes choisis parmi la plus brave jeunesse de Constantinople :
- Telle était l'importance de l'expédition dirigée contre les Vandales.
La septième année du règne de Justinien, à l'époque du solstice d'été (22 juin 533), le vaisseau amiral que montait Bélisaire, sortant du port, se dirigea vers le palais impérial pour recevoir solennellement, aux yeux du peuple assemblé, la bénédiction du patriarche : au même instant un soldat nouvellement baptisé y monta, afin que son innocence attirât sur l'entreprise la protection du ciel. C'était le signal du départ.
Les nombreux vaisseaux déployèrent à la fois leurs voiles et s'éloignèrent aux acclamations d'une foule innombrable.
Le vaisseau amiral ouvrait la marche , distingué le jour par la couleur rouge de l'extrémité de ses voiles et la nuit par des torches ardentes placées au sommet des ses mâts. La flotte impériale relâcha d'abord à Héraclée (cité grecque), puis à Abydos (ville d'Egypte proche de Louxor) (pendant cette relâche forcée, Bélisaire donnait à ses troupes une sévère leçon de discipline que l'histoire doit recueillir.
Deux Huns ou Massagètes (peuple nomade vivant de la mer d'Aral à la mer Caspienne) , pris de vin, massacrèrent l'un de leurs compagnons.
Le général les interrogea ; ils ne niaient point le meurtre mais ils prétendaient échapper à la juridiction romaine et jouir du bénéfice de leur propre loi qui payait le sang par une amende. Leurs compatriotes, nombreux dans l'armée, appuyaient leurs réclamations ; les Romains auraient vu sans peine qu'elles fussent écoutées afin de s'en prévaloir dans l'occasion.
Bélisaire fut inflexible. Les corps des deux meurtriers suspendus à un gibet sur une hauteur voisine, apprirent à l'armée silencieuse que dans un grand caractère la bonté n'exclut point la sévérité, alors que la sévérité est nécessaire au salut commun.)
De là un vent favorable la poussa vers Sigée (cité grecque) entre les caps Malée et de Ténare (cap du Péloponnèse), passage étroit et difficile qu'elle franchit sans accident.
Ensuite elle se dirigea vers la Sicile en longeant le Péloponnèse.
Arrivé près de Syracuse, Bélisaire consacra quelques jours à faire rafraîchir son armée et à se procurer des renseignements exacts sur les positions occupées par les Vandales, qui ignorant son approche, ne s'attendaient nullement d'être attaqués. Après ce court repos, la flotte remis à la voile, et bientôt, perdant de vue la Sicile, découvrit les caps de l'Afrique.
On jeta l'ancre au promontoire de Caput Vada, aujourd'hui Capoudia à cinq journées de marche (160 kilomètres environ) au Sud de Carthage.
La traversée n'avait pas duré moins de trois mois. Bélisaire voulut que le débarquement s'effectuât aussitôt.
La découverte inattendue d'une source abondante qu'on fit jaillir en creusant un fossé parut aux soldats un heureux présage : le ciel favorisait les vengeurs de la foi catholique !
Cette terre où les troupes gréco-romaines venaient d'aborder si heureusement était une terre amie :
- Il fallait prouver à ses habitants qu'on venait réellement les affranchir de la tyrannie des Vandales,
- il fallait leur épargner autant que possible les malheurs de la guerre,
- respecter les personnes et les propriétés,
- ne rien permettre,
- en un mot, de contraire aux lois de la plus sévère discipline.
Bélisaire pourvut à tous ces soins.
Des jardins clos de murs ayant été dépouillés de leurs fruits par les maraudeurs, il fit saisir et châtier les coupables ; puis, faisant mettre ses troupes sous les armes, il leur représenta dans une énergique allocution que le succès de l'expédition reposait presque entièrement sur l'antipathie que les Romains d'Afrique éprouvaient pour les Vandales. " Ces espérances, ajouta-t-il, vous les détruisez vous-mêmes par votre discipline.
Arrêtez-vous donc sur cette pente funeste ; ne cherchez point dans le pillage un gain périlleux et criminel qui causerait votre perte ; craignez de vous ravir à vous-même l'amitié et la confiance de ces peuples qui nous ont appelés comme leurs libérateurs et que nous forcerions bientôt à nous traiter en ennemis.
Ces sages exhortations firent impression sur l'armée ; elle s'abstint de tout acte de violence, et les habitants se voyant protégés dans leurs biens et dans leurs personnes, fournirent spontanément tous les vivres et tous les renseignements dont on avait besoin.
La petite ville de Syllecte, dont les remparts avaient été détruits sous Genséric, mais dont chaque maison, fortifiée afin de résister plus sûrement aux incursions soudaines des Maures, pouvait soutenir un siège, ouvrit volontairement ses portes à un détachement envoyé par Bélisaire.
Lemptis (Lempte) et Adrumette (Hammamet), villes importantes, situées sur le passage de l'armée, suivirent cet exemple et reçurent avec joie le magnanime lieutenant de Justinien.
Conservés par lui dans leurs fonctions, les officiers civils en continuèrent l'exercice au nom de l'empereur d'Orient, et le clergé catholique, suivant à la fois les aspirations de sa conscience et de son intérêt, favorisa de tout son pouvoir la cause d'un prince dont le succès devait rendre à la religion son ancienne prépondérance.
D'Adrumette, Bélisaire se porta sur Grasse (Jerads), château de plaisance des rois vandales.
Après avoir donné quelques jours de repos à ses soldats :
- au milieu de belles fontaines,
- dans les frais bocages,
- sous les arbres chargés de fruits délicieux dont cette résidence était parsemée, il se remit en marche, se dirigeant sur Carthage par la base de la presqu'île que termine le cap Bon.
Cependant Gélimer, au fond de la Byzacène avait appris l'arrivée des gréco-Romains et courait à la défense de sa capitale.
Sa situation devenait de plus en plus critique, car la consternation régnait parmi les siens et partout les populations se montraient favorables aux envahisseurs.
Il ne possédait aucune place forte qui pût lui servir de point d'appui.
Carthage seule avait conservé ses murailles ; mais mal entretenues depuis longtemps, elles étaient une bien faible défense.
L'incurie des rois vandales livrait ainsi leur empire aux hasards d'une seule bataille et Gélimer pensait, non sans terreur que c'en était fait de lui s'il n'obtenait un premier avantage.
Au milieu de ces hésitations, tantôt il veut traîner la guerre en longueur et attendre le retour de ses vétérans encore retenus en Sardaigne, tantôt se jeter entre sa capitale et l'armée conquérante.
Enfin s'arrêtant à ce dernier parti, il divise en trois corps les troupes qu'il a sous la main :
- le premier aux ordres de son frère Ammatas, prend position en avant du faubourg de decimum, point sur lequel l'ennemi devait se présenter d'abord, enfin de l'arrêter dans les défilés qui précèdent ce faubourg ;
- le second commandé par Gundamund, son neveu, et uniquement composé de cavalerie, reçoit l'ordre de longer le rivage de la mer.
Ce corps devait prendre en flanc les Gréco-Romains après les avoir séparés de leur flotte.
A la tête du troisième, Gélimer occupa les hauteurs, prêt à tomber sur l'arrière garde. Ces dispositions stratégiques ne manquaient pas d'habileté ; mais, dans cette circonstance, la politique du monarque vandale ne répondit pas à ses qualités militaires. Il fit mourir Hildéric et ses partisans ; inutile cruauté qui n'eut d'autres résultats que d'exciter la compassion du peuple et de le rendre plus favorable à Justinien.
Ponctuellement obéi dans l'exécution d'un ordre sanguinaire, Gélimer fut moins heureux sur-le-champ de bataille.
Ammatus était jeune et fougueux : emporté par son ardeur, il oublia que le succès dépendait de l'ensemble des mouvements et ne tint aucun compte de l'heure fixée pour l'attaque.
Maître du faubourg de Decimum (proche de Carthage), au lieu de s'y retrancher et d'attendre l'ennemi, il se porta en avant avec une faible partie de ses troupes et aborda sans hésiter l'avant-garde gréco-romaine.
Cette avant-garde composée de trois cents cavaliers d'élite sous les ordres de Jean l'Arménien, un des meilleurs lieutenants de Bélisaire, fut d'abord assez maltraitée ; et le prince vandale, combattant au premier rang avec une valeur qui ne rachetait point sa faute, avait tué douze hommes de sa propre main, lorsqu'il tomba lui-même atteint d'une blessure mortelle.
Se voyant privés de leur chef, ses soldats prennent la fuite, entraînant ceux qui s'avançaient pour les soutenir ; et tous pêle-mêle sont poursuivis sur le chemin de Carthage.
A la gauche, les deux mille cavaliers commandés par Gundamund éprouvaient le même sort. Attaqués par six cents Massagètes seulement, ils furent mis en pleine déroute.
Toutefois ce double échec ne décidait pas du sort de la journée, et Gélimer, avec le gros de ses forces pouvait encore arracher la victoire aux Gréco-Romains.
Ignorant ce qu'il se passait, il s'avançait à travers de longues chaînes de collines qui lui dérobaient la plaine où l'imprudent Ammatas était encore étendu sans vie au milieu des douze cavaliers immolés par lui.
A cet affreux spectacle, rempli de douleur et de colère, le roi suspend sa marche pour rendre les derniers devoirs à son malheureux frère, après quoi il s'élance sur l'ennemi pour le venger.
Ce choc imprévu jette le trouble et l'hésitation parmi les détachements de l'armée gréco-romaine qui se trouvent sur son passage ; et ils se replient en grande hâte sur le corps principal où ils portent un moment la confusion.
De son côté Bélisaire s'avança avec une prudente lenteur à la tête de sa cavalerie. On premier soin fut de rallier les fuyards qui purent dés lors se reformer derrière lui. Mais sitôt qu'il eut appris la mort d'Ammatas, il ordonna de fondre sur les Vandales, qui, saisis à leur tour d'une panique insurmontable, prirent la fuite en désordre et se dispersèrent dans les montagnes.
Gélimer se retira du côté d'Hippone ; les vainqueurs passèrent la nuit sur-le-champ de bataille, à la dixième borne militaire de Carthage.
Le lendemain l'armée gréco-romaine se remit en marche et arriva le soir aux portes de la ville qu'elle trouva ouvertes ; mais Bélisaire refusa d'y entrer.
En vain les habitants sortent en foule, portant des flambeaux et poussant des cris de joie, le prudent général ne donne rien à l'entraînement du succès,
- soit qu'il craignait quelque embûche,
- soit plutôt qu'il ne voulut pas exposer la ville aux désordres inséparables d'une occupation faite pendant la nuit,
- il ordonna de dresser les tentes,
- établit des postes, et
- plaça partout des sentinelles comme s'il était encore en présence de l'ennemi.
La flotte seule, dont tous les mouvements avaient été habilement combinés avec ceux de l'armée de terre, reçut l'ordre de pénétrer dans le port.
Enfin le jour parut, et l'armée entra dans Carthage enseignes déployées, comme si elle revenait d'un exercice militaire.
Aucun désordre ne ternit son triomphe : l'Afrique ne faisait que changer de maître. Le commerce de la ville ne fut pas un instant suspendu ; les promenades publiques étaient couvertes de monde comme d'habitude.
Seulement un mouvement inaccoutumé se faisait remarquer aux portes des églises, où les Vandales couraient chercher un refuge, et les catholiques remercier Dieu de leur délivrance.
Un de ces édifices dédié à Saint Cyprien, s'élevait au bord de la mer.
Par un heureux concours de circonstances, ce jour-là se trouvait être celui de la fête du glorieux martyr : ce fut aux pieds de ces autels qu'après quatre-vingt-quinze ans d'une cruelle oppression les chrétiens orthodoxes se réunirent avec un empressement plus marqué pour offrir au ciel leurs actions de grâce.
L'habile et sage général qui présidait à ces évènements occupa le palais des rois Vandales, si souvent souillés par l'assassinat et leurs fureurs de ces princes schismatiques.
Maître de la capitale, Bélisaire ne crut point l'être encore de la province ; ne pensant plus qu'à une seule bataille eût suffi pour renverser une domination si solidement établie, il s'attendait à un dernier et terrible effort de la part des vaincus : en conséquence il se hâta de tout préparer pour consolider sa conquête. Les fortifications de Carthage tombaient en ruine ; il les fit relever y ajoutant même de nouvelles tours et plusieurs ouvrages de terrassement considérables, puis creuser autour de la ville un large fossé qui acheva d'en rendre l'approche impossible. Soldats et matelots, aidés par une population de deux cent mille âmes, prirent part à ces travaux ; et l'ardeur fut telle qu'en moins de deux mois Carthage se trouvait en état de soutenir un siège.
Le bruit de cette prodigieuse activité, répandu dans toute l'Afrique, porta le plus profond découragement dans le cœur des Vandales.
De leur côté, les Maures, ce peuple sur l'imagination duquel le récit des choses extraordinaires est toujours si puissant, courbèrent la tête devant ce signe de grandeur et de force.
Plusieurs de leurs chefs, vassaux ou ennemis de Gélimer, vinrent solliciter l'amitié des Gréco-Romains.
Bélisaire les accueillit avec distinction et, faisant revivre un antique usage, leur remis de sa main les marques distinctives de la dignité royale. C'était :
- un sceptre d'argent doré,
- un diadème à bandelettes,
- un manteau retenu par une agrafe d'or,
- une robe et une tunique blanche,
- des brodequins enrichis d'ornements et de broderies en or
- Il y ajouta encore de riches présents.
Séduits par cette magnifique investiture qui flattait leurs passions dominantes, l'orgueil et la cupidité, ces barbares s'engagèrent à observer une stricte neutralité, mais tinrent parole à leur manière, c'est-à-dire fort mal.
Toute l'Afrique septentrionale avait donc les yeux fixés sur les Gréco-Romains et s'apprêtait à reconnaître leur domination.
Encore une victoire, et l'œuvre si bien commencée était complète, autant du moins que la conquête peut passer pour définitive dans une contrée où l'on ne s'établit qu'à la condition de toujours combattre.
Mais il ne s'agissait, pour le moment que de chasser les Vandales, sauf à compter plus tard avec les indigènes.
Tel était le plan du général grec, toujours imité par des nations qui ont aspiré à la possession de l'Afrique et toujours entravé par les mêmes obstacles.
Réfugiés sur les frontières de la Numidie et la Bysacène où il était parvenu à réunir autour de lui la nation vandale presque toute entière, Gélimer attendait, pour tenter de nouveau la fortune, que son frère, jusqu'alors resté en Sardaigne, vint le joindre avec ses vétérans.
Or à la première nouvelle des succès des Gréco-Romains, Tzazon avait spontanément fait embarquer ses troupes et après une heureuse navigation il arriva enfin en Afrique où son retour presque inespéré releva le courage de ses compatriotes.
Après avoir tenu plusieurs fois conseil, les deux princes levèrent leur camp et se rapprochèrent de Carthage.
Aussitôt Bélisaire, sortant d'une inaction prolongée à dessein, marche droit à eux, et disperse sans peine leurs troupes, qui laissent sur-le-champ de bataille le cadavre du frère de leur roi, de Tzazon, ce dernier et noble soutien de la race de Genséric.
La journée fut peu sanglante : huit cents Vandales et cinquante Romains perdirent la vie : mais ce sont moins les pertes matérielles que la démoralisation des armées qui amènent les grands résultats.
A la fin du combat, Gélimer s'était enfui vers la Numidie, abandonnant à l'ennemi son camp ouvert de toutes parts et dans lequel se trouvaient réunis les derniers débris de son peuple :
- femmes, enfants, vieillards avec tous ses trésors.
Un tumulte étranger y régnait car frappés d'une terreur profonde, ces barbares songeaient plutôt à fuir qu'à combattre.
Sans éprouver aucune résistance sérieuse, les Romains firent un butin immense.
- L'or et l'argent,
- les objets précieux de tout genre qu'ils avaient rapporté de leurs nombreuses expéditions, tout ce qu'ils avaient extorqué en Afrique,
- soit par les spoliations,
- soit par les impôts, étaient entassés dans le camp des vaincus, et devinrent à leur tour la proie du vainqueur.
Cette bataille, qui anéantit politiquement la puissance des Vandales en Afrique fut livrée vers la fin de décembre 533, trois mois après l'entrée de l'armée romaine dans Carthage, six mois après son départ de Constantinople.
Pour compléter la victoire, il ne restait plus qu'à s'assurer de la personne de Gélimer. Ce prince avait trouvé asile chez une tribu maure des montagnes de Pappua (Djebel-Edough) près des sources de la Seybouse où il traînait l'existence la plus misérable.
Plus sauvages même que les Kabyles de nos jours, ses hôtes habitaient de sombres huttes, des cavernes creusées dans le roc, ou couchaient pêle-mêle sur la terre nue :
- hommes, femmes, enfants, troupeaux.
Ils portaient toute l'année la même tunique et le même manteau.
Des espèces de gâteaux d'orge, d'avoine ou de seigle, à demi cuits sous la cendre était leur unique aliment, le seul qu'ils pussent offrir au roi fugitif.
Étranges courtisans et nourriture plus étrange encore pour un prince naguère assis à la table la plus somptueuse de l'univers !
Pourtant il fallait se résigner à vivre dans cette affreuse retraite, ou consentir à se rendre.
La montagne, presque inaccessible de toutes parts, et le fort de Midenos (Ce fort était à la fois une petite ville qui n'était habitée qu'à certaines époques de l'année. Il n'en reste aujourd'hui aucune trace.) qui la couronnait, étaient étroitement resserrés par Pharos, lieutenant de Bélisaire. Après quelques inutiles tentatives d'escalade, cet officier changea le siège en blocus.
Pendant ce temps le général victorieux retournait à Carthage afin d'achever de soumettre le pays et de l'arracher à l'influence des Vandales.
- Césarée de Maurétanie, Ceuta, appelé, alors le fort de sept ou Septen ;
- Tripoli la première des villes d'Afrique qui eût reconnu le pouvoir de Justinien, reçurent garnison romaine.
De son côté la flotte ne restait pas inactive ; elle soumettait :
- la Sardaigne,
- la Corse,
- Les îles Baléares,
- dépendances du vaste empire crééé par Genséric.
Telle était la situation des affaires en Afrique lorsque Justinien reçut les lettres de son général qui lui annonçait l'heureux succès de sa glorieuse entreprise.
A la joie publique se mêlèrent aussi les intrigues de tout genre, tant chacun avait hâte d'aller prendre sa part des dépouilles du vaincu. Une nuée d'agents de toute espèce envahit la province, moins pour assurer la conquête que pour l'exploiter. On s'y rendait pour s'enrichir, n'importe par quels moyens.
L'empereur lui-même allait au devant de toutes les mesures qu'on s'empressait de lui suggérer pour tirer de ses nouveaux sujets les plus fortes contributions possibles. Les subtilités du fisc impérial remplacèrent les extorsions des Vandales.
Tous les descendants des anciens propriétaires romains furent autorisés à revendiquer les maisons et les terres dont le soldats de Genséric avaient dépouillé leurs ancêtres.
A l'aide d'une telle loi, secondée par des déportations en masse, on s'explique comment ces envahisseurs ont tellement disparu du sol de l'Afrique, que leur trace peut à peine être aperçue.
Cependant le siège de la montagne Pappua continuait et l'opiniâtreté de Gélimer faiblissait chaque jour devant la vigilance de Pharos.
Près de se rendre sur la promesse d'être généreusement traité par Justinien, la honte le retenait encore. Depuis six mois il manquait de tout ; une famine horrible moissonnait autour de lui ce qui lui restait :
- de parents, d'amis et d'alliés.
Enfin un jour ayant vu son neveu disputer avec désespoir à un enfant maure un dernier gâteau d'orge à demi cuit et couvert de cendre, son courage l'abandonna et il consentit à capituler.
Conduit à Carthage il fut accueilli avec distinction par Bélisaire, à qui une telle capture causa d'autant plus de joie qu'il avait hâte de retourner à Constantinople où ses ennemis répandaient des bruits injurieux à sa gloire : On disait qu'il voulait se faire roi de l'Afrique, et le caractère jaloux et soupçonneux de l'empereur lui faisait craindre que ce prince n'ajoutât foi à de telles calomnies.
Le vainqueur des Vandales fit embarquer sans délai :
- ses gardes, ses captifs, ses trésors
Et sa navigation fut si heureuse que son arrivée précéda la nouvelle de son départ. La calomnie se tut, et les soupçons s'évanouirent devant une telle preuve de loyauté.
Il fur reçu avec des honneurs extraordinaires.
Après un intervalle de six siècles, les pompes triomphantes de la Rome républicaine reparurent pour honorer le courage et la vertu d'un grand citoyen.
Jamais la ville de Constantin n'avait vu dans ses murs ce magnifique spectacle et l'Afrique faisait tous les frais de celui-ci.
Outre les nombreux esclaves, de riches dépouilles attestaient l'importance de la conquête. C'étaient :
- des vêtements de soie à l'usage des rois vandales,
- des chars de guerre,
- des pierreries,
- des vases richement ciselés,
- des monceaux d'or et d'argent, restes des trésors enlevés à Rome par Genséric, et qui, par un de ces retours inattendus de la fortune, venaient enrichir la Rome orientale, héritière naturelle de sa sœur aînée la Rome italienne.
Derrière les chars qui portaient ces trésors marchaient lentement sur une longue file les nobles vandales et leur roi captif :
- Les premiers, remarquables par un reste de fierté et par leur haute stature,
- le second, couvert d'une robe de pourpre et répétant de temps en temps les paroles de Salomon : vanité des vanités, tout n'est que vanité !
Cependant sa philosophie échoua au moment où, arrivé au pied du trône de l'empereur on le dépouilla de sa robe royale en le forçant à se mettre à genoux.
Cette expression de l'historien grec dit assez qu'il opposa à cette dernière humiliation une inutile résistance.
Le jour même de cette imposante cérémonie, Bélisaire fut nommé consul pour l'année suivante et une fête nouvelle fut célébrée en son honneur.
Ce fut un second triomphe.
Dans le premier le héros avait marché modestement à pied à la tête de ses braves compagnons d'armes, s'effaçant autant qu'il le pouvait, dans la crainte d'éveiller la jalouse susceptibilité de son maître.
Dans le second, il crut pouvoir accepter comme magistrat les honneurs qu'il avait déclinés comme général.
Porté par des esclaves dans sa chaise d'ivoire à travers la ville, le nouveau consul jeta au peuple, de ses mains victorieuses, une partie des richesses conquises sur les Vandales :
- des coupes d'or,
- de riches ceintures,
- de l'argent,
- des bijoux,
Fruits d'une conquête dont l'honneur lui revenait tout entier.
Mais la récompense la plus chère au héros fut de voir l'empereur tenir au monarque captif toutes les promesses que lui-même avait faites en Afrique.
En descendant du trône Gélimer avait subi sa dernière épreuve : un vaste domaine lui fut assigné, pour lui et pour sa famille, dans la province de Galatie (région historique d'Anatolie dont le nom vient d'un peuple celte, les Galates, qui y a migré dans l'antiquité vers 279 avant J .C). L'arianisme seul, qu'il s'obstinait à ne pas adjurer, l'empêcha d'être revêtu de la dignité de patrice.
Il vécut et mourut en homme privé et ne laissa point d'enfants. Ainsi finirent la race royale de Genséric et le royaume qu'il avait fondé.
Rien n'est demeuré de ce peuple qu'un nom vaguement odieux que les nations modernes considèrent comme une injure et appliquent comme un stigmate flétrissant au front de tous les ennemis des arts et de la civilisation.
A peine même reste-t-il aux savants quelques médailles pour appuyer d'une preuve matérielle le témoignage des historiens.
Cependant soyons justes même envers ces barbares. Les Vandales, une fois établis en Afrique, ne restèrent pas absolument étrangers aux paisibles occupations des Romains. Ils concoururent avec leur nouveaux concitoyens :
- à la culture des terres,
- de l'exploitation de diverses industries,
- à la formation d'une grand nombre d'entreprises commerciales, et
- importèrent même une industrie qui y était totalement inconnue avant leur conquête, industrie qui s'y est perpétuée après eux, c'est-à-dire la fabrication des sabres et des épées, qui coupaient les métaux les plus durs et dans lesquels ont pouvait se mirer comme dans une glace.
Ils exécutèrent aussi plusieurs grands travaux hydrauliques,
- soit pour l'arrosement des terres,
- soit pour le luxe de leurs jardins.
Disons aussi que sous le rapport intellectuel les auteurs grecs et latins ont jugé les Vandales très défavorablement, parce que, repoussant la culture des langues étrangères, ces peuples s'en tenaient à leur idiome particulier.
Un neveu de Genséric était cependant versé dans la langue latine et dans les sciences que l'on cultivait à Rome.
De l'aveu de plusieurs auteurs contemporains, le roi Trasalmund était l'homme le plus lettré de l'Afrique, il se plaisait à discuter en latin sur les questions de théologie et de philosophie avec les membres du clergé catholique.
Il composa aussi dans cette langue, en faveur de l'arianisme un ouvrage qui, dit-on, se recommandait autant par l'élégance du style que par la force du raisonnement.
Ainsi donc, on le voit ici, les traditions les plus accréditées ne sont pas toujours absolument vraies.
D'abord inférieurs aux Romains en civilisation, les Vandales finirent par gagner à leur contact, et les habitudes de luxe qu'ils contractèrent en très peu de temps prouvent assez qu'ils n'étaient pas demeurés complètement étrangers au sentiment des arts et de la poésie.
On assure même que Gélimer, leur dernier roi, alors qu'il était bloqué par les troupes de Bélisaire dans les montagne de Pappua, composa sur ses malheurs des chants épiques empreints de grâce et de mélancolies.
Mais de tout ce que les Vandales on écrit, rien n'est parvenu jusqu'à nous. Par suite des guerres et des dévastations du moyen âge, leurs armes elles-mêmes ont disparu ; il ne nous est resté de leur langue que quelques mots et des noms propres.
C'est cette distinction complète de leurs monuments qui a justifié et validé en quelque sorte, l'anathème irrémissible que la postérité laisse encore peser sur eux.
Histoire de l'Algérie ancienne et moderne
depuis les premiers établissements carthaginois
par Léon Galibert, Directeur de la revue britannique. Édition 1842.
|
|
EMMANUEL MACRON 2017-2022
Envoyé par Hugues.
|

Message subliminal, au soir de l'élection,
Qu'Emmanuel Macron adresse aux Français
Devant une pyramide ! Mais, quelle réflexion
Intime et personnelle animera leurs pensées ?
Pourquoi, une nouvelle fois, inscrire, dans un triangle,
L'ensemble des Ministres responsables de nos "vies" ?
Cette forme géométrique, hors de sa base, s'étrangle.
Des sociétés secrètes est symbole de survie !
Ascension foudroyante d'Emmanuel Macron :
Dans le monde Financier International,
De la Banque Rothschild, "est adoubé baron",
Puis de l'Economie, Ministre hexagonal !
Avant même d'être élu, annonce, sans ambages,
Qu'il serait, Président, dieu des dieux, Jupiter !
Au sommet, nul, alors, ne porterait ombrage
A son Pouvoir suprême civil et militaire !
Puis, quelques mois après, imbu de la puissance
Que lui confère son titre, humilie, publiquement,
Le Général en Chef des Armées de la France.
Ce dernier, sans tarder, démissionne dignement.
Mais, ce premier accroc, ce péché de jeunesse
D'un Président pressé d'imposer ses réformes,
Démontre que l'ambition, dépourvue de sagesse,
Conduit à la méprise, à la "bavure" énorme !
Hugues Jolivet
11 mars 2022
|
|
| Colonisation gréco-byzantine
(536-630 avant J. C)
Envoi de M. Christian Graille
|
Les victoires de Bélisaire remirent en quelque sorte l'Afrique dans l'état où elle se trouvait au moment de la conquête des Vandales.
Ceux-ci disparurent du sol presque en un instant et l'oligarchie qu'il avait constituée allait se perdre dans les rangs de l'armée gréco-romaine.
Mais sous d'autres rapports les représentants de Byzance en Afrique, les Exarques (titre qui désormais va servir à désigner les gouvernements investis du pouvoir civil et militaire) allaient se trouver vis-à-vis des populations indigènes, dans des conditions moins favorables encore que les derniers gouverneurs envoyés par les empereurs d'occident.
Après l'expulsion des Vandales, il fallut compter avec de nouveaux ennemis bien autrement opiniâtres et toujours indomptables, c'est-à-dire les indigènes, dont la soumission n'est jamais que momentanée.
Sortis de leurs retraites, descendus de leurs montagnes pendant la triste période de la domination vandale, depuis longtemps les nomades faisaient paître leurs troupeaux et dressaient leurs tentes dans les mêmes plaines d'où les colons venus d'Italie tiraient naguère la subsistance de la métropole.
Des six-cent quatre-vingt-dix évêchés que sous les empereurs romains l'on comptait dans les sept provinces, qui s'étendaient depuis Tanger à Tripoli, il n'en existait plus que deux cent dix-sept : toutes les autres villes épiscopales avaient été ruinées par les Vandales ou par les Maures, ou s'éteignaient obscurément sous la domination des chefs des tribus barbares.
Leurs succès contre les Vandales avaient semblé leur promettre comme une proie assurée tout ce qui restait de l'Afrique civilisée.
Aussi la plupart virent-ils avec regret les victoires de Bélisaire. De ce regret à la guerre il n'y avait qu'un pas ; ce pas fut bientôt franchi.
Le successeur que s'était choisi Bélisaire fut l'eunuque Salomon. Général habile, administrateur éclairé, Salomon n'avait rien du caractère de cette classe d'hommes si méprisés et si puissants néanmoins dans les intrigues des cours d'Orient.
- Brave et actif,
- Prudent et juste, il possédait la confiance des troupes et l'estime des habitants du pays.
- Ses vertus et ses talents ne purent cependant lui assurer le triomphe.
Après une guerre de plusieurs années, il succomba, comme tant d'autres, dans cette œuvre si souvent reprise et jamais achevée : l'assujettissement des peuplades de l'Atlas.
Quoique les chefs maures sollicitassent toujours avec avidité auprès des gouverneurs pour obtenir ces tuniques brodées d'or et d'argent qui représentaient pour eux les insignes du pouvoir, Byzance ne trouvait en eux ni soumission réelle, ni véritable dévouement.
Avant même le départ de Bélisaire, ces mêmes Mauro-Gétules que nous avons vu reconnaître sa suprématie, avaient commencé à se soulever : bientôt toutes les tribus firent trêves à leurs inimitiés particulières et se réunirent contre les Gréco-Romains.
D'un même élan, elles se précipitèrent à la fois sur les fertiles plaines de la Numidie et de la Bysacène, brûlant les villes et les villages, et emmenant captifs les habitants. Le premier combat heureux accrut encore leur audace.
Deux braves officiers, qui commandaient un détachement peu considérable de cavalerie avaient perdu la vie dans une embuscade dressée presque aux portes de Carthage : leurs têtes promenées triomphalement dans toutes les tribus, devinrent le signal d'une insurrection générale.
Les lieutenants de Salomon voulurent ramener au devoir ces peuplades égarées, en leur rappelant :
- les désastres des Vandales,
- les promesses de soumission qu'elles-mêmes, ou leurs chefs, avaient faites à Bélisaire, et
- les otages qu'elles avaient livrés pour garantir leur fidélité.
Enhardies par cet heureux coup de main, elles répondirent fièrement aux généraux byzantins : " L'exemple des Vandales ne noue effraie pas ; vous ne les avez vaincus que parce que nous les avions déjà affaiblis par plusieurs défaites.
Quant aux menaces que vous nous faite de mettre à mort nos otages, c'est aux Romains qu'il importe de ménager leurs enfants, car ils n'ont chacun qu'une seule femme ; pour nous, qui pouvons en avoir cinquante, nous ne craignons pas de mourir sans postérité. "
Une réponse si arrogante détermina Salomon à marcher sans plus tarder sur la Bysacène.
Ses troupes occupèrent immédiatement cette riche province, autrefois le grenier de Rome, maintenant inculte et dépeuplé.
Campés dans la plaine de la Manimée, les insurgés l'attendaient au pied d'une longue chaîne de montagnes. De là, s'ils étaient vainqueurs ils pouvaient se porter droit à Carthage. S'ils étaient vaincus, la connaissance qu'ils avaient du pays assurait leur retraite vers le désert.
L'ordre de bataille dans lequel ces Maures orientaux se présentèrent était vraiment remarquable et différait complètement de la manière de combattre des Numides et des Maures occidentaux.
Les chameaux, placés en travers à la suite les uns des autres, formaient un vaste cercle qui, leur servait de retranchement, comme leurs charriots aux Teutons et aux Cimbres. L'infanterie, armée :
- de lances, de boucliers et d'épées, complétait le cercle et en fermait les intervalles.
Au milieu étaient
- les femmes, les enfants, le bagage.
Parmi ces femmes :
- un certain nombre étaient placées de manière à pouvoir prendre part au combat,
- les autres dressaient les tentes,
- pansaient les chameaux,
- aiguisaient les armes.
Enfin, outre cette masse d'infanterie, ainsi disposée dans la plaine, on apercevait sur les hauteurs les plus voisines plusieurs corps de cette cavalerie sauvage et à demi nue qui attaque ou qui fuit, selon les circonstances, avec une égale rapidité.
Le général grec conduisait lentement ses troupes à l'assaut de ce camp défendu par une muraille vivante ; mais effrayés à la vue des chameaux ou rebutés par leur odeur repoussante, les chevaux refusèrent d'avancer.
Alors Salomon donna ordre à sa cavalerie de mettre pied à terre, et portant tous ses efforts sur un tel point, il perça la ligne des chameaux et pénétra dans le cercle : toute l'armée se précipita par cette brèche.
L'infanterie ennemie fut taillée en pièces ...
On assure que cette affaire coûta la vie à plus de dix mille Maures. Cependant ils continuèrent la guerre avec leur opiniâtreté accoutumée. Instruits par leur défaite, ils choisirent un nouveau champ de bataille. Ce ne fut plus dans une plaine ouverte, mais sur une montagne escarpée qu'ils établirent leur camp.
Du côté de l'Est, cette montagne paraissait inaccessible ; elle l'eût été, en effet, pour une armée marchant en ordre de bataille ; mais des hommes agiles et hardis pouvaient parvenir un à un jusqu'au sommet.
Au couchant, la pente était assez douce ; de chaque côté de cette pente s'élevaient deux rochers d'une hauteur prodigieuse, entre lesquels circulait un chemin sinueux et fort étroit : c'était sur ces rochers que les Maures avaient pris position.
Quant au point culminant, qui dominait leur position, le croyant inaccessible, ils avaient jugé inutile de l'occuper.
Parvenu au pied de la montagne, Salomon fit halte pour reconnaître les lieux.
Vers le soir il appela l'un de ses lieutenants, sur la valeur et la prudence duquel il pouvait compter et lui ordonna de choisir dans toute l'armée mille fantassins vigoureux et déterminés.
Sortis du camp en secret, comme pour explorer la campagne à la faveur de nuit, ces hommes d'élite se rapprochèrent du pied de la montagne dont ils gravirent les flans en silence et sans être aperçus. Arrivés au sommet, ils s'y tinrent :
- sans déployer leurs enseignes,
- sans lancer un trait,
- sans pousser un cri.
Dès le point du jour Salomon mit en mouvement le reste de son armée et marcha à l'assaut.
Se croyant sûrs du succès les Maures s'apprêtaient à le recevoir vigoureusement, lorsque levant la tête ils virent flotter au-dessus d'eux les enseignes de l'ennemi et entendirent ses chants de triomphe bientôt suivis d'une grêle de traits l'épouvante se mit parmi eux.
Le chemin de la plaine et celui de la montagne était fermé ; ils se précipitèrent confusément, cavaliers et fantassins, dans les profondes fissures et sur les pentes abruptes des deux rochers latéraux afin de gagner une autre montagne qu'un précipice séparait de celle qu'ils occupaient.
Mais la foule était si grande, la confusion si horrible, qu'ils tombaient les uns sur les autres et roulaient pêle-mêle au fond de l'abîme.
Cinquante mille hommes, dit-on, perdirent la vie dans cette sanglante journée et des tribus entières furent anéanties. La multitude des enfants et des femmes traînés en captivité fut telle qu'à Carthage un enfant maure était livré pour le prix d'un mouton.
Les barbares de l'Afrique proprement dite ne se relevèrent pas de ce désastre et la Bysacène respira plus librement.
Mais la lutte continua en Numidie, pays où les populations étaient plus nombreuses et le terrain plus difficile encore.
Si florissante sous la domination romaine, la Numidie était divisée entre les Grecs et les Barbares, de plus déchirée par les Maures ou Numides qui s'y battaient sur les ruines de la civilisation, paraissant d'accord sur un seul point, celui de menacer incessamment du pillage et de la mort ce qui restait d'habitants d'origine ou de mœurs européennes.
A cette époque, le plus puissant de ces princes était Jabdas, chef des tribus guerrières et populeuses du mont Auraze (Aourès).
Or tandis que Salomon délivrait la Bysacène des bandes insurgées qui la dévastait, ce Jabdas suivi de trente mille hommes que l'amour du pillage avait réunis autour de lui, prenait sa revanche dans la Numidie : toutes les tribus de la province lui obéissaient de gré ou de force ; celles qui avaient voulu lui résister ou suivre d'autre chefs avaient été frappées sans pitié, et pour mieux assurer sa suprématie il avait forcé ses rivaux à chercher un asile auprès des Byzantins.
De leur côté ces bannis imploraient le secours de Salomon, le pressant de venger à la fois ses injures et les leurs, l'assurant que pour se soulever contre Jabdas leurs nombreux amis n'attendaient que la présence d'une armée.
Cédant à leurs instances, Salomon passa en personne dans la Numidie.
Les Maures fugitifs lui servirent de guides dans ce pays qu'il ne connaissait que très imparfaitement ; mais après une marche pénible de sept jours sans rencontrer l'ennemi, n'ayant que très peu de vivres, il jugea prudent de ne pas s'engager plus avant.
D'ailleurs plusieurs circonstances lui avaient déjà rendu suspecte la fidélité de ses guides : nulle de leurs promesses ne se réalisait, aucune tribu ne venait se joindre à eux ; le pays au contraire paraissait complètement désert, et les chemins devenaient de plus en plus difficiles.
Craignant d'être entraîné dans quelque embuscade, le général grec se rendit au vœu unanime de ses troupes et rebroussa chemin.
Sa retraite ne fut pas inquiétée et cette expédition eut au moins pour lui ce double avantage qu'elle lui procurait la connaissance des lieux et leur rappelait qu'il ne faut pas se fier légèrement aux promesses de ces peuplades si mobiles et si disséminées.
De retour à Carthage Salomon prépara une nouvelle expédition, mais cette fois, sans le concours des Maures et avec des approvisionnements suffisants pour n'être point obligé de revenir sur ses pas avant d'avoir atteint son but.
Malheureusement, au moment d'entrer en campagne, une révolte fomentée de longue main par le clergé arien et par les familles vandales restées à Carthage, éclata tout à coup parmi les troupes indigènes qui composaient la majeure partie de son armée.
Ces sectaires avaient formé le projet de sacrifier le gouverneur au pied des autels, au milieu des solennités de la fête de Pâques.
La crainte ou le remord arrêta le poignard des assassins ; mais la sécurité qu'il montra les enhardit et dix jours après éclata dans le cirque une sédition qui se répandit en un instant dans tous les quartiers de la ville : le pillage, le massacre de ses habitants, sans distinction d'âge ni de sexe, ne furent suspendus que par la nuit, le sommeil et l'ivresse de ces forcenés.
Salomon lui-même fut contraint de se réfugier en Sicile, accompagné de sept personnes seulement parmi lesquelles se trouvait l'historien Procope.
Les deux tiers de l'armée prirent part à cette rébellion et huit mille insurgés, assemblés dans les champs de Bulla élurent pour chef un simple soldat nommé Stoza.
Ce chef improvisé avait toutes les qualités nécessaires pour imposer à la multitude :
- brave, actif, entreprenant,
- doué d'une force prodigieuse, sa parole, quoique grossière était persuasive et tous ses actes empreints de cette brutale énergie qui exerce une irrésistible influence sur l'esprit d'une soldatesque indisciplinée.
Sous la conduite d'un tel chef, les Maures espéraient s'emparer de l'Afrique entière. Dans cet audacieux dessein, Stoza fit un appel à ce qui restait encore d'énergique et de guerriers parmi les Vandales.
Il offrit aux esclaves la liberté. Enfin tous ces vagabonds, tous ces hommes perdus de vices qui encombrent ordinairement les grandes villes, vinrent grossir les rangs de son armée, bientôt forte de huit mille hommes.
Avec un tel ramassis de troupes sans nationalité et dépourvues d'esprit de corps, il marcha sur Carthage, comptant y entrer sans résistance.
Mais un brave officier, Théodore, capitaine des gardes de Salomon avait pris le commandement de la ville avec la résolution bien arrêtée de ne la rendre qu'à la dernière extrémité.
Lorsque les rebelles arrivèrent sous ses murs, toutes les dispositions étaient prises à l'intérieur pour soutenir un siège. Malgré les instances de Théodore malgré le sang-froid et l'habileté qu'il déploya en cette grave circonstance, les habitants songeaient à capituler.
Ils avaient même résolu de le faire le lendemain, lorsque Bélisaire entra de nuit dans le port. Il n'avait qu'un seul vaisseau et n'était accompagné que de Salomon avec cent hommes d'élite.
Les troupes de Stoza (chef improvisé élu par les insurgés) dormaient paisiblement sous leurs tentes, s'attendant qu'à leur réveil on leur apporterait les clefs de la ville ; mais au point du jour, quand ils apprirent l'arrivée de Bélisaire, frappés de stupeur rien qu'à ce nom, ils prirent tumultueusement la fuite.
A la tête d'un corps de deux mille hommes seulement, le général les poursuivit à outrance et finit par les atteindre à Membrese (ville située à 16 lieues de Carthage) près du fleuve Bagrada, à dix-sept lieues de Carthage.
Sans leur laisser le temps de se rallier ni de se reconnaître, il les attaque et les presse avec une vigueur que favorise d'une part l'avantage du terrain et de l'autre un vent impétueux qui leur jette au visage et dans les yeux des tourbillons de sable. Enfoncés dès le premier choc, les insurgés prirent de nouveau la fuite et ne se rallièrent que sur le territoire numide, où ils reconnurent non sans une extrême confusion qu'ils n'avaient perdu qu'un très petit nombre des leurs, Vandales pour la plupart.
Bélisaire ne jugea pas à propos de les poursuivre longtemps ; il retourna à Carthage et partit immédiatement pour la Sicile où une insurrection plus importante à réprimer rendait sa présence indispensable.
Salomon de son côté fit voile pour Constantinople. En récompense du service qu'il venait de rendre, Théodore fut appelé au commandement de Carthage et de la province. Marcel ayant sous ses ordres trois lieutenants fut chargé d'observer les insurgés en Numidie.
Brave officier d'ailleurs, ce Marcel s'était distingué dans les positions secondaires, mais il manquait des qualités nécessaires pour commander une armée dans un pays où l'ennemi emploie sans cesse de nouvelles ruses pour vaincre.
Après être resté quelques mois en observation, il apprit que retiré à Gazophyle, petite ville située à deux journées de Constantine, Stoza s'occupait d'y rassembler des troupes.
Il conçut le projet de surprendre les Maures avant que toutes les forces fussent concentrées : idée heureuse en elle-même, et dont cependant les résultats furent désastreux.
En effet, se portant sur Gazophyle, (petite ville située à 2 jours de Constantine) Marcel parvint d'abord à investir complètement l'ennemi. Mais pendant l'exécution de ce mouvement difficile, Stoza avait fait pénétrer dans les rangs de l'armée byzantine d'habiles émissaires chargés de gagner le soldat à sa cause.
Rappelons ici qu'à cette époque de désordres l'armée impériale, mal payée, ne se composait que d'éléments hétérogènes et que l'absence presque complète de discipline ne tendait qu'à l'énerver.
Le jour du combat, Marcel exhortait vainement ses troupes à se conduire avec courage, à fondre avec impétuosité sur l'ennemi. Elles restèrent sourdes à sa voix. De son côté Stoza leur criait : " Avez-vous donc oublié qu'on vous refuse depuis longtemps cette misérable paye, unique salaire de vos fatigues et de vos blessures ?
- Qu'on vous enlève les dépouilles acquises par tant de périls ?
- Que vos généraux prétendent jouir seuls du fruit de vos victoires ?
- Qu'ils s'enrichissent sur votre misère ?
- Qu'ils s'enivrent de votre sang ?
Et vous consentez à servir des maîtres si cupides, si impitoyables !
Ralliez-vous à moi : tout sera commun entre nous, le danger comme la gloire ; nous partagerons en frères :
- les esclaves, les terres, l'or,
- l'argent que nous aurons conquis par nos efforts communs. "
Entraînés par ces séduisantes paroles, les soldats Gréco-Byzantins :
- courent vers Stoza,
- l'embrassent avec effusion,
- l'appellent leur père, et
- jurent de mourir en combattant pour sa cause.
En peu d'instants, l'infortuné Marcel se voit abandonné de tout son monde, à l'exception d'un petit nombre d'officiers grecs.
La fuite leur étant impossible, cette poignée d'hommes restés fidèles se retira avec résignation dans l'église de Gazophyle afin d'implorer l'assistance divine ; mais Stoza les arracha du saint lieu et les fit décapiter en présence des deux armées réunies.
Dès ce moment, l'heureux et hardi soldat se trouva maître de la Numidie et de la Bysacène ; mais son ambition non encore satisfaite le portait à s'emparer de Carthage.
Telle était la situation des affaires en Afrique (537 J.C), lorsque Justinien se décida à y envoyer son neveu Germanus qui, depuis sa brillante campagne contre les Antes (tribu slave du nord du Danube) avait été tenu dans l'inaction.
En arrivant à Carthage Germanus fit la revue des troupes et reconnut que plus des deux tiers de l'armée impériale étaient passés dans les rangs de Stoza.
En outre, tous les soldats, presque sans exception, comptaient un parent ou un ami dans celle du rebelle.
N'ayant amené de Constantinople qu'un très petit nombre de recrues, le neveu de l'empereur comprit que dans des circonstances si difficiles, au milieu d'un tel dénuement, recourir à la force c'eût été tout compromettre : il appliqua son génie à faire jouer les ressorts parfois si puissants de la politique.
Sa mission était toute pacifique, disait-il à ceux qui pouvaient approcher de lui.
Il n'était point venu en Afrique pour punir les soldats mais pour les protéger contre leurs oppresseurs.
Appuyées de la destitution de plusieurs officiers, ces paroles conciliantes ne tardèrent pas à faire cesser le mécontentement et à ramener tout le monde au sentiment du devoir.
Bientôt la plupart des transfuges qu'avait embauchés Stoza revinrent à Carthage où ils furent accueillis avec bonté ; Germanus régla leur solde et leur fit même compter le temps qu'ils avaient servi contre l'empereur.
Une si étonnante générosité décida ceux qui hésitaient encore ; on les vit déserter en masse et venir faire leur soumission.
Recueillant le fruit d'une conduite empreinte toute à la fois de fermeté et de modération, Germanus se voyait enfin à la tête d'une armée capable d'entrer immédiatement en campagne.
De son côté, Stoza, craignant de voir ses forces se fondre complètement par la désertion, prit aussitôt l'offensive, et marcha droit sur Carthage.
Pour encourager les siens, il s'efforçait de les persuader qu'il avait des intelligences dans l'armée ennemie ; que ceux qui paraissaient l'abandonner agissaient de concert avec lui et que dès qu'il le verrait sous les murs de la ville, ils viendraient se ranger de nouveau sous ses étendards.
Voyant les esprits quelque peu rassurés, il porta son camp à une lieue de Carthage. Germanus courut à sa rencontre et déploya en ordre de bataille son armée. Aucun de ses soldats ne quitta les rangs ; tous faisaient retentir les airs des cris de " vive l'empereur ! Mort à Stoza ! "
Ce spectacle inattendu acheva de démoraliser les partisans du rebelle ; saisis d'épouvante, ils tournent le dos sans avoir combattu et s'enfuient vers la Numidie où ils avaient laissé leurs femmes et leurs enfants.
Cependant le vainqueur les poursuivit chaudement et les atteignit dans une plaine nommée Scales.
- Ranger son armée en bataille,
- former une ligne de ses charriots en laissant des intervalles pour le passage de son infanterie,
- se placer lui-même à la tête de l'aile gauche avec l'élite de sa cavalerie, tel est le plan rapidement conçu et exécuté par Germanus, tandis que Stoza ne pouvait refuser la bataille, ranime le courage des siens et les dispose en pelotons à la manière des barbares.
Un très nombreux corps de cavaliers maures commandés par les roi Jabdas et Ortaïas (chef berbère), devait lui prêter un puissant secours ; mais ces princes, jugeant le succès douteux, refusèrent de prendre part au combat et se bornèrent à en attendre l'issue afin de se ranger sous les drapeaux de celui qui favoriserait la victoire. Ce moment se fit peu attendre.
Après une bien faible résistance, l'armée de leur ancien allié fut enfoncée de toutes parts ; et aussitôt, sourds aux prières du malheureux Stoza, Jubdas et Ortaïas fondirent avec leurs cavaliers sur ces bataillons rompus et en désordre.
Quant à lui, après avoir vaillamment combattu, voyant que tout espoir était perdu, il se décida à fuir.
Suivi de quelques Vandales il se réfugia en Maurétanie où il épousa la fille d'un prince du pays et y fixa sa résidence.
Ceux des rebelles qui avaient échappé au carnage vinrent se jeter aux pieds de Germanus qui leur fit grâce de la vie et les incorpora dans ses troupes.
Ainsi fut réprimée cette révolte qui avait failli ruiner la prépondérance des Byzantins en Afrique ; mais elle avait déposé des germes profonds dans les esprits : habitués à passer impunément d'un camp dans un autre, les soldats commencèrent à faire entendre des murmures dès qu'ils se virent enfermés dans les garnisons et assujettis à une vie uniforme et réglée.
Carthage était surtout le grand centre où fermentaient les intrigues, où s'élaboraient les germes des futures insurrections.
Les Ariens excitaient ces mauvaises dispositions en leur promettant des auxiliaires ; pour des chefs, il n'en manquait pas.
Un garde de Théodore, nommé Maximin, se présenta entre autres pour continuer le rôle de Stoza ; mais moins heureux que ce dernier, à peine eut-il accepté cette périlleuse mission, qu'il fut arrêté par les ordres de Germanus, et pendu à l'une des portes de Carthage.
Ce double succès donna à Germanus un immense ascendant moral sur l'armée et sur les habitants : tous ces germes d'insurrection disparurent en présence d'un homme qui savait si bien les comprimer.
Quant à lui, il ne profita de sa victoire et du raffermissement de son autorité que pour extirper les abus qui s'étaient glissés dans l'administration des villes dans la perception des impôts.
Aussi, pendant deux ans que dura son gouvernement,
- l'ordre, la paix,
- la justice régnèrent-elles dans cette partie de l'Afrique.
Les tribus indigènes s'abstinrent de tout pillage, et elle aurait sans doute repris la prospérité dont elle jouissait sous les Romains, si l'épouse de Justinien, Théodora, qui haïssait le neveu de son mari, ne lui eût fait ôter son commandement. Salomon fut nommé à sa place (589 J. C).
C'était pour la seconde fois que l'ancien lieutenant de Bélisaire allait remplir ce poste difficile et si envié. En arrivant à Carthage, il trouva l'ordre rétabli.
Les factions étaient apaisées ; le nom de Stoza avait cessé de retentir dans la bouche des soldats et une rigoureuse discipline les maintenait dans le devoir.
Trois ans auparavant, et il en conservait le souvenir.
Salomon avait inutilement tenté de s'emparer du mont Aurase sur lequel Jadba exerçait un pouvoir incontesté ; il avait donc à cœur de réparer cet échec par un éclatant succès.
D'ailleurs il craignait qu'une inaction trop prolongée ne fît renaître parmi les troupes cet esprit inquiet et mutin auquel son prédécesseur avait si heureusement fait succéder une complète soumission.
Une expédition contre les tribus du mont Aurase fut résolue et presque aussitôt exécutée.
Les monts Aurase (Aurès ou Aourès) sont la portion de la chaîne du grand Atlas qui appartient à la province de Constantine et qui se déploie entre cette ville et Biskra. Cette chaîne imposante, regardée jadis comme le rempart et le jardin de la Numidie, offre dans sa vaste étendue une grande variété de sol et de climats.
Les vallées profondes, les plateaux élevés dont elle se compose renferment de riches pâturages et produisent des fruits d'un goût délicieux et d'une grosseur surprenante. De ses sommets les plus élevés jaillissent des torrents dont le cours ne tarit jamais mais dont les eaux vaporisées par le soleil dans la saison des chaleurs, déposent à leurs pieds de nombreuses roches salines.
Les possesseurs de ces beaux lieux sont les anciens sujets de Bocchus et de Jugurtha : ils ont bien des fois changés de nom pour les nations étrangères, mais leur caractère est resté le même.
Dans leur langage sauvage, ils s'appellent le peuple libre (Imazirgh) et ils le sont en effet :
- Ni les Carthaginois,
- ni les Romains,
- ni les Vandales,
- ni les Grecs,
- ni les Arabes,
- ni les Turcs,
- n'ont pu les assujettir complètement.
Derrière eux est le désert, le désert brûlant et inhabitable. C'est là qu'ils se retirent lorsqu'ils se voient pressés par un ennemi trop puissant ; mais ce n'est que pour revenir bientôt.
Cette terre féconde leur appartient, ils la veulent sauvage comme eux.
- Les villes, les forts,
- les châteaux que les Romains y avaient bâtis couvrent le solde leurs ruines et l'on voit paître des troupeaux parmi les colonnes brisées d'un temple consacré à Escalape.
Toujours en guerre avec lui-même et avec les autres, ce peuple étrange n'épargne personne ; partout il ne voit qu'ennemis ; il n'apparaît dans la plaine que pour :
- piller, brûler, égorger.
C'était contre ces formidables adversaires que Salomon entreprenait une campagne décisive à la tête de toutes ses forces.
La première affaire eut lieu au pied même de ces montagnes abruptes et fut malheureuse pour les Gréco-Romains : peu s'en fallut que, par un habile stratagème, toute leur avant-garde ne fut détruite.
Divisées en un nombre infini de petits canaux, les eaux de l'un des fleuves qui s'en précipitent, servent à l'irrigation des plantations d'arbres et des prairies ; les indigènes en réunirent le volume entier en un seul courant qu'ils dirigèrent sur le camp des assaillants.
Presque en un clin d'œil, un vaste lac se forma autour de ce camp et l'avant-garde, assiégée à la fois par les eaux et par les Maures, eût infailliblement succombé si Salomon, accourant avec le reste de l'armée, ne leur eût arraché la victoire. Il les poursuivit jusqu'au milieu de leurs inaccessibles retraites et ne leur laissa ni paix ni trêve qu'il ne les eût chassés complètement.
Les précipices affreux dans le fond desquels ils essayaient d'échapper, les roches escarpées sur lesquelles ils se réfugiaient avec leurs familles comme dans des nids d'aigles, furent assiégés tour à tour comme autant de forteresses.
Enfin le dernier asile de leur chef ayant été enlevé par surprise :
- ses femmes, ses enfants,
- ses trésors, tombèrent entre les mains des vainqueurs.
Lui-même ne parvint qu'à grand peine à gagner le Sahara.
Maître de ces hauteurs qui depuis longtemps interceptaient les communications entre la Bysacène et la Numidie, Salomon s'y établit solidement au moyen de forts qui commandaient tous les défilés par lesquels les montagnards descendaient dans le plat pays.
La sécurité et le commerce reparurent dans la partie de l'Afrique qui avait été soumise aux Romains : les antiques cités d'Adrumète et de Leptis retrouvèrent une partie de leur splendeur passée ; Carthage fit fortifiée et embellie.
Les villes d'une moindre importance ne furent pas non plus négligées : Dans les unes on construisit des bains publics, dans les autres :
- des aqueducs, des églises, des promenades.
Toutes furent environnées de remparts suffisants pour les mettre à l'abri d'un coup de main. La prospérité du pays semblait encore une fois assurée ; mais ces brillantes espérances furent presque aussitôt déçues.
En voulant favoriser l'avancement de jeunes officiers incapables et efféminés, le général compromit l'avenir de son propre ouvrage.
Eunuque dès sa plus tendre jeunesse, par suite d'un funeste accident, Salomon n'avait point d'enfants ; en revanche il portait le plus vif intérêt à ses deux neveux Cyrus et Sergius.
Ces jeunes hommes lui tenaient lieu de fils. Il les fit venir en Afrique et obtint pour Cyrus le gouvernement de la Pentapole (duché italien de l'empire byzantin de la côte Adriatique), pour Sergius celui de la Tripolitaine.
Sans mérite et sans expérience, fiers du pouvoir de leur oncle, ils se crurent en droit de tout oser.
Une tribu de Maures, nommée Leucathes, était venue sous les murs de Leptis, (ville Tunisienne) résidence de Sergius pour renouveler son alliance avec les Gréco-Romains et recevoir du gouverneur les présents accoutumés, quatre-vingts de leurs députés furent introduits dans la ville et Sergius les fit asseoir à sa propre table.
Tout à coup, sans aucun motif plausible, il accuse ces Maures de trahison et les livre aux poignards d'assassins aposté par lui.
Un seul de ces malheureux échappa au massacre et vint apporter à ses frères cette sinistre nouvelle.
Aussitôt le cri de guerre retentit dans toutes les vallées de l'Atlas, depuis les Surtes jusqu'à l'océan atlantique ; les Maures marchent en masse sur Leptis ; mais mal commandés, ils sont aisément vaincus.
Toutefois ils ne se découragent pas et, organisant une armée plus considérable que la première, envahissent le Pentapole. Antalas, chef d'une autre partie du pays, jusqu'alors resté fidèles aux Gréco-Romains, joignit ses forces à celles de ses compatriotes et marcha sur Carthage.
Il était personnellement irrité contre Salomon qui après avoir fait mourir son frère, accusé de trahison, lui avait retranché à lui-même les provisions de vivres qu'il recevait annuellement pour prix de sa neutralité.
Cependant l'exarque (haut dignitaire) était sorti de Carthage à la tête de ses troupes, accompagné de ses neveux, dans la ferme résolution de châtier sévèrement les rebelles ; mais les ayant rencontrés aux environs de Sébeste (ville de Turquie), la supériorité de leur nombre et de leur contenance farouche, lui imposèrent, et il proposa de traiter avec eux, offrant de se lier par les serments les plus solennels : " Par quels serments peut-il se lier ? répondirent avec indignation ces hommes à bon droit ulcérés. Jurera-t-il sur les Évangiles, Livre que la religion chrétienne regarde comme divin. C'est sur ce livre que son neveu Sergius avait engagé sa foi à quatre-vingts de nos innocents et malheureux frères ! S'il veut que les Évangiles nous inspirent une seconde fois quelque confiance, qu'il commence par nous donner des preuves de leur efficacité, en châtiant le parjure : C'est le seul moyen de réparer l'honneur de son livre sacré. "
Cet honneur fut réparé dans les champs même de Sébeste par la mort de Salomon et par l'entière destruction de son armée.
Les Maures étaient supérieurs en nombre ; les Gréco-Romains combattirent mollement parce que la veille on leur avait refusé une part dans le butin enlevé à l'ennemi : Salomon, seul à la tête de ses gardes, se défendait courageusement lorsque son cheval s'étant abattu, il roula dans un ravin où il fut massacré.
En apprenant la mort de son lieutenant, Justinien confia le commandement de l'Afrique à Sergius. Il était impossible de faire un plus mauvais choix.
- Présomptueux,
- inhabile,
- perdu de débauche, ce violateur de la foi jurée abusait chaque jour de son pouvoir. Il devint également odieux aux officiers, aux soldats et surtout aux populations qu'il était appelé à gouverner.
D'autres actes d'oppression et de cruauté firent éclater l'orage et tous les Maures se réunirent sous les ordres d'Antalas pour le chasser de Carthage.
Stoza lui-même sortit de sa retraite afin de le seconder.
Vainement Antalas, qui ne faisait la guerre qu'à regret, écrivit-il, à Justinien qu'il était prêt à poser les armes s'il rappelait cet indigne gouverneur ; ses remontrances ne furent pas écoutées ; une volonté plus forte que celle de l'empereur protégeait Sergius. Théodora l'avait désigné et l'Afrique devait le subir.
Tous les vices qui infestaient la cour de Byzance firent donc irruption dans cette malheureuse province. D'un côté les soldats qui ne recevaient ni soldes, ni vivres,
- pillaient et saccageaient les propriétés des particuliers,
- les officiers dilapidaient le trésor public ;
De l'autre les Maures poussaient leurs courses jusque sous les murs de Carthage ravageant les villes et les campagnes. Tel était le sort de cette malheureuse contrée, lorsque enfin l'empereur et ses indignes conseillers se décidèrent à donner un collègue à Sergius : le choix tomba sur Aérobinde, sénateur d'une naissance illustre et mari de Préjecte, nièce de Justinien.
Ce personnage était au-dessous de sa mission mais on lui adjoignit Athanase, préfet du prétoire, Jean d'Arsacides et son frère Artabane, officiers capables et remplis d'expérience. Sergius resta chargé de faire face aux Maures de la Numidie. Aréobinde eut à combattre ceux de la Bysacène.
En arrivant à Carthage, le nouveau général apprit que Stoza et Antalas campaient à trois journées de cette ville, près de Sicca Veneria ; il donna aussitôt à Jean de Sisinniole l'ordre de les attaquer et fit demander des renforts à Sergius.
Mais celui-ci ne tint aucun compte de sa lettre et le laissa livré à ses propres forces. Jean ne pouvait disposer que d'une faible armée ; il n'en attaqua pas moins l'ennemi car depuis longtemps il avait voué à Stoza une haine profonde.
Dès qu'il le voit s'avancer à la tête des siens il court à lui et le provoque en personne. Stoza, plein de bravoure, accepte le défi et la lutte s'engage entre les deux chefs pendant que leurs armées attendent dans une complète immobilité le résultat de ce combat singulier.
Enfin blessé grièvement Stoza tombe de cheval. A ce signal les Maures se précipitent sur les Gréco-Romains, les enveloppent de toutes parts, s'emparent de leur général et le tuent.
La défaite fut complète, les principaux chefs, ainsi que Jean Arsacides périrent dans la mêlée et Stoza apprit avant de mourir l'éclatante victoire qui vengeait sa chute : " Je meurs, content s'écria-il puisque les ennemis de mon pays sont vaincus ! "
Lorsque la nouvelle de cette défaite fut parvenue à Constantinople, Justinien reconnut la faute qu'il avait commise en scindant le gouvernement de l'Afrique. Il rappela Sergius et laissa Aréobinde présider seul aux destinées de ce pays.
Mais Sergius et Aréobinde étaient aussi, incapables l'un que l'autre de maîtriser ces fières et indomptables tribus de l'Atlas, toujours prêtes à la révolte, toujours excitées par de nouveaux mécontents.
A peine ce dernier était-il installé dans ses fonctions de gouverneur qu'un nouveau chef se présente pour remplacer Stoza.
Cet autre ambitieux était Gontharis, ancien officier de Salomon qui commandait alors en Numidie et s'était distingué à l'attaque des monts Aourès.
Il révéla son dessein à Antalas lui promettant la Bysacène s'il consentait à le seconder : l'offre fut acceptée et tout aussitôt les Maures se dirigèrent sur Carthage Tandis que lui-même rentrait dans la ville pour faire soulever les soldats et les habitants : " Voyez le lâche gouverneur qui nous a été envoyé de Constantinople ! s'écriait-il. Pendant que les ennemies sont à nos portes, il s'enferme dans son palais, entouré de femmes, vivant au sein de toutes les voluptés, dépensant en festins et en plaisir l'argent destiné à votre solde. Il s'apprête à fuir, au lieu de se préparer au combat. Prévenons-le, saisissons-nous de sa personne ; je trouverai dans les trésors qu'il se réserve de quoi payer tout ce qui vous est dû. "
Entraînés par ces paroles captieuses, les soldats prononcent la déchéance du gouverneur et élèvent sur leurs boucliers Gontharis à qui ils prêtent le serment d'obéissance.
Au premier bruit de cette révolte Aréobinde se disposait à prendre la fuite, mais une tempête l'empêcha de s'embarquer. Pendant ce temps un de ses lieutenants Artabane, homme de courage et d'exécution, de la famille des Arsacides, rassemblant aussi ses Arméniens et les soldats grecs restés fidèles marchait contre Gontharis.
Pressés de toutes parts les conjurés commençaient à battre en retraite, lorsque le pusillanime Aérobinde, qui n'avant jamais assisté à aucun combat, courut se réfugier dans une église située au bord de la mer, où il avait déjà fait retirer sa famille avec ses trésors.
Les troupes suivirent son exemple, malgré les efforts que faisaient Artabane pour les retenir.
Maître du palais et du port, Gontharis députe l'évêque de Carthage vers l'exarque expulsé, pour lui assurer qu'il ne lui sera fait aucun mal s'il se rend auprès de lui.
Aérobinde croyant pouvoir se fier à la parole de son bienheureux adversaire, vient se prosterner à ses pieds vêtu d'une casaque d'esclave, Gantharis :
- le relève, lui promet de le faire partir le lendemain puis
- l'invite à sa table où il le place près de lui ;
- enfin il lui donne pour la nuit un appartement dans le palais.
Ce malheureux se croyait déjà hors de danger, mais à peine commençait-il à se livrer au sommeil que des gardes entrent brusquement dans sa chambre et le massacrent malgré ses supplications.
La tête d'Aréobinde fut envoyée à Antalas par Gontharis qui lui refusa la cession de la Bysacène se croyant assez fort pour manquer impunément à sa parole.
Sans hésiter le chef maure réunit ses troupes à celles de Marcentius qui commandait cette province au nom de l'empereur.
Artabane entra secrètement dans cette ligne et pour mieux seconder les projets de ses alliés, il feignait de reconnaître l'autorité de Gontharis (officier de Salomon) Celui-ci lui confia la direction de la guerre contre Antalas (chef berbère) et Marcentius (officier byzantin) : c'était détruire l'édifice qu'il venait d'élever au prix de tant de crimes.
En effet, Artabane se retirant chaque jour devant les troupes auxquelles il était opposé, parvint à persuader l'usurpateur que lui seul était capable de terminer la guerre.
Son dessein secret était de l'attirer hors de Carthage afin de se débarrasser de lui : mais ayant trouvé l'occasion favorable, il le fit poignarder au milieu d'un repas qu'il donnait à ses généraux et à ses courtisans la veille du jour fixé pour son départ. Pour prix de ce service, Artabane reçut la main de Projecte, veuve d'Aréobinde (sénateur) et alla habiter le palais des empereurs à Constantinople.
Gontharis n'avait exercé que pendant trente-six jours un pouvoir usurpé.
Jean Troglita, frère de Pappus le mathématicien, déjà illustre dans plusieurs campagnes, fut enfin l'homme que la cour de Byzance fit succéder aux inhabiles et ambitieux gouverneurs qu'elle avait envoyés en Afrique.
- Il dispersa les Maures dans une première rencontre,
- reprit sur eux les enseignes perdues dans la bataille où Salomon avait trouvé la mort et
- finit par remporter sur les tribus libyennes une suite de victoires décisives dans lesquelles périrent dix-sept de leurs princes.
Ce furent les derniers exploits des Gréco-Byzantins : on le célébra à Constantinople par des fêtes splendides et un poème héroïque fut publié Johanneis, la Jeanneide (ce poème écrit par Flavius Cresconius Crippus parait avoir été perdu. Cuspinien le vit au mont Cassin et il en cite plusieurs vers dans son histoire des Césars. C'est ce qui faisait soupçonner à Barthins, cent ans après, que l'un des manuscrits pouvait avoir été transféré à Vienne.
Il invitait avec insistance les savants à en faire la recherche ajoutant que s'il pouvait en obtenir une copie à quelque prix que ce fût il suspendrait tout autre travail pour ne s'occuper que de la publication de ce poème avec un commentaire. Léon Marcier en fait l'éloge dans la chronique du mont Cassin sur cette guerre si glorieusement terminée (548).
Mais ce n'était encore qu'une soumission incertaine et passagère : retirés dans le désert et dans les parties inaccessibles de l'Atlas, les tribus n'attendaient que le moment favorable pour reprendre les armes.
Chacun des évènements qui vinrent successivement miner les forces du Bas-Empire détermina en Afrique une déplorable victoire de l'homme sauvage sur l'homme civilisé.
Les Maures ne se rebutaient pas ; leur vie errante dans d'immenses déserts les aidait efficacement à se soustraire au joug d'un conquérant qu'affaiblissaient de jour en jour ses discordes intestines.
Aussi, avant même la fin du règne de Justinien, leurs incursions réitérées avaient réduit le territoire de la province d'Afrique à un tiers de celui que Rome avait possédé.
En Numidie la domination byzantine ne s'étendait guère au-delà des premières chaîne de l'Atlas ; sur le littoral les villes de :
- Césarée,
- de Tingis et
- de Septem n'assuraient que très imparfaitement cette domination en dehors de leurs enceintes.
A l'intérieur la plupart des villes furent obligées d'élever de nouvelles fortifications pour se mettre à couvert des attaques toujours plus vives et plus fréquentes des nomades. Ces précautions trahissaient des dangers réels, dangers que chaque heure voyait s'accroître.
Telle était la dévastation de cette contrée à la fin du règne de Justinien, qu'en plusieurs cantons un voyageur marchait des jours entiers sans rencontrer ni amis, ni ennemis.
La nation des Vandales qui compta un moment cent soixante mille guerriers, outre :
- les femmes, les enfants et les esclaves était anéantie.
Une guerre impitoyable avait fait périr un nombre incalculable de Maures.
Le climat, les divisions intestines n'enlevèrent pas moins de monde aux Gréco-Romains.
Lorsque Procope avait débarqué pour la première fois en Afrique, il admirait la population des villes et des campagnes, l'activité du commerce et de l'agriculture ; en moins de vingt ans, cette contrée n'offrait plus qu'une muette solitude.
Les citoyens opulents s'étaient réfugiés en Sicile et à Constantinople, le reste avait été décimé par les guerres et par les persécutions de tout genre.
(Procope assure que dans l'espace de vingt années, depuis l'invasion de Bélisaire, la population de l'Afrique diminua de cinq millions d'habitants).
A tant de causes de dissolution il faut joindre la rapacité du fisc impérial qui se montra encore plus oppresseur envers le peuple que ne l'avait été le gouvernement vandale.
On à peine à concevoir l'exagération insensée des impôts prélevés sous les successeurs de Justinien.
L'un d'entre eux, Anastase avait imaginé d'imposer le droit de respirer l'air. Les registres qui constataient les anciens tributs ayant, pour la plupart, été brûlés ou dispersés.
Les collecteurs ou exacteurs n'en furent que plus inventifs à créer de nouvelles taxes. Un grand nombre de soldats avaient épousés les veuves ou les filles des vaincus, et réclamaient pour leur propre compte les terres qui avaient autrefois fait partie du domaine de l'empire : partagés entre les conquérants, ces terres portaient encore le nom d'héritages des Vandales.
Ces prétentions combattues à leur tour par les descendants des anciens Romains, lesquels revendiquaient l'héritage de leurs pères, faisaient naître des procès interminables, source de ruine pour les familles.
Afin d'en tarir la source, un écrit impérial prononça l'exil de toutes les femmes vandales.
Près d'un siècle s'écoule dans cet état d'oppression et de dépérissement continu et voit cinq empereurs occuper le trône :
- Justin II,
- Tibère II,
- Maurice,
- Phocas et
- Héraclius.
Quels que soient leur caractère privé, leurs vertus ou leurs vices, chacun d'eux ne s'occupe de l'Afrique que pour en tirer de nouveaux impôts ; aussi, la population européenne y diminue-t-elle constamment.
Encore vivace sur les rives du Bosphore, partout ailleurs l'empire gréco-Byzantin ne présente plus que des ruines.
Les gouverneurs envoyés en Afrique pour tirer sa dernière goutte de sang à un peuple épuisé, se hâtent de dévorer une proie que les Maures leur disputent et que les Visigoths d'Espagne, déjà maîtres de Ceuta menacent de leur arracher.
Déplorable et horrible lutte qui continuera jusqu'au moment où un peuple nouveau, poussé par son fanatisme non moins que par la soif du pillage, sortira de ses déserts pour conquérir la partie septentrionale de l'Afrique et lui imposer ses mœurs et ses lois.
L'Afrique ancienne et moderne
depuis les premiers établissements carthaginois par
Léon Galibert, Directeur de la revue britannique. Édition 1842
|
|
| Domination arabe (622-1490 de J. C)
Envoi de M. Christian Graille
|
|
I
L'histoire de l'Afrique septentrionale sous la domination romaine nous a montré l'importance que le sénat et les empereurs attachaient à la possession de cette contrée.
Les Grecs du Bas Empire en sentirent également le prix ; mais pour la conserver, il eut fallu une énergie soutenue non moins éclairée.
L'affaissement moral dans lequel était tombée la cour de Byzance ne lui permit pas de garder longtemps cette position et de la défendre contre les nouveaux envahisseurs.
De toutes les conquêtes des Arabes, la plus longue et la plus difficile sans contredit, fut celle de l'Afrique.
Si les Gréco-Romains ne leur opposèrent qu'une faible résistance, les terribles populations de l'Atlas que nous avons vu si souvent aux prises avec les conquérants étrangers, ne cédèrent le terrain que pied à pied.
l ne fallut aux Arabes pas moins de trois expéditions successives pour consolider leur puissance, encore n'y parvinrent-ils que grâce à la communauté d'origine qui, suivant la tradition, existait entre eux et les Maures.
Comme la période de domination arabe est une des plus importantes de l'histoire d'Afrique, il est nécessaire :
- de remonter à la naissance du mahométisme,
- de dire l'origine des nouveaux conquérants,
- d'indiquer les lieux qu'ils habitaient,
- d'expliquer leur caractère,
- leurs opinions religieuses,
- leurs coutumes et leurs mœurs.
L'Arabie forme une grande presqu'île, bornée :
- à l'Est par le golfe persique,
- au Sud par la mer des Indes,
- à l'Ouest par la mer Rouge.
C'est une vaste contrée absolument dépourvue d'eau, car le petit nombre de rivières qui l'arrosent sont peu profondes et se perdent dans le sable non loin de leur source. Les anciens divisaient l'Arabie en trois parties principales :
- L'Arabie pétrée,
- l'Arabie déserte et
- l'Arabie heureuse.
L'Arabie pétrée, située au milieu de la Palestine et dans la partie occidentale du golfe arabique était habitée par les Madianites qui furent successivement attaqués plutôt que soumis par les Juifs, sous David ensuite par les Perses et les Romains.
Madiana (Megar-el-Chouaïb) en était la capitale. Le nom moderne de cette ville signifie grottes de Jéthro, parce que c'est là, suivant la tradition, que demeurait Jéthro, beau-père de Moïse.
Les Iduméens, peuple pasteur, descendant d'Esaü, frère de Jacob, occupaient la région septentrionale de cette partie de l'Arabie. A l'Est de l'Idumée vivaient les Nabatéens, nation nombreuse, issue de Nabajoth, fils aîné d'Ismaël.
L'Arabie heureuse (Arabia felix) est située entre le golfe arabique et le golfe persique : c'est le Yemen des Arabes et le pays où croît l'encens ; elle doit son nom à sa fertilité et sans doute aussi au commerce de parfum que faisaient et que font encore ses habitants. Dans cette contrée s'élève la Mekke (la Macaraba des anciens) dont on attribue la fondation à Abraham.
On y distingue encore Hawr sur la mer Rouge où les Romains avaient établi une douane ; Médine ou la ville du prophète et l'ancienne Saba, Sabbara, la scheba des Hébreux qui était la capitale de toute l'Algérie heureuse.
L'Arabie déserte qui comprend une région immense et aride entre l'Arabie pétrée et l'Arabie heureuse, s'entend au Nord-Est jusque vers la Mésopotamie ; elle était habitée comme aujourd'hui par différentes races d'Arabes :
- C'étaient les Bédouins ou Arabes scéniques ;
- les Ituriens autres peuples adonnés au vol et au brigandage, vivant sur les limites du désert,
- les Rubénites de la tribu de Ruben,
- les Ismaélites, descendant d'Agar, race qui, à une époque a été plus particulièrement connue sous le nom de Sarrasins.
Les géographes modernes, d'après Aboufeda (historien, écrivain) l'ont partagé en six régions :
- Le Berriah ou le désert au Nord,
- le Barkheim et l'Oman, districts maritimes situés en face de la Perse,
- l'Hedjaz et l'Yémen, à l'occident, en regard de l'Afrique et
- le Nedjid, vaste plateau qui s'élève au centre, semblable à une île entourée de sables et de plaines basses.
Les mêmes géographes classent la race arabe en trois grandes familles :
- les Arabes primitifs ou ceux qui habitèrent les premiers l'Arabie après le déluge et dont les descendants s'allièrent avec les peuples qui vinrent plus tard s'établir dans le pays,
- les Arabes purs, c'est-à-dire ceux qui, après la confusion des langues se fixèrent dans l'Yémen et repoussèrent toute alliance étrangère, enfin
- les Mosarabes ou Arabes naturalisés.
Elien (historien) qui vivait sous le règne d'Adrien, nous a laissé une esquisse des mœurs arabes à son époque ; elles offraient la plus grande analogie avec celles d'aujourd'hui. " Ce peuple, dit-il, est voisin des Nabatéens ; ce sont des guerriers à demi nus, vivant tous de la même manière, et ne portant que de petites saies (courts manteaux) de couleur qui s'arrêtent au haut des cuisses.
Montés sur de rapides coursiers et secondés par des chameaux agiles, ils sont toujours errants çà et là, qu'ils soient en paix, qu'ils soient en guerre. Aucun d'eux :
- ne touche à la charrue,
- ne soigne un seul arbre,
- ne demande à la terre cultivée sa subsistance ;
- toujours en mouvement, ils sont :
- sans foyer, sans demeure fixe, c'est sans loi.
Pour eux voyager, c'est vivre.
Le gouvernement de ces peuples était purement patriarcal.
Dans chaque tribu, le plus ancien de certaines familles privilégiées était investi de pouvoirs étendus pour la direction ou la défense des intérêts communs, et ses décisions étaient toujours fidèlement exécutées.
Quant aux rapports de tribus à tribus, les contestations qui s'élevaient entre elles,
- soit pour la possession de pâturages,
- soit par suite d'enlèvement de bestiaux, étaient soumis au conseil des cheiks ou anciens qui prononçaient souverainement : cela n'empêchait pas les parties d'en venir aux mains lorsqu'elles croyaient à se plaindre du jugement prononcé.
Parmi les sujets de discorde, le plus fréquent et le plus grave était l'extrême divergence des opinions religieuses :
- Quelques-unes de ces nombreuses tribus adoraient le soleil et les étoiles,
- plusieurs admettaient la transmigration des âmes,
- d'autres leur supposaient le sentiment après la mort,
- celles-ci immolaient à leurs idoles des moutons et des chameaux,
- celles-là ensanglantaient leurs autels par des sacrifices humains.
Chaque chef de famille, tout homme influent, se croyait le droit de modifier le culte ou d'en imposer un nouveau. De cette confusion inextricable naissaient :
- des querelles,
- des luttes et
- des haines sans nombre.
Ainsi ce peuple énergique, endurci aux rudes fatigues et si admirablement constitué pour exécuter de grandes entreprises, se trouvait sans cesse entravé par des querelles intestines.
Pour le rendre conquérant, il fallait qu'un homme supérieur parvint à lui faire accepter une foi commune, afin d'entraîner dans une direction unique ces volontés si diverses.
Cette tâche difficile Mahomet eut la gloire de l'accomplir. (D'après les documents les plus certains, Mahomet est né le 10 novembre 570 de J. C).
Sa famille appartenait à la tribu de Koraïsch, laquelle prétendait descendre en ligne directe d'Ismaël, fils d'Abraham.
Après la mort de son père et de son aïeul, le jeune orphelin fut recueilli par un de ses oncles qui exerçait la première autorité à la Mekke, en qualité de chef des Koraïschites (tribu des Arabes du Nord au sein de laquelle naquit Mahomet).
Abou-Thaleb éleva son neveu avec la plus touchante sollicitude, l'initiant à tous les détails de son négoce, l'emmenant même avec lui en Syrie lorsque ses affaires commerciales l'y appelaient.
Pendant un de ces voyages, ils s'arrêtèrent à Bostra (ville du Sud de la Syrie) dans un monastère où un moine nestorien (partisan d'une doctrine affirmant que deux hypostases, l'une divine, l'autre humaine coexistent en Jésus-Christ) les reçut avec cordialité.
Ce moine que les Arabes nommaient Bohaïra et les Grecs Sergius, présagea, dit-on la grandeur futur de cet enfant, âgé alors de treize ans mais que la sagesse de ses discours, la régularité de sa conduite avaient déjà fait surnommer al Amin (le Fidèle).
A vingt ans Mahomet fit ses premières armes sous les ordres d'Abou-Thaleb qui, comme tous les chefs arabes, était à la fois :
- guerrier, négociant et pontife.
Dans ces diverses expéditions, il se distingua par son courage et bientôt on le cita comme le plus brave de la tribu ; peut-être même eût-il été appelé à un commandement si son extrême jeunesse ne s'y était opposée.
Il n'avait pas encore atteint sa vingt-cinquième année lorsqu'une jeune et riche veuve, nommée Khadidja, dont il administrait les biens, lui offrit sa fortune et sa main.
A trente-cinq ans, il fut appelé à résoudre une grave difficulté qui s'était élevée entre les Kraïschites à l'occasion de la pause de la pierre noire du temple de la Caâbah. (on pense que cette pierre est un aérolithe, pierre tombée du ciel).
Les Musulmans la regardent comme le gage de l'alliance que Dieu lie avec les hommes et ils croient qu'Adam l'avait emportée en sortant du paradis terrestre. Elle fut remise par l'ange Gabriel à Abraham lorsqu'il bâtit la Caabah. Cette pierre est placée à hauteur d'homme à l'un des angles du temple).
Ainsi la richesse et la considération souriaient à cet homme déjà si remarquable ; mais des circonstances plus favorables encore vinrent lui ouvrir une carrière digne de son génie.
L'anarchie religieuse ne régnait pas en Arabie seulement ; les Chrétiens d'Orient, divisés en une infinité de sectes, se persécutaient avec fureur tandis que la cour de Constantinople, toute occupée de querelles théologiques abandonnait l'empire aux ravages des Persans , qui eux-mêmes se trouvaient épuisés par de longues guerres civiles et par les entreprises de leur souverain.
Ce fut au milieu de ces conflits divers que Mahomet crut pouvoir se donner comme inspiré de Dieu. Il avait d'ailleurs toutes les qualités nécessaires pour remplir ce rôle surnaturel :
- une imagination ardente,
- une éloquence persuasive,
- une rare présence d'esprit,
- une fermeté et un courage inébranlable et
- possédait à un haut degré l'art de dissimuler, ressort indispensable aux ambitieux qui veulent faire tourner à leur profit les passions et la crédulité des hommes.
- Enfin, les livres du christianisme ne lui étaient pas moins familiers que ceux de Moïse.
Jusqu'à l'âge de quarante ans, le futur prophète n'avait rien négligé de ce qui peut frapper les yeux de la multitude : affectant une grande austérité de mœurs, il passait des mois entiers dans les vastes solitudes du mont Haro moins sans doute pour prier qu'afin de mûrir ses projets dans la retraite et la méditation.
Enfin, résolu de faire dans sa propre famille le premier essai de son influence religieuse, il dit un jour à sa femme que l'ange Gabriel lui était apparu la nuit, l'appelant apôtre de Dieu, et lui intimant au nom de l'Éternel l'ordre d'annoncer aux hommes les vérités qui devaient lui être révélées.
Khadidja, transportée de joie à l'idée d'être la femme d'un prophète, s'inclina devant son époux et le salua comme un envoyé de Dieu.
Le second disciple de Mahomet fut Ali, son cousin germain, âgé de dix à douze ans, fils de cet Abou-Thaleb qui avait pris soin de son enfance.
Après Ali, l'esclave Zaïd confessa hautement la mission divine de son maître et en reçut la liberté pour récompense.
Mahomet gagna ensuite un homme fort considéré parmi les Arabes et dont la grande influence servit admirablement ses projets : c'était son beau-père Abou-Bekr, magistrat civil et criminel à la Mekke.
Il ne s'agissait plus que de donner un nom à la religion nouvelle : On l'appela Islam, mot arabe qui exprime l'action de s'abandonner à Dieu.
Nous ne parlerons point des difficultés sans nombre dont fut assailli Mahomet lorsqu'il voulut pour la première fois annoncer publiquement sa mission. Se raidissant contre les obstacles, il continua de prêcher sa doctrine et parvint à attacher à sa cause deux puissants prosélytes : Rammzah, l'un de ses oncles et le fameux Omar, qui de son plus ardent adversaire devint un de ses serviteurs les plus dévoués. Cependant l'heure du triomphe n'était pas encore venue : le nouveau prophète était sans cesse en butte aux sarcasmes de la multitude.
- On l'insultait,
- on le persécutait de mille manières,
- les habitants de Taïef l'assaillirent même un jour à coups de pierre et
- faillirent le massacrer.
Mais toujours les persécutions religieuses produisent un effet contraire à celui qu'on s'était proposé. Il en fut ainsi pour Mahomet.
Chaque jour le nombre de ses prosélytes allait croissant ; tandis qu'une partie de la population le maudissait, l'autre, plus ardente, recueillait avec ferveur ses paroles comme une émanation divine.
Parmi ses partisans les plus dévoués, six habitants du Jathreb (ville juive, future Médine) de la tribu juive de Kharadj se firent particulièrement remarquer : ils jurèrent de le soutenir de tout leur pouvoir. Leur promesse fut scrupuleusement remplie.
De retour dans leur foyer, ces néophytes proclamèrent hautement l'excellence de l'islamisme et déterminèrent deux autres tribus à s'attacher au prophète. On nomma ces nouveaux convertis Ansariens, c'est-à-dire auxiliaires.
Pendant que Mahomet s'occupait sans relâche de propager sa nouvelle croyance, les Koraïschistes, ses concitoyens, formaient secrètement le projet de se défaire de lui.
L'exécution de cette criminelle entreprise avait été confiée à des hommes choisis parmi toutes les tribus, afin que le meurtre, une fois accompli, ne pût à l'avenir faire entre eux un sujet d'aucune récrimination.
La vigilance de Mahomet déjoua le complot ; mais il fut obligé de quitter la Mekke et se retira au Jathreb où il comptait des amis sûrs.
Accompagné de ses principaux disciples, Ali ne tarda pas à l'y rejoindre.
Cette fuite est devenue si célèbre que les musulmans en ont fait le commencement de l'ère dont ils se servent ; ils la nommèrent hedjah (hégire), mot arabe qui signifie fuite. (Cette ère commence le 1er de moharrem, premier mois de l'année musulmane, jour qui correspond au vendredi 16 juillet 622 de Jésus-Christ.
Mahomet avait alors cinquante-quatre ans ; c'était la quatorzième année de sa mission.
La ville de Jathreb capitale du district, reçut le nom de Médinah-al-Naby (ville du prophète) ou simplement Médine. Depuis cette époque, elle est restée parmi eux l'objet de la plus grande vénération.
A partir de ce moment, la vie de Mahomet ne présente qu'une longue suite de batailles et de luttes de tout genre, qu'il serait inutile de rapporter ici.
Nous, nous bornerons à dire qu'en dix ans il termina, soit par lui-même, soit par ses lieutenants un grand nombre d'entreprises guerrières qui contribuèrent à fonder sa puissance en imposant sa religion à presque toute l'Arabie.
Chacune de ses victoires, comme on le pense bien, était signalée par des prodiges indices certains de l'intervention divine. Aussi la plus grande exaltation religieuse régnait-elle dans son armée : " Mes frères, s'écriait-il souvent au milieu des dangers, je suis le fils et le protégé d'Allah, je suis l'apôtre de la vérité ; hommes soyez constants dans la foi : Dieu va nous envoyer des secours. "
Et aussitôt les fuyards faisant volte-face, fondaient sur l'ennemi avec une impétuosité à laquelle rien n'était capable de résister.
Après la victoire Mahomet se montrait inexorable envers les vaincus qui se refusaient à embrasser l'islamisme : ainsi lors de la prise de Taïef les habitants de cette ville lui ayant demandé une trêve de trois ans et le libre exercice de leurs cultes (ils adoraient les idoles) : " Non, leur répondit Mahomet, je ne vous accorderai pas un mois, pas un jour. Dispensez-nous, du moins, de la prière. La religion est inutile sans la prière. "
Les uns furent convertis, les autres massacrés. (A la suite d'une de ces expéditions quelques soldats ivres ayant failli le tuer par mégarde, Mahomet interdit à ses sectateurs l'usage du vin, des liqueurs fortes et des jeux du hasard. Cet ordre fut rigoureusement exécuté dans la suite, comme un des préceptes de l'islamisme.
Non content de convertir par la force des armes, Mahomet envoyait des missionnaires dans tous les pays limitrophes de l'Arabie.
- La Perse, la Syrie, Constantinople même reçurent ces missionnaires, qui lançaient insolemment l'anathème contre tous ceux qui se montraient sourds à leurs voix.
Quelques villes les chassèrent, comme fauteurs de troubles et de discordes ; d'autres les virent avec indifférence, le plus grand nombre les combla de présents.
Ce fut au milieu de ce mouvement énergique de propagande que la mort vint frapper Mahomet, l'an 11 de l'hégire, le lundi 12 de rabieh (632 de J. C).
Les derniers jours de sa vie ne firent qu'augmenter encore l'enthousiasme de ses sectateurs : " S'il y a un homme, avait-il dit peu avant de mourir, que j'ai traité avec injustice, qu'il le dise, et qu'il exerce contre moi des représailles ; consens.
Si j'ai flétri la réputation d'un musulman, qu'il s'avance et déclare la faute dont je suis coupable.
Si j'ai dépouillé un fidèle de ses biens, je lui dois le capital et l'intérêt de sa dette.
Le peu que je possède est à sa disposition. "
Un des assistants s'avança et réclama trois drachmes d'argent. Mahomet les lui fit compter en le remerciant de l'avoir accusé dans ce monde et non dans l'autre.
Il montra, dit Gibbon, une fermeté tranquille à l'approche de la mort :
- il affranchit ses esclaves, (dix-sept hommes et onze femmes),
- régla l'ordre de ses funérailles, et
- donna sa bénédiction à tous ceux qui l'entouraient, gardant jusqu'au dernier moment de sa vie toute la dignité d'un apôtre et toute la confiance d'un prédestiné.
Il avait dit un jour dans un entretien familier que, par la prérogative spéciale, l'ange de la mort ne viendrait s'emparer de son âme qu'après lui en avoir demandé la permission. Quelques instants avant de mourir, il déclara qu'il venait de l'accorder. Puis la tête penchée sur les genoux d'Aïcha, la plus chérie de ses femmes, il articula d'une voix défaillante ces paroles entrecoupées : " Dieu…pardonnez mes péchés…oui… je vais retrouver mes concitoyens qui sont au ciel … "
Et il rendit le dernier soupir, étendu sur un tapis qui couvrait le plancher de sa chambre.
Ceux de sa famille qui se trouvaient le plus près de lui par les liens du sang l'ensevelirent à l'endroit même où il expira.
Sa mort et sa sépulture ont consacré Médine et les innombrables pèlerins qui tous les ans se rendent à la Mekke se détournent souvent pour aller faire leurs dévotions sur la tombe du Prophète.
En mourant, Mahomet laissait achevée l'œuvre qu'il avait pris à tâche d'accomplir pendant sa vie.
L'Arabie n'était plus déchirée par les factions.
Les différentes tribus se trouvaient animées d'un même esprit et formaient un grand corps soumis aux même lois religieuses et politiques.
A la bravoure, à l'esprit aventureux de leurs devanciers, les sectateurs du Coran avaient ajouté une force nouvelle, l'union.
Ils n'avaient tous qu'un même but, la propagation de l'islamisme.
Pour soutenir et propager ce mouvement il fallait un homme digne de succéder au Prophète.
Trois concurrents se présentaient au suffrage des Arabes :
- Ali, le premier des vrais croyants,
- Omar, le plus brave des lieutenants de Mahomet
- et le vénérable Abou-Bekr.
Ce dernier fut élu d'une voix unanime.
Et ses premiers actes il exalta au plus haut degré l'enthousiasme de ses coreligionnaires.
A sa voix les habitants des vallées de l'Yemen et les pasteurs des montagnes d'Oman, toutes les tribus qu'éclairent depuis la pointe septentrionale de Belis, sur l'Euphrate jusqu'au détroit de Bab-el-Mandeb, et depuis Bassora sur le golfe Persique, jusqu'à Suez et aux confins de la mer rouge, vinrent en foule se ranger sous ses drapeaux aux cris mille fois répétés de : La Allah ill Allah, Mohammed rassoul Allah ! (Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son Prophète).
Confiants dans le succès et dédaignant la prudence, les chefs arabes se mirent à attaquer tous leurs voisins à la fois. Vezid-Ben-Ali reçut l'ordre d'aller conquérir la Syrie ; Khaled-ben-Walid, surnommé le glaive de Dieu fut chargé d'envahir la Perse ; les villes :
- de tésiphon, de Malayn, d'Hémadan, Caszwin, Tauris firent leur soumission.
Rien ne résistait au flot envahisseur.
Franchisant ensuite l'Oxus (fleuve Amour Daria naissant dans les montagnes du Pamir) les Arabes réduisirent les vastes régions situées entre ce fleuve, le Juxartes et la mer Caspienne, refoulant leurs ennemis jusqu'aux frontières de la Chine.
La mort vint surprendre Abou-Bekr au milieu de ses triomphes ; mais cet évènement ne ralentit pas d'un seul jour la marche de son armée.
Appelé au califat, le fougueux Omar poursuivit avec activité la guerre commencée par son prédécesseur en Perse et en Syrie. Les villes :
- de Gérusa,
- de Philadelphie et
- de Bosra que les empereurs avaient entourées d'une ligne de forts, tombèrent en son pouvoir.
Damas elle-même l'ancienne capitale de la Syrie, ouvrit ses portes après avoir soutenu un siège de soixante-dix jours.
La chute de cette place importante amena la reddition des autres villes de la province. En très peu d'années :
- la Syrie, la Perse, la Judée
- furent soumises à la loi du prophète, aussitôt les armées arabes se dirigèrent sur l'Afrique. Amrou-Ben-el- Aasi marchait à leur tête.
Ce général, l'un des plus célèbres capitaines des premiers temps de l'islamisme devait le jour à une courtisane, qui de cinq Khoraïstes qu'elle recevait chez elle ne put dire lequel était le père de son fils.
Ce fut, d'après la ressemblance des traits qu'elle en attribua la paternité à Aasi, le plus ancien de ses amants.
Amrou, dans sa jeunesse avait montré une haine profonde contre le Prophète, qu'il avait plusieurs fois attaqué dans des vers satyriques : Mais Mahomet parvint à le convertir et à en faire l'un des plus fidèle sectateurs du Coran, l'un de ses champions les plus intrépides.
Abou-Bekr et Omar durent à sa bravoure et à ses talents militaires la conquête de la Palestine.
On rapporte qu'Omar ayant un jour prié Amrou de lui montrer le glaive qui avait massacré tant de chrétiens, celui-ci lui présenta un petit cimeterre dont la forme n'avait rien d'extraordinaire ; le calife parut surpris : " Hélas ! s'écria Amrou avec modestie, sans le bras de Dieu, ce cimeterre n'est ni plus tranchant ni plus lourd que le sabre de Farezduk le poète ! "
Nommé gouverneur de la Syrie, qu'il avait contribué à soumettre, Amrou se dirigeait vers l'Égypte quand il reçut une lettre d'Omar qui lui ordonna de revenir s'il n'était pas encore entré dans le pays.
Se trouvant en ce moment à peu de distance des frontières, il fit doubler le pas à ses troupes ; lorsqu'il eut atteint le sol égyptien, il ouvrit la lettre du calife.
Après l'avoir lue en présence de ses officiers, " continuons notre marche, s'écria-t-il puisque déjà nous avons dépassé la frontière. "
Son armée ne se composait que de quatre mille hommes ; cependant elle s'empara de Peluse (ville d'Égypte) et de Merr en très peu de temps.
Pour consolider sa conquête, Amrou jeta les fondements d'une ville nouvelle, qu'il nomma Fostat, aujourd'hui Le Caire ; puis il vint assiéger Alexandrie dont il s'empara après un siège des plus opiniâtres. C'est à la suite de ce brillant succès qu'il écrivait au calife Omar : " J'ai pris la grande ville de l'occident. Il me serait impossible de faire l'énumération des richesses et des édifices qu'elle renferme.
Il me suffira de dire qu'elle possède :
- quatre mille palais,
- quatre mille bains,
- quatre cents théâtres ou lieux de plaisirs,
- douze mille boutiques de comestibles et
- quarante mille Juifs tributaires.
La ville a été subjuguée par la force des armes ; elle n'a obtenu ni traité ni capitulation et mes soldats sont impatients de jouir des fruits de leur victoire. "
On connaît la réponse que les écrivains chrétiens ont mis dans la bouche d'Omar lorsque son général lui demanda ce qu'il devait faire à la bibliothèque d'Alexandrie : " Si les écrits des Grecs sont d'accord avec le Coran, ils sont inutiles, il ne faut pas les conserver ; s'ils contrarier les assertions du livre saint, ils sont dangereux et on doit les brûler. "
Les mêmes écrivains ajoutent que les volumes renfermés dans cette bibliothèque, dont la destruction est à jamais déplorable, furent distribués aux quatre mille bains de la ville et que six mois suffire à peine à les consumer tous.
Cependant des jalousies profondes, des rivalités ambitieuses éclataient déjà parmi les conquérants arabes.
On se rappelle que des trois candidats qui s'étaient présentés pour succéder à Mahomet, Abou-Bekr l'emporta et, qu'avant de mourir, il désigna Omar comme calife. Mais Ali avait de nombreux adhérents qui soutenaient ses prétentions.
Il se forma alors deux partis rivaux d'où sortirent la secte des Shictes, qui maintiennent que, si Mahomet est l'apôtre de Dieu, Ali est le vicaire de la divinité, et la secte des Sonnites ou musulmans orthodoxes.
Omar mourut assassiné, et Othman qui lui succéda, eut le même sort.
Le parti vainqueur promut aussitôt Ali, qui malgré sa longue expérience des hommes ne put calmer ces dissensions.
Les deux rivaux se livrèrent en Syrie une bataille sanglante.
Ali fut tué dans la mêlée et Mohawyah-ben-Omnyah, chef des musulmans sunnites, devint calife.
Le nouveau chef fixa sa résidence à Damas et exposa dans la mosquée la robe ensanglantée d'Osman en appelant les orthodoxes à la défense de sa cause. Soixante-dix mille Syriens jurèrent de lui être fidèles et de combattre pour lui.
Ces dissensions qui ensanglantaient le mahométisme à son berceau, lui seraient devenues fatales si les chefs arabes n'étaient pas de temps en temps parvenus à les assoupir.
L'intérêt de leur politique, le danger de leur position et surtout l'amour du pillage, leur commandaient ces soudaines réconciliations car les pays qu'ils avaient conquis, loin d'accepter sans conteste leur domination profitaient de toutes les circonstances favorables pour se débarrasser d'un joug odieux.
Après la complète réduction de l'Égypte, l'attention des Arabes se porta sur l'Afrique septentrionale que le patrice Grégoire, profitant des désordres de l'empire de Byzance gouvernait alors plutôt à titre de roi indépendant que de lieutenant de son maître.
Abdallah, fils de Saïd et frère de lait du calife Othman, le plus habile et le plus courageux des cavaliers de l'Arabie fut chargé de cette expédition.
Parti d'Égypte à la tête de quarante mille guerriers, Abdallah pénétra dans les régions qui avaient échappé à la domination romaine et après plusieurs jours d'une marche pénible dans le désert, il arriva sous les murs de Tripoli, ville maritime, dont les habitants s'étaient enfuis avec ce qu'ils avaient de plus précieux. Cent vingt-mille Grecs, commandés par le patriarche Grégoire, s'avancèrent à sa rencontre.
Le général musulman envoya d'abord offrir la paix au patrice, à condition d'embrasser avec ses sujets l'islamisme ou du moins de se reconnaître pour son tributaire. Mais celui-ci ayant rejeté ces propositions, il fallut combattre.
Les deux armées déployèrent dans cette première rencontre un égal acharnement. On rapporte même que la fille du patrice, jeune personne d'une rare beauté, combattait auprès de son père qui avait promis sa main avec cent mille pièces d'or à celui qui lui apporterait la tête du général ennemi.
Cette offre séduisante redoubla l'ardeur des Africains et les Arabes allaient être culbutés si Abdallah n'eut également promis à ses soldats que quiconque lui apporterait la tête du patrice recevrait la même récompense.
Après un combat sanglant, la victoire resta aux Arabes. Grégoire fut tué dans la mêlée et sa fille tomba au pouvoir de l'ennemi.
Les vaincus se retirèrent en désordre à Sofaytala, ville importante, située à cent cinquante milles au Sud de Carthage ; mais ils abandonnèrent bientôt cette place qui tomba au pouvoir des vainqueurs.
Les habitants de la province consentirent les uns à embrasser l'islamisme, les autres à payer le tribu.
Cependant cette journée était loin d'être décisive. Épuisée par les fatigues et les maladies épidémiques, l'armée victorieuse fut obligée de regagne l'Égypte et la soumission définitive de l'Afrique septentrionale se trouva ajournée.
Une seconde invasion fut entreprise par le calife Moawyah (653). Cette fois les Arabes étaient appelés par les habitants eux-mêmes, qui, en butte aux exactions et au despotisme intolérable des ministres de la cour de Byzance, voulaient s'y soustraire à tout prix.
Ils avaient même envoyé une députation à Damas, pour inviter ce calife à rentrer en Afrique afin de la placer sous sa domination.
L'armée musulmane, composée de l'élite des troupes de Syrie et d'Égypte, s'avança donc jusqu'à l'extrémité de la Pentapole (ville de Palestine).
Elle mit en fuite les Byzantins et s'empara de l'antique Cyrène (ville de Chypre) ; mais un ordre venu de Damas l'arrêta au milieu de ses succès et elle fut obligée de revenir sur ses pas.
Toutefois Moawyah n'abandonnait pas ses projets de conquête ; il cédait seulement à la nécessité de comprimer avec toutes ses forces des symptômes d'insurrection qui venaient de se manifester en Égypte et en Syrie.
Une troisième invasion fut plus heureuse ; elle eut lieu sous les ordres de Oukbah-ben-Nafy (Okba) qui ayant déjà fait partie de l'expédition précédente était demeuré longtemps à Baréah dans le double but de contenir les Berbères et de les convertir au mahométisme.
Oukbah était le plus brave des lieutenants du calife et c'est à lui qu'appartient à bon droit le surnom de vainqueur de l'Afrique. Ce fut lui aussi qui, parmi les Arabes, porta le premier le titre de ouali (gouverneur) de l'Afrikiah. (Les Arabes comprenaient alors sous cette domination presque tout le pays qui forme aujourd'hui la régence de Tunis et de Tripoli.)
Oukbah défie en plusieurs rencontres l'armée des Byzantins, qui trop faibles pour lui résister s'étaient réunis aux Berbères, soumit complètement la Bysacène, puis, se portant vers l'Ouest, s'empara de Bougie et marcha vers Tanger. En vain les Berbères voulurent s'opposer à son passage, ils furent complètement défaits.
Oukbah les poursuivit dans toutes les directions et ne s'arrêta que sur les bords de l'Atlantique. Ce fut là qu'avec tout l'enthousiasme d'un zélé musulman il poussa son cheval dans l'océan, et, que brandissant son cimeterre, il s'écria : " Grand Dieu ! Si je n'étais pas retenu par les flots, j'irais jusqu'aux royaumes inconnus de l'Occident. De la, je prêcherais sur ma route l'unité de ton saint nom et j'exterminerais les peuples qui adorent un autre Dieu que toi ! "
Maître de cette vaste contrée, Oukbah voulut en assurer la soumission en fondant une grande ville qui servit aux musulmans de place d'armes pour étendre leurs conquêtes et de lieu de retraite en cas de revers.
Lorsque l'emplacement fut choisi, il fit élever une forte muraille en briques, flanquée de tours, sur un circuit d'une lieue et demie ; il y construisit ensuite des palais et une mosquée spacieuse qu'ornaient cinq cents colonnes :
- de granit, de porphyre ou de marbre de Numidie.
De nombreuses habitations se groupèrent bientôt autour de ces édifices.
Kairouan fut le nom de cette nouvelle ville qui devint la résidence habituelle des gouverneurs arabes en Afrique et quoiqu'elle n'offre aujourd'hui que des ruines, elle fut pendant plusieurs siècles célèbre par sa splendeur et ses écoles publiques. (De la frontière de Tunis à l'océan atlantique la plus grande partie du littoral n'avait pas cessé d'appartenir à l'empire grec.
La conquête arabe s'était d'abord dirigée le long du revers méridional de l'Atlas, à travers ces tribus sauvages, voisines du désert, ennemies des villes et de leurs habitants, alliées naturelles de l'islamisme vainqueur.
C'est ainsi que les débris des anciennes populations grecques et carthaginoise voyaient se rétrécir chaque jour leur territoire et se trouvaient de plus en plus resserrées entre la mer et le désert.
Carthage, elle-même, nommée par les Arabes Kasthadjma, centre et siège des positions byzantines, était incessamment menacée par Kairouan, place à huit jours de marche.
Fier de ce résultat et considérant la puissance du calife comme définitivement établie dans le Maghreb, Oukbah ne songeait qu'à embellir sa ville et y attirer des habitants.
Les Berbères, profitant de sa sécurité, descendirent en foule de leurs montagnes, se joignirent aux Byzantins chez qui l'arrivée d'une flotte et d'une armée avait ranimé une lueur d'espérance, et ils marchèrent ensemble contre les Musulmans.
Ne se laissant pas effrayer par le nombre, Oukbah s'avance à la rencontre de l'ennemi, décidé à couronner par une mort honorable la gloire de ses exploits passés.
On raconte qu'à cet instant décisif, ayant fait appeler un chef arabe du nom de Mouéghir, qu'il traînait à sa suite et dont il était jaloux, il lui dit en l'embrassant :
- " Ami, c'est aujourd'hui le jour du martyre et des palmes les plus précieuses que puisse cueillir un musulman. Je ne veux pas que tu perdes une si bonne occasion.
- Je te rends grâce de m'accorder cette faveur, répondit Mouéghir, car j'ai le vif désir de partager une telle félicité. "
A ces mots, brisant les fourreaux de leur cimeterres ils s'élancent ensemble dans la mêlée. De tels hommes pouvaient être accablés mais non vaincus.
La bataille fut longue et opiniâtre : les deux chefs réconciliés combattaient au premier rang, portant la mort de tous côtés.
Les Berbères et les Byzantins, terrifiés, semblaient hors d'état de se défendre.
Cependant leur nombre ranimant leur courage, ils entourèrent les deux héros, dispersent leurs gardes et finissent par les massacrer.
Oukbah expira sur le monceau de cadavres, et le champ de bataille qui fut son tombeau est encore aujourd'hui un monument de sa valeur : il a conservé le nom de champ d'Oukbah (la mort d'Oukbah est attribuée à Koseilah-Ben-Behram, chef des Berbères converti depuis à l'islamisme.)
Sous le poids de cette défaite, l'invasion arabe recule jusqu'à Barkah. Zohaïr-Ben-Kaïs, successeur d'Oukbah essaie de la continuer mais après quelques succès balancés succombe sous les effets des Barbares et des Byzantins réunis.
Hassan le Gassanide, gouverneur de l'Égypte, envoyé en Afrique avec quarante mille hommes, parvient enfin à fixer la victoire.
Il marche droit sur Carthage, l'emporte d'assaut et après l'avoir livrée au pillage la détruit de fond en comble, désespérant sans doute de pouvoir s'y maintenir. Le siège de la domination arabe continua d'être concentré à Kairouan.
Ainsi, malgré les vicissitudes qu'elle avait d'abord éprouvées, la puissance des califes n'a cessé de grandir en Afrique.
Après Hassan, Moussa-Ben Nosaïr, investi du gouvernement de ce pays, pousse ses conquêtes jusqu'à Sousse et constitue définitivement le gouvernement du Maghreb.
Mais après avoir vaincu les Byzantins et les Maures, les musulmans allaient rencontrer de nouveaux ennemis.
Maîtres de l'Espagne et de quelques villes du littoral africains, les Goths étaient pour eux d'incommodes voisins. Ils avaient récemment donné des secours à Carthage lors du siège de cette ville par Hassan.
Ainsi s'emparer de l'Espagne étaient pour les vainqueurs de l'Afrique une espèce de représailles et de plus un premier pas vers l'asservissement futur de l'Europe. Dans leurs rêves de conquête :
- ils espéraient traverser les Pyrénées,
- soumettre la Gaule et l'Italie,
- réduire les peuples de la Germanie,
- suivre le Danube depuis sa source jusqu'au Pont Euxin (situé en Turquie),
- renverser l'empire de Constantinople et repassant d'Europe en Asie
- rattacher ces conquêtes au gouvernement des provinces de Syrie.
C'était embrasser le pourtour de la Méditerranée et fonder un nouvel empire romain.
Ce projet gigantesque plaisait à l'imagination aventureuse des Arabes. La conquête de l'Espagne leur paraissait d'ailleurs ne présenter aucune difficulté sérieuse.
En effet les Goths n'étaient plus ces terribles barbares qui, après avoir humilié l'orgueil de Rome et s'être enrichi de ses dépouilles, avaient promené leurs armes triomphantes du Danube à la mer Atlantique.
Séparés du reste de l'Europe par les Pyrénées, les successeurs dégénérés d'Alaric s'énervaient dans les douceurs d'une longue paix ; les remparts de leur ville tombaient en ruines, la discorde régnait parmi eux.
A la suite d'un outrage fait à sa fille par le roi Rodéric, le comte Julien, l'un de leurs généraux, venait de faire des ouvertures secrètes à Tarik-ben-Zaïd, lieutenant de Moussa, lui offrant d'introduire les Arabes au cœur de l'Espagne.
Tarik choisit 500 cavaliers et traversa sur quatre grandes barques le détroit qui séparait Tanger de la rive opposée.
A la tête de cette petite troupe, il parcourut les côtes de l'Andalousie sans rencontrer aucune résistance.
Après avoir fait un butin immense et un grand nombre de prisonniers, il revint en Afrique (juillet 710).
Encouragé par ce succès, il prépara une expédition plus considérable ; et dès les premiers jours du printemps de l'année suivante, il repassa en Espagne et débarqua au pied du mont Calpé auquel il donna son nom. (Gebel-Tariçk, aujourd'hui Gibraltar). En apprenant cette nouvelle agression, Rodéric, qui prenait le titre de roi des Romains, marcha à la rencontre de Tarik avec une armée de cent mille hommes.
Le général arabe n'en comptait que vingt mille y compris les mécontents que l'influence du comte Julien avait jetés dans ses rangs.
La bataille s'engagea aux environs de Cadix, auprès de la ville de Xérès et de la petite rivière de Guadalète qui séparait les deux camps.
Elle dura neuf jours et la victoire fut longtemps indécise. Un moment la défaite des Arabes parut certaine. Ils pliaient de toutes parts lorsque Tarik arrêtant les fuyards leur crie : " Frères, l'ennemi est devant vous et la mer derrière ! Où pourriez-vous vous retirer ? Suivez-moi ! J'ai résolu de mourir ou de fouler à mes pieds le roi des Romains. "
A ces paroles les Arabes reforment leurs rangs et se jettent avec fureur sur l'ennemi. La mort de Rodéric, tué d'un coup de lance, décida de cette journée.
Dès ce moment les Arabes furent maîtres de l'Espagne.
Après sa victoire Tarik partagea son armée en trois corps :
- le premier se porta sur Cordoue et s'en empara,
- le second soumit la côte de Bétique ou le royaume de Grenade,
- avec le troisième il se porta du Bétis au Tage, traversa la sierra Morena qui sépare l'Andalousie de la Castille, et parut bientôt sous les murs de Tolède.
Entré dans cette ville sans résistance, il laissa aux habitants :
- leurs propriétés,
- leurs lois et même
- leurs temples à la condition qu'ils n'en élèveraient pas de nouveaux et
- s'abstiendraient de faire des processions publiques.
Maître de la capitale, Tarik parcourut les provinces centrale de l'Espagne, et détruisit les restes épars de l'armée des Goths.
De si grands et si rapides succès excitèrent la jalousie de Moussa-Ben-Nozaïr
Afin d'enlever à son lieutenant le profit et l'honneur de cette conquête, il se hâta de quitter son gouvernement avec des forces considérables et franchit le détroit.
Son armée se composait de dix mille Arabes et de huit mille.
Il avait sous ses drapeaux les plus nobles d'entre des Koraïschistes.
Moussa réduisit Séville et quelques autres villes que Tarik avait laissées derrière lui, et qui depuis son éloignement avaient secoué le joug du vainqueur.
- Cormora fut emporté d'assaut.
- Mérida se rendit après une longue résistance.
- Le Portugal et la Galice se soumirent également.
Cependant la jalousie de Moussa contre Tarik était plus violente que jamais.
Vainement celui-ci était allé à sa rencontre et lui avait présenté une large part du butin.
Loin d'être touché par cette soumission, Moussa lui adressa de vifs reproches, l'accusant d'avoir méconnu son autorité et d'avoir compromis l'armée qui lui était confiée.
Enfin consommant son injustice,
- il le priva de son commandement,
- le fit charger de fers, et
- s'oublia, dit-on, jusqu'à le frapper.
Sur les ordres du calife, Valid 1er, Tarik fut peu de temps après rendu à la liberté et on lui remit le commandement d'un corps d'armée avec lequel il conquit :
- une partie de l'Aragon,
- de la Catalogne et
- de la province de Valence.
- Ces deux chefs parurent un moment oublier leurs querelles, mais cette réconciliation fut peu durable.
- Moussa dans ses expéditions, s'appropriait tout le butin fait sur l'ennemi.
Tarik, au contraire, abandonnait le sien à ses soldats, n'en prélevant que la cinquième partie pour le calife.
A SUIVRE
|
|
| MARCHE ARRIÈRE
De Jacques Grieu
| |
Certains, en écrevisse, prônent la marche arrière,
L'historien, lui aussi, ne regarde qu'hier.
Prophète du passé, fouineur de cimetière,
C'est en arrière-plan qu'il met les faits divers.
Le retour en arrière et la fuite en avant,
Pour le vrai voyageur sont proscrits tout autant.
Regarder en arrière est mauvais pour le cou
Et nous fait nous cogner aux choses devant nous.
L'ayatollah Poutine apprit à ses dépends
Qu'il n'est pas si aisé de foncer en avant
Quand c'est contre un pays à l'âme si vaillante
Qu'il renvoie tous les chars en retraite humiliante.
La guerre, on peut la faire au moment que l'on veut
Mais pour la terminer, on le fait quand on peut.
Le retour est souvent plus ardu que l'aller
Et tourner les talons est parfois malaisé.
Un coup porté au dos est une offense vile,
Et celui par devant est un affront hostile.
Le coup bas est-il pire ? Ou encor le coup haut ?
Par devant, par derrière, ce sont toujours des maux.
Ce qui ne se dit pas est le plus avéré :
Nos arrière-pensées sont notre vraie pensée.
De l'animal pensant, c'est ce qui nous distingue,
Qu'on soit aveugle ou muet ou encore… bilingue !
Regarder en avant, regarder en arrière ?
Regarder vers le haut serait plus… salutaire ?
Vers le haut, vers le bas, que faisaient nos aïeux ?
Question d'orientation pour savoir où est Dieu ?
Jacques Grieu
|
|
|
| Domination arabe (622-1490 de J. C)
Envoi de M. Christian Graille
|
|
II
Valid 1er vint à mourir sur ces entrefaites et Soliman son frère lui succéda. Le nouveau calife rappela ces deux généraux qu'il fit paraître devant lui.
Moussa fut exilé à la Mekke où il mourut.
Tarik, lui-même tomba en disgrâce peu de temps après. Telle était déjà à cette époque la justice distributive des musulmans.
Nous ne suivrons pas les tribus de l'Ymen dans leurs excursions au-delà des Pyrénées.
- Laissons-les s'établir à Narbonne réclamer la province du Languedoc à titre de dépendance de la monarchie espagnole,
- inonder les provinces de l'Aquitaine après avoir battu l'intrépide Eudes dont la fille avait épousé un chef arabe,
- laissons-les arborer leurs drapeaux victorieux sur les murs de la capitale de la Touraine er essuyer enfin une défaite sanglante aux environs de Poitiers.
Ce qui nous importe ici c'est de rechercher quelle espèce de civilisation les nouveaux conquérants apportèrent dans le Maghreb, et comment ils parvinrent à faire accepter leurs mœurs et leurs croyances religieuses aux différents peuples de l'Afrique septentrionale.
Les califes de Damas et de Bagdad n'avaient pas tardé à dédaigner la simplicité des premiers musulmans et à vivre dans la pompe et la splendeur.
On peut s'en faire une idée par le récit suivant de l'historien arabe boulféda : " Toute l'armée du calife était sous les armes, la cavalerie et l'infanterie formaient un corps de cent soixante mille hommes. Les grands officiers, ses esclaves favoris, vêtus de la manière la plus brillante, portant des baudriers étincelant d'or et de pierreries se trouvaient rangés autour de sa personne.
Venaient ensuite sept mille eunuques et sept cents portiers ou gardes des appartements.
Des gondoles richement décorées promenaient leurs banderoles sur le Tigre ; la somptuosité régnait partout dans l'intérieur du palais. On y remarquait :
- trente-huit mille pièces de tapisserie
- parmi lesquelles
- douze mille cinq cents étaient de soie, brodées en or.
On y trouvait
- vingt-deux mille tapis de pied.
- Le calife entretenait cent lions qui chacun avait un garde.
- Entre autres raffinements d'un luxe merveilleux, il ne faut pas oublier un arbre d'or et d'argent dont les dix-huit branches étaient chargées d'oiseaux de toute espèce ; cet arbre s'agitait à volonté comme ceux de nos bois, et alors on entendait un mélodieux ramage. "
Damas et Bagdad trouvèrent des imitateurs :
- au Caire, à Fez, à Kairouan, en Espagne.
C'est ainsi que le troisième et le plus grand des Abderrhamanes éleva à trois milles de Cordoue, en l'honneur de sa sultane favorite,
- la ville, le palais et les jardins de Zehra.
Les sculpteurs et les architectes les plus habiles de Byzance furent appelés pour la construction et l'ornementation de ces édifices qui étaient soutenus par douze cents colonnes de marbres :
- d'Espagne, d'Afrique, de Grèce et d'Italie.
On y voyait :
- des incrustations d'or et de perles,
- des figures d'oiseaux
- et de quadrupèdes, les seuls êtres vivants que sa loi religieuse permit à l'artiste musulman de retracer.
Sillonnée sans cesse par le passage de leurs armes qui se rendaient en Espagne, l'Afrique ne demeura pas étrangère à cette magnificence ; en effet à l'époque de la conquête de Maghreb les Arabes y avaient trouvé des traces nombreuses de la grandeur romaine que leur esprit prompt à s'enflammer dut naturellement chercher à imiter, et qu'ils firent entrer comme éléments dans leurs créations artistiques et architecturales.
- Kairouan, Fez et Maroc brillèrent d'un grand éclat dans les sciences et les lettres, et leurs écoles rivalisèrent avec celles de Cordoue.
La culture en avait été recommandée aux Arabes par le Prophète lui-même.
" Enseignez la science du Coran, car l'enseigner c'est glorifier Dieu.
La dispute sur la science est une dispute sacrée. Par la science on distingue ce qui n'est juste de ce qui n'est injuste. Elle est :
- la lumière sur le chemin du paradis,
- une confidente dans le désert,
- une compagne dans la solitude,
- un guide fidèle dans le bonheur et le malheur.
Les anges désirent son amitié ; tout ce qui existe sur la terre brigue sa faveur. Elle est le remède des cœurs contre la mort et l'ignorance, le luminaire des yeux dans la nuit de l'injustice. "
La littérature arabe se divisait en deux parties distinctes. la première embrassait :
- les mathématiques, l'astronomie, la physique,
- la philosophie c'est-à-dire ce que ces peuples avaient puisé à des sources étrangères,
La seconde tout ce qui lui appartenait en propre, c'est-à-dire :
- les ouvrages d'histoire, géographie, de poésie, de philologie.
Les Œuvres :
- d'Euclide, d'Archimède, d'Apommonius, de Ptolémée devinrent la base de leurs études mathématiques.
La plus célèbre des versions d'Euclide est celle de Nassir-Eddin qui a été imprimée à Rome à la fin du XVIe siècle
Le bel ouvrage astronomique de Ptolémée acquit une si grande autorité chez les Arabes que l'astronomie est souvent appelé par eux la science d'Almedjisti dérivé du grec (signifiant très grand). Ils firent connaître cet ouvrage en Europe et encore aujourd'hui son titre arabe (Almajest) nous est plus familier que celui que porte l'original grec.
Non contents de traduire et de commenter les auteurs grecs, ils y ajoutèrent beaucoup d'éclaircissements fondés sur leurs propres recherches, simplifièrent les méthodes et préparèrent la voie aux découvertes importantes de nos mathématiciens modernes.
C'est encore à eux que l'arithmétique est redevable de l'usage des chiffres et du système décimal ; ce sont eux qui ont simplifié les opérations trigonométriques par la substitution du calcul des sinus à celui des cordes (théorème dans lequel les particules ponctuelles de la physique des particules sont représentées par des objets ….).
Ce sont eux enfin qui, par l'introduction de l'algèbre ont fourni aux savants modernes un des plus puissants moyens d'analyse mathématique.
Ils ne cultivaient pas avec moins d'ardeur la médecine et les sciences naturelles.
C'est dans Hippocrate et surtout dans Aristote qu'ils puisèrent les principes de leurs connaissances physiques et médicales.
Le préjugé religieux les empêcha de se livrer à l'anatomie ; en revanche ils tirent de grands progrès dans :
- la thérapeutique, la pharmacologie, la chimie et
- la botanique. Parmi les auteurs qui ont écrit sur la médecine et l'histoire naturelle on peut signaler les savants :
- Abou-Behlur-Al-Razi (932) surnommé le Gallien arabe qui écrivit le premier sur la petite vérole,
- Isak-Ben-Someiman, israélite de Kouraman (941) célèbre par son ouvrage sur les fièvres,
- Abou-Ali-Hosain-Siner, dit Avienne(1.036) dont le nom et les écrits furent longtemps regardés, même en Europe, comme la base de toute science médicale,
- Abou-El-Kasi-Al-Zahari (1106) auteur d'une méthode médicale universelle dans laquelle on distingue surtout d'excellents traités de chirurgie.
On peut mentionner encore :
- Abou-El-Valed-Ibn-Ruschd (1198), son disciple,
- le rabbin Mous-Ben-Macinoun (1208),
- Abdallah-Ibn-Beitar (1248), voyageur et botaniste,
- Abou-Vahya-Zacariyya-Al-Kuzwini (1281) le Pline des orientaux, célèbre par son grand ouvrage sur les merveilles de la nature et
- Kemadeddin-Mohamed-Ben-Mousa-Damiru (1405) auteur d'une histoire d'animaux.)
Les Arabes importèrent avec eux dans le Mahgreb toutes ces connaissances, fruit d'une haute civilisation mais ils éprouvèrent de plus grandes difficultés à y faire adopter leurs doctrines religieuses.
Ce ne fut qu'un demi- siècle après l'expulsion des Byzantins, qu'Abderrhaman, gouverneur d'Afrique, annonçait au calife Abboul-Abbas la conversion des infidèles. Il avait fallu déployer contre ces populations toutes les rigueurs de la conquête pour leur faire abandonner leurs idoles.
Mahomet avait dit dans le Coran : " Combattez les infidèles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus lieu aux disputes, combattez jusqu'à ce que la religion de Dieu domine seule sur la terre ! "
Quelques-uns de ses successeurs immédiats suivirent ce précepte à la lettre.
Mais ce procédé barbare n'était guère applicable à de grandes masses de populations.
Quand les musulmans eurent étendu leurs conquêtes, ils furent obligés de se montrer moins intolérants.
Ainsi, en Afrique et en Espagne, ils se contentèrent d'engager :
- les idolâtres,
- les juifs et
- les chrétiens à embrasser l'islamisme, leur laissant le libre exercice de leur culte ;
Ils se contentèrent de les subalterniser politiquement en les soumettant à un tribut et leur interdisant l'accès des fonctions publiques.
Cette barrière qui séparait le vainqueur du vaincu, il ne dépendait que de celui-ci de la faire disparaître en prononçant la formule sacramentelle : " Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. "
Aussitôt il entrait dans la société islamique et y prenait une place proportionnelle à ses talents et à son courage. Il ne faut donc pas s'étonner que toutes les populations africaines, à l'exception peut-être de quelques tribus errantes dans le désert, aient accepté la religion de Mahomet.
Toutefois ces conversations intéressées ne produisirent pas pour l'empire des califes, les heureux fruits qu'ils s'en étaient promis.
Avec l'islamisme entra chez les tribus berbères ce cortège de schismes et d'hérésies qui détruisirent l'entité musulmane.
Sous le titre commun de Khouaridj, des sectaires de noms et de croyances diverses (Ibadis, Sofris) formèrent en Afrique le germe de discussions pareilles à celles qui, déjà sous les empereurs chrétiens, l'avaient tant de fois ensanglantées.
Ces mêmes tribus qui avaient fourni aux donatistes et aux circoncellions (terme désignant les bandes qui parcourent les campagnes africaines au IVe siècle) leurs partisans les plus intrépides, une fois convertis à l'islamisme, se jetèrent avec autant plus de fureur dans les dissidences de la religion nouvelle, qu'elle leur fournissait un prétexte pour entrer en révolte contre leurs nouveaux maîtres.
Sous les premiers émirs du Maghreb, quelques tentatives d'insurrection avaient éclaté ; elles avaient été facilement et promptement réprimées ; mais sous ce gouvernement d'Obaïd-Allah-Benel Habab, elles prirent un caractère de gravité qui faillit compromettre l'existence même de la domination arabe. Le sofri Meïsara-el-Medghari fut salué calife par les Berbères hérétiques.
Son successeur El-Khaled-Ben-Hamid-el-Zenati, vainqueur dans un combat qui reçut le nom d'Ouakat-el-Achraf (journée des Chérifs) à cause du grand nombre de guerriers illustres qui y perdirent la vie, parvint à resserrer les Arabes dans Kairouan et le Maghreb tout entier sembla un instant abandonné aux Khouaridji.
La situation des affaires dans cette partie de l'empire réclamait de prompts et énergiques remèdes.
En conséquence le calife Hescham fit un appel aux armes, auquel les milices (djends) de Syrie répondirent en fournissant à elles seules un contingent de douze mille cavaliers.
Handala-Ben-Safouan-el-Kelbi, gouverneur d'Égypte, chargé de châtier les rebelles, s'avança à leur rencontre, les mit en pleine déroute sous les murs de Kairouan, fit prisonnier leur chef qui fut mis à mort.
Tant de révoltes successives trahissaient dans les populations du Maghreb un profond malaise. Chose étrange ! Plus l'Afrique se peuplait d'Arabes ou le devenait elle-même, plus le mal semblait s'accroître.
Cet immense empire de l'islamisme succombait en quelque sorte sous le fardeau de ses conquêtes.
Peuples et rois paraissaient sentir à la fois le danger et l'impuissance des dominations lointaines, en l'absence surtout de toute autre constitution que la volonté du maître.
C'est ainsi que se préparait sourdement la scission des différentes parties de ce grand empire, le partage, et finalement la chute du califat.
En Orient Ali avait été dépossédé par Moaviah, fondateur de la dynastie des Omiades (dynastie arabe dont la capitale était Damas).
Un siècle après, cette famille fut à son tour dépossédée par les Abbassides (dynastie qui a régné depuis Bagdad sur l'ensemble de l'empire musulman).
- Les premiers n'avaient jamais eu de partisans qu'en Syrie, on leur reprochait l'injustice de leur élévation et le sang qu'ils avaient versé pour parvenir au pouvoir.
- Les seconds qui descendaient en ligne directe d'Abbas, oncle du prophète, étaient au contraire l'objet de la faveur générale.
- Une troisième famille, celle des Fatimides, (dynastie chite ismaélienne qui régna en Afrique du Nord et en Égypte) ou descendants de Fathmé, fille de Mahomet était moins puissante.
Ces trois parties ou sectes se distinguaient non seulement par différents points de dogmes et de rite, mais encore par la couleur de leurs vêtements :
- les Ommiades avaient adopté la couleur blanche,
- les Abbassides la couleur noire,
- les Fatimides la couleur verte.
Le quatorzième et dernier calife de la dynastie Ommiade fut défait une bataille sanglante par Saffah, représentant de la maison des Abbassides et perdit la vie.
Saffah fut nommé calife.
Les Ommiades furent proscrits et quatre-vingts personnes de la même famille trop confiantes dans la clémence du vainqueur, s'étaient rendus à un festin solennel qui se préparait à Damas, y furent égorgées sans pitié.
Le plus jeune de tous Abderrhaman échappa au massacre.
Après avoir longtemps erré :
- en Syrie, en Égypte,
- dans le désert du Barcak, poursuivi partout par la haine des Abbassides, il trouva enfin un asile dans une ville appelée Tuhar, dont les ruines sont situées à quatre journées de marche à l'Est de Tlemcen.
Telle fut l'origine de ces divisions funestes qui détruisirent la grande unité religieuse et politique fondée par Mahomet.
En Arabie, en Perse, la puissance des Abbassides fut reconnue. Ils quittèrent Damas, et transportèrent le siège de leur califat sur la côte orientale du Tigre, à environ quatre milles des ruines de Modain.
Ils y fondèrent Bagdad, dont la population, suivant les écrivains arabes, s'éleva bientôt à huit cent mille âmes, et qui fut l'une des villes les plus florissantes de l'Islamisme.
En Espagne, au contraire, le parti des Ommiades conserva tout son prestige. Les Abbassides voulant faire rentrer cette province sous leur obéissance, y envoyèrent des généraux chargés de remplacer les gouverneurs nommés par leurs adversaires. Loin de reconnaître l'autorité des Abbassides, ceux-ci envoyèrent une députation en Afrique pour offrir ler pouvoir au jeune Abderrhaman qui passa aussitôt le détroit, suivi de mille Africains de la tribu des Zénètes.
Sa présence inattendue intimida ses ennemis, et ceux qui voulurent opposer quelque résistance tombèrent sous ses coups.
Proclamé calife, Abderrhaman établit sa résidence à Cordoue (il devint la tige des Ommiades d'Occident qui régnèrent sur l'Espagne pendant plus d'un siècle et demi) par les ordres d'Almanzor, deuxième calife de la race des Abbassides, Ali-Ben-Mogueir, émir d'Afrique, passa en Espagne à la tête d'une armée.
Mais ses efforts restèrent inutiles ; vaincu et mis à mort, sa tête, conservée dans du camphre fut envoyée à Kairouan pour y montrer combien était déjà redoutable la puissance d'Abderrhaman. Ce prince reçut le surnom d'El-Mançour (le victorieux.)
L'Afrique elle-même ne tarda pas à devenir le théâtre d'évènements analogues à ceux qui venaient d'enlever l'Espagne aux Abbassides : elle se fractionna en une multitude de petits états indépendants dont les chefs ne cherchèrent qu'à affermir et à étendre leurs domaines aux dépens de voisins plus faibles.
Le Maghreb n'eut plus d'émir titulaire ; chaque petit cheik s'attribua ce titre.
La puissance politique des califes de Bagdad cessa même d'être reconnue ; on ne le considéra plus que comme chef spirituel de la religion et non comme souverain temporel.
L'avènement dans le Maghreb de dynasties purement africaines, devint pour ce pays le commencement d'une nouvelle période.
Cet état ne pouvait être que transitoire : plus forts et plus ambitieux que tous ces cheiks désunis, dans l'Ouest les Beni-Edris (Édrissites) et dans l'Est les Ben-Aghlab (Aghabites) rétablirent quelque unité.
Le fondateur de la dynastie des Érissites, Edris-Ben Edris, descendait d'Ali, gendre de Mahomet et de Fathmé sa fille.
Réfugié d'abord en Afrique pour échapper aux persécutions de l'abissade Haroun-el-Raschid auquel le rendaient redoutable les prétentions rivales de sa maison, il s'était depuis retiré à Tanger où commandait le cheik Abd-el-Medjed-el-Euroubi qui le reçut avec amitié.
Edriss se fit connaître de son hôte qui le présenta à sa famille et aux tribus d'El-Euroubi (kabyles).
Profitant de l'ascendant que lui donnait son origine, il parvint à enthousiasmer ces tribus qui le proclamèrent émir.
Les Zénètes et les autres tribus berbères suivirent cet exemple. Se mettant alors à leur tête Edris se porta sur Tlemcen dont il s'empara, soumit quelques autres provinces et finit par conquérir le Maghreb tout entier.
La nouvelle de ces brillants exploits parvint bientôt à Bagdad ; le calife en fut alarmé et résolu de se défaire du nouvel émir, il fit partir l'un de ses affidés avec ordre de s'insinuer dans les bonnes grâces d'Edris et de profiter de l'accès que lui ouvrait cette intimité pour lui donner la mort.
Cet homme accomplit sa mission à l'aide d'un flacon empoisonné.
Edris ne laissait pas d'enfants ; mais sa femme était enceinte.
Un de ses lieutenants proposa aux Arabes d'attendre l'accouchement de Ketlhira (c'était le nom de sa veuve) : " Si Khétira accouche d'un enfant mâle, leur dit-il, nous le nommerons notre chef ; si elle accouche d'une fille, nous donnerons la souveraineté à un autre. "
Cette proposition fut acceptée, et Kéthira ayant donné le jour à un enfant du sexe masculin, le nouveau-né fut proclamé chef suprême des croyants du Maghreb sois le nom d'Edris-ben-Edris qui était celui de son père.
Lorsqu'il eut atteint l'âge de douze ans, le jeune émir prit en mains les rênes du gouvernement et toutes les tribus du Mahgreb lui prêtèrent de nouveau le serment d'obéissance.
Peu de temps après il conclut avec El-Haklem, calife de Cordoue, un traité d'alliance défensive contre le calife d'Orient.
Fier du nombre de ses sujets, Edris-ben-Edris voulut devenir le fondateur d'une ville nouvelle qui reçut le nom de Fez (807).
Il la partagea en divers quartiers séparés par des murailles dont les principaux était le quartier de Karawis, et le quartier des Andalous.
Huit mille Arabes, exilés de Cordoue par Hakem 1er à la suite d'une révolte formèrent le noyau de la population de cette ville. Edris-ben-Edris fut alors proclamé calife de Fez. (Jusqu'à l'avènement de Mahdi (908) fondateur de la dynastie des Fatimides, la famille des Béni-Edris posséda tout le pays désigné par les Arabes sous le nom de Greub-el-Djouarin qui s'étendait depuis Fez jusqu'à Tlemcen c'est-à-dire presque la moitié de l'Afrique.)
Presque à la même époque un autre califat se formait à Kairouan, après l'affranchissement de l'Espagne du joug des Abbassides un certain Ibrahim, fils d'Aghlab, sentit naître en lui l'ambition d'imiter le jeune Abderhaman.
Le succès couronna cette nouvelle tentative.
Déjà depuis longtemps l'autorité des oualis du Maghreb était presque indépendante de celle des califes. Ibrahim ne fit donc que sanctionner un fait tacitement reconnu. Pour affermir son pouvoir :
- il abolit une partie des impôts,
- créa une armée de noirs esclaves,
- bâtit une forteresse auprès de Kairouan,
- en un mot sur des bases solides un empire qui passa à ses enfants.
Sous le règne de Ziadel-Allah, le second de ses successeurs, les Aghlabites firent la conquête de la Sicile, ravagèrent :
- le royaume de Naples,
- la Toscane et
- toutes les côtes de l'Italie.
La France, elle-même, ne fut point à l'abri de ses insultes.
De concert avec les Sarrasins d'Espagne, les Aghlabites et les Edrissites attaquèrent la Provence et s'établirent sur différents points du littoral.
Ils y construisirent un grand nombre de forteresses et de châteaux dont on trouve encore quelques restes. Ils s'emparèrent successivement :
- de Marseille, d'Avignon, d'Arles, de Saint-Tropez.
Ils s'établirent principalement au Nord-Ouest du golfe de Grimaud, à trois lieues de cette dernière ville au sommet d'une haute montagne appelée Fraxinet d'où l'on découvre la mer et les Alpes.
Les Sarrasins firent du Fraxinet une redoutable forteresse : construite sur un immense rocher qui contournait la montagne, pourvue d'une vaste citerne creusée dans le roc, elle passait pour être imprenable.
Au-dessous de la forteresse principale et à quelques centaines de pas de distance, ils avaient bâti un château appelé la Garde et sur toutes les hauteurs voisines avaient élevé des tours de vigie, qui, par des signaux transmettaient les nouvelles au loin.
En l'année 940, les Sarrasins du Fraxinet, renforcés par des secours venus d'Afrique assiégèrent Fréjus et la livrèrent à toute les horreurs d'une ville prise d'assaut.
En 942, Hugues, Comte de Provence, et roi de Lombardie, entreprit de chasser de ces états ces hôtes incommodes, mais il ne put y résister.
Vingt-six ans après, en 968, Othon 1er fit également de vains efforts pour se débarrasser des sarrasins : ils furent attaqué simultanément par terre et par mer, mais ils parvinrent à s'emparer des principaux passages des Alpes et interrompirent les communications avec l'Italie.
Ainsi, à cette époque, les Arabes s'étaient établis sur les côtes de la Méditerranée plus facilement peut-être que la France aujourd'hui à Alger.
Ce fait seul peut donner une idée de leur puissance, de l'exubérance de vie et d'activité qu'ils avaient développé en Afrique.
Pendant tout le temps qu'ils occupèrent le trône, les califes Aghlabites et Édrissites protégèrent les sciences et les lettres.
Bien que séparés de l'unité politique et religieuse représentée par les califes d'Orient, ils cherchèrent à imiter le mouvement littéraire et artistique qui se produisait à Bagdad et s'efforcèrent de rivaliser avec eux en bon goût et en richesse.
Cette émulation fit de Kairouan et de Fez des foyers de lumière et d'érudition où pendant longtemps la jeunesse musulmane vint puiser les connaissances les plus variées. Mais cette prospérité touchait à son terme.
Les peuples indigènes de l'Afrique, connus sous la dénomination générale de Berbères (les Maimoudes habitaient la partie occidentale et méridionale de l'Atlas, c'est-à-dire les plaines et les vallées qui s'étendent vers les frontières du Maroc.
Les Gomerules se tenaient dans les montagnes de la Maurétanie qui avoisine le détroit.
Les Zénètes, les Haxarah et les Sanhadjah résidaient plus avant dans les terres et ces derniers qui étaient très nombreux avaient des tribus répandues derrière les différentes chaînes de l'Atlas) n'avaient jamais accepté complètement la domination arabe.
Une tribu des Zénètes, les Beni-Mesquineça, s'étant soulevée, les califes de Fez furent réduits à mettre en campagne toutes leurs troupes.
Malgré ce déploiement de forces, les Beni Mesquineça remportèrent quelques avantages qui rallièrent à leur cause un grand nombre d'autres tribus.
Tout ce qui était en dehors des villes devint la proie des insurgés. Un évènement imprévu aggrava encore cette situation.
Un marabout de la province de Tlemcen, nommé Quenin-Ben-Menul qui se donnait pour prophète et prétendait avoir été envoyé pour délivrer les peuples de la tyrannie des Edrissites se mit à prêcher l'insurrection aux tribus africaines.
Les populations coururent aux armes et bientôt Quenin-ben-Menul se sentit assez puissant pour déclarer la guerre au calife de Fez Menacé à la fois par le marabout et la tribu des Beni-Méquineça, se voyant dans l'impossibilité de faire face à ces deux ennemis, le calife crut prudent de se débarrasser du premier en traitant avec lui.
La paix fut conclue mais à des conditions humiliantes pour son orgueil car le marabout exigea que Tlemcen fut érigé en principauté.
A partir de cette époque (935) la province de Tlemcen se trouva placée en dehors de l'autorité des califes de Fez et conserva son indépendance jusqu'au règnes des Almoravides (dynastie qui domina l'Afrique du Nord et l'Espagne). En se débarrassant d'un de ses ennemis, le calife avait cru pouvoir aisément se rendre maître de l'autre ; il en fut tout autrement.
Les Zénètes loin de se soumettre, redoublèrent d'ardeur, et parvinrent en effet à fonder une principauté indépendante dont ils établirent le siège dans l'ancienne Sidda à douze lieues de Fez. Cette ville fut appelée Mesquinez, du nom de la tribu des Beni-Mequineça.
Vers la même époque, une révolte trouva des imitateurs dans l'Est de l'Afrique septentrionale. Un nouveau marabout, non moins ambitieux que l'usurpateur de Tlemcen, Obeid-Allah-Abou-Mohammed, surnommé Mahadi qui prétendait descendre en ligne directe de Fatmeh, fille du prophète, s'annonça comme l'imam régénérateur attendu par les musulmans orthodoxes pour réunir tous les peuples dans une même croyance.
Mahadi parvint à réunir une armée avec laquelle il attaqua Kairouan, dont il s'empara après avoir chassé le dernier des Aghlabites.
Après cette victoire il fonda sur la côte, à quelques lieues de Kairouan, une ville à laquelle il donna le nom de Mehedia et jeta dans cette partie de l'Afrique les fondements de la puissance de ces califes fatimides qui devaient plus tard soumettre l'Égypte à leur domination.
Ayant réuni autour de lui un grand nombre de mécontents et de fanatiques, et vu ainsi considérablement augmenté son influence, Mahadi se porta sur Fez pour en chasser les Edrissites qui déjà épuisés par la lutte qu'ils venaient de soutenir contre les Zénètes ne purent résister ; leur capitale fut prise ainsi que Ceuta, Tanger et plusieurs autres villes.
Il écrivit alors au gouverneur de Isakor, ville que les musulmans andalous possédaient dans le Maghreb, cette lettre pleine d'orgueil et de fierté : " Si vous venez doucement à moi, j'irai vers vous avec douceur et clémence , si vous voulez que nous mesurions nos forces dans une bataille, mon épée victorieuse humiliera la vôtre. "
Dans ce péril extrême, les Edrissites se hâtèrent d'envoyer une députation à Cordoue pour demander des secours au calife Abderrhaman III, fils de Mohammed.
Ce prince en qui les musulmans andalous avaient placé toutes leurs espérances et qu'ils se plaisaient à regarder comme le régénérateur de l'islamisme en Espagne, accueillit favorablement la députation et s'engagea à envoyer les secours demandés, ajoutant qu'il avait une injure personnelle à venger, puisque Mahadi avait osé attaquer le gouverneur andalou du Maghreb.
En effet, il fit passer en Afrique l'élite de son armée, s'empara de Fez, de Tlemcen (on rapporte qu'Abderrhaman fit réparer à ses frais le dôme de la grande mosquée et que pour rendre hommage à la mémoire de celui dont il venait de dépouiller le dernier descendant, il ordonna de placer à la partie la plus élevée de l'édifice l'épée du fondateur de Fez) et obligea le calife Fatimide à quitter l'Ouest de l'Afrique pour se réfugier dans la partie orientale de la Barbarie.
Déjà les Edrissites se félicitaient du succès des armes de leur allié lorsque celui-ci déclara qu'il s'appropriait leurs états pour son compte personnel et se fit proclamer dans Fez prince des croyants (954).
Mais son ambition n'était pas encore satisfaite ; Voulant à tout prix étendre sa puissance maritime et commerciale.
Il avait fait construire à Séville un gros navire pour transporter des marchandises en Égypte et en Syrie.
Dès sa première sortie ce bâtiment se trouva arrêté dans les eaux de Sicile par un navire appartenant aux Fatimides.
Un combat s'engagea entre eux et ce dernier fut capturé.
En représailles, le calife de Kairouan équipa une flotte à laquelle se rallièrent les Sarrasins de la Sicile. Cette flotte donna la chasse aux navires andalous et fit des prises importantes.
La guerre allait donc recommencer avec une nouvelle fureur. Abderrhaman envoya Ahmed, un de ses plus habiles généraux, avec une armée à Oran.
Celui-ci se porta sur Mehedia à la tête de vingt-cinq mille hommes et après diverses rencontres dans lesquelles les Fatimides furent constamment battus, il mit le siège devant Tunis, ville renommée alors pour son commerce avec l'Occident, et qu'habitaient un grand nombre de négociants juifs.
L'espoir du pillage animait les Andalous et les Zénètes leurs alliés ; ils serrèrent vigoureusement la place par terre et par mer.
Les habitants, voyant le danger qui les menaçait, n'ayant aucun espoir d'être secourus, demandèrent à capituler et offrirent une forte somme d'argent ; mais ils furent contraints de se rendre à discrétion.
Ahmed fit un riche butin ; il s'empara :
- d'une immense quantité d'étoffes,
- d'or et de pierreries,
- d'armes, de chevaux et d'esclaves.
Les vaisseaux qui se trouvaient dans le port, avec leurs cargaisons, devinrent la proie du vainqueur. Il les fit partir avec les siens et les ramena à Séville.
Les richesses recueillies de cette brillante expédition furent telles qu'après le prélèvement du cinquième appartenant de droit au calife il en resta encore assez pour enrichir :
- Ahmed, ses officiers et ses soldats.
Après sa défaite le calife fatimide s'était retiré dans Kairouan où il dévorait en silence l'affront fait à ses armes, attendant l'occasion d'en tirer une revanche éclatante. Cette occasion ne tarda pas à se présenter.
Le puissant Abderrhaman était devenu médiateur entre les princes chrétiens. Sancho, petit-fils de Tuda, reine de Navarre, s'était retiré à sa cour après avoir été chassé de son royaume de Léon.
Étant parvenu à captiver les bonnes grâces du souverain de Cordoue, il en obtint le commandement d'une armée destinée à le replacer sur le trône, ce qui mit celui-ci dans la nécessité de faire revenir d'Afrique une partie de ses troupes.
Aussitôt la partie de Maghreb qui dépendait du califat de Cordoue fut envahie.
Djehwarel-Roumy (le romain) qui commandait l'armée d'invasion, avait ordre de déposer les cheiks de la maison des Ommiades d'Espagne, Djali-Ben-Mohamed, lieutenant d'Abderrhaman alla à la rencontre de d'El-Roumy.
Les deux armées se retrouvèrent en présence dans les environs de Tlemcen.
La journée fut fatale à Djali qui y trouva la mort.
El-Roumy alla aussitôt mettre le siège devant Fez dont il s'empara (960).
Sigilmesse, place importante, s'était rendue un peu auparavant.
La reddition de ces deux villes entraîna la soumission momentanée de tout le Maghreb, à l'exception toutefois :
- de Ceuta, de Tlemcen et de Tanger dont le vainqueur n'osa pas entreprendre le siège.
En apprenant ces cruels désastres, Abderrhaman ne put contenir sa colère. Pour les réparer, il équipa une flotte considérable et fit passer en Afrique une puissante armée.
Ses généraux se portèrent devant Fez, s'en emparèrent de nouveau et y firent un grand carnage des Fatimides et des tribus africaines leurs alliées.
Ils soumirent tout le pays jusqu'à l'océan et le nom de l'imam de Cordoue fut de nouveau proclamé dans toutes les mosquées du Maghreb (961).
Après avoir réhabilité la gloire de ses armes Abderrhaman mourut.
Il était parvenu à sa soixante-douzième année et avait occupé le trône d'Occident pendant cinquante années musulmanes.
La paix fut conclue à la suite de cette expédition et pendant quelque temps les provinces espagnoles du Maghreb jouirent d'un profond repos.
L'ambition des califes de Kairouan, vaincus dans l'Ouest de l'Afrique, allait se tourner d'un autre côté.
Depuis leur élévation au califat de Bagdad les Abbassides avaient été constamment en butte aux attaques de dangereux compétiteurs, et leur puissance avait éprouvé de cruels échecs.
- Leurs ennemis levaient la tête jusque dans l'intérieur de leur palais,
- on contestait les titres,
- on avait vu un de ces prince arraché de son trône par ses sujets révoltés,
- son palais livré au pillage,
- et lui-même dépouillé de son armure et de sa robe de soie,
- jeté dans un cachot après qu'on lui eut crevé les yeux.
Cette décadence des Abissides éveilla l'ambition des Fatimides de Kairouan :
ils résolurent d'agrandir leur empire aux dépens du califat d'Orient.
Une expédition contre l'Égypte et la Syrie fur résolue et la fortune secondant cette entreprise hardie, ces deux provinces furent soumises à leur domination (972).
Ainsi tomba cette dynastie des Abbassides qui avait jeté un si vif éclat sur les annales des Arabes. Bagdad seule lui restait encore. On les y vit longtemps :
- jeûner, prier,
- étudier le Coran et la tradition,
- remplir avec zèle et même dignité les fonctions spirituelles.
- Les nations respectaient en eux les successeurs du Prophète et les oracles de la foi musulmane.
La guerre éclata de nouveau entre les califes de Kairouan et ceux de Cordoue.
Abderrhaman , en mourant avait laissé la couronne à son fils El-Hakem qui avait nommé pour gouverneur des provinces espagnoles du Maghreb Hassan, de la famille des Edrissites.
Tout à coup un chef de la tribu de Zanaga, appelé Balkin-Ben-Zeiri se jette à l'improviste sur ces provinces.
Hassan vient à sa rencontre et est vaincu ; mais Balkin, ne se sentant pas assez fort pour rester indépendant entra en pourparlers avec lui.
Ce descendant des Edrissides n'avait pas oublié que ses ancêtres régnaient en maîtres dans un pays où lui-même n'était plus que le délégué du calife de Cordoue. Il crut pouvoir s'emparer du pays pour son compte et secouer le joug de l'Espagne.
A la nouvelle de cette trahison, El-Hakem envoya en Afrique une armée qui fut renforcée de tous les Berbères demeurés fidèles à la cause espagnole.
El Gralib, qui la commandait, rencontra l'armée de Hassan dans les environs de Ceuta.
Avant d'en venir aux mains, le général andalou répandit l'or à profusion parmi les chefs africains qui étaient dans l'armée du rebelle et grâce à ce talisman il parvint à en ramener un grand nombre.
Une bataille sanglante s'engagea ; Hassan fut vaincu et poursuivi de près il se réfugia dans le château des Aigles, asile ordinaire des Edrissites dans leurs moments de péril.
Bloqué dans cette forteresse, le manque d'eau le força de se rendre à discrétion (973). El-Gralib lui accorda la vie sauve, avec la jouissance de tous ses biens, sous la condition qu'il fixerait sa résidence à Cordoue.
Puis se mettant à la poursuite de Balkin :
- il le chassa du pays,
- se rendit maître de Fez, et
- replaça sous l'autorité de son maître toutes les provinces du Maghreb.
Malgré ces succès la guerre n'était pas encore terminée.
Le chef des Zanagas, que nous avons vu fuir devant les armes victorieuses d'El-Gralib, se hâta de reparaître et de reprendre l'offensive dès que ce général eut quitté l'Afrique.
Le moment était d'autant plus favorable que le calife de Cordoue se trouvait engagé dans une guerre contre les chrétiens, guerre qui absorbait tous ses soins, toutes ses forces. El-Hakem se vit donc obligé de traiter avec lui.
Un nouvel évènement vint compliquer encore cette situation. Une querelle ayant éclaté entre le calife et son prisonnier Hassan, celui-ci s'enfuit et dépouillé de tous ses biens, parvint à se réfugier en Égypte auprès du calife Fatimide, qui lui promis s'épouser sa cause et de le rétablir sur le trône.
L'effet suivit de près la promesse. Hassan qui comptait encore de nombreux partisans dans le Maghreb, y arriva avec les troupes que lui avait données le calife d'Égypte.
Mais vaincu et sans ressources, cette fois encore il fut obligé de se rendre à discrétion.
Pendant ce temps El-Hakem était mort, laissant le trône à son fils Almanzor. Abd-El-Malek, fils et lieutenant du nouveau calife promit la vie sauve au vaincu ; mais ce prince, qui se rappelait de quelle manière Hassan avait abusé de la générosité et des bienfaits de son père, envoya à sa rencontre un homme chargé de le mettre à mort.
Cet ordre fut exécuté et la tête du dernier des Edrissites fut déposée sanglante aux pieds d'Almanzor (985).
On rapporte qu'au moment du supplice, il s'éleva un vent impétueux qui emporta le burnous de dessus les épaules de Hassan et, que, malgré les recherches les plus actives, on ne put le retrouver.
(El-Hassan, dit un historien de Fez était inhumain et cruel. Quand il s'emparait d'un ennemi, il le faisait étrangler ou précipiter du haut du château des Aigles …. Cette forteresse était si haute que le patient mourait au milieu de la chute et longtemps avant d'avoir atteint le sol.)
Avant de quitter l'Afrique, le vainqueur d'Hassan avait laissé à un chef de la tribu des Zénètes nommé Zeiri-Ben-Atia le soin de pacifier les provinces de Maghreb où restaient encore quelques germes d'insurrection. Ce chef qui P 150 devint le fondateur de la famille des Zeirites (tribu et dynastie maure), refoula au-delà de l'Atlas le fils et successeur de Balkin, et soumit toute l'Afrique occidentale.
Ses succès lui donnèrent une si haute idée de sa puissance qu'il osa se déclarer indépendant (997). A cette nouvelle Almanzor (vizir du palais du calife omeyade de Cordoue), qui préparait une expédition contre Santiago, se transporta lui-même à Algésiras où il avait donné rendez-vous aux officiers des provinces voisines.
Après avoir rassemblé son armée, il en confia de nouveau le commandement à Abd-el-Meleck.
A la tête de toutes les tribus africaines appartenant à la famille des Zénètes, Zeiri marcha à sa rencontre et le joignit sur les confins de la province de Tanger.
La bataille qui s'engagea aussitôt dura depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.
Vers le soir au plus fort de la mêlée, Zeiri reçut une blessure profonde qui l'obligea à se retirer.
Chargé par Abd-El-Melek, avec une nouvelle ardeur, l'armée des Zeirites fut mise en déroute et on en fit grand carnage.
Zeiri parvint à gagner le désert avec sa famille et ne survécut pas longtemps à sa défaite.
Abd-El-Melek s'attacha le fils de Zeiri, Alman, qu'il nomma émir du Maghreb avant de retourner en Espagne pour aller occuper le trône de Cordoue. La soumission d'Alman ne se démentit jamais.
L'Afrique se trouvait encore divisée en deux grands États, celui des califes de Cordoue qui, comme nous l'avons vu, après avoir conquis l'Égypte, avaient transporté le siège du califat au Caire.
Kairouan, l'ancienne capitale, n'était administrée que par un cheick berbère.
Ce gouverneur profita du moment où Kaïm, le calife d'Égypte était engagé dans une guerre lointaine, pour se déclarer indépendant.
Ne pouvant disposer de ses troupes pour punir lui-même le traître, Kaïm fit publier dans les trois Arabies une proclamation par laquelle il offrait un dinar d'or et le libre passage à ceux qui voudraient se rendre en Afrique pour combattre le rebelle. Une foule d'Arabes répondirent à cet appel.
Un écrivain de l'époque évalue leur nombre à cinquante mille combattants, suivis d'un million d'individus. Ils s'emparèrent de Kairouan après un siège de huit mois, et firent périr le gouverneur berbère dans les supplices.
Cette ville fut détruite de fond en comble par les assiégeants trois-cent-quarante-sept ans après sa fondation (392 de l'hégire, 1001 après J. C). Elle ne fut relevée de ses ruines que sous la domination des Almohades.
Les factions sans nombre qui bientôt scindèrent l'Afrique en mille petits états indépendants préparèrent le triomphe des lamptumes Almoravides (fraction de la tribu de Zanaga).
D'un autre côté l'Espagne, après la mort d'Abd-El-Malek, fatiguée par ces guerres intestines, laissait échapper de lassitude la souveraineté qu'elle s'était acquise au prix de tant de combats sur les provinces du Maghreb.
Un prince faible et sans énergie, Hikem, occupait le trône. L'ambitieux Abderrahman, second fils de Mohammed-Al-Mançor, était premier ministre.
Peu scrupuleux sur les moyens d'arriver à ses fins, il conçut le dessein de succéder à Hikem, qui n'avait point d'enfants et par la menace il le décida à le reconnaître pour son héritier. Deux factions puissantes se formèrent :
- Celle des Alameris (on appelait ainsi les partisans d'Abderrhaman, du nom de son père le grand Almanzor qio était aussi appelé Abi-Amer),
- et celle des Omniades qui, par ce choix, voyaient leurs droits méconnus.
Ces deux factions en vinrent aux mains et firent de Cordoue le sanglant théâtre de leurs luttes. La victoire pencha un moment en faveur d'Abderrhaman.
Il pénétra dans le palais et se rendit maître de la personne du calife. Mais le peuple était contre lui. L'orgueilleux ministre tomba entre les mains de ses ennemis qui le firent mettre à mort en le clouant à un pieu (1009).
De là naquirent ces guerres interminables dans lesquelles devaient s'éteindre la dynastie des Omniades, et avec elle le califat d'Occident. Le dernier de ses représentants fut Hescham, qui dépossédé du pouvoir termina ses jours en 1036.
Elle avait duré deux-cent-soixante-seize ans.
Histoire de l'Algérie ancienne et moderne
depuis les premiers établissements
carthaginois par Léon Galibert,
Directeur de la revue britannique. Édition 1842
|
|
CONVAINCU !!!
Envoyé par Mme Elyette
|
|
Un conférencier essaie de convaincre la salle des méfaits de l’alcool et n’hésite pas à employer des exemples très terre-à-terre.
- Mettons deux seaux devant un âne : un rempli d’eau et un rempli d’alcool. D’après vous, vers quel seau se dirigera-t-il ?
Dans la salle, un homme éméché répond :
- Vers l’eau.
- Et pourquoi, d’après vous ?
- Parce que c’est un âne!
Auteur inconnu
|
|
| Le calvaire des Pieds Noirs
Envoi de M. Christian Graille
|
En Afrique on achevait les victimes. Il n'est pas simple de raconter l'horreur. Toutes les images qu'elle charrie semblent gonflées de boursouflures qui atteignent l'invraisemblable.
On ne les croit pas tout à fait. Elles s'inscrivent aux frontières indécises de l'abstrait avec les monstres nés de l'imagination des artistes hantés par l'insolite.
Elles paraissent une offense à un ordre et l'horreur est réellement cette injure. Elle est cauchemar dont la mémoire ne garde souvenir qu'à travers des juxtapositions incohérentes mal liées par les traînées de sang.
A Oran sous le prétexte d'effectuer des contrôles d'identité, les gendarmes et les gardes procédaient à de vastes rafles dans les lieux publics et disposaient les captifs enchaînés en longs cordons autour des casernes, boucliers vivants qui les protégeaient des éventuels assauts de commandos préoccupés de libérer les innocents.
Les récalcitrants étaient embarqués de force dans les camions et transportés puis abandonnées dans les quartiers arabes, ce qui revenait à déférer aux autres des assassinats que l'on avait honte de perpétrer soi-même.
- Dans le Constantinois, à Bône, un enfant avait été tué par un officier parce qu'il collait des affiches.
- Quelque part en Algérie un adolescent frappé d'une rafale de mitraillette par un gendarme avait crié : " Monsieur vous m'avez tué ! "
- Partout on enlevait des hommes simplement parce que des voyous algériens convoitaient leur automobile.
- On les arrêtait au bord des routes,
- on leur volait leur véhicule.
- Ils étaient traînés quelques jours de tribu en tribu, couverts de plaies, les mains liées par des fils de fer, mannequins vivants sur lesquels les gosses s'amusaient à jeter des pierres.
Puis on les égorgeait et on les jetait dans des puits ou dans ces charniers ouverts dans un trou, ou dans les champs d'épandage d'ordures.
Les ravisseurs se prélassaient sur les lieux mêmes de leur crime dans les automobiles volées.
Les militaires refusaient de se mêler de ces enlèvements et de ces assassinats.
A Oran, l'un des garçons livrés aux tueurs du " village nègre " échappe à ses bourreaux, poursuivi, il aperçoit une jeep occupée par des soldats. Il tente d'y sauter. On le repousse.
Les soldats lancent la jeep dans les ruelles. L'homme poursuivit tente de s'y accrocher ; il implore. On frappe à coups de crosse sur les doigts qui s'agrippent. Il cède. Il glisse dans la mort sous le couteau des poursuivants ; la mort douce disent les chirurgiens, quand le corps saigné flotte sur des nuées légères et que l'inconscience descend comme un crépuscule vibrant d'échos de cloches.
Des militaires interceptés sur des routes et des jeunes gens enlevés dans les faubourgs travaillaient au fond des galeries de mine sous le fouet de la chiourme.
A Alger au cours du bouclage de Bab-el-Oued, les patrouilles de gardes avaient tiré au hasard sur les fenêtres closes, ravageant les plafonds à travers les volets et blessant les habitants terrorisés réfugiés dans les couloirs.
Au cours des perquisitions, les gendarmes et les gardes avait vidé le linge des armoires, l'avaient systématiquement piétiné et, en certaines occasions, avaient vidé des encriers sur ces pauvres trésors de draps et de chemises serrées dans les tiroirs. Dans les bordels arabes fraîchement installés dans les villas de la banlieue autour des grandes villes :
- Oran, Bône, Mostaganem, Alger, ..
Les matrones disaient aux hommes-fauves armés de mitraillettes dont les bandes surgissaient partout de la lie des faubourgs : " J'achète les filles françaises. "
Les jeunes femmes enlevées en pleine rue étaient poussées dans ces antres où elles commençaient à vivre nuit après nuit le pire cauchemar qui se puisse imaginer. C'était l'enfer dans le bruit des musiques tonitruantes et sous les injures des brutes ivres qui sentaient la crasse et le sang.
A Alger la force dite " de maintien de l'ordre " crée à Évian pour protéger la minorité française d'Algérie, avait ouvert le feu sur une foule désarmée et couchée sur l'asphalte de la rue d'Isly une centaine de victimes.
Derrière le docteur Jean Massonnat agenouillé sur un blessé une voix avait crié : tue-le et calmement, délibérément de trois rafales de mitraillettes, l'homme du maintien de l'ordre avait tué Jean Massonnat dont la courte vie n'avait été qu'une offrande la charité et à l'amour.
A Boca-Sahnou, l'épouse d'un officier français est l'unique pensionnaire forcée d'un bordel arabe qui " sert " chaque nuit une cinquantaine de clients.
A Alger une femme avait été tuée sur son balcon, rafale tirée :
- par des gardes, ou
- éclat de bombes, ou
- balle perdue ?
On ne saura jamais. Elle s'appelait Émilie, un nom d'autrefois qui fait penser à Rousseau et suggère aux poètes des ravissements de campagne italienne.
Elle avait un visage coloré enchâssant eux yeux bleus d'une infinie douceur que confirmait la voie placée aux limites du chant et teintée d'une gaieté cristalline qui prêtait à Emilie un air de jeunesse éternelle. Elle avait près de soixante ans.
Elle était la compagne d'un orfèvre ; vieille idylle toute en secrets et en nuances dont je connaissais les moindres chuchotements. Jour après jour depuis plus de vingt ans, l'orfèvre avait paré son idole de tous les bijoux qu'il imaginait.
Elle en portait beaucoup avec une simplicité de sainte espagnole. Les autres dormaient dans des coffrets doublés de soie élimée. Il n'était pas possible d'imaginer un couple plus étranger au mal, plus isolé dans son rêve de douceur et de sourires, au milieu du cauchemar qui maculait les choses.
Au cours de la perquisition qui avait suivi la mort d'Émilie, les bijoux avaient disparu. Il faut bien dire les choses comme elles sont, dans leur terrible simplicité.
Les gendarmes ou les gardes les avaient volés. L'orfèvre était absent pour la journée. On avait emmené la morte à la morgue.
Sur les pistes du Sud travaillaient les esclaves français livrés aux caprices et à la sauvagerie de leurs gardiens.
Dans un quartier populaire d'Alger, deux jeunes gens avaient été torturés pendant quarante jours. Leurs bourreaux leur avaient :
- coupé le nez, les oreilles,
Avaient :
- tranché la langue de l'un d'eux et
- crevé les yeux de l'autre.
A Teniet-el-Haad, des prisonniers avaient été liés à des branches d'arbres par des fils de fer noués autour des poignets et des chevilles.
Leurs squelettes exposés au soleil et au vent ont longtemps témoigné de leur supplice.
A Oran des garçons enlevés dans les quartiers populaires avaient été saignés par le FLN qui manquait de plasma sanguin pour ses blessés … La mort douce ; le jeune homme lié les bras en croix, et la vie qui s'écoule comme une fièvre légère … Et le crépuscule vibrant de cloches qui descend selon les affirmations des médecins.
La mort du Christ ! Quand meurent des innocents, c'est toujours le Christ que l'on crucifie de nouveau ; car on peut n'être pas chrétien, mais les symboles portent à tous les hommes leur bouleversant message.
Et quand les adolescents meurent les bras en croix, l'image se grave, insupportable, sur un contexte de pitié et de colère.
A Alger Mgr Duval, les bras en croix, célébrait la messe et parlait d'amour en termes de rébus, mais négligeant d'appeler dans ses paradis les adolescents que l'on saignait dans les faubourgs.
Mon ami l'orfèvre piétinait dans l'eau sanguinolente qui imbibait le sol sur le seuil de la morgue.
Les hommes et les femmes agglutinés là appartenaient à tous les clans qui s'entre-tuaient dans les rues de la ville :
- femmes arabes qui gémissaient sous le voile,
- épouses de gendarmes furieuses ou résignées, et
- sœurs ou mères de Français d'Afrique murées dans leur silence, hautaines inaccessibles parce qu'elles avaient depuis longtemps dépassé les limites du désespoir ou de l'indignation et de la colère.
Quand vint le tour de l'orfèvre, le préposé à la morgue lui cria : Quel âge ?
C'était un gros homme au torse moulé dans un maillot de marin.
Les tatouages jetaient des fleurettes bleues sur ses bras.
- Cinquante-huit ans.
- Non ! dit l'homme, nous n'avons rien au-dessus de quarante.
- L'orfèvre insistait : Cependant …
L'homme haussa les épaules.
- Cherchez !
- Les morgues dans l'Algérie de 1962 …
Les grandes morgues des villes sous la lumière glacée qui tombe des lampes au néon, ou les morgues improvisées des villages, éclairées par les flammes qui vacillent sur les pots d'acétylène.
Ce sont autant d'atroces répliques du même tableau de l'école flamande.
Dans le demi-jour sale, les corps s'entassaient, masses crayeuses imbriquées les unes dans les autres et liées les unes aux autres par des filets de sang que les gardiens lavaient à intervalles réguliers au bout du jet d'une lance à eau.
Cette eau qui ruisselait sur les morts sans parvenir à les laver complètement de leurs blessures semblait souder les corps dans une même masse gélatineuse enfermée dans les mailles distendues d'une résille rouge.
Et à côté de ces victimes entassées, le gardien moulé dans son maillot de marin prêtait une vraisemblance moderne aux vieux mythes du batelier convoyeur de morts sur sa barque de ténèbres.
Il criait : " Cherchez ! Nous n'avons rien de plus de quarante ans. "
L'orfèvre chercha. Emilie était là, nue comme les autres, étonnement rajeunie par l'apaisement de la mort. Elle souriait dans sa géhenne (enfer, souffrance intolérable) à ce passé :
- de sourires,
- de chuchotements et
- de cadeaux amoureusement offerts au fil des années ; à tant de douceur presque surannée, qu'une rafale avait versé dans ce cloaque.
L'orfèvre revint à pied par les rues saccagées où se tramaient les ordures.
Sur le Plateau des Glières, la statue de Viviani (Né à Sidi-Bel-Abbès en 1863 et mort en métropole en 1925, avocat de formation) avait été coiffée d'une poubelle.
L'homme de bronze montrait le ciel, de son bras levé à la verticale et sur le socle de pierre, on lisait encore l'inscription gravée : Nous avons éteint dans le ciel des lumières qui ne se rallumeront jamais … " Et maintenant la lumière s'était définitivement éteinte pour celui-là, sous une poubelle.
On pensait à l'archevêque qui lui aussi avait éteint dans le ciel, pour des milliers d'hommes et de femmes d'Afrique des lumières qui ne se rallumeraient jamais.
Le Pape devait le coiffer d'un chapeau de cardinal qui, pour nous, est une poubelle. Partout sur les aérodromes et les quais des ports, des foules prostrées dans cette patience que l'Orient apprend aux êtres, attendaient un moyen de rallier la France pour échapper à l'horreur et à cette menace que portait en elle l'échéance de juillet qui verraient les multitudes algériennes se répandre sur les villes comme une marée.
L'Algérie se vidait littéralement du sang français, autre saignée pareille à la saignée des victimes immolées pour recueillir quelques gouttes de sang.
Ici aussi les meutes en délire ne seraient plus entre leurs mains un prisonnier mais une dépouille.
Et les gens attendaient des jours et des nuits dont ils ne savaient plus le nombre sous le soleil des midis et les silences de la nuit, parqués, conscients de ce qu'il y avait d'intention de punir encore dans ces avions mesurés et ces bateaux refusés.
Punir de quoi ?
Ils avaient dépassé le seuil de la souffrance au-delà duquel commence l'hébétude où l'idée même du châtiment n'a plus de sens.
Ils étaient inaccessibles, veillant un rêve mort et ne croyant plus à la vie parce que les jours vidés de rêve ne sont plus qu'absurde défilés d'aurores et de crépuscules. Ceux qui venaient :
- des hautes plaines de lumière,
- des steppes présahariennes ou
- des montagnes figées dans une évocation concrète du chaos, avaient déjà quitté l'Afrique.
Rivés pour quelques heures encore aux ports qui leur étaient étrangers, ils entraient en exil avant les autres qui pouvaient encore apercevoir leur maison à demi enfouie dans les grands éboulis de pierre des villes couvertes comme des carrières face à l'horizon marin.
Ceux-là cherchaient instinctivement du regard l'angle de rue, ou la courbe de l'avenue, et la tache sombre d'une place où resterait amarré pour le bonheur avec ses illusions ses mythes lentement mués en souvenirs.
Ni les uns ni les autres ne possédaient plus rien que ce trésor et, déjà, ils commençaient à l'embellir par le miracle de l'imagination dans une démarche qui ne cesserait jamais.
Beaucoup avaient essayé de faire un tri dans ce qu'ils possédaient, pour emporter ce qui leur semblait le plus précieux.
Mais comment choisir entre ce qui revêt une valeur matérielle et ces babioles qui dorment dans un tiroir, et sous leurs patines de souvenirs dérisoires, restent les témoins des joies passées ; épaves embaumées de bonheur et laissées par la décrue des jours.
J'en connaissais qui, rendus furieux dans la nécessité de choisir et l'impossibilité de s'y résoudre, avaient saisi une hache et dans un brusque accès de folie, avaient tout fracassés, les meubles et les objets futiles mais précieux, mais maculé jusqu'aux peintures des murs. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée des profanations futures.
Au moins les " autres " rentreraient dans des maisons hostiles, vidées même des reflets d'une intimité saccagée
Ceux-là serraient les poings face aux villes intactes baignées de merveilleuses harmonies. Ils rêvaient d'incendies dans la tentation d'un sacrilège.
Et face aux grandes villes qui coulent dans la lumière d'étranges empreintes de l'abstrait, avec leurs constructions cubiques modelées par des reflets d'ambre et de bleu, ils commençaient à pressentir que ce qui leur manquerait le plus désormais, ce dont la perte leur infligeait la plus cruelle blessure, ce serait moins le domaine ou le métier ou l'aisance, mais la silencieuse chanson des choses …
- Les paysages de pierre patinées d'éternité,
- l'ébullition minérale des " djebels " de porcelaine bleue,
- les horizons rongés par le soleil,
- les longues houles qui déferlent dans les steppes d'alfa sous la poussée du vent et éveillent l'esprit à une dimension du mot liberté, les vagues qui versent leurs crêtes d'écume sur les plages et les grands viviers d'étoiles des nuits.
Ils entraient en exil par de honteuses poternes, traînant derrière eux, comme un fardeau et un tourment, le manteau d'apparat de leurs souvenirs rebrodé de mirages.
Extrait de Jean Brune, " Interdits aux chiens et aux Français . "
Le drame de l'Algérie française. Éditions Atlantis 1988.
|
|
PHOTOS de CONSTANTINE
Envoyé par diverses personnes
|
ROUTE DE LA CORNICHE

RUE NATIONALE

VUE GENERALE
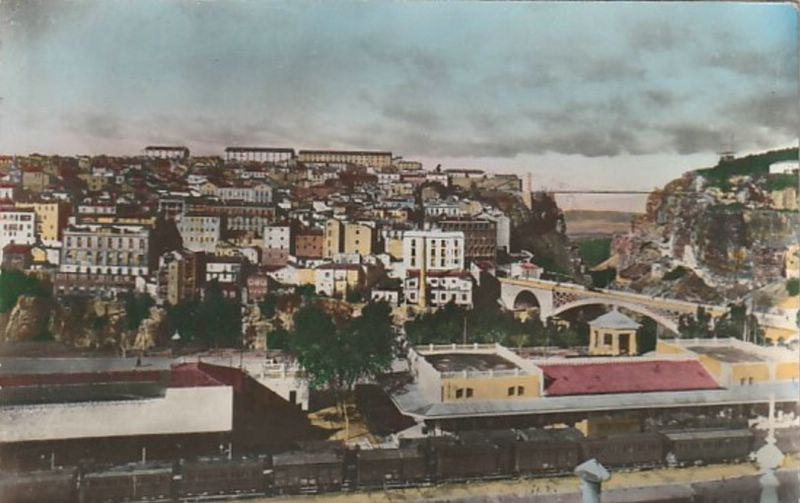
VUE GENERALE
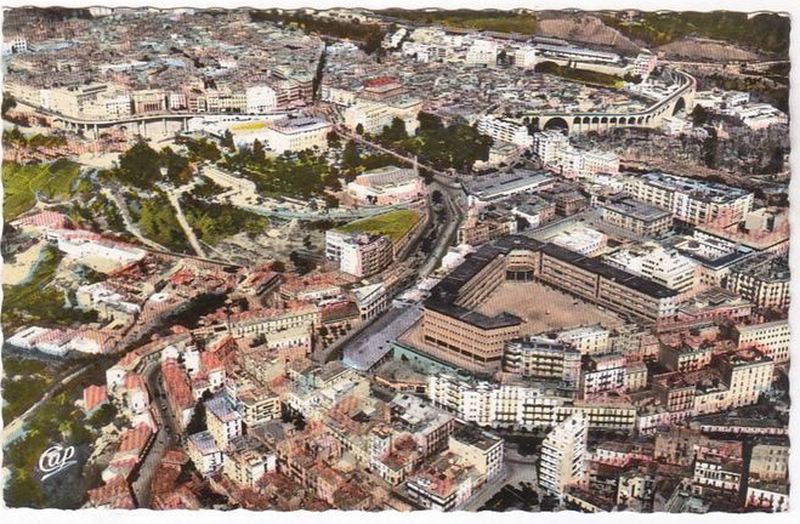
VUE GENERALE

RUE DES GALETTES --- SORTIE DES GROTTES

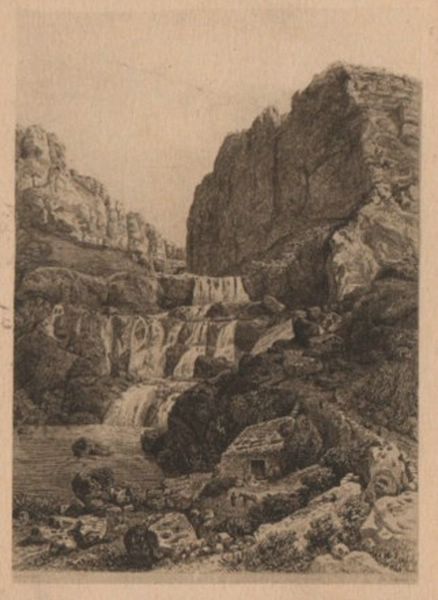
|
|
| LES LOISIRS
Par M. Bernard Donville
|
|
Chers amis,
Nous arrivons à la fin de l'évocation de nos activités de loisirs "là-bas" par un parcours cinématographique.
Nous découvrirons l'historique du cinéma tourné sur notre terre et ainsi comment Fort de l'Eau est devenu (brièvement) Jérusalem.
Après quelques rappels sur des cinémas de village je m'arrêterai sur ceux de grandes villes, en particulier Oran et surtout Alger.
Voilà c'est fini pour tous ces moments de joie et de gaité que je vous ai livrés comme je les ai ressentis avec aussi toutes les erreurs de transcription que certains ont pu me reprocher.
Mais malgré tout je continue et vous ferai la surprise d'ici 15 jours d'une nouvelle série !
En ce jour de Pâques la cloche toulousaine vous apporte de nouvelles lectures, comme promis !
Je vous propose une autre facette de mes conférences en vous présentant un artiste, cher à la vie algéroise, mais ayant bien débordé sur toute l'algérie : BROUTY.
Nous le retrouverons pendant de longues semaines, bien sûr par l'entremise de ses œuvres .
Pour commencer je vais vous faire découvrir l'homme, les traits marquant de sa vie en survolant les différents domaines de ses interventions.
PS. J'ai toujours fait savoir que je ne m'opposais pas à la divulgation de mes envois sur "Notre histoire de l'Algérie Française". Mais je vous serais reconnaissant que vous fassiez savoir à vos correspondants personnels que je suis choqué de trouver certains de mes travaux (élaboration personnelle) sans référence d'origine .
Bonne lecture et peut être découverte.
Amitiés, Bernard
Cliquer CI-DESSOUS pour voir les fichiers
LOISIRS 7
BROUTY 1
A SUIVRE
|
|
| PLEURNICHAGES
De Jacques Grieu
| |
|
0n dit souvent que rire est le propre de l'homme.
On pourrait dire aussi que pleurer, c'est tout comme.
On a rarement vu un animal pleurer,
Sauf les gros crocodiles et ça n'est pas prouvé.
Rire et pleurer aussi sont donc notre dada.
" Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera "
Pourtant, rire et pleurer, chacun on doit décrire :
On " donnait" à pleurer alors qu'on " prête " à rire !
Si le vin fait chanter, c'est l'eau qui fait pleurer ;
Mais chanter, c'est pleurer si l'on veut méditer.
On vieillit bien plus mal à se gausser des autres
Qu'à pleurer sur soi même avec des patenôtres.
Si pour faire pleurer, il faut pleurer soi-même,
Pour savoir faire rire, restez digne à l'extrême.
On a des mots qui pleurent et des larmes qui charment ;
La bouche sourit mal quand les yeux sont en larmes
Mais la larme de l'œil rit du bruit de la bouche.
Mieux vaut pleurer pour rien que trop rire à la louche.
Qui n'a jamais pleuré, ses larmes a bien masqué,
Car souvent le mouchoir les a dissimulées.
Où sont allées les larmes empêchées de couler ?
Parfois sous les lunettes où on les a cachées !
La vie est un oignon qu'on épluche en pleurant
Et l'on n'a pas trouvé de légume hilarant…
Jacques Grieu
|
|
|
AFRIQUE SEPTENTRIONALE.
Gallica : Revue d'Orient 1847-2, pages 304-310
|
ALGERIE, LA PRESSE ARABE.
EL MOUBACHER, LE NOUVELLISTE.
La presse ! Voilà ce qui a manqué aux Arabes pour conserver la haute position qu'ils s'étaient faite par la conquête, voilà ce qui s'est opposé au développement de leur civilisation si brillante à son début, ce qui a assuré définitivement la suprématie puissante du christianisme sur le mohammédisme, et on peut dire que le triomphe de l'un sur l'autre a été assuré du jour où Laurent Koster, le Hollandais, jetait dans ses moules le métal qui allait servir à traduire la pensée avec la rapidité de l'éclair. Les historiens se sont en vain fatigués à rechercher les causes de la supériorité de l'une des religions sur l'autre ; elle est non pas toute là, mais surtout là et, pour s'en convaincre, il suffira d'examiner l'état dans lequel se trouvaient, au moment de l'invention de l'imprimerie, les sociétés placées sous l'empire des principes religieux dont le Christ et Mohammed sont l'expression vivante. On sera étonné d'y voir l'esprit humain, quelle que soit la direction qu'il prenne, y obéir aux mêmes impulsions, y revêtir les mêmes formes. Mais, aussitôt que l'habileté de Gutenberg eut donné à la merveilleuse découverte de Koster un développement complet, tout change, et le génie occidental s'avance brillamment vers les sphères immenses d'un progrès indéfini en laissant son rival mourir dans sa gloire inféconde.
Enfin, après plusieurs siècles de somnolence, l'Orient se réveille à l'appel de l'Europe, et la première chose dont celle-ci croit devoir lui faire présent, c'est le journal, cette feuille volante et fragile qui cependant devient le lien des âmes, le symbole de l'union des peuples, le lien par lequel se fait la grande communion de la pensée, force dont il est difficile de calculer la puissance, car elle sait soulever des tempêtes et les calmer aussi.
Les essais de publications quotidiennes ou hebdomadaires faites jusqu'à présent au milieu des peuples orientaux n'ont pas eu, dira-t-on, grande portée. Cela est vrai, mais il faut convenir aussi que, s'ils ne sont pas prématurés, le terrain était bien mal préparé pour les faire. On a eu cependant raison de les tenter, parce que jamais une pensée ne meurt, surtout lorsqu'elle est de l'immense grandeur de celle-ci.
Depuis quelques années, on pensait à doter l'Algérie d'une feuille arabe. Plusieurs cheikhs de la province d'Oran avaient même adressé une demande de ce genre au gouvernement, qui y souscrivit d'ailleurs avec empressement, car il en vit de suite toute la portée. Mais on fut arrêté fort longtemps dans l'exécution par quelques difficultés matérielles assez difficiles à vaincre, telles, par exempte, que celle de la rédaction. Elles ont été enfin heureusement surmontées, et, le 30 octobre dernier, trois numéros avaient déjà paru d'une feuille périodique, entièrement écrite en arabe, intitulée El-Moubacher, dénomination qui correspond à celle de Nouvelliste, avec cette différence que le terme arabe implique la qualification de utile, ce qui se représenterait assez exactement par le Nouvelliste utile.
Ce journal s'imprime à Alger et est destiné à être répandu dams toute l'Algérie. Il parait deux fois par mois, le 15 et le 30, et le premier numéro est daté du 15 septembre 1847 (5 du mois de cheoual 1263 de l'Hégire).
Le programme placé en tête du premier numéro indique avec quelques détails le but de cette fondation, uniquement instituée dans une intention d'utilité pour les indigènes de l'Algérie, Les nouvelles particulières ou étrangères qui toucheront aux intérêts de la colonie, ou qui pourront piquer la curiosité des lecteurs arabes, de tous les indigènes et colons, les mouvements du commerce intérieur et extérieur, t'état des marchés dans les principales localités de l'Algérie et des places riveraines de la Méditerranée en Europe, les relations avec Constantinople, la Perse, la Syrie, Tunis, Tripoli, le Maroc, les faits industriels importants, les développements survenus dans les arts, et les explications
Scientifiques, mais aussi simples que possible dans leurs développements, composent le cadre des matières que le Nouvelliste se propose de traiter dans ses feuilles.
" Pour ajouter l'agréable à l'utile, il s'occupe également de littérature, surtout de littérature arabe, et aussi d'histoire, d'astronomie, de poésie. L'étude des législations musulmanes et françaises y aura aussi sa place.
Mais l'agriculture surtout, les soins à donner à l'élève, à la conservation et à la reproduction du bétail, en un mot, tout ce qui a trait au bien et aux progrès de la grande et de la petite culture, seront l'objet de l'attention du Nouvelliste algérien. Il indiquera les améliorations ou tentatives d'améliorations qui sembleront ou seront véritablement applicables à la colonie dans les différentes natures de terrains, les naturalisations des plantes qui peuvent être utilement transportées sur le sol de l'Algérie. "
On a observé que, quant à la forme matérielle du Mobacher, elle était loin d'être irréprochable. On eût voulu qu'au lieu d'être imprimé à pleines pages, chacune de celles-ci eut été divisée en deux colonnes ; on a vivement critiqué la forme des caractères, auxquels il a été reproché surtout d'être et trop larges et trop maigres, défauts propres d'ailleurs à tous les types arabes de l'Europe. Si nous accueillons les deux premières, observations pour bonnes, il n'en est pas de même de celle-ci. En effet, l'examen des manuscrits prouve que l'écriture orientale, comme toutes les écritures, varie beaucoup, et nous connaissons, par exemple, des Korans et d'autres livres écrits en caractères aussi effilés, aussi peu nourris que ceux employés pour le Mobacher, bien qu'il faille reconnaître qu'en général l'écriture arabe est plutôt grasse que maigre. Mais cela ne tient-il pas uniquement aux instruments dont on se sert et non à l'essence même du caractère dans sa forme typique ?
Cela ne se modifiera-t-il pas avec le temps sous l'influence d'autres moyens matériels de transcription, en présence, par exemple, de la plume de fer, de la plume d'oie même, ainsi que nous pourrions en montrer déjà quelques épreuves ? C'est là, du reste, une question d'un intérêt secondaire et à laquelle un peuple fait à peine attention.
Qui a remarqué le changement produit par les plumes métalliques en France ? et cependant il y en a eu un fort remarquable. Qu'est devenue notre bâtarde arrondie aux formes si gauloises, si nationales ? *
Qui la regrette ? qui même lui a donné le plus modeste souvenir ? Mais revenons à notre nouvelle feuille périodique.
Voici la pièce placée en tête du premier numéro et à laquelle nous eussions désiré un caractère plus profondément arabe, une physionomie plus orientale ; c'est une proclamation aux Arabes.
Proclamation aux Arabes.
De la part du duc d'Aumale, le fils du roi des Français, gouverneur général de l'Algérie, à tous les Arabes et Kabyles, grands et petits, salut ; "Le roi des Français (que Dieu bénisse ses desseins et lui donne la victoire!) m'a confié le gouvernement du royaume d'Alger, depuis les frontières du Maroc jusqu'à celles de Tunis. "Vous avez appris, ô musulmans! combien le bras de la France était puissant et redoutable, et combien son gouvernement était juste et clément. Vous avez obéi à l'immuable volonté de Dieu qui donne les empires à qui bon lui semble sur la terre.
"Vous avez fait votre soumission au maréchal, et vous avez éprouvé la bonté de son gouvernement; vous vous souviendrez toujours qu'il honora les grands, qu'il protégea les faibles et qu'il fut équitable avec tous. Rien ne sera changé à ce qu'il avait fait, et ce qu'il avait établi sera maintenu, car il n'a jamais fait que le bien, et il n'a agi que par la volonté du roi des Français. C'est le roi qui lui avait ordonné de se montrer grand et généreux après la victoire c'est le roi qui a voulu que vos biens et votre religion fussent respectés, et que vous fussiez gouvernés par les principaux d'entre vous, sous l'autorité bienfaisante de la France c'est le roi, dont la bonté est inépuisable, qui a pardonné tant de fois aux insensés qui, poussés par de perfides conseils, ont trahi la parole qu'ils nous avaient jurée. Les insensés ont reconnu l'inanité de leurs efforts, et la main de Dieu les a frappés jusque sur la terre étrangère, où ils avaient cherché un refuge.
"Remerciez Dieu de ce qu'il vous a donné les richesses et les jouissances de la paix en échange des maux inséparables de la guerre.
"C'est pour vous donner un gage encore plus éclatant de ses bonnes intentions à votre égard que le roi des Français m'a envoyé au milieu de vous comme son représentant sur cette terre qu'il aime à l'égal de la France. J'ai déjà vécu parmi vous ; je connais vos lois et vos usages, et tous mes actes tendront à augmenter votre prospérité et celle du pays.
"Vous savez que notre parole est aussi ferme que notre force est irrésistible ; vous avez éprouvé la terrible puissance de nos armes ; vous avez apprécié et vous apprécierez chaque jour davantage les bienfaits de notre amitié ceux d'entre vous qui sont restés fidèles à leurs serments ont prospéré, ceux qui ont été parjures ont souffert tant de malheurs que le cœur en est profondément accablé ! Vous connaissez la seule voie qui peut vous conduire au bonheur, et Dieu vous inspirera de la sagesse pour y persévérer. SALUT
C'est une grande et heureuse idée que d'avoir crée une feuille destinée à la partie éclairée de là grande famille arabe et cette qui a sur lès masses l'action la plus évidente, la plus énergique. Pensée féconde, digne de l'esprit de paix et de civilisation qui doit nous animer, dont le mérite, j'allais dire la gloire, revient tout entier à la direction des affaires de l'Algérie. Après le combat par les armes, le combat par la pensée ; après avoir montré à nos adversaires vaincus la force de nos armés replaçons-les, au sein de la paix; pour employer le langage de la persuasion, l'influence des bons conseils ; la puissance irrésistible des raisonnements fondée sur les principes de la morale de tous tes temps et de l'immortelle raison humaine.
L'œuvre, ainsi comprise, sera longue. On ne change pas en quelques années les idées d'un peuple ; mais elle sera d'autant plus complète, d'autant plus profonde.
Et puis, voyez-en les conséquences. Le Mobacher ne restera pas longtemps seul qu'on multiplie les écoles et les talebs, qu'on donne à l'instruction cette étendue qui lui est accordée avec tant de peine chez nous, et les Arabes répondront à nos efforts. Intelligences vives, brillantes, pleines de poésie et de désirs, ils boiront ardemment à cette nouvelle coupe qui leur vaudra des jouissances intimes. Il n'y a pas chez eux cette lenteur de l'esprit si rebelle à tous progrès, à tous changements que t'en remarque aujourd'hui dans la masse de nos populations. La vie nomade, leur état de guerre ; de lutte incessante semble avoir imprimé aux éléments mêmes de la vie intellectuelle plus de virtualité, de mouvement, une précipitation qui disparaît, pourrait-on croire, devant la fixité, le repos, et ce travail monotone, ennuyeux d'une existence stable fixée, une fois pour toutes, aux puissances matérielles de la vie positive comme l'est ta nôtre. Puissances n'est pas ici un mot impropre, car quoi de plus tyrannique que toutes ces nécessités auxquelles se rattachent d'une manière si terrible les mille liens de nos besoins de chaque jour?
Ce n'est pas à dire que la vie nomade ait grande supériorité sur la vie stable. Non ; mais celle-ci a bien évidemment besoin de la variété infinie; des émotions multiples de l'autre. Cela est si vrai, que chacun de nous sent à chaque instant le besoin d'échapper au fatigant fardeau de sensations qui sont toujours les mêmes, et d'aller, par les voyages, retremper l'âme aux sources immortelles et toujours splendides de la nature. Oui, l'homme, intelligence et matière à la fois, reflet du grand livre de Dieu, ne peut, ne doit pas être condamné à rouler sans cesse dans le cercle insipide d'une existence toujours la même, ce faisceau brillant de facultés auquel le changement, la variété ont été assignés comme condition impérieuse d'une éternelle durée. Un jour viendra où, reflétant ce qui se passe dans les cieux, il sera, comme les astres brillants du jour et de la nuit. fixe, dans une mobilité incessante, et déjà n'avons-nous pas fait l'inauguration de cette ère si désirable en projetant, sur des routes de fer, ces véhicules impétueux qui nous transportent à travers l'espace matériel avec une vitesse qu'atteint à peine l'aile de l'oiseau rapide ?
Que l'on ne dise pas qu'il y ait incompatibilité entre le mouvement et la stabilité, ce serait blasphémer; la nature n'est-elle pas toujours une et grandiose dans les incessantes évolutions de ses éléments ?
L'esprit gagnera bien évidemment à cette nouvelle vie ; il se complètera par la flexibilité de sa puissance créatrice de tout ce que lui vaut le calme du repos ; l'élaboration paisible de la pensée il reprendra cette vivacité, cette délicatesse de sensation, cette exquise sensibilité que l'on dirait atrophiées par un repos trop prolongé, et que l'on retrouve chez la race ismaélique.
Le hasard a mis en contact sur le sol algérien comme ta démonstration de ce que nous avançons ici : le Kabyle à côté de l'enfant des steppes, le travailleur à côte du poète, et celui-ci a bien reconnu tout ce qui manque à t'autre, lorsqu'il compare l'intelligence des hommes de la montagne à la dureté de leurs rochers. Cela est vrai à ne remuer que des pierres, on devient pierre. Un journal comme le Moubacher ne ferait pas sur le Berbère l'impression qu'il fait sur l'Arabe. Les fils de Ber sont trop positifs et pas assez rêveurs; mais il est heureusement d'autres moyens aussi énergiques de les rapprocher de nous. Vingt feuilles périodiques, au contraire, lancées chaque jour à travers les camps nomades les traverseront comme des flammes ardentes, activant le mouvement du pouls, ainsi que le ferait le fluide électrique, laissant après elles, empreints sur tous les visages, la joie, le contentement, l'étonnement ou la surprise.
Vous figurez-vous le journal venant chaque jour leur dire quelque chose de la grandeur et de la gloire de la France, leur donner des nouvelles de ce qui les intéresse, des pays les plus proches, des contrées les plus éloignées, leur apprendre les progrès de nos sciences, de nos arts, de notre industrie, de toutes choses qu'ils ne connaissent pas, que quelques-uns d'entre eux seulement ont entrevu avec un sentiment d'admiration dont ils n'ont pu déguiser toute la grandeur ? *Au contact répété de ces récits variés de formes diverses, dans lesquels seront examinées toutes les questions où toutes les opinions seront discutées, où les faux raisonnements, les jugements erronés seront combattus, où la philosophie, la vraie philosophie de l'Europe occidentale, la philosophie de tous les temps, viendra doucement attaquer les méchantes erreurs de la barbarie ;les mauvaises pensées perdront de leur âcreté; la haine, de son fiel ; les préjugés s'effaceront, le fanatisme disparaîtra pour faire place à une douce tolérance, et les idées de guerre, de violence, de haine s'éloigneront à toujours devant l'influence irrésistible des anges de la paix; la concorde reliera Arabes et chrétiens dans un même ensemble. Pour les uns, le Koran, le livre par excellence, aura perdu une partie de son prestige, l'Evangile deviendra ce qu'il est véritablement, une bonne nouvelle. Mohammed verrait-il ce changement avec regret ? Non ; car c'est lui qui a dit " Cherchez la science et la vérité, dussiez-vous ne les trouver qu'aux extrémités du monde ! "
Honneur donc, encore une fois, aux créateurs de la presse arabe en Algérie !
0. MAC CARTHY.
|
|
Révoltés......
Par M. Alain Algudo
|
|
Piqûre de rappel à l’occasion
du soixantième anniversaire de notre exode !
Discours de Alain ALGUDO
Président CDFA/UCDARA
Vice Président de VERITAS
Au Congrès de VERITAS LE 23 SEPTEMBRE 2017
Révoltés......
Mais comment, nous Français d'Algérie, pourrions nous aujourd'hui ne pas l'être ?
Comment pourrions-nous rester insensibles à cette injustice et ce rejet qui perdurent à notre égard quand nous évoquons les conséquences criminelles et dramatiques d'une trahison d’État avérée contre nos populations des 15 départements Français d'Algérie bradés dans le sang des nôtres ?
Comment pourrions nous rester en effet insensibles à ces tromperies sans frein, à ces débauches verbales perverties et prostituées de personnalités se disant humanistes, se croyant bien pensantes, et qui en fait, nous prouvent qu'elles ne sont ni sages, ni cultivées, souvent ignares (n'est-ce pas Monsieur Macron?)
Et voyez vous, chers Amis, dans ces hauts responsables qui se succèdent depuis plus d'un demi siècle maintenant, que voyons nous ?: des mystificateurs progressistes que les médias aux ordres, et leurs sbires qui les entourent, qualifient de « libéraux et d'humanistes. »
Mais voilà aujourd'hui, toute cette faune est confrontée à une réalité qui dépasse la fiction, l'obscurcissement général des esprits devant un danger mortel, alors que « la mâle réaction » internationale réside dans le dépôt, par le bon peuple anesthésié, de fleurs, de bougies et de nounours, de marches blanches de protestation sur les lieux des attentats.
Et en face, les milliers de djihadistes sont morts de rire devant leurs cibles potentielles encore ainsi offertes. Ils aiguisent leurs couteaux, rechargent leurs kalachnikov, et préparent d'autres rouleaux compresseurs.
Soyons lucides ! Depuis 1962 et la victoire offerte aux tenants du terrorisme djihadiste islamique en Algérie, les Français ont perdu tous les critères d'un rapport avec les réalités éclatantes d'une guerre ouverte qui n'a jamais cessée, et qui va irrémédiablement s'amplifier.
Ils sont, déjà depuis longtemps, le ver dans le fruit. Mais voilà ce n'est finalement pas le ver qui crève, mais le fruit qui pourrit !! Nous en sommes là aujourd'hui : Le ver lui va se multiplier et accentuer son œuvre de destruction massive si l'on ne prend garde. Les chrysalides sont là, en attente,de temps en temps un papillon mortel éclot et frappe !! Mais n'est-il pas déjà trop tard ?
Mais où est donc passé ce sens salvateur de réaction d'un peuple qui, à travers les millénaires, à fait sa grandeur...... aujourd'hui en phase terminale. Ce peuple qui avait prouvé qu'il n'était jamais attaqué impunément, avec Jeanne D'ARC comme exemple, entre autres Jean MOULIN !!
Mais voilà, quand l'exemple de la crasse décadence vient d'un personnage dont tout prouve la duplicité, le machiavélisme, le don du mensonge et de la trahison, et que l' adulation dont il est l'objet, s'étale dans tous les discours de tous les partis politiques, je dis bien tous, (même les communistes qu'il a installés au pouvoir en 45 et qui lui ont bien renvoyé l’ascenseur pour la trahison de 1962), alors nous sommes en droit, nous Français d'Algérie, de leur faire aujourd'hui une piqûre de rappel, succincte, car de multiples ouvrages dénoncent ce qui restera dans l'histoire la plus immonde des impostures.
OUI, nous sommes révoltés devant les preuves indéniables des machiavéliques manœuvres qui ont mené à un monstrueux nettoyage ethnique qui, à l'échelle des populations, (nos compatriotes harkis ayant subi l'enfer, et c'est peu dire) n'a rien à envier à ceux des Hitler, Staline, Mao et autres Pol Pot.
Et la liste n'est pas exhaustive.
Oui, bien sûr nous allons nous répéter et certains esprits bien intentionnés diront « ressasser » « rabâcher, » eux évidemment ne faisant que se « souvenir ! »
Alors nous leur disons OUI, nous ressasserons, nous rabâcherons, nous crierons, nous hurlerons ces terribles réalités, ne vous en déplaise, jusqu'à notre dernier souffle, ces réalités qui ont fait de notre peuple la victime expiatoire du plus grand, dramatique, et sanglant déplacement de populations de l'histoire de France. Et circonstances aggravantes, odieuses, et déplorables, sous les yeux d'une majorité de compatriotes métropolitains hostiles, shootés à la désinformation gaullo/communiste qui nous a accueillis avec des cris de haine.
Mais, ici, mille fois MERCI, à cette minorité qui a su racheter la lâcheté et l'inqualifiable attitude du plus grand nombre, nous permettant ce petit baume au cœur qui a permis la réinstallation réussie de beaucoup des nôtres. C'est pourquoi nous insistons auprès de tous les nôtres pour que ne soient pas oubliés nos héroïques combattants pour garder l'Algérie à la France, pour soutenir aussi l’incommensurable chagrin de ceux qui pleurent encore leurs disparus et NOTRE pays perdu.
C'est pour leur mémoire et le respect que nous leur devons que nous continuons cette lutte pour la justice et la vérité sur notre histoire.
Alors pour conclure, brièvement car la documentation est énorme, un rappel des étapes du déroulement de notre drame, sciemment organisé et que les différents gouvernements et les médias, complices des deux côtés de la Méditerranée, cachent à nos deux peuples depuis plus d'un demi-siècle : POUR LES GAULLISTES CE NE SONT QUE PURES INVENTIONS DES « ULTRAS DE L'ALGERIE FRANCAISE !! et Pourtant :
Déjà en 1944 à l'hôtel de ville d'Alger capitale de la France en guerre il déclare :
« La France quoiqu'il arrive, n'abandonnera pas l'Algérie. Cela signifie que nous ne devons jamais mettre en question sous aucune forme , ni en dedans, ni en dehors, que l'Algérie est notre domaine. »
Miche DEBRE en novembre 1956
« Que les Algériens se rappellent que l'abandon de la souveraineté Française en Algérie est un acte illégitime qui met tout ceux qui s'en rendent complices hors la loi et tout ceux qui s'y opposent, quelque soit le moyen employé, en état de légitime défenses !! »
Pourquoi alors avoir réprimé si férocement avec l'aide de l'ennemi , la révolte d'auto défense de nos militaires et combattants de l'OAS qui étaient ainsi légitimés ?
Charles DE GAULLE (après le « Je vous ai compris ! »)
Le 4 juin 1958 :
« Dans toute l'Algérie il n'y a que des Français à part entière ! »
Il faisait ce jour là une découverte le bougre !
Le 5 juin 1958 :
« L'Algérie est une terre Française, organiquement et pour toujours ! »
Il pensait alors exactement le contraire !
Le 6 juin 1958 à MOSTAGANEM:
« Vive l'Algérie Française ! »
Je suis un témoin direct de cette déclaration qui déchaîna l’enthousiasme de la foule présente.
Le 7 juin 1958 à ORAN :
« OUI, OUI, OUI, la France est ici pour toujours. Elle est ici avec sa vocation millénaire qui s'exprime aujourd'hui en trois mots:Liberté, Égalité, Fraternité...vive Oran, ville que j'aime et que je salue, bonne, chère grande ville d'Oran, grande ville Française ! »
C'était la déclaration d'amour d'un cobra qui fascine sa future proie!!
Le 1er juillet 1958 à BATNA
« Français de confession musulmane, vous devez venir de plus en plus nombreux parmi nous.
N'ayez pas peur l'armée Française est là.
Vive Batna ! Vive l'Algérie Française ! Vive la République ! Vive la France !
Le 2 octobre 1958 à El BIAR
Le Capitaine OUDINOT le questionnant en s'inquiétant du sort des harkis en cas de retrait de la France, je vous recommande particulièrement cette réponse :
« Eh bien dites-moi OUDINOT , avez-vous vu DE GAULLE abandonner quelques chose ?»
Non seulement il les abandonna mais il les traita de « magma ! »
Le 30 août 1959
« Le drapeau du FLN ne flottera jamais sur Alger, moi vivant !! »
C'est lui-même qui le plantera un certain 19 mars 1962 en abaissant celui tâché du sang d'HERNANDEZ pour la libération de la France lors des deux dernières guerres avec l'armée d'Afrique.
Le 30 octobre 1959 :
« A quelles hécatombe ne condamnerions nous pas ce pays si nous étions assez stupides et assez lâches pour l'abandonner ! »
Les événements à venir allaient nous prouver qu'il était lui-même tout cela en même temps !!
3 mars 1960 :
« L'indépendance réclamée par Ferhat Abbas et sa bande est une fumisterie ! »
Il n'y aura pas de Dien Bien Phu en Algérie, l’insurrection ne nous mettra pas à la porte. »
La France ne doit pas partir. Elle a le droit d'être en Algérie, elle y restera !! »
Et, en matière de fumisterie, l'histoire nous apprendra qu'il était un expert en la matière.
22 octobre 1960 :
« Les insurgés voudraient que nous leur passions la main. Cela nous le ferons jamais ! »
Ainsi, la confiance de la population bien installée, la sécurité rétablie, l'armée réduisant à sa demande les derniers résidus de la rebellion dans le pays :
« Achevez de prendre les armes aux rebelles » ordonnait-il à l'armée, « la France ne quittera jamais l'Algérie ! »
Soudain, c'est la douche mortelle !!!!
Nous le savons maintenant, son plan machiavélique avait mûri en secret depuis 1954.
C'est un revirement total mais prévu dans son esprit tordu. Sans état d'âme : il commence par libérer tous les détenus du FLN, traite ouvertement avec la rébellion et fini par s'allier à elle pour combattre ses opposants qui refusaient de renier la parole donnée aux populations.
Le défaite politique est consommée, l'armée qu'il n'a cessé d'encourager à détruire l'ennemi, attisant ainsi la haine, est mise sur la touche. Les récalcitrants éliminés !
Il n'est plus question de l'Algérie Française, mais de l'Algérie Algérienne provoquant un épiphénomène clandestin qui ne durera, entre 61 et 62, que 11 mois : l'OAS, réaction d'auto défense contre l'insoutenable et odieuse trahison.
Puis les calamiteux « accords d'Evian » qui garantissaient la protection des personnes et des biens sont signés le 18 mars, mis en application le 19, et plébiscité par les Français lors du référendum du 8 avril 1962 violant sa Constitution de 1958, excluant tous les départements Français d'Algérie de la consultation, alors que les DOM/TOM y participaient.
Le comble de la perfidie à notre encontre !!
Mais le déshonneur du Général à tire provisoire n'allait pas s'arrêter là, il n'avait alors plus de limite quand il déclare :
Il n'est pas question que l'armée protège les Français d'Algérie, ils n'auront qu'à se débrouiller avec le FLN !!!
(ces propos ont été rapportés par l'Académicien Éric ROUSSEL)
Puis il répond à Michel DEBRE qui lui annonce que nos compatriotes se font massacrer à ORAN le 5 juillet 1962 :
« Eh bien, ils n'avaient qu'à rentrer avant ! »
Français de Métropole, il faut que vous sachiez qu'il venait de donner le jour même des ordres formels à l'armée de ne pas intervenir, même en cas de danger de mort pour les victimes d'exactions......nous connaissons la suite pour nos disparus et nos compatriotes Harkis dont certains sont passés dans des concasseurs de carrière en marche pour avoir fait confiance à la parole de celui que le journaliste Alain DUHAMEL a justement qualifié de
« plus grand traître de la V° République pour les Français d'Algérie. »
Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, après la tragédie DE GAULLE déclare dans une interview accordée à Michel DROIT :
« Si je n'avais pas été l’État, j'aurais été dans l'OAS ! »
Nous nous rajouterons : oui comme dans la résistance en France occupée, avec son arme de prédilection, un micro quelque part à l'abri des dangers à l'étranger !!
Voilà mes Amis ! Tout n'est pas dit...mais pour nous le crime prémédité était consommé !! !! »
Et par sa faute, près d'un million d'êtres humains ont perdu la vie, dans les deux camps.
VOILA POURQUOI, AU NOM DE CEUX DONT NOUS REFUSONS DE TRAHIR LA MEMOIRE, NOUS RECLAMONS JUSTICE EN DEMONTRANT LES ETAPES D'UNE TRAHISON PROGRAMMEE QUI A MENE A CET INDENIABLE CRIME IMPRESCRIPTIBLE CONTRE L'HUMANITE !!
Alors, je pose la question, ne sommes nous pas en droit,
nous Français d'Algérie, toutes ethnies confondues
d'avoir les raisons d'être
Révoltés ?
Alain ALGUDO
Le 23 septembre 2017
|
|
Qui veut la guerre ?
Envoyé par Mme N. Marquet
|
Alexis ARETTE - 19 mars 2022
Quand, après la défaite nazie, la Russie soviétique supérieurement armée par les Américains parut agressive pour le reste de l'Europe, Churchill eut cette terrible boutade en comparant Staline à Hitler : " Nous avons tué le mauvais cochon ! ". Le propos ne fut guère commenté, car la vérité " officielle " état autre, depuis que De Gaulle, ayant absolument besoin des communistes pour s'imposer, avait parlé de la Russie comme " notre belle et bonne alliée ! "
Plus tard, Soljenitsyne renouvela le propos de Churchill en soutenant que le communisme était pire que l'Hitlérisme, ce qui lui aliéna les faveurs officielles. Cependant, les Américains prirent des mesures de défense, avec l'ONU qui installa un réseau militairement " sanitaire " aux frontières soviétiques, et, lorsque le communisme s'effondra, les bases de l'Otan, qui n'avaient plus de raison d'être, restèrent en place. C'est l'argument de cette manifestation " inamicale ", jugée menaçante, dont s'est servi le Président Poutine pour justifier son offensive. Il nous semble que d'autres moyens eussent été préférables, mais les Américains ont aussi leur part de responsabilités dans l'affaire !
Mais que le président des Etats-Unis, puisse traiter le Président Russe de " criminel de Guerre ", ne prouve que son idiotisme et sa prétention. Quand on appartient à une nation qui s'est établie sur le génocide des tribus indiennes, sur la société meurtrière de Ku-Klux-Klan organisée par le général maçon Pike, et sur le mensonge des armes secrètes Irakiennes, pour s'emparer et piller un des territoires arabes, où les Chrétiens étaient respectés, voilà qui justifie l'opinion qu'avait Einstein d'une nation " Passée de la barbarie à la décadence, sans avoir connu la civilisation ! "
En fait, la Société Yankee, a repris la prétention juive " du peuple élu " qui justifia le massacre des Cananéens, comme étant ordonné par Dieu ! Ainsi, voici quels furent les propos du Président Truman (1884-1972) alors qu'il était Grand Maître maçon de la loge du Missouri, qui fit ensuite jeter la bombe atomique sur les populations civiles de Hiroshima et de Nagasaki, alors que les japonais avaient déjà fait des offres de reddition !
Le 22 Juin 1941, alors que la guerre ravageait l'Occident, il écrivait dans le " New York Times : " Si nous voyons que les Russes l'emportent sur les Allemands, nous aiderons les Allemands ! Si nous voyons que les Allemands l'emportent sur les Russes, nous aiderons les Russes ! "
Telle est la morale Yankee ! Et telle été l'acceptation de cette morale par nos derniers Présidents Fantoches, serviteurs, o combien dociles, du capitalisme international ! Nous avons aujourd'hui une petite modification du plan mondialiste des Yankees. C'est, qu'après la guerre d'Irak, ils ont tiré la leçon de leurs armes psychotoniques qui ont anéanti toute volonté des soldats irakiens : C'est que ces armes n'ont pu être totalement contrôlées et que quantité de leurs effroyables effets ont mentalement et physiologiquement atteints leurs troupes, provoquant jusqu'à la stérilité des individus. Dès lors, il a été décidé que l'armée Yankee ne serait plus engagée pour des conflits extérieurs, mais qu'à sa place, on susciterait des conflits dans les peuples " colonisés ", qui pourraient ainsi s'exterminer ! En fait les Etats-Unis font acte de la fameuse boutade : " Armons-nous et…partez " ! Ainsi les décideurs ne seront pas les payeurs ! Et en sus, le président Poutine a révélé, le 15 septembre 2013, que lui aussi possédait l'arme diabolique !
Ainsi voyons-nous que la politique mondialiste ne cesse d'exalter la livraison de nouvelles armes à l'Ukraine, afin que Russes et Ukrainiens se détruisent davantage. Un seul de nos Présidents semble avoir vu clair dans le jeu des USA. Bien qu'incapable de changer les choses, le Président Mitterrand a pu dire : " Les Français ne le savent pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique (…) Une guerre sans morts, mais une guerre." Les incitateurs yankees et leurs valets occidentaux ont oublié une leçon que donne l'Histoire : c'est que toute société qui s'embourgeoise, perd ses qualités viriles. La décadence romaine en est un exemple connu, mais moins éloigné, l'exemple Wisigoth démontre la même chose. Régnant en maîtres sur l'ensemble hispanique, le pouvoir avait tellement amolli cette race conquérante, que lorsque, en 711, l'Arabe Tariq-ibn-Ziyad, eut franchi le détroit qui serait un jour Gibraltar, le Roi Rodrigue eut beau vouloir mobiliser ses guerriers, la moitié du Ban ne répondit pas à son appel ! Et un an après, les cavaliers Maures buttaient aux Pyrénées !
C'est ce qui s'est passé lorsque De Gaulle, livrant l'Algérie à l'ennemi, put s'appuyer sur la couardise d'une partie du contingent qui traitait le drapeau national de " serpillière " ! Et le peuple français, par voie électorale, entérina l'infamie.
Nous subissons aujourd'hui les conséquences de ce phénomène de lâcheté populaire plutôt rare dans l'Histoire de France. Et nous en avons le début des conséquences, selon ce qu'en dit la Bible : " Les parents ont mangé les raisins verts, et ce sont les fils qui en ont eu les dents agacées ! "
Face à l'invasion mahométane, la Chrétienté Ibérique mettra 8 siècles pour reconquérir le territoire ! Mais la guerre atomique pourrait aujourd'hui, résoudre autrement et définitivement le problème…
Parlant d'un désastre qu'il entrevoyait comme " sans précédent ", Einstein ajoutait : " Je ne sais pas ce que sera la troisième guerre mondiale, mais je sais que la quatrième se fera avec des bâtons et des pierres ! "
Héritiers, malgré nous, de l'ignominie que fut le Gaullisme je me demande si nous avons mérité de survivre !
Alexis ARETTE
|
|
|
1962/2022 -
Par M. Alain Algudo 12 avril 2022
|
|
SOIXANTENAIRE DE LA PLUS GRANDE HONTE DE L'HISTOIRE DE FRANCE
La question doit être posée : Comment un pays civilisé a-t-il pu arriver à laisser commettre de tels crimes par dévotion à un seul homme ?
CRIMES !!! Le mot n'est pas trop fort ! Pourquoi ? : pour la seule raison qu'il y a eu abandon délibéré des citoyens des départements Français d'Algérie aux exactions mortelles de l'ennemi en violation des promesses de protection.
Aujourd'hui, enfin, la vérité explose, les archives commencent à parler, la forfaiture sanglante du Chef de l'état de l'époque commence à suinter des dossiers classés " SECRET DÉFENSE ! "
Maître des esprits, exploitant les crédules, un Général rappelé au pouvoir par ceux-là même qu'il allait trahir en les excluant du choix de leur propre avenir, faisant endosser par un référendum la responsabilité de son carnage, programmé et prémédité, à un peuple intoxiqué par cette désinformation que le sinistre personnage maîtrisa avec un vice qui ne pouvait appartenir qu'à un être ayant été trempé directement dans un bain de malédiction.
1962/2022 !! Soixante ans de combats pour la justice et la vérité, combat qui débuta, avec toute une équipe de compatriotes décidés à BÉZIERS, par des confrontations avec les communistes dont nous utilisions la colle fraîche de leurs affichages pour apposer nos affiches pour l'Amnistie. Puis ce fut le dur conflit contre les films " La Bataille d'Alger " et " Vingt ans dans les Aurès ", quelques copains décidés ont fait de BÉZIERS une ville qui grouillait de CRS après une " strounga " au cinéma incriminé, et c'est sous cette protection que ces projections eurent lieu non pas au cinéma, mais au Palais des Congrès fortifié, alors que nous n'étions qu'une quinzaine " d'actifs " !
Nous avons eu droit alors à des arrestations et gardes à vue de sécurité, passage devant le procureur de la République et surveillance rapprochée.
Et les années passèrent sans que cesse la plus hideuse des désinformations d'État, les gouvernements se sont succédés sans que n'aboutissent nos principales revendications.
Soixante ans après la duplicité Gaulliste perdure, les promesses de justice ne sont que des sifflements de ces reptiles qui savent si bien se mouvoir dans un univers où les proies hypnotisées sont toujours faciles à atteindre.
Des résultats substantiels sur le plan matériel ont été obtenus par un travail forcené des Associations de défense et ce à travers des " lois d'exceptions " qui nous ont permis d'obtenir des résultats qui ont sauvé des situations délicates malgré les obstacles rencontrés par des interprétations toujours défavorables des textes par les administrations de tutelle.Mais hélas, jamais nous n'avons pu obtenir la simple application des articles 544 et 545 du code civil de la République Française, jamais nous n'avons pu obtenir la simple application de l'article 17 des droit de l'homme et du citoyen prouvant par là encore, s'il le fallait, que nous n'avons jamais été considérés comme des Français à part entière.
Voilà ce qu'il faut faire savoir avec fermeté, cet ostracisme scandaleux de gouvernants vis-à-vis d'une catégorie de citoyens chassés de leurs départements pour " raison d'État " ; un État qui en l'occurrence violait et viole encore la Constitution dont il était justement l'auteur et aujourd'hui le garant !
Alors préparons intelligemment cette année du soixantenaire d'une manière digne, en hommage à nos victimes. Ne sombrons pas dans le ridicule de certains simulacres de notre exode en tombant dans le piège de rapprochements trop faciles pour nos détracteurs à l'affût de tout faux pas pour nous démolir.
Nous avons l'occasion de prouver nos capacités de mobilisation autour des stèles rendues célèbres par le déchaînement médiatique haineux dont elles ont fait l'objet ces dernières années (Marignane, Béziers, Perpignan …...).
Et ne nous méprenons pas, elles sont toujours " sous les feux de la rampe ! "
Alors pourquoi en ces lieux, pour l'anniversaire du soixantenaire, ne réussirions nous pas dans ces villes symboles des " opérations Stèles Fleuries " comme celle de Béziers en 2008 (PJ), qu'un journal national qualifia de " stèle la plus fleurie de France ? " Ce dernier 26 mars a déjà été un succès grâce à certains d'entre vous chers compatriotes réunis au sein de notre COMITE DE LA STÈLE DU SOUVENIR DE NOS MARTYRS de Béziers.
Mais pour cela il faut que nous réalisions " l'union sacrée ", nous soutenant sur le plan national, ne vous y trompez pas l'ennemi, profitant de nos faiblesses d'engagement, fourbit toujours ses armes pour démolir le dernier bastion que nous représentons, bastion ô combien déjà fragilisé par nos conflits et par cette désinformation dont les relents ne sont que le résultat d'un pourrissement d'État qui ne fait que s'accentuer.
Nous avons été les victimes d'un " monstre " qui nous traitait de " braillards " de " Pétainistes " ou de " va nu pieds, " ou de " magma " pour les Harkis ; ses sbires dévots actuels, ne le disent pas mais n'en pensent pas moins. Alors calmement, ayant tous les éléments en main et les arguments irréfutables, dénonçons ses trahisons et multiples crimes en suivant les traces de sang qu'il a laissées sur son chemin tortueux depuis 1940 marqué par l'organisation de massacres directs et indirects, par sa guerre franco-française pour arriver au pouvoir par l'élimination de ses opposants, par des attentats attribués opportunément à l'OAS (ben voyons), des assassinats, des " accidents " ou la mise en place d'autorité de tribunaux d'exception à sa botte, pourvoyeurs de tous les excès mortels que nos patriotes ont subis !
En nous insultant sur notre terre natale en 2017, éructant des propos démentiels et mensongers puant la retape électorale, l'actuel Président de cette Vème république de la trahison d'État ne fait que confirmer l'injustice à notre égard en s'inscrivant, par son insensibilité totale, dans la droite ligne de celui qui marquera l'histoire de France du sceau de l'infamie, Charles Degaulle !
Alain ALGUDO SAINT UPERY
Président d'honneur CDFA/VERITAS -
Auteur de " Mon Combat. "
Comité de la stèle du souvenir de nos martyrs de Béziers
|
|
Défendre un peuple qui veut se suicider ?
Par M. Jacques Guillemain.
Envoyé par M. Lemaitre
|
|
Réflexion faite c’est non !
On ne peut sauver un peuple qui veut se suicider.
Hier soir, Eric Zemmour a décidé de poursuivre le combat et nous avons salué son courage et sa détermination. J’ai même dit qu’il fallait se battre à ses côtés.
Mais j’avoue que ce matin, c’est la colère qui l’emporte et j’en veux au peuple français, qui ne mérite pas d’être sauvé contre son gré. Après tout, s’il veut que la France crève de l’immigration, c’est son droit. S’il se fout de l’avenir de ses enfants, c’est son droit.
Car force est de constater que ce scrutin est absolument consternant et a de quoi décourager les caractères les mieux trempés. De quoi se demander si tous ces chiffres ne sont pas truqués. Réunir 100 000 personnes au Trocadéro et faire 7 % quinze jours plus tard, c’est impossible.
Voilà maintenant plus de 40 ans que JMLP tire la sonnette d’alarme en criant « La Patrie en danger », mais les Français n’ont toujours pas compris que leur pays se libanise à grande vitesse et va disparaitre à jamais dans le tourbillon mondialiste, en sombrant dans des violences interethniques et interconfessionnelles des plus sanglantes.
Et le pire est que les jeunes générations sont encore plus aveugles et inconscientes que leurs aînés.
Au vu des résultats sidérants de cette élection présidentielle, il est clair que le peuple français devient de plus en plus immature et incohérent dans ses choix politiques. Jugez plutôt :
Les Français sont 75 % à ne plus vouloir d’immigration ni d’islam, mais c’est Mélenchon, l’immigrationniste et l’islamophile le plus acharné, qui fait un tabac dans les urnes, avec 2,5 points de plus qu’en 2017 !
Dans certaines villes, grâce au vote immigré, Mélenchon a dépassé les 30 % !. Encore huit jours de campagne et il était au deuxième tour de l’élection, devant Marine.
De plus, la gauche et les Verts totalisent plus de 33 % des voix, un vote totalement immigrationniste, malgré le naufrage avéré de la politique mondialiste et malgré le ratage absolu de l’intégration.
Les Français ne veulent surtout pas d’un remake de 2017, mais ils plébiscitent Macron et Marine, le premier améliorant son score de 3,6 points par rapport à 2017 et Marine faisant 2 points de mieux également.
Les Français adhèrent à 70 % aux idées de Zemmour, mais ils lui accordent royalement 7 % dans les urnes !
Les Français sont 84 % à ne plus vouloir de Macron, selon un sondage récent aussitôt retiré de la toile, mais ils le portent en tête avec 28 % des voix, soit 3,6 points de plus qu’en 2017.
Et tous les sondages d’opinion sur les problèmes de société sont du même tonneau.
Plus les Français se plaignent de l’insécurité, du déclassement social, de l’appauvrissement du pays et du déclin inexorable de la France dans le monde, et plus ils reconduisent ceux qui sont responsables à 100 % du désastre.
Les 3/4 des jeunes musulmans placent la charia au dessus de la loi républicaine, et les Français n’y voient rien à redire. Ils ne vont plus à l’église mais réclament des mosquées ? Avec Macron, ils vont en avoir !
Il n’y a donc rien à faire contre un tel masochisme. Plus les Français pleurent sur leur sort et plus ils en redemandent.
Comprenne qui pourra. Ce peuple qui a rayonné sur le monde, n’a visiblement plus envie de vivre. Et il défend l’Ukraine avant de se protéger lui-même du Grand Remplacement.
En tout cas, plus RL se bat pour lui ouvrir les yeux et pour l’informer de ce que les mondialistes lui cachent, plus on se défonce pour dénoncer les ravages de l’immigration de masse et pour l’ alerter sur la menace existentielle de l’islam conquérant, et plus le peuple français a peur de voter pour ceux qui ambitionnent de renverser la table.
Le programme d’Eric Zemmour est tout simplement exceptionnel et le seul véritablement à la hauteur du danger. Un programme courageux, qui nécessite une volonté et une détermination sans faille. Eric est l’homme de la situation, le seul.
Mais les Français n’ont rien compris. Accorder 7 % à Zemmour, c’est profondément injuste et même indécent, compte tenu de l’immense travail accompli par notre champion de l’identité gauloise et par ses équipes.
Ce vote révèle en fait l’extrême immaturité politique du peuple français, incapable de voir qu’il est en train de se suicider et qu’il va tout simplement disparaitre.
Il n’y a rien à faire pour sauver un peuple qui veut se suicider.
Accorder 28 % à Macron, le président le plus détesté de la Ve République, et seulement 7 % au patriote le plus sincère et désintéressé depuis de Gaulle, c’est tout simplement inexplicable pour moi.
Par conséquent, je n’ai plus l’intention de m’investir dans un combat inutile et perdu d’avance, contre la volonté du peuple français, qui vient de voter pour davantage d’immigration, davantage d’islam, davantage d’insécurité, davantage de précarité. Il veut Macron, il l’aura.
Pour ma part, j’écrirai sur la géopolitique, l’économie, ou bien j’alimenterai la rubrique des chiens écrasés. Des sujets qui n’intéressent personne, mais peu importe.
Et jusqu’au 24 avril, je n’écrirai pas un seul article sur la politique, ni pour ni contre Marine. Ca ne servirait à rien.
Je n’ai pas encore décidé de ce que je ferai pour le second tour. Voter Marine, voter blanc ou m’abstenir, peu importe. J’ai la conviction que Macron, le fossoyeur de la nation, va gagner cette élection. Un verdict que j’accepterai avec fatalisme.
Puisque la volonté du peuple, aussi idiot soit-il, est souveraine !
Et dans cinq ans, nous aurons encore un président immigrationniste, car c’est le vote immigré de plus en plus décisif, qui va devenir le faiseur de roi. 2022 était le point de non retour. Les Français ne l’ont pas compris.
Ils vont très vite en payer le prix fort, car tout va empirer dans des proportions qu’ils ne soupçonnent même pas.
Comme disait JMLP à propos de l’immigration, il y a bien longtemps : « Vous n’avez encore rien vu » !
|
|
Antifasciste
« Quiconque rêve d’une liberté sans limites et sans frein porte en soi le germe du fascisme, même s’il crie son antifascisme à tue-tête. » (Maurice Schumann).
C’est fou le nombre de citations de grands hommes – ou d’hommes réputés grands – qui ne veulent strictement rien dire. Je pense par exemple à cette envolée de De Gaulle : « Fécamp est port de mer et entend le rester ». Craignait-il l’ensablement, comme à Aigues-Mortes, ou l’envasement, comme à Brouage ? Ou « Le Nationalisme c’est la guerre », tirade idiote de François Mitterrand, ou « le Nationalisme c’est la haine de l’autre » de Romain Gary, ou encore « Le 21ème siècle sera religieux ou ne sera pas » d’André Malraux. Dans notre monde dégénérescent, c’est avec de telles inepties, de telles fadaises, de tels lieux communs, qu’on entre dans l’histoire par la grande porte !
Si la citation de Schumann en entête de cet article avait une once de véracité, nul doute que l’anar de droite que je suis serait résolument fasciste. En effet, depuis toujours, j’ai cherché à être un homme libre. Mais je prône une liberté civilisée, qui s’arrête où commence celle de mon voisin, une liberté encadrée par le décalogue chrétien (qui, rappelons-le, a servi de trame au Code Napoléon).
Je suis adepte de « Fays ce que vouldras » – la devise de l’« Abbaye de Thélème » de François Rabelais – ce qui revient à dire que des gens éduqués selon les mêmes valeurs morales et les mêmes principes n’ont pas besoin de lois pour régenter leur vie quotidienne, mais encore faut-il avoir des valeurs qui ne se limitent pas à une jouissance totalement dépravée, à la permissivité sans limite, à l’interdiction d’interdire, au fric-roi et à un égoïsme ou un égocentrisme narcissique !
Dans mon esprit, l’homme de droite a davantage de devoirs que de droits: celui de défendre « la veuve et l’orphelin », de travailler pour nourrir sa famille, d’éduquer ses enfants, etc…
L’état n’est là, au dessus du citoyen, que pour exercer ses fonctions régaliennes: la défense nationale, l’éducation, la justice, la santé publique.
Ma vision des choses n’a donc rien à voir avec le Fascisme italien ou le Nazisme allemand qui sont, de manière évidente et incontestable, deux phénomènes de gauche : Le Fascisme est un avatar du Socialisme. Sa déviance nationale-socialiste est un mouvement prolétarien fondé sur une toute puissance de l’état bureaucratique ; le pouvoir absolu des apparatchiks du parti unique.
C’est donc, fondamentalement, intrinsèquement, une notion de gauche !!!!
« Ma » droite, elle, se rattache philosophiquement à l’ordre naturel, au message chrétien, même si elle englobe aussi des agnostiques et des athées. Ces derniers ayant compris (et admis) ce que nous devons à la monarchie et à nos racines chrétiennes.
Durant toute la campagne pour l’élection présidentielle qui vient (enfin !) de s’achever la droite nationale – incarnée par Eric Zemmour au premier tour, puis par Marine Le Pen au second tour – s’est fait traiter de fasciste par des ignares qui n’ont jamais lu « La doctrine du Fascisme »(1) ou « L’Etat corporatif »(2) de Mussolini, et qui ne font pas la différence entre le National-socialisme d’Hitler, le Fascisme italien, le National-syndicalisme de Primo de Rivera en Espagne (3) ou « L’Estado Novo » de Salazar au Portugal. En France, être de droite c’est forcément être fasciste !
C’est d’ailleurs ce que subodore Maurice Schumann, ce godillot du Gaullisme alimentaire : Il rejoint Londres dès juin 1940 et devient alors le porte-parole de la France Libre. C’est ce gaillard qui, embusqué derrière un micro de la BBC, incitait les Français à s’entretuer de 1940 à 1944 (4).
Gaulliste, démocrate-chrétien et européen convaincu, il a été député du Nord pendant trente ans puis sénateur pendant quinze ans, et plusieurs fois ministre. On le confond souvent avec Robert Schuman, l’un des pères-fondateurs de l’Europe, démocrate-crétin comme lui.
Commençons par écorner la légende de ce Schumann « grande figure de la Résistance ».
En 1946, le colonel Passy, lassé des racontars des exploits – vrais, magnifiés, voire carrément faux – de certains résistants, dévoile à la presse que, contrairement à ses dires, Schumann est un pétochard qui n’a pas osé sauter en parachute. Ulcéré, ce dernier eut l’idée saugrenue de demander l’arbitrage du « premier résistant de France », mal lui en prit : De Gaulle lui répondit dans une lettre qui arriva, on ne sait trop comment, au « Canard enchaîné » qui se fit un plaisir de la publier le 6 novembre 1946. Cette lettre disait ceci, entre autres :
« Vous attribuez trop d’importance à l’affaire. On a vu des gens très braves au feu qui reculaient au moment de sauter en parachute. Vous avez eu tort de vous mettre en avant pour cette mission de Bretagne, car, pendant quatre ans, vous n’avez pas bougé. »
Pour avoir pratiqué le parachutisme militaire, puis le parachutisme sportif et le parapente, Je ne pense pas qu’il faille un courage exceptionnel pour sauter en parachute.
Le saut en parachute a même permis à Jean d’Ormesson, en son temps coqueluche des plateaux télé, le « précieux ridicule » dont toute l’œuvre gravite autour de son nombril, de se faire mousser. « Jean d’O » comme l’appelait le tout-Paris mondain, a effectué son service militaire à la demi-brigade de parachutistes coloniaux, à Vannes-Meucon. Mais ce faux modeste, toujours cabotin, devait déclarer plus tard sur RTL : « On sautait par la porte et naturellement on sautait dans le vide. C’est compliqué. On saute par stick, un stick c’est 12 ou 15 types et chacun pousse celui qui est devant. Et moi, …par ironie parce que j’étais un intellectuel, ils m’ont dit : « Toi, on ne te poussera pas. Tu sauteras si tu veux ». Et je me suis dit : « Si tu ne sautes pas, tu es déshonoré » et j’ai sauté. Sauter en parachute, c’est très très amusant… ». Tout Jean d’Ormesson est résumé dans cette tirade : l’art de raconter n’importe quoi, avec désinvolture et légèreté, tout en se donnant le beau rôle au passage. Pourtant, ceux qui ont connu le sort peu enviable des « inaptes moraux » (2) en unité para savent qu’on ne saute pas « si l’on veut ». Les refus de saut sont d’ailleurs relativement rares.
De plus, n’en déplaise à d’Ormesson, « sauter en parachute » en ouverture automatique, chargé comme un mulet et à basse altitude, n’est pas « très très amusant ». C’est un moyen efficace de déposer au sol, des caisses, des véhicules, et des bipèdes…Pour ma part j’ai toujours préféré les héliportages. En « OA »(6) on est un colis largable, rien d’autre. Quand on a 20 ans, ça permet de frimer devant les nanas mais ce n’est pas « amusant », contrairement au parachutisme sportif.
Bon, revenons à nos moutons, à savoir le Fascisme et les imbéciles qui le voient partout.
Il est regrettable que les Français connaissent si mal leur histoire, sinon ils sauraient qu’il n’a existé que deux partis fascistes – groupusculaires et éphémères – en France, et qu’un seul d’entre eux a bénéficié du soutien de l’Italie fasciste de Mussolini.
Le premier, chronologiquement, est « Le Faisceau » de Gorges Valois.
Etrange personnalité que ce Valois ! Homme d’extrême-gauche, il milite d’abord dans divers mouvements anarchistes et collabore au journal « L’Humanité nouvelle ». Il devient le disciple de Georges Sorel, théoricien du syndicalisme révolutionnaire, puis il découvre la monarchie et le catholicisme, et adhère, à l’été 1906, à « l’Action Française » de Charles Maurras dans laquelle il voit une arme révolutionnaire contre le capitalisme. Il y restera presque 20 ans.
En 1925 avec les capitaux de deux industriels milliardaires, le parfumeur Francois Coty et le producteur de cognac Jean Hennessy, Georges Valois fonde un nouveau mouvement, « Le Faisceau », premier parti fasciste non italien, et un journal, « Le Nouveau Siècle ».
Malgré l’adhésion de diverses personnalités de gauche, et de Marcel Bucard (issu lui aussi de « l’Action Française », et futur fondateur du « Francisme »), « Le Faisceau » se saborde en 1928, faute d’adhérents et après de graves dissensions internes.
Georges Valois crée alors le « Parti Républicain Syndicaliste ».En 1935, Il demande à adhérer à la SFIO(7) ; malgré le parrainage de Marceau Pivert, l’adhésion lui est refusée.
Au début de la guerre, il s’engage dans la Résistance. Arrêté par la Gestapo, le 18 mai 1944, à l’hôtel d’Ardières, aux Ardillats, il meurt au camp de concentration de Bergen-Belsen, en février 1945.
Un fasciste – le premier facho français – qui fait de la Résistance et meurt en déportation, ça fait désordre dans le camp des bien-pensants. Du coup les historiens insistent sur le fait que Valois est mort… du typhus. Oui, c’est parfaitement exact, comme Anne Frank et sa sœur Margot, mortes elles aussi du typhus, à Bergen-Belsen, comme tant d’autres…
Parlons à présent du second parti fasciste, celui créé par Marcel Bucard : « Le Francisme » ou « Mouvement Franciste ». Bucard, né en 1895, est fils d’un boucher de Saint-Clair-sur-Epte. Après des études dans un collège catholique, à Versailles, il entre au petit séminaire et est sur le point d’être ordonné prêtre quand éclate la Première Guerre Mondiale. Engagé volontaire, il se distingue par son courage exceptionnel: en 1914, à 19 ans, il est caporal. Il finit la guerre en 1918, comme …capitaine.
Il est blessé trois fois et titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre avec dix citations. Comme la plupart des combattants de cette grande boucherie, il restera marqué à vie. Son traumatisme est aggravé par la perte de son meilleur ami, l’abbé Léandre Marcq, tué à 24 ans, le 16 avril 1917, au cours de la désastreuse offensive Nivelle.
Après la guerre et après avoir milité à la Fédération Nationale Catholique (FNC), il décide de prendre part à l’agitation menée par les mouvements d’anciens combattants.
En 1925, il adhère, parmi les premiers, au « Faisceau » de Georges Valois. Il a en charge la propagande. Mais, en 1927, Valois, dans « Le Fascisme », traite Benito Mussolini de « réactionnaire », Bucard le désapprouve et se tourne vers François Coty et son journal « L’Ami du peuple ». Il se voit confier la rédaction de la page consacrée aux anciens combattants.
Le 29 septembre 1933, Bucard fonde le « Mouvement Franciste », mouvement s’inspirant du Fascisme italien mêlé à du spiritualisme. Il participe aux émeutes du 6 février 1934.
Le « Francisme » de Marcel Bucard n’a originellement rien d’antisémite. Ses articles vantent l’amitié des tranchées et la tolérance entre Français de toutes confessions. Mais il défend la thèse des deux « Internationales » qui déchirent la France : celle des socialo-communistes et celle des ploutocrates. Il écrit à la Ligue Internationale Contre l’Antisémitisme (LICA), pour affirmer qu’il n’est pas antisémite, il trouve cela «imbécile et odieux ».
Pourtant il bascule dans l’antisémitisme radical après son arrestation fin 1935 et l’interdiction de son mouvement, prononcée par le Front Populaire en 1936.
Il attribue alors aux Juifs « une fonction de désagrégation sociale ». Cet antisémitisme sera une constante de son discours politique par la suite. En 1938, il publie « L’Emprise juive ».
En 1941, Bucard se range du côté de la Collaboration et reforme son mouvement, sous le nom de « Parti franciste ». Il est un des fondateurs de la « Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme » (LVF), mais interdit à ses militants d’y entrer quand il apprend que l’uniforme est celui de la Wehrmacht. En fait, il ne tient sous l’Occupation qu’un rôle d’arrière-plan, souffrant de ses anciennes blessures de guerre. Il est opéré à deux reprises des séquelles de ses blessures.
Le 12 août 1944, devant l’avancée des Alliés, Bucard a juste le temps de fuir en Allemagne avec quelques Francistes. D’Allemagne, il organise des commandos de saboteurs, parachutés en France par l’aviation du IIIème Reich.
Alors qu’il cherche à gagner l’Espagne, il est arrêté à Merano en juin 1945, extradé en France et jugé par la Cour de justice de la Seine. Au terme d’un procès-éclair de trois jours, il est condamné à mort le 21 février 1946 et fusillé le 19 mars, dans les fossés du fort de Châtillon.
Voilà l’histoire, certes très brièvement résumée, du Fascisme français : deux partis qui auront duré à peine quelques années, animés pour l’un, par un militant de gauche mort en déportation, et pour l’autre par un combattant héroïque de la Première Guerre Mondiale qui s’est trompé de camp en misant tout sur les perdants, lors de la Seconde.
Je n’oublie pas non plus que, pour les bien-pensants, le colonel de La Rocque était fasciste, or François de La Rocque, catholique et patriote, récusait totalement l’idéologie fasciste. Dès 1940, il appelait à la Résistance. Arrêté par la Gestapo, le 9 mars 1943, il est déporté le 31 août 1943 au camp de concentration de Flossenbürg. Il décède le 28 avril 1946, des suites de ses mois de détention.
Il m’est arrivé, à moult reprises, de dire mon respect pour la foi chrétienne et la rectitude morale de Salazar. Il m’est arrivé aussi de reconnaître les qualités guerrières du général Franco et le fait qu’il aura sauvé le Catholicisme en Espagne. J’assume totalement mes prises de positions, mais je dispense les salopards qui étaient staliniens sous Staline (ou maoïstes sous Mao-Zédong) ; ceux qui ont applaudi la « libération » du Cambodge par Pol Pot, qui idéalisent Che Guevara, ou Fidel Castro, de me traiter de facho. Et puis non, finalement, je m’en moque, je m’en bats l’œil, je m’en tamponne le coquillard, bref, je m’en fous : être insulté par des ordures, c’est presque un compliment non ?
Eric de Verdelhan
1)- « La doctrine du Fascisme » est un essai que l’on attribue à Mussolini. En réalité, la première partie de l’essai, intitulée « Idee Fondamentali » a été écrite par le philosophe Giovanni Gentile. Seule la seconde partie « Dottrina politica e sociale » est de Mussolini lui-même.
2)- « L’Etat corporatif » de Benito Mussolini ; réédition Trident ; 1987.
3)- Dont le Franquisme est plus ou moins l’héritier, ceci est à nuancer.
4)- Fils d’un industriel du textile d’origine juive alsacienne, on ne l’a jamais entendu s’émouvoir du sort des Juifs durant toute la guerre.
5)- «l’inapte moral» est un surnom qu’on doit au Lt-colonel Pierre Langlais – futur patron des paras de Diên-Biên-Phu – lorsqu’il commandait la demi-brigade de paras-colos : c’est un « refus de saut ». Considéré comme un dégonflé, il était coiffé d’un grand béret noir et d’une longue capote. Il était l’objet de toutes les humiliations, vexations et corvées, jusqu’à sa mutation dans une unité de biffins. Ca se passait encore comme ça quand j’ai été incorporé au 1° RPIMa, à Bayonne, en 1970.
6)- OA : Ouverture Automatique.
7)- Section Française de l’Internationale Ouvrière.
|
|
Lettre d'information - Avril 2022
www.asafrance.fr
Envoi de l'ASAF 25 avril 2022
|
|
" À propos des soldats français en Algérie,
un président ne devrait pas dire cela ! "
Dans sa longue quête mémorielle destinée à réaliser une impossible réconciliation entre la France et l’Algérie, le président de la République a ajouté une étape le mercredi 26 janvier 2022 à l’Elysée.
Dans sa longue quête mémorielle destinée à réaliser une impossible réconciliation entre la France et l’Algérie, le président de la République a ajouté une étape le mercredi 26 janvier 2022 à l’Elysée.
Rappelez-vous, ce véritable chemin de croix avait commencé en février 2017 à Alger, lorsque Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle, avait déclaré sur un média algérien que la colonisation avait été un « crime contre l’humanité », que la France « devait présenter ses excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avions commis ces gestes ».
Puis, le Président commanda à l’historien Benjamin Stora un rapport destiné à apaiser les mémoires rivales entre la France et l’Algérie autour de la guerre. Ce document, remis le 20 janvier 2021, proposait très modestement de dresser des « passerelles sur des sujets toujours sensibles » (disparus de la guerre, séquelles des essais nucléaires, partage des archives, coopération éditoriale, réhabilitation de figures historiques…). Mais, à sa lecture, il apparaît très nettement que la majorité des pas en avant attendus le sont de la France.
Le 26 janvier, la cible visée était les rapatriés d’Algérie qui, depuis l’accession à la présidence de monsieur Macron, estimaient n’avoir reçu de lui aucun message de soutien ou de sympathie. Le palliatif à ces manquements passés a consisté à revenir sur la fusillade de la rue d’Isly à Alger, dans laquelle des dizaines de partisans de l’Algérie française furent tués par l’armée le 26 mars 1962. Le Président décrivit alors cet événement tragique en soulignant que « les soldats français, déployés à contre-emploi, mal commandés, ont tiré sur des Français ».
« Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République » ajouta monsieur Macron.
Il est vrai que pour faire bon poids et dans le cadre du « en même temps » qui lui est coutumier, le Président condamna aussi les massacres perpétués à Oran par des Algériens, le 5 juillet 1962, qui firent entre plusieurs centaines et deux mille victimes parmi lesquelles des femmes et des enfants.
Mais revenons à la rue d’Isly. Alors que le cessez-le-feu ouvrant la voie à l'indépendance de l'Algérie a été proclamé le 18 mars, plusieurs milliers de partisans de l'Algérie française sont appelés par l'OAS (Organisation armée secrète) à se diriger le 26 mars vers le quartier de Bab-el-Oued, refuge de membres de l'OAS, afin de forcer les barrages installés par l'armée française après plusieurs meurtres de jeunes du contingent par cette organisation. Ils sont invités à s'y rendre « sans armes » et « drapeau en tête », alors que la manifestation est interdite par le préfet.
À partir de là, différentes versions circuleront. Cependant, selon l'une d'elles, certes contestée notamment par des familles des victimes, ce sont des tirs visant les militaires depuis une fenêtre ou un toit, rue d'Isly, qui enclenchent en retour, de la part des tirailleurs gardant le barrage, la fusillade vers la foule paniquée.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas admissible que 60 ans plus tard, un président de la République, chef des Armées, porte dans un discours politique un tel jugement sur la façon dont les soldats étaient alors commandés. Est-il utile de rappeler que les soldats « mal commandés » d’alors, étaient, comme ceux d’aujourd’hui, sous les ordres du pouvoir politique ? Faire porter le chapeau aux militaires est une coutume dans notre République dès lors que cela permet d’épargner les responsables politiques. C’est le même procédé qui a été utilisé pour fustiger les « fusilleurs pour l’exemple » de la Grande Guerre.
Le préfet avait interdit la manifestation. Le préfet, c’est le représentant local de l’État et c’est donc l’État qui, en premier lieu, a failli en ayant été incapable de faire exécuter ses directives. Alors que les historiens eux-mêmes ne sont pas d’accord sur les circonstances du drame et sur le nombre de victimes, n’aurait-il pas été préférable, plutôt que d’asséner un jugement péremptoire, d’annoncer la création d’une commission d’enquête pour faire la lumière sur toutes les zones d’ombre de cette sinistre journée ?
De même, sur le 5 juillet 1962 à Oran, le Président est passé un peu vite. Il aurait pu exiger de l’Algérie l’ouverture de ses archives sur cette tragédie, la reconnaissance par celle-ci de l’existence de charniers, près d’Oran, qui renferment des centaines de corps de victimes françaises de même que leur restitution en vue de leur identification. Il faut arrêter de donner des gages à l’Algérie en espérant un retour qui n’arrivera jamais.
Quant aux rapatriés d’Algérie, leurs responsables estiment que « M. Macron a reconnu le plus simple, l’aspect mémoriel, mais n’a pas franchi le pas de l’indemnisation », évoquant une revendication toujours présente chez certaines associations en dépit de compensations financières déjà versées mais critiquées comme « partielles ». Ainsi, l’utilisation de l’armée comme bouc émissaire afin de gagner les bonnes grâces des pieds-noirs apparaît vaine.
La phraséologie macronienne débouche donc sur un double échec : ses relations avec les rapatriés ne se sont pas franchement réchauffées depuis le 26 janvier pas plus que celles avec les militaires.
« Le chemin tortueux de la repentance ne peut que s’enliser dans les sables mouvants[2]. »
La RÉDACTION de l’ASAF
[1] Un président ne devrait pas dire ça..., sous-titré Les secrets d'un quinquennat, est un livre des journalistes d'investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme, publié le 12 octobre 2016 par les éditions Stock.
[2] Expression utilisée par Barbara Lefebvre dans Le Figaro Vox du 27 janvier 2020.
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens de faire des mises à jour et d'ajouter Oued-Zenati, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Clauzel, Duvivier, Duzerville, Guelaat-Bou-Sba, Guelma, Helliopolis, Herbillon, Kellermann, Millesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Oued-Zenati, Penthièvre, Petit et Randon, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
Complexe Sider El-Hadjar
Envoyé par Sylvain
http://www.lestrepublicain.com/index.php/annaba/
item/9034573-pres-de-25-000-tonnes-exportees-depuis-janvier
lestrepublicain.com - 21 Avr 2022 Annaba
Près de 25.000 tonnes exportées depuis janvier
Durant le premier trimestre de cette année, le complexe sidérurgique d’El-Hadjar, a exporté, un volume de produits sidérurgiques avoisinant les 25.000 tonnes.
Il comprend des produits finis, semi-finis et co-produits, rapporte la revue « info usine » dans son numéro 138. La même source, a précisé dans ce cadre, que durant le mois de janvier dernier, le volume des produits sidérurgiques de Sider El-Hadjar, exportés vers l’Italie, a atteint 9.191 tonnes de brames et de fonte cassée.
Tandis que pour le mois de février de l’année en cours, le volume exporté à destination du même pays, s’élève à 3631 tonnes de fonte en gueuse. Pour le mois de mars, Sider El-Hadjar a pu exporter, quelque 11.655 tonnes de produits, dont 7.000 tonnes de bobines vers l’Italie et 4655 tonnes de brames et ébauches vers la Turquie.
Par ailleurs, nous apprenons que le volet de l'environnement industriel n’a pas été ignoré par les responsables du complexe sidérurgique d’El-Hadjar. Il requiert un certain degré d’ordre et de propreté, de nettoyage industriel et d'organisation. Il permet de créer des solutions qui favorisent et améliorent la sécurité du personnel et le flux de production.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que la direction de Sécurité a lancé récemment le processus « housekeeping » (organisation et aménagement du lieu de travail). Il concernera les différentes unités du complexe, à savoir, la zone fonte et aciéries, les laminoirs, les services, la maintenance, les carrières, le four à chaux et la station de concassage.
Il est indiqué à ce sujet, que les directeurs ont choisi deux périmètres de zones dans chaque unité avec deux responsables housekeeping. L’objectif est de bien accomplir cette mission qui vise à garantir un lieu de travail propre et sain. Il est aussi question d’éviter que des accidents de travail se produisent.
Le premier responsable de la direction de sécurité a souligné : « Ce processus va nous obliger à être rigoureux et à faire circuler la communication, en utilisant des tableaux d’affichage des activités et des réunions périodiques pour atteindre nos objectifs ».
Permanence durant l’Aïd-el-fitr à Annaba
Envoyé par Germain
http://www.lestrepublicain.com/index.php/annaba/item/
9034627-pas-moins-de-885-commercants-requisitionnes
lestrepublicain.com - 24 Avr 2022 Annaba
Pas moins de 885 commerçants réquisitionnés
En application des dispositions de l'article 8 de la loi 13-06 du 23 juillet modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, les services de la direction du Commerce de la wilaya d’Annaba ont élaboré un programme de permanence des commerçants durant l’Aïd-el-fitr à l’effet d’assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation.
La direction du Commerce a mis au point un important dispositif concernant la mobilisation des commerçants pour assurer la permanence lors des deux jours de l’Aïd-el-fitr. Cet ensemble de moyens mis en œuvre est décidé afin d’éviter toute perturbation ou pénurie de produits de large consommation durant cette fête religieuse. Selon ladite direction, le programme de permanence cible 885 commerçants issus de divers secteurs.
Il couvre 125 boulangeries, 338 locaux d’alimentation générale, 56 locaux de fruits et légumes, 121 boucheries, 120 commerces de restauration et 49 distributeurs de produits laitiers. En outre, quelques 300 autres activités commerciales y compris des stations de carburants et de transport, des laiteries, des minoteries, des unités de production d’eaux minérales et bien d’autres prestations seront également concernées par cette instruction.
Par ailleurs et afin de satisfaire les consommateurs et assurer un approvisionnement continu en produits de consommation et autres denrées alimentaires, 14 brigades composées de plusieurs agents de contrôle et de la répression des fraudes seront mobilisées sur le terrain. Elles seront chargées de contrôler le taux de conformité des commerçants réquisitionnés durant les deux jours de l’Aïd et dresser la liste de ceux qui se déroberaient aux instructions.
A noter que des sanctions allant jusqu’à la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d’un mois, des amendes, voire des poursuites judiciaires peuvent être appliquées à l’encontre de ceux qui refusent d’assurer la permanence. La liste nominative de commerçants concernés par la permanence durant l’Aïd, activant dans les grandes agglomérations ou dans les localités rurales sera affichée dans les jours à venir sur la page Facebook de la direction du Commerce.
Pisciculture à Berrahal
Envoyé par Emile
http://www.lestrepublicain.com/index.php/annaba/
item/9034629-du-beurre-dans-les-epinards-des-agriculteurs
lestrepublicain.com - 24 Avr 2022 Annaba
Du beurre dans les épinards des agriculteurs
L’intégration de l’aquaculture dans l’activité agricole reste un défi à atteindre dans la wilaya d’Annaba. Des représentants de la direction de la Pêche et de la direction des Services agricoles (DSA) ont effectué une sortie de sensibilisation dans les communes de Berrahal et Oued-Laneb, avant-hier samedi 23 avril.
Ils ont exhorté les agriculteurs de la région à faire usage des réservoirs d’irrigation pour la pisciculture afin d’améliorer leurs revenus et valoriser leurs exploitations agricoles. La culture des poissons dans ces espaces permettrait de booster le secteur de l’aquaculture.
L’existence préalable de l’infrastructure facilite le lancement de ces projets d’avenir. Les autorités font actuellement des efforts pour la promotion de ce secteur. Elles visent à créer une production nationale importante de poisson et réduire la facture d’importation notamment pour la transformation industrielle.
Le potentiel que détient la wilaya d’Annaba est énorme du fait de l’existence d’un secteur agricole développé et structuré qui puisse participer à l’essor de l’aquaculture en eau douce. Quant à l’aquaculture en eau de mer, des projets ont été accordés à des investisseurs pour installer des équipements dans certains endroits du littoral annabi.
La réussite de ces projets va créer une dynamique positive qui contribuera à l’éclosion d’un pôle d’aquaculture à Annaba.
Économie
Envoyé par Pascale
https://www.tsa-algerie.dz/legumes-secs-
pourquoi-lalgerie-est-a-la-traine/
Par TSA - Par: Djamel Belaid 24 Avril 2022
Légumes secs : pourquoi l’Algérie est à la traîne
Comme de nombreux produits alimentaires, ces derniers mois, les lentilles et les pois chiches ont connu des augmentations de prix en Algérie. Des hausses que les points de vente des CCLS ont tenté de juguler.
Face à la demande, les importations viennent régulièrement à la rescousse de la production locale. La récente augmentation des prix à la production vient donner un coup de fouet à cette production.
Le 10 avril, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres, l’augmentation des prix d’achat des légumineuses auprès des agriculteurs.
Le prix d’achat est fixé à 3 000 dinars algériens pour les lentilles et à 2 000 dinars algériens pour les pois chiches « afin d’encourager les agriculteurs« , précise le communiqué à l’issue du Conseil.
Une culture sensible aux mauvaises herbes
Par rapport aux autres cultures, les cultures de lentilles et de pois chiches présentent un inconvénient : la taille des plants. Résultat, ils sont sensibles à la concurrence des mauvaises herbes.
En l’absence de désherbage chimique, il n’est pas rare de voir des champs envahis de graminées et autres herbes indésirables. Pendant longtemps, c’est un désherbage manuel qui a été pratiqué.
Certaines exploitations réalisant un désherbage mécanique à l’aide de bineuses où d’autres décalant la date de semis des pois chiche pour tenter de réduire la poussée des mauvaises herbes. Mais, le rendement s’en trouvait réduit d’un tiers.
Ces difficultés ont fait que les légumes secs n’ont jamais suscité l’engouement des agriculteurs algériens. Dans le Sersou (Tiaret) durant les années 1970, les lentilles étaient encore récoltées manuellement et les services agricoles avaient du mal à proposer cette culture aux fermes d’État.
Mécanisation de la culture
Les légumes secs présentent cependant un atout : leur mécanisation. Ils peuvent être cultivés avec le même matériel que les céréales. Dès les années 1980, l’Institut technique des grandes cultures (ITGC) a réussi à proposer un programme de culture en s’inspirant de ce qui se faisait en matière de céréales. Semis, désherbage et récolte pouvaient enfin être entièrement mécanisés.
Sur les réseaux sociaux, l’agronome Mohamed Eddouh témoigne : « Lors de mon mémoire de fin d’études, j’ai préconisé la résorption de la jachère travaillée en pratiquant la mécanisation de la culture des lentilles avec désherbage chimique à base de Tréflan et de Gesagard« . Fièrement l’agronome ajoute : « Les résultats obtenus ont été satisfaisants« .
Une culture longtemps restée confidentielle
Malheureusement la greffe n’a pas pris. C’est qu’il n’est pas donné à toutes les exploitations agricoles de maîtriser les programmes de désherbage. Malgré les efforts des services agricoles et d’entreprises privées telle la Sarl Sersou ou Axium à Constantine, la production algérienne de légumes secs est longtemps restée confidentielle.
Cependant, vaille que vaille, quelques agriculteurs du Sersou ont continué à produire malgré les obstacles : irrégularité dans la disponibilité des semences certifiées ou des herbicides. Puis, les prix à la production ne semblaient pas suffisants.
La région de Tiaret assure jusqu’à 50 % de la production nationale de lentille, notamment à Rahouia, Mechraa-Sfa et Mahdia.
Les légumes secs s’avèrent agronomiquement utiles. Comme le montrent les travaux de l’université de Batna, après une culture de légumes secs, le sol est enrichi en azote par ces plantes qui ont la capacité de fixer l’azote de l’air.
Dans la commune de Didouche Mourad (Constantine), l’agriculteur de pointe Debbah Mostefa explique qu’une culture de lentille bien désherbée a un effet nettoyant. Le blé qui suit la lentille est indemne de mauvaises herbes et en particulier de brome.
Une culture hautement stratégique
Le récent relèvement des prix a suscité l’enthousiasme des agriculteurs. Debout dans son champ, un agriculteur confie à Ennahar TV : « Voilà qui va nous encourager à développer la culture de pois chiche« .
Dans un contexte d’augmentation des prix de la viande, les légumes secs s’avèrent être des aliments stratégiques. Leur richesse en acides aminés leur confère le statut de « viande du pauvre« .
Aujourd’hui à l’étranger, les légumes secs font l’objet d’un regain d’intérêt. Leur faible empreinte carbone est par ailleurs appréciée et les recherches vont bon train.
À Montpellier (France), la chercheuse Valérie Micard a mis au point des spaghettis à base de légumes secs. Prudente, elle a immédiatement déposé un brevet. Dans le sud-ouest de la France, la société « Les Graineurs » commercialise des pâtes alimentaires à base de farine de céréales et légumes secs germés.
L’investisseur Laurent Spanghero à l’origine de cette entreprise vante ces produits dont « 100 grammes contiennent autant de protéines que 100 grammes de viande« .
Toujours à l’étranger, des brevets sont déposés pour protéger la mise au point de process industriels permettant de séparer les protéines du pois chiche de l’amidon de sa graine.
Ces protéines permettent de fabriquer des aliments super protéinés. En août 2021, Bloomberg Intelligence estimait que le marché mondial des protéines végétales devrait être multiplié par 5 et atteindre en 2030 le montant de 162 milliards de dollars.
À l’heure de la crise ukrainienne, les pois chiches qui ont toujours garnis nos plats de couscous et autres préparations culinaires s’avèrent être un produit hautement stratégique.
Djamel Belaid
Économie
Envoyé par Solange
https://www.tsa-algerie.dz/gaz-lalgerie-a-t-elle-rate-une-occasion-en-or/
- Par TSA - Par: Ryad Hamadi 23 Avril 2022
Gaz : l’Algérie a-t-elle raté une occasion en or ?
Prix des hydrocarbures en hausse et une Europe qui sollicite des quantités supplémentaires pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, la situation se présente comme une aubaine pour l’Algérie, reliée en plus par plusieurs gazoducs au Vieux continent.
Pour le Financial Times, la crise ukrainienne et la volonté de l’Union européenne de mettre fin aux importations de gaz russe auraient pu être une occasion en or pour l’Algérie de renforcer ses parts sur le marché européen de l’énergie.
Mais l’Algérie a des quantités supplémentaires limitées à mettre sur le marché, la faute au manque d’investissements, aux politiques de gestion et de développement des hydrocarbures et à la hausse de la demande interne, résume le journal économique britannique, qui rapporte les analyses de plusieurs experts abondant dans le même sens.
Ces derniers soulèvent en outre la question pertinente des réformes que l’Algérie a toujours hésité à engager.
Mostefa Ouki, chercheur senior à l’Oxford Institute for Energy Studies, a indiqué que, « à court terme, l’Algérie ne pourrait fournir à l’Europe que quelques milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires ».
« L’Algérie a raté une occasion de réaliser tout son potentiel. Cela est dû à des années de sous-investissement par les compagnies pétrolières internationales en raison de conditions budgétaires difficiles et d’un environnement opérationnel global marqué par la bureaucratie et la lenteur de la prise de décision », explique pour sa part Anthony Skinner, consultant en risques politiques.
Le journal britannique rappelle dans ce sens que lors de la dernière attribution de licences opérée par l’Algérie en 2014, seuls quatre des 31 blocs proposés ont trouvé preneur.
La nouvelle géopolitique de l’énergie pourrait permettre « le retour de partenariats internationaux dans le secteur algérien des hydrocarbures en amont », entrevoit Mostefa Ouki, mais, tempère-t-il, le développement conjoint de nouveaux approvisionnements en gaz serait un processus long et pourrait être incompatible avec les plans de décarbonation de l’Europe.
L’expert a aussi noté l’augmentation de la demande intérieure de gaz naturel en Algérie, susceptible d’influer sur les quantités disponibles pour l’exportation.
Conseil national de l’énergie : un bon signe ?
L’Algérie a récemment mis en place un conseil national de l’énergie, présidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans but de coordonner la politique des hydrocarbures. Certains experts cités par le Financial Times y voient un signe positif.
« Cela pourrait aider l’Algérie à réfléchir à une stratégie à long terme plutôt que de se concentrer uniquement sur les gains actuels. Le bricolage constant des règles avait renforcé la perception que l’Algérie était instable dans ses conditions d’investissement », analyse Riccardo Fabiani, responsable du programme Afrique du Nord à l’International Crisis Group.
Pendant des décennies, rappelle FT, l’État algérien fournissait des subventions et des emplois aux citoyens en échange de leur acceptation du maintien du régime. « Mais cet arrangement s’est effiloché avec la chute des prix du pétrole en 2014 », écrit le journal économique de référence.
« Chaque président qui arrive a une base de pouvoir limitée et ne veut prendre les décisions de réforme difficiles que lorsque les revenus sont serrés et lorsqu’il est plus difficile de les prendre. Une fois que le prix du pétrole a augmenté, ils arrêtent les réformes et commencent à distribuer de l’argent pour augmenter leur popularité », indique Riccardo Fabiani.
FT souligne dans ce sens qu’après l’augmentation des revenus des exportations de pétrole et de gaz à 35 milliards de dollars en 2021, contre 20 milliards en 2020, l’Algérie a suspendu ses projets d’augmentations d’impôts et de réformes des subventions et introduit une allocation chômage au profit des jeunes.
« Si le gouvernement Tebboune avait lancé des initiatives de réforme pour encourager les investissements du secteur privé dans des secteurs tels que l’agriculture et les start-ups, c’était encore en situation hybride. Il veut trouver des moyens de se réformer, mais il est toujours coincé autour de l’ancien contrat social expiré centré sur la répartition de la rente », analyse de son côté Adel Hamaizia, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House à Londres.
Ryad Hamadi
|
|
|
Il neige
Envoyé par Jean Pierre
|
Il a neigé toute la nuit. Du coup, ce matin, j'ai fait un bonhomme de neige devant la maison ! ??
09:00 : mon bonhomme de neige est terminé.
09:10 : une féministe passe et me demande pourquoi je n'ai pas fait une bonne femme de neige.
09:15 : je fais aussi une bonne femme de neige...
09:17 : la nounou des voisins râle parce qu'elle trouve que la poitrine de la bonne femme de neige est trop voluptueuse.
09:20 : le couple d'homo du quartier grommelle que ça aurait pu être deux bonshommes de neige.
09:25 : les végétariens du n°12 s'indignent de la carotte qui sert de nez au bonhomme. Les légumes sont de la nourriture et ne doivent pas servir à ça.
09:26 : les deux lesbiennes du quartier d'à côté me demandent pourquoi je n'ai pas plutôt construit deux femmes de neige ?
09:28 : d'autres me traitent de raciste car le couple est blanc.
09:31 : les Musulmans de l'autre côté de la rue me demandent d'ajouter un foulard à ma bonne femme de neige.
09:37 : des gilets jaunes débarquent, ils menacent de tout faire fondre si je n'enfile pas un gilet jaune à tout ce beau monde. Par peur d'inonder le quartier je m'exécute.
09:39 : une cohorte désordonnée et ''bruyante'' de lycéens tente de mettre le feu à mes hommes et femmes de neige. Trop de culture accumulée, ils ne savent pas que la neige ne brûle pas...
09:40 : quelqu'un appelle la police qui vient voir ce qui se passe.
09:42 : on me dit qu'il faut que j'enlève le manche à balai que tient le bonhomme de neige car il pourrait être utilisé comme une arme mortelle.
Les choses empirent quand je marmonne : mouais, surtout si vous l'avez dans le …
09:45 : avec toute l'agitation, l'équipe de TV locale s'amène. Ils me demandent si je connais la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige. Je réponds : Oui, les boules. Je suis alors traité de sexiste.
09:52 : mon téléphone portable est saisi, contrôlé et je suis embarqué au commissariat.
10:00 : mon histoire est annoncée sur les radios. On me suspecte d'être un terroriste profitant du mauvais temps pour troubler l'ordre public.
10:10 : tout le monde s'accorde pour dire que j'ai des complices.
10:29 : un groupe djihadiste inconnu revendique l'action. ??
Il n'y a pas de morale dans cette histoire...
C'est juste le monde d’aujourd'hui ...
|
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|




 Chez nous, le jeu consistait à " passer une datte " non pas avec le pouce, mais avec le majeur qui servait de truchement. Un majeur fièrement dressé en érection au-dessus de la paume, le pouce s'appuyant sur l'index. Et pour nous, pauvres gamins qui n'avions ni tablette, ni smartphone, ni Skype, ni Whatsap, pas de télé, bien sûr (mais comment avons-nous survécu ?), ce jeu en valait bien d'autres. Seul Paris Hollywood, passé sous la pèlerine, froissé par les copains précédents, imprimé dans des nuances d'encre orange nous offrait l'image de stars américaines dévêtues et ressortait taché après des exercices manuels qui seuls nous étaient permis (et encore !). Altra tempora, altra mores ! Nous étions plus ignares que dépravés.
Chez nous, le jeu consistait à " passer une datte " non pas avec le pouce, mais avec le majeur qui servait de truchement. Un majeur fièrement dressé en érection au-dessus de la paume, le pouce s'appuyant sur l'index. Et pour nous, pauvres gamins qui n'avions ni tablette, ni smartphone, ni Skype, ni Whatsap, pas de télé, bien sûr (mais comment avons-nous survécu ?), ce jeu en valait bien d'autres. Seul Paris Hollywood, passé sous la pèlerine, froissé par les copains précédents, imprimé dans des nuances d'encre orange nous offrait l'image de stars américaines dévêtues et ressortait taché après des exercices manuels qui seuls nous étaient permis (et encore !). Altra tempora, altra mores ! Nous étions plus ignares que dépravés.